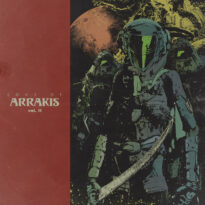|
|

Après un précédent album The Wolf Bites Back d’il y a six ans, qui nous avait laissé un peu sur notre faim, nous étions sans rancœur (après presque trente ans de bons et loyaux services on a bien le droit à ses moments de faiblesse) dans l’attente d’un nouvel opus de Orange Goblin. Une attente sans autre désir qu’un son frotté au papier de verre, des riffs venus de la tombe de Lemmy et une bonne dose de puissance viscérale, la base quoi ! Alors que sort enfin Science (Not) Fiction, le Goblin emballe la marchandise dans un artwork faisant appel à un univers futuriste sur lequel pourrait planer un doute d’intelligence artificielle. Allons donc déballer le bout de viande pour voir s’il n’est pas aussi synthétique que la couverture veut bien l’annoncer.
Tout soupçon se retrouve vite écarté car aussi vrai que l’artwork est d’un artiste humain, Science (Not) Fiction débute fort sur trois Hits comme on disait du temps de Marc Toesca. “The Fire at The Centre of The Earth is Mine” ne met pas plus d’une écoute pour devenir une évidence dont on reprend le chant en chœur avec Ben Ward. C’est ensuite au tour de “(Not) Rocket Science” d’appliquer une futée ligne continue de piano façon ragtime, qui, bien que discrète, rend le morceau poignant, et d’autant plus lorsque Chris Turner s’en prend à sa cowbell. Enfin, “Ascend the Negative” vient compléter le trio de tête avec des riffs glorieux comme du Motörhead mais avec cette patte propre au Goblin.
Même si les autres pistes semblent plus “faibles”, on ne passera pas à côté de la puissance de la basse sur “False Hope Diet” et les riffs toujours bien sentis de Joe Hoare, surtout lorsqu’ils sont faits de solides mélodies arpégées sur le même titre. Ils se font heavy au possible sur “The Justice Knife”. On ne boudera pas non plus les courts soli à l’image de celui de “The Eye of The Minotaur” qui est d’une efficacité redoutable.
Science (Not) Fiction a beaucoup à dire et bénéficie d’une narration très aboutie, que ce soit dans le texte ou dans la musique, et de ce coté là, il est évident que le clavier apporte beaucoup à cet album. “Cemetery Rat” exhibe à ce sujet une mise en scène entre piano et cloches avant l’entrée en scène théâtrale du triptyque basse-guitare-batterie. Ce même clavier ajoute ce qu’il faut de profondeur sur “False Hope Diet” en doublant les gémissements de la guitare.
Cet album ne déroge pas aux habitudes d’Orange Goblin, cela va de soi. On retrouve la référence jamais voilée à Motörhead, notamment sur “(Not) Rocket Science”, la voix toujours abrasive du frontman, la lourdeur continue des riffs et les envolées épiques où fusionnent tous les instrumentistes, ces cavalcades à en perdre haleine où l’on se plaît tant à les suivre. Après deux ou trois écoutes, il est alors évident qu’il n’y a rien à jeter dans cette galette et cela inclut la basse de Harry Armstrong qui complète le groupe pour la première fois sur album (aucun doute n’était cependant permis pour ceux qui l’auraient vu sur scène).
Avec Science (Not) Fiction, on retrouve le Orange Fuckin’ Goblin que l’on aime tant. Ce maître ès Stoner qui se la joue rock’n’roll et qui remplit les esgourdes de ses auditeurs d’or en fusion. La galette est taillée dans ce que les Anglais font de mieux et annonce une déferlante de sueur et de cris en live. Il nous tarde d’aller éprouver et fêter ce dixième album dans un collectif remuant et d’en savourer toute la puissance.

Tandis que son prédécesseur se sera fait attendre (sept ans entre leur premier et leur second disque), ce Pilgrims of the Sun n’aura mis que trois ans à être conçu et à parvenir à nos oreilles. Atomic Vulture, pour rappel, est un trio belge de stoner instrumental, peu actif, mais dont les rares sorties discographiques nous ont toujours séduit. Autre surprise avec ce disque : le groupe s’est lancé dans l’aventure en solo, en autoproduction, donc sans soutien d’un label.
Le style musical des brugeois n’a (heureusement ?) pas trop évolué et c’est avec plaisir que l’on se plonge dans ces sept compos : le trio évolue toujours dans un riff rock fuzzé instrumental assez construit (on n’est pas sur du jam band débridé), et au style assez “ouvert”. A ce titre la variété est bien présente sur le disque, et les différentes compos sont bien diversifiées : on a du riff bien charpenté, à foison (“Ad Astra”, “Black Blizzard”), mais aussi plusieurs titres bien emmenés par une rythmique enlevée et emballante, empruntant largement au kraut rock, à l’image de “Alpha Wave”, “Reverse Osmosis” ou “Dust Fall”. Malheureusement certains passages ne sont pas du même niveau d’intensité, à l’image de certains plans de “Subterranean Surfers”, de la fin presque jazzy de “Reverse Osmosis”, ou du final un peu poussif de “Ad Astra” ou de “Dust Fall”.
Bref, si cet album recèle, comme ses prédécesseurs, de véritables perles de stoner rock instrumental, certains (rares) passages montrent une petite panne d’inspiration ; le disque n’est pas parfait et quelques compos auraient pu être un peu plus peaufinées. Mais le plaisir est bien là, au détour de quasiment chaque compo, avec des riffs bien sympas, des soli emballants, et même quelques petits instants de grâce disséminés ici ou là. Un bon album.

Même s’il ne fait pas beaucoup d’effort pour celà, ici on aime beaucoup Huanastone : ce quatuor suédois est plus que rare sur scène (le groupe dans toute sa carrière n’a joué live que dans 3 pays hors scandinavie : une date en Allemagne, une au Portugal et une poignée en Croatie) et ne sort son second long format que cette année, après plus de douze ans de carrière… L’ambition du groupe n’est donc pas dans ces conditions de devenir un leader mondial du genre, mais plus modestement de proposer de la bonne musique, en particulier sur disque. Ils en font une affaire personnelle et c’est même sans label qu’ils sortent ce second album, comme à la maison.
A l’image de son prédécesseur Third Stone from the Sun, ce Son of Juno propose un ensemble de chansons avec une large part de mid-tempo, ce qui n’est pas forcément la propension habituelle des groupes de stoner scandinaves. Musicalement, on baigne dans un stoner rock assumé, assez subtil, où des vapeurs grunge viennent se méler à des influences bluesy, le tout au service d’un travail mélodique tout le temps prépondérant. Et c’est bien cette subtile et réussie alchimie qui nous fait irrémédiablement revenir vers ce disque, qui ne lasse jamais.
Dans ce joli petit échantillon de sept titres, difficile d’en voir certains émerger du lot, il n’y a pas de titre faible. On y retrouve des titres plus heavy (“… And then Came the Sun”, le très catchy “Love in Black Tar” et ses ambiances psych fuzzées), et d’autres franchement plus soft (ce “Black Rain” qui s’apparente plus à une balade), ainsi que quelques ovnis et inclassables, comme ce “Gaea” gorgé à l’americana, où les sonorités steel guitar rappelleront occasionnellement certains titres de Ry Cooder. Quand au morceau titre, mélant riff fuzzé et atmosphères planantes bluesy, il est littéralement emmené par la prestation vocale impeccable de Tobias, le chanteur/guitariste apportant une valeur ajoutée décisive à chaque titre par son feeling remarquable. Pour autant, tout ne repose pas sur sa voix chaude et puissante, tel que l’illustre le final sur ce “Red Dunes” de plus de huit minutes, 100% instrumental, et où ne s’ennuie pas une seule seconde.
Huanastone nous propose à nouveau un disque qui, s’il n’est pas fondamentalement d’une originalité folle, se place dans un segment musical mélant de nombreuses influences, et les emmenant dans des sphères qualitatives remarquables, s’appuyant dans cet exercice sur une line up impeccable (instruments et chant). Ces compos suaves et malines s’immiscent dans vos têtes et ne les quittent plus pendant longtemps. Un très bon disque, encore.

Duel est un groupe que nous apprécions tant, que leur effort précédent, In Carne Persona, nous avait un peu laissé sur notre faim, proposant certes une poignée de bons brulots, mais associés à quelques titres plus « faciles ». Autant dire que l’on attendait cette nouvelle livraison des texans avec une légère anxiété.
Il leur aura fallu moins de trois ans pour composer et enregistrer ce Breakfast with Death (à l’artwork peu enthousiasmant) et ses neuf titres pour 38 minutes (un standard impeccable pour leur style). Autant dire tout de suite qu’ils n’ont pas changé grand-chose à leur recette, ce qui n’est pas fait pour nous déranger.
On retrouve donc sur le disque une généreuse représentation de tous les styles que Duel se complaît à développer et hybrider depuis les débuts de leur carrière, produisant une sorte de heavy rock old school énergique, empruntant autant au punk rock qu’au Heavy Metal (un grand écart difficile à maîtriser), parfois empreint de plans de classic doom metal bien old school, l’ensemble baignant dans un déluge de groove probablement endémique du Texas, et de généreux et jouissifs soli de guitare en guise de cerises confites sur le gâteau.
Le sens du riff de Tom Frank fait mouche quasi systématiquement, à l’image des dévastateurs « Ancient Moonlight », « Fallacy » (un riffing metal énervé), ou le pattern mélodique de « Berserker ». Les atours plus proto hard rock sont toujours bien présents aussi, comme sur « Satan’s Invention » (d’autant plus avec son solo en harmonie), ou le catchy « Tigers of Destruction ».
Dans le segment plus « metal », on trouve aussi son compte avec les solides « Greet the Dead », « Fallacy » ou encore « Chaos Reigns » (qui développe un gros metal plutôt doom sur son couplet… et limite thrash sur son refrain !).
Au bout de quelques écoutes seulement, l’habileté d’écriture du groupe se dessine à travers des passages que l’on se plaît très vite à entonner, à l’image du couplet de « Fallacy » ou des refrains de « Berserker » ou « Pyro » par exemple. « Pyro » puisqu’on en parle, repose largement sur une rythmique très punk rock, une inspiration que l’on retrouve aussi derrière le massif « Burn the Earth », même si ce dernier repose sur un spectre musical bien plus dense et audacieux – probablement l’un des meilleurs titres de la galette. En bref, ça ratisse toujours aussi large, mais le squelette musical de Duel reste d’une constance irréprochable, picorant ici ou là des éléments qui viennent avant tout servir l’efficacité d’un ensemble de compos punchy (peu ou pas de mid-tempo sur cette galette).
Vous l’aurez compris, ce Breakfast with Death, s’il n’est pas parfait, est à classer parmi les meilleures galettes de Duel : même s’il ne peut se targuer du charme frais et de cette prod garage qui a fait l’aura de ses deux premières galettes, ce dernier disque représente un groupe prêt à prendre un nouvel élan et, espérons-le, à atteindre une notoriété plus représentative de ce qu’il a à proposer dans le paysage musical actuel.

Depuis plusieurs semaines, le petit monde du stoner doom chuchote le nom de ce duo du Pacifique Sud, de toutes parts et en toute occasion. Forcément, sur le CV du jeune combo néo-zélandais (ils n’ont même pas huit ans d’existence) on aura noté la première partie de QOTSA sur leurs dates néo-zélandaises, mais on commence à voir Earth Tongue squatter les meilleures places de premières parties des tournées européennes les plus excitantes (Acid King, 1000Mods ou Ty Segall…). L’occasion de croiser leur route sur les planches récemment nous aura fait toucher du doigt le « petit phénomène », et nous a incité à nous pencher sur leur second album, Great Haunting.
Quelques écoutes suffisent à comprendre que l’on n’est pas confronté à un groupe très traditionnel, en out cas pas dans les genres musicaux dans lesquels nous sommes habitués à évoluer. Comment mieux illustrer ce déstabilisant diagnostic qu’à travers les premières secondes du disque, à savoir l’intro de « Out of this Hell » ? L’auditeur y est d’abord (ac)cueilli par quelques notes de synthé space-pop sucrés pour mieux être chavirés immédiatement par un gros riff fuzzé. Et c’est ainsi que le jeune duo nous balade pendant les 37 petites minutes de ce disque, dans une sorte d’environnement musical instable où cohabitent riffs doom, mélodies pop, dynamique rock indé… Très déstabilisant sur les premières écoutes, l’album se dessine peu à peu comme une petite friandise en mode plaisir coupable (pas évident pour le doomster velu et bourrin d’assumer l’attrait de certains passages quasi pop du disque). Car pour un gros paquet de riffs lourds et tranchants (« Nightmare », « Out of this Hell », « The Mirror », « Sit next to Satan », « The Reluctant Host »…) combien de plans surréalistes, venus de nulle part, parviennent à chambouler nos repères en une paire d’accords de guitare ? On mentionnera par exemple « Bodies Dissolve Tonight ! » et « Nighmare » avec leur jeu de batterie aux bornes du punk rock / pop rock, le break girly sirupeux de « The Mirror » porté par un petit pattern de synthé avec un chant option fillette de Gussie Larkin, « Reaper Returns » et son couplet presque… « dansant » !?… Et au milieu de ce bazar, quelques pépites stoner doom catchy à mort, comme « The Reluctant Host », « Out of this Hell », « Sit next to Satan”, …
On pense assez souvent à une sorte d’accouplement sordide entre Electric Wizard et White Stripes (toutes proportions gardées, lâchez pas les chiens !), ces derniers en particulier du fait d’un batteur occupant un rôle clé dans le mix musical, et surtout une chanteuse-guitariste qui finit d’insuffler une identité forte au groupe, à travers son son de guitare puissant et protéiforme (quelle densité, quelle variété) mais aussi son chant : s’il s’agit du principal facteur qui en rebutera certain(e)s, la tessiture foncièrement « girly » de Larkin, complètement assumée dans un registre vocal pourtant assez vaste, est assez clairement le « facteur X » de la musique du groupe (e ce même lorsque Ezra Simons la complète sur des chœurs d’intonation pas forcément beaucoup plus grave). Serait-ce l’avènement d’une sorte de « Riot Grrrl Doom », version gentille et doomy du mouvement punk des années 90 ?
S’il est difficile de parler de disque de référence (référence de quoi ? dans quel style ?), Great Haunting s’avère absolument addictif pour l’amateur de stoner doom ouvert d’esprit, et ouvert à d’autres genres musicaux. Rempli d’autant de riffs puissants que de refrains éhontément catchy, le groupe ne laissera personne insensible. Et le fait que vous ne vouliez pas les aimer ne les empêchera de continuer leur tranquille et modeste conquête mondiale !
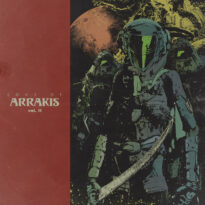
C’est presque trop beau pour ne pas être fait exprès. Le quartet montréalais Sons Of Arrakis revient avec un second opus, seulement quatre mois après la sortie en salle du deuxième volet de Dune de Denis Villeneuve (un Québécois, encore!). On pourrait crier au coup marketing, mais nous étions tombés sous le charme du Volume I (voir notre chronique ici) et nous sommes d’un naturel plutôt bienveillant. Nous avons donc accueilli le nouvel opus, Volume II, avec enthousiasme.
Force est de constater que les atouts qui nous avaient séduits lors de la précédente sortie sont toujours présents sur ce second volume. Les riffs sont toujours aussi accrocheurs, saisissant l’auditeur au détour de solos heavy à souhait, d’une virtuosité indéniable, comme le prouve à elle seule la piste “Metamorphosis”.
L’univers de Sons Of Arrakis nous est familier, à mi-chemin entre l’épique et le prog, comme l’illustrent l’intro “Scattering” ou le morceau “Beyond The Screen Of Illusion” qui en mettent plein la vue dès le début. Pour autant, on aime toujours se promener dans ces paysages aux mille chemins de traverse, où l’on se laisse surprendre par une approche stoner et pêchue, comme dans “Burn Into The Blaze”, ou par une piste calme à la mélodie poignante, comme “High Handed Enemy”.
Au final, on trouve encore peu de défauts à cet album, puisant dans la même veine que le précédent, si ce n’est une fois de plus la trop courte durée. Trente-trois minutes, c’est maigre, et on a l’impression de se faire voler l’épice directement sous le nez.
Sons Of Arrakis chevauche le ver des sables, Shai-Hulud, avec brio une fois de plus, et tel le visionnaire Muad’Dib, ils nous ouvrent les portes d’un univers stoner plus vivant que le dessèchement dont il fait souvent montre. Merci, Sons Of Arrakis, de nous offrir l’Eau de Vie et de tordre pour nous le temps et l’espace.

The Head & The Habit est le neuvième album de Greenleaf, l’émanation de Dozer née sous l’impulsion de Tommi Holappa il y a 25 ans cette année. Nous avons pu voir le groupe évoluer et mûrir, se tourner vers des compositions et des mélodies de plus en plus populaires et fédératrices. Chaque sortie est un petit événement, tout du moins jusqu’à leur précédent opus, Echos From A Mass, qui avait laissé notre rédaction sur sa faim, voire désorientée. À quelle sauce allons-nous être mangés cette fois-ci ? Laissons de côté nos craintes et espérons un renouveau, appuyons sur le bouton Play.
Dès les premières notes, l’album nous laisse sans haleine, enchaînant des pistes enthousiasmantes les unes après les autres. Greenleaf reprend du poil de la bête et fonce tête baissée dans un créneau qu’il exploite déjà très bien depuis de longues années. De “Breathe Breathe Out” à “Avalanche”, les Suédois annoncent la couleur ne serait-ce qu’avec les titres des pistes. Le premier moment d’accalmie rare intervient sur “That Obsidian Grin”, où le groupe démontre qu’il peut encore être émouvant tout en se lançant dans une démonstration bluesy où le riff est maître. Le pont de “The Tricking Tree” vient en écho à ce moment de calme apaiser l’ardeur de la galette, avec sa basse secondée de la guitare. On se sera aussi arrêté sur “The Sirens Sound” qui confirme la tendance riffesque de cet album oú les melodies s’impriment facilement sur les tympans. Si facilement d’ailleurs qu’on en vient à soupçonner une écriture faite pour la radio. Et bien que ce soit le cas où non, laissons le groupe rayonner au-delà des frontières du stoner et flatter l’oreille des néophytes.
Avec The Head & The Habit, Greenleaf nous amène à nous poser la question de ce qui définit un vrai bon album. Des efforts et de l’adhésion à l’écoute, il y en a à la pelle cependant dire que l’on sort hystérique de l’aventure serait exagéré. Néanmoins, on replonge toujours dans l’écoute avec plaisir, cherchant à mémoriser encore plus les titres fédérateurs du groupe et ce malgré une fin plus anecdotique sur “An Alabastrine Smile”. Au final, The Head & The Habit marque le retour aux affaires de Greenleaf avec une riche sélection de 9 pistes pour près de 43 minutes. Le groupe, gonflé à bloc, risque bien de jouer les lames de fond et d’entraîner un paquet de nouveaux fans sur son passage.

Il aura fallu plus de six ans à Fu Manchu pour revenir avec un nouvel album, après le sympathique Clone of The Universe, six ans durant lesquels ils n’auront certes pas chômé, sans pour autant faire preuve d’une énorme productivité : un paquet de EP/singles/12’, une V.O. (en réalité compil’ de plein d’anciens titres), des re-sorties vinyliques, des mini tournées très ciblées ou quelques rares dates one-shot en festivals… Une période finalement assez calme qui fut l’occasion pour certains des musiciens du groupe de mener (ou participer à) des projets musicaux parallèles de diverses natures, notamment (en particulier pour l’hyper-actif Bob Balch).
The Return of Tomorrow est en réalité un « double album » – comprendre que dans son format vinyle il sera composé de deux disques… Pour un album de 49 minutes (une durée très raisonnable), c’est encore une illustration des lubies générées pour se plier au business toujours porteur du vinyl. Par l’intermédiaire du speech promo qui accompagne le disque, le groupe décrit une « expérience d’écoute vinyle », une démarche intentionnelle de séparer un premier disque de 7 titres supposément plus « directs », classiques du répertoire du quartet, et un second disque de chansons plus « calmes ». C’est peut-être la vraie vision du groupe, mais dans les faits il n’est pas forcément évident de discriminer stylistiquement les deux rondelles, concrètement issues du même « moule » (par ailleurs, un message aux amateurs du format CD ou digital : ne vous prenez pas la tête, ça passe parfaitement…).
La première salve de titres semble vaguement cautionner ce parti-pris en tout cas, avec une fort belle triplette de purs brulots emblématiques du stoner punkoïde produit par le groupe depuis belle lurette : “Dehumanize”, “Loch Ness Wrecking Machine” et “Hands of the Zodiac” ont en commun des riffs énormes, un son de gratte fuzzé jusqu’à l’os, des leads jouissives (Balch s’épanouit sur cet album…) et des refrains accrocheurs… Bref, exactement ce à quoi on s’attendait ! Première écorchure au concept bicéphale proposé par le groupe, “Haze the Hides” déroule sa rythmique penaude à la vitesse du mammouth fatigué, tout comme “Destroyin’ Light” un peu plus loin. Une autre poignée de titres sans risques se dessine ensuite avec “Roads of the Lowly” et “(Time is) Pulling You Under” (un titre rageur où la guitare lead de Balch fait encore des miracles à tous bouts de champs). Fin du premier disque.
Le second commence par le über-groovy mais un peu mou “Lifetime Waiting”, un titre passable sauvé par une excellente série de soli. Et c’est un peu le même constat sur “Solar Baptized”, un titre très accrocheur et efficace mais manquant un peu de relief… si ce n’était ce final absolument jouissif, avec une dernière minute de soli merveilleusement inspirés, sur une couche rythmique développant un groove rarement pratiqué avec une telle maîtrise par le groupe jusqu’ici. Superbe moment de grâce. Après le mollasson et très dispensable “What I Need”, arrive le morceau-titre de l’album, encore un mid-tempo plutôt bien ficelé, avec ce qu’il faut où il faut. Ça fonctionne très bien, sans casser trois pattes à un canard… et ça rappelle Clutch plus qu’à son tour, à l’instar du riff principal de “Liquify” derrière, lui aussi très Clutch-ien. Le disque se termine ensuite sur l’instrumental et mélodique “High Tide”, pas un point fort du disque.
Forcément, après bientôt 40 ans de carrière (!!) et 13 albums, il est normal d’envisager une sorte de bilan de ce disque au regard de ce parcours superlatif. The Return of Tomorrow est un (très) bon cru pour le combo culte californien, à la hauteur de son rang. Il est très dense, ce qui peut en revanche en refroidir certains : treize chansons, n’est-ce pas trop à digérer ? On vous laisse juges (on peut présumer que c’est aussi pour éviter ce risque que le groupe vend le concept un peu exagéré de « double album »…). Les fans de Fu Manchu apprécieront en revanche le soin apporté au travail d’écriture : certes le groupe capitalise à fond sur son fonds de commerce, ça riffe dru et fuzzé, ça (dé)roule à fond les cheveux au vent, ça aligne refrains catchy et couplets ravageurs… Peu de surprises musicalement et stylistiquement, mais ce qu’ils savent faire ils le font ici bien, voire très bien. Autre avantage de cette profusion de matériel, le disque supporte des dizaines et des dizaines de ponçages en règle, sans jamais provoquer l’ennui. Peu de disques récents (et peu de groupes) peuvent en dire autant. En outre, cela fait longtemps que l’on ne s’était pas dit à la sortie d’un album de Fu Manchu que certains titres trouveraient bien leur place dans les set lists live du groupe (ce qui aura été confirmé dans les faits, le groupe interprétant rarement voire jamais sur scène des chansons de leur fin de carrière) – or plusieurs titres de ce nouveau disque pourraient y prétendre. Inutile donc de couper les cheveux en quatre et de sur-intellectualiser la chose : The Return of Tomorrow c’est du miel musical, du plaisir pour les oreilles et pour le cerveau, du stoner intelligent mais sans prise de tête.

A peine plus de deux ans après son sympathique God of Spinoza, les allemands de Daily Thompson décident de faire à nouveau confiance à Tony Reed derrière la table d’enregistrement et de mixage, et s’envolent donc dans la région de Seattle pour aller enregistrer son successeur. Le groupe a beau être prolifique (6 albums en un peu plus de dix ans de carrière), ses disques passent trop souvent sous les radars, et on attendait de ce Chuparosa qu’il amène le groupe à un autre niveau.
Notre espoir est quelque peu douché par le premier titre du disque, “I’m Free Tonight”, qui dès les premières secondes crie “Fu Manchu” à gorges déployées, avec son riff sec, son groove nonchalant… Alors certes, le titre héberge un petit solo de Bob Balch, mais est-ce que ça justifiait de plagier le groupe californien aussi frontalement ? Avec même les “cowbells” pour un effet “Mongoose”, on croît rêver… Vraiment pas ce qu’on attendait du groupe, qui a tant à démontrer en développant sa propre identité musicale. Heureusement “Pizza Boy” vient juste derrière nous rappeler que le trio germanique sait écrire : riff de cochon, couplet efficace, refrain hyper catchy… Certes, le titre est un peu trop long, mais cette longue séquence de soli sur la fin n’est pas inintéressante. Agréable surprise aussi sur le très efficace “Raindancer”, encore un riff séduisant, mais toujours un petit grief sur la longueur du titre, qui aurait pu perdre 2 minutes (le break soft mélodique en milieu de chanson est un peu longuet et poussif). Autre point fort du disque, “Ghost Bird” et ses sonorités de cigar box graisseuse et saturée emportent le pompon, sur un titre enlevé et groovy très accrocheur.
Au rayon plus soft, “Diamond Waves” en mode balade catchy/mid-tempo mélodique est effectivement très accrocheur et fonctionne bien, mais malgré quelques embardées bien électrisées, on reste dans du soft lent. Le morceau titre est dans la même veine, symptomatique de ces balades grungy que le groupe affectionne tant : une mélodie super catchy, une construction bien foutue, des embardées saturées sentant bon le heavy rock des radio FM US, un refrain fédérateur bien électrique…
Et pis c’est tout. Ben oui, six chansons seulement, pour moins de 37 minutes au compteur, c’est peu. Avec un titre Fu Manchu-esque dans le lot, deux titres bien soft et d’autres titres qui tirent un peu en longueur, c’est vraiment trop peu. Peut-on décemment faire émerger une identité de ce disque, dire quelle tendance il développe, en quoi il se distingue de leur discographie ? L’offre musicale est trop réduite pour ça.
Du coup on se retrouve à l’heure du bilan avec un VRAI constat partagé. Parce que ce qui émerge avant tout c’est la poignée de vrais super titres qui figurent sur ce disque, des titres efficaces, bien écrits, de beaux riffs, des mélodies super accrocheuses. Il y a du talent à revendre chez Daily Thompson. Mais pourquoi ne pas avoir rajouté deux ou trois compos à ce disque pour lui apporter un peu plus de densité musicale, plus de propositions, plus de musiques ?… Grosse frustration, sur un très bon disque.

Difficile de s’y retrouver dans la discographie chaotique et dense de Thou : leur page bandcamp déborde de disques de reprises plus ou moins obscurs, de bandes annonces de jeux vidéos, d’EP, de collaborations… Dans cette jungle digitalo-vinylique, Umbilical n’est que leur 6ème véritable album en presque vingt ans de carrière, et surtout le seul véritable LP depuis le très bon Magus, sorti il y a presque 6 ans. Depuis, jamais inactif, le groupe a expérimenté, s’est frotté à des musiciens différents, s’est confronté à ses influences… En outre, on le sait, Thou est un groupe qui réfléchit (qui a dit « une bande de nerds introspectifs » ?!), qui essaye des choses, et ce nouvel album suscite donc une forte curiosité.
On est cueilli à froid par le très solide « Narcissist’s Prayer » en intro, qui propose probablement le meilleur choix pour rappeler très vite à l’auditeur à qui il a affaire – et fondamentalement que Thou n’a pas changé sur ses bases. Gros riff sale et rampant, mur de guitares, et ce chant de Bryan Funck qui, littéralement, vient couvrir le tout. Jetons immédiatement le pavé dans la mare : les cris de gorge de Funck sont tout à la fois une marque de fabrique inébranlable de Thou et, plus largement, l’un des meilleurs exemples de chant/cris sludge pur jus, tous groupes confondus, sa technique étant clairement au-dessus du lot. En revanche, le groupe propose des choses vraiment très intéressantes (sur ce disque et précédemment) et l’inconvénient de ce chant est son aspect « monocorde », avec finalement un spectre de tonalité très faible. Mixé tellement en avant par rapport aux instruments, il vient très souvent recouvrir l’ensemble pour y apporter une sorte de couche filtrante, qui efface les reliefs et les subtilités instrumentales. Est-on surpris ? Non, la musique de Thou s’est toujours réfugiée derrière ce rempart « d’agression vocale ». En revanche, on peut être un peu frustré, ou plutôt curieux de se demander si, avec un peu plus de nuance, la musique du groupe n’en ressortirait pas plus riche ? Voir à titre illustratif l’excellent « The Promise », où Funck n’est finalement jamais calé sur l’amplitude mélodique développée sur le refrain… Éternel débat qui ne trouvera pas d’issue aujourd’hui.
Le sujet principal est donc la qualité de ces compos, qui cette fois encore est de haut vol. Le groupe s’épanouit évidemment toujours dans un sludge assez classique (riff poisseux, agression sur chaque refrain, mid-tempo ou rapide) qu’il maîtrise sur le bout des doigts, à l’image de quelques pièces maîtresses du disque, comme « Emotional Terrorist », le glauquissime « Siege Perilous » ou encore le très bourrin « I Feel Nothing when You Cry » où Coburn se déchaîne sur ses futs. Mais le quintette de Baton Rouge ne se repose pas sur ses points forts, et vient greffer des plans très intéressants. On pense par exemple à la deuxième moitié de « House of Ideas » et son pattern mélodique très accrocheur, au dévastateur « I Return as Chained and Bound to You » qui mêle hardcore et doom (une certaine définition du sludge…), à « The Promise », mentionné plus haut, probablement le titre le plus catchy du disque avec « Panic Stricken, I Flee ».
Il apparaît très vite que Umbilical va se placer dans le peloton de tête de la discographie du groupe, qui ne compte pourtant pas vraiment d’albums faibles. Efficace, riche, très bien écrit, l’album est assez malin pour proposer de quoi satisfaire à la fois le gros sludgeux bas-du-front amateur d’agression sonore en premier lieu (vous nous connaissez assez pour savoir qu’il n’y a rien de péjoratif selon nous derrière ces qualificatifs…), mais aussi l’auditeur exigeant qui cherche plus de recherche musicale et d’expérimentation, qui trouvera dans les recoins de ce disque de quoi satisfaire sa soif de découverte et d’expérimentation – généralement – réussie. Bref, on est à peu près sur un carton plein, une réussite à tous niveaux – même si réservée à un public réceptif à ce style musical exigeant.

Il aura fallu à peine plus de deux ans à Djiin pour nous proposer son troisième album, successeur de Meandering Soul. Le quatuor breton aura mis à profit ces quelques mois pour peaufiner son style, densifiant notamment son expérience scénique en jouant sur un maximum de scènes. C’est donc un groupe plus mature, plus sûr qui se présente sur ce Mirrors (qui sort chez Klonosphere), un album exigeant qui nous aura un peu désarçonné.
Stylistiquement, avec 5 titres pour presque 45 minutes de disque, on s’imagine bien que ça ne va pas verser vers le punk rock. Le disque nous prend la main et nous amène au contraire dans un monde où les compos sont élaborées, sinueuses, denses… Il y a beaucoup de choses dans ce disque, et les atours prog rock y sont plus développés que sur ses prédécesseurs. Les amateurs de structures simples, couplet-refrain / couplet-refrain ne s’y retrouveront pas.
Même ses morceaux les plus directs comme « Fish », s’ils développent néanmoins un bon gros riff, emmènent l’auditeur sur une bonne moitié du morceau dans des sphères plus aériennes, pleines de jolis arpèges légers, avant de conclure via un retour de son riff péchu. Même schéma pour « Mirrors », qui en outre développe encore plus ses aspects prog rock, chargé d’harmonies arpèges/chant et de rythmes de batterie décalés, avec aussi une deuxième moitié de morceau tortueuse, parfois aux échos jazz contemporain, avant un retour sur son riff initial. Pfiou…
« In the Aura of my own Sadness” amène ces aspects prog rock dans leurs retranchements, avec des harmonies chant-guitare parfaitement maîtrisés, mais effectivement assez (d)étonnantes ; les sourcils se lèvent souvent sur ces sonorités atypiques, mais l’exécution est encore une fois sans faille. L’occasion de louer le talent de ce quatuor de musiciens doués, tous dans leur discipline, avec une base rythmique redoutable, et des mélodies pilotées aléatoirement par le chant, la guitare, la harpe ou la basse – parfois en simultané ! « Blind » plus loin propose une sorte de parenthèse dark, avec ses mélodies dépressives menant à un break mêlant chant torturé et leads de guitare dissonants, pour aboutir à un final bourré d’énergie rock, mené tambour battant (c’est le cas de le dire). Enfin, un gros morceau – littéralement – vient clôturer la galette, avec ce « Iron Monsters » de 13 minutes, complexe, déchiré de multiples breaks, et son final puissant très réussi.
Vous l’aurez compris, les amateurs de musique d’ambiance à écouter distraitement ne seront pas la clientèle première de ce disque. Sur Mirrors, Djiin pousse fort les curseurs pour poser sur vinyle ce qui se rapproche le plus de son énergie scénique, quelque chose de nerveux, jamais ennuyeux, qui prend le spectateur par surprise plus qu’à son tour – et à rebrousse poil, souvent. Le quatuor ne s’embarrasse pas de dogmes formels, et va un peu partout où il lui chante : psych rock, gros rock qui tâche, prog rock, jazz, blues… Un disque qu’on recommandera à des auditeurs avertis, et la promesse de prestations live probablement toujours plus fiévreuses.

Le trio sludgeux craspec québecois nous revient presque six ans après son précédent méfait (le réussi Transcanadian Anger) – ils nous avaient habitués à plus de régularité ! Le COVID a bon dos… ? Peu nous chaut, en fait, et on se jette sur la nouvelle galette comme le rat d’égout sur un bout de viande verdâtre. Il faut dire que l’artwork donne envie : du sang, de la viande, des cartouches, de vieilles canettes vides, des lames de rasoir, un peu de neige… Bienvenue à Hochelaga, le quartier glauque de Montréal d’où vient le groupe ! Gageons que cet amoncellement gracieux d’immondices prend probablement toute sa dimension imprimé en grand sur une belle pochette de vinyl ! Et que dire du titre : hommage appuyé au Sabbath Noir (le « S » ne laisse que peu de doutes), il laisse augurer du meilleur…
Les premières écoutes confortent un premier constat : Dopethrone fait du Dopethrone, et les choix de production des deux derniers albums en particulier sont assumés, et même renforcés ! On retrouve bien cette prépondérance du duo guitare/basse et surtout ce chant de gorge redoutablement crado de Vince (toujours plus maîtrisé) mixé de manière assez homogène un peu en arrière, en deuxième niveau sonore. Le riff en premier, le tout baignant dans un sludge grassouillet, pour un son bien à eux – on pense inévitablement à un mix d’Eyehategod quand c’était bien, à Crowbar pour la densité du son de guitare, à Thou pour le chant, à des vieux Church of Misery parfois… Bref, on est bien, là.
La trame sonore étant posée, c’est les compos qui vont finir de décider de la robustesse de ce disque. Ça commence assez fort avec probablement le titre le plus catchy, « Life Kills You », son riff fiévreux et sa rythmique indus (on est pas loin de la batterie emblématique des premiers Rob Zombie) bien calée par la frappe de mule de Shane. Autre démonstration d’efficacité un peu plus loin avec « Uniworse » qui aligne les planètes en cumulant un gros riff principal, un couplet super bien foutu, et un break fort bien senti.
« ABAC » ou « Shlaghammer » quant à eux viennent traîner longuement leurs guêtres en terres doom, où le sludge québecois fait des merveilles, voire même sur « Sultans of Sins » (dont quelques subtiles et rares fragrances viennent parfois nous rappeler Type O Negative…).
En revanche, avec des titres comme « Truckstop Warlock » ou « Rock Slock » le groupe démontre tout à la fois son talent d’écriture (des riffs excellents, des plans vraiment bien foutus)… mais se perd un peu sur des segments tortueux moins intéressants ici ou là. 8min30 pour ce dernier, c’est peut-être un peu long tandis que la messe est dite au bout de 4 min… Mais c’est aussi le charme du groupe, qui en fait à sa guise, sans se préoccuper des formats trop rigides.
En tout cas aucun morceau ne vient plomber le disque, et à ce titre Broke Sabbath est peut-être l’album le plus homogène de la discographie du combo. Les aficionados de Dopethrone, et esthètes du slutch (la vision du sludge made by Dopethrone), trouveront leur bonheur dans cette galette : prod efficace, compos bien foutues, son bien dégueu… Les ingrédients d’un bon disque de Dopethrone sont réunies, et avec elles la promesse de quelques belles torgnoles live à venir. Un bon cru.

Il y a quatre ans, suite à un hiatus que l’on a quand même cru définitif à l’époque, Ufomammut revenait aux affaires avec à son bord un nouveau batteur, Levre, et la sortie d’un nouvel album dans la foulée, le bien nommé Fenice (“Phénix” en italien). L’album gardait évidemment les marqueurs Ufomammut-iens, tout en accentuant une sorte d’ouverture, facilitant l’accès à sa musique via des atours un peu moins âpres et « exigeants » (relativisons : on parle quand même de Ufomammut, c’est pas vraiment Bon Jovi…). Quoi qu’il en soit ce Hidden, leur nouvel album rapidement sorti à peine deux ans plus tard (le groupe aura étonnamment peu tourné dans l’intervalle), amène son lot d’interrogations : quelle tendance va suivre le groupe après ce soubresaut dans sa carrière et cette légère inflexion stylistique détectée sur son prédécesseur Fenice ?
En première approche, un constat s’impose : leur style est toujours là, bien présent, et reconnaissable entre mille : une sorte de doom ultra-répétitif, empruntant en terme de rythmique autant au kraut qu’au metal indus. Ils déclinent ainsi à l’envie leur son « trademark » : un gros riff lancinant et répétitif, un son de guitare au son froid et lourd, chargé d’une fuzz bien costaud, le tout sur loops et nappes lointaines de synthés, avec quelques rares lignes de chant, souvent noyées sous une tonne d’effets.
On se fait néanmoins la remarque au fil des écoutes que leur prod avec le temps s’avère un peu répétitive et monolithique : certains riffs mériteraient un son encore plus « massif » pour littéralement écraser comme ils le font en live. Mais ne devient-on pas aussi inconsciemment un peu trop tatillon et exigeant ? C’est quand même rudement efficace, et niveau maîtrise, c’est assez clair, on est au top niveau du genre. Ca déroule de manière fluide et inspirée, c’est efficace et très carré.
Les points remarquables du disque ? On note avant tout une foultitude de riffs parfaitement ciselés, de ceux qui, c’est évident, sont tous susceptibles de venir étoffer les set lists live du groupe. On croirait même la plupart des compos écrites dans ce sens. Quelques moments de grâce supplémentaires viennent séduire l’auditeur au fil de la galette, à l’image de « Spidher » et de son break étonnamment « groovy » pour le groupe, un « Crookhead » protéiforme sur plus de 10 minutes (qui propose une intro touffue et exigeante au disque) avec son chant moins noyé d’effets qu’à l’habitude… On notera aussi que le travail mélodique mis en exergue sur Fenice trouve d’autres échos ici, comme sur « Soulost » et ses penchants mélancoliques qui pourront rappeler le type d’ambiance développées par Mars Red Sky par exemple. Globalement on reste sur des titres costauds, à l’image du long mais pas ennuyeux « Mausoleum », une des plus belles pièces du disque, mêlant adroitement doom et mélodie, et injectant l’air de rien de très bien senties volutes orientales sur sa section médiane…
Après 25 ans de carrière, et une discographie finalement assez « touffue », il devient difficile de donner un avis tranché sur les nouvelles productions de Ufomammut… surtout quand ils font systématiquement « du Ufomammut » ! Celles et ceux qui aiment le groupe sur le dernier tiers de leur carrière, en gros, vont apprécier Hidden, qui en constitue une fidèle et efficace continuité – voire une synthèse. Si vous êtes demandeurs de nouveautés, d’expérimentations voire de prises de risques, vous serez en revanche assez frustré, ce n’est pas le fort de cette galette. Hidden montre un visage solide du trio transalpin, un groupe ferme sur ses basiques, en maîtrise, et toujours inspiré en termes d’écriture (on est sur du riff de qualité). A ce titre son écoute représente un réel intérêt pour l’amateur du groupe et/ou de ce type de son. Mais est-ce que ça suffira, dans quelques années, à nous faire choisir de ressortir CE disque plutôt qu’un autre dans leur riche discographie ? Probablement pas.

Nell’ Ora Blu (“À l’Heure Bleue”, en français) est la nouvelle production de Uncle Acid and the Deadbeats, le groupe de doom psyché malsain qui tourne principalement autour de son frontman et grand manitou Kevin Starrs. Ce dernier, non content d’être musicien, se voit aussi cinéaste et, à défaut de pouvoir produire un film comme il le regrettait dans l’interview qu’il nous avait donnée en 2018 (Lien vers l’interview), il réalise ici une bande son imaginaire dédiée au cinéma de genre italien des années 60 à 80, le Giallo. Starrs promet avec cette production un album qui soit totalement autre chose que du Uncle Acid… prenons tout de même le risque de nous y plonger.
Nell’ Ora Blu est bel et bien une bande son d’un film de style particulier. On retrouve sur ce disque des traces de Cinecittà, des relents de fiction sociale ou encore d’anxieux passages que l’on aurait pu croiser sur les premières heures de Monsieur Argento. Starrs réussit dans les grandes lignes son pari de bande son, utilisant comme fil conducteur de l’œuvre des sonneries de téléphone ou des samples de réponses angoissées au souffle de l’appelant harceleur. L’utilisation variée de l’orgue offre une palette de visions allant de l’angoissant sur “Il Sole Sorge Sempre” à l’étourdissement d’une course haletante sur “Guidando Veloce Verso La Campagna” en passant par la mélancolie d’un plan séquence sur “Cocktail Party”. Il y a donc bien avec ce Nell’ Ora Blu l’aboutissement d’une promesse, celle de faire quelque chose de totalement différent – notamment car l’album de bout en bout nous fait vivre l’inquiétante intrigue d’un film policier sans image (il se dit que Starrs aurait rédigé le script complet du film, mais ça pourrait être une simple légende urbaine…).
Le pari pourtant n’est qu’à moitié tenu. D’une part à cause du choix d’épouser l’image d’un film imaginaire de giallo, un style généralement angoissant voire horrifique, servant une intrigue policière. Or cet horrifique c’est justement la marque de fabrique du groupe depuis ses débuts. D’autre part, il est impossible de ne pas reconnaître la patte de Mister Acid qui voudrait pourtant avec cet album n’être que Docteur Starrs. Ce Mister Acid dont on détecte la présence dès “Vendetta (Thema)” et qui crève l’écran sur “La Morte Te Ammenata”, refaisant surface sur “Il Gato Morto”. Au final, Kevin Starrs n’arrive pas à se départir de son alter ego Uncle Acid & The Deadbeats… et c’est heureux. Ces quelques moments nous offrent à voir le groupe que l’on aime tant et qu’on aurait pu croire disparaître derrière un projet trop grand pour lui.
Alors quoi dire au fond de cet album : réussite ou raté ? De mon point de vue, c’est une grande réussite, la musique est hautement visuelle de bout en bout, on vit pleinement chaque piste comme une scène filmée. On retrouve également les références à l’identité du groupe ce qui permet à l’auditeur de ne pas être complètement perdu. Il est clair que Nell’ Ora Blu ne pourra pas être réellement qualifié de doom psychédélique et que si ce n’était pas l’oeuvre de Uncle Acid, cet album n’aurait probablement pas figuré parmi nos chroniques. Cependant, l’écoute reste une expérience unique et un travail abouti qu’on ne saurait trop recommander à nos lecteurs les plus ouverts d’esprit.

Plus de 10 ans après Adversarial, le trio US revient avec un quatrième album. De quel trio parle-t-on au final ? Rappelons que Black Pyramid est un groupe dont le line up a de tous temps été particulièrement volatil (allant jusqu’à ne comporter aucun membre d’origine parfois !). Après un break, le groupe a repris avec sa formation d’origine en 2015, et a assuré quelques concerts plutôt convaincants, qui nous ont fait espérer ce nouveau disque. Même si le batteur-fondateur Clay Neely a quitté le groupe en 2018, ce sont bien Andy Beresky et Eric Beaudry qui sont aux manettes.
Black Pyramid nous a déjà habitué à une sorte de stoner doom psych puissant et efficace, et à ce titre ce nouveau disque ne change pas la donne : il glisse d’un univers à l’autre dans une production cohérente. On retrouve assez difficilement son souffle, une promenade atlante qui laisse un peu dubitatif mais néanmoins sous le charme. “Take Us On The Threshold” flirte tout à la fois avec les riffs les plus velus, un mid tempo délicat et un chant au souffle épique. On retient aussi l’atmosphere inquiétante du clavier et des samples sur “The Paths of Time are Vast part III”, piste qui met une minute à disparaitre dans le souffle ténu d’une note suspendue, jusqu’à l’introduction de “The Quantum Phoenix” qui de son côté nait d’un riff de basse, pour mourir d’un flirt avec le post metal. Obsédante c’est le moins qu’on puisse dire de “Bile, Blame and Blasphemy” qui signe une ouverture hautement qualitative d’un album qui l’est tout du long.
Black Pyramid c’est du riff à chaque morceau, des galopades effrénées côté batterie, des mélodies de gratte qui font dresser l’oreille même aux plus sourds et des pavés de basse qui ancrent la musique des trois étasuniens. Le style doom du groupe varie inlassablement du plus classique au stoner le plus crunchy en passant par une phase psychédélique de bon aloi (voir sur “Astral Suicide” ou la balade “The Paths of Time are Vast part I”). Les constructions sont riches, les titres souvent longs et tortueux, mais ne se perdent jamais en route ou dans la moindre divagation stérile : tout est bien en place, et l’ensemble est remarquablement bien assemblé.
Au final c’est une vraie perle d’éclectisme que nous livre Black Pyramid sans pour autant se risquer sur le bizarre. The Paths of Time are Vast est un album construit et cohérent qui figure d’ores et déjà parmi les meilleures productions de ces derniers mois.
|
|