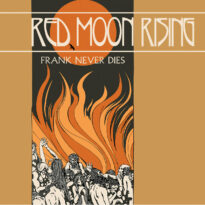|
|

On avait été cueilli un peu à froid avec la précédente galette de Bismarck, Oneiromancer, des norvégiens sortis de nulle part (même si c’était leur second album, leur premier nous était alors passé à côté) avec une assurance et une maîtrise qui nous avait bien remué. Evidemment, on attendait son successeur avec impatience et espoir de voir le groupe confirmer nos attentes. C’est dans une nouvelle écurie (Dark Essence records) que sort ce nouveau disque (il semblerait qu’Apollon records, leur précédent label, se concentre sur des sorties moins « lourdes » ces dernières années).
Profonde frustration, en particulier pour ce style musical : ce nouveau disque, Vourukasha, ne dure que 35 minutes, à l’image de son prédécesseur Oneiromancer. Huit morceaux, dont un titre « à part » plutôt ésotérique, « Kigal » (tout en percus, instrumentation acoustique et vocaux alternant entre chant clair et incantations tribales) et un autre instrumental soft / transition (« The Tree of All Seeds »), pour presque 8 minutes à eux deux. Ça ne laisse derrière que 4 « vrais » morceaux ; ils ont intérêt à être bons…
C’est le cas clairement de la première paire, les plus directs aussi, à commencer par la torgnole « Sky Father », qui démarre sur son riff-upercut, puis qui alterne sludge-hardcore et doom grassouillet, développant sur sa seconde moitié une séquence typique du groupe, mélant post-metal et doom sludgy. Une jolie pièce, à l’image de son successeur « Echoes », qui propose un doom/post metal un peu plus groovy, ouvrant lui aussi en son milieu une parenthèse complètement ambiant/psych, avant de replonger dans un doom sludge poisseux (et un final rapide rageur, blast beat et mur de guitare en pleine face). Même pas à la moitié qu’on déja pris un coup de barre à mine derrière les genoux.
Après la parenthèse « allégée » sus mentionnée, on attaque les deux derniers titres de la galette bille en tête via un bon « retour aux affaires ». Ça repart avec le morceau-titre qui, exempt de surprise, déroule un gros (gros gros) riff avant d’aménager une plage instrumentale plus « aérienne », assez longue, avec laquelle viennent s’entreméler des rasades de gros metal (avec des aller-retours entre guitares et nappes plus « post »). « Ocean Dweller » qui clôture la rondelle prend plus de 4 minutes d’instru et vocaux aériens pour construire sa montée en tension, avant de rentrer dans le dur via une rythmique d’une lenteur écrasante – et toujours ce chant hurlé déchirant… La trame mélodique manque un peu « d’accroche » pour rendre ce titre monstrueux, mais il est riche et bien mené.
Le seul défaut de ce Vourukasha est qu’il n’est plus porteur du facteur surprise : Bismarck, désormais, « fait du Bismarck », et le groupe affine une recette dont la plupart des composantes figuraient déjà sur Oneiromancer (gros riffs, sonorités sludge et post-metal, emprunts aux musiques tribales et flokloriques…). Ça ne fait pas de cette nouvelle offrande un mauvais disque, loin s’en faut. En revanche, l’apport de nouveauté est faible : stylistiquement évidemment (ce n’est pas un reproche, répétons-le) mais quantitativement aussi, avec moins de 30 minutes de « vraies » nouvelles chansons, et la frustration induite. Mais ce nouveau Bismarck satisfera toujours les amateurs d’un sludge doom intelligent, audacieux et travaillé, qui n’hésite pas à emprunter au post-metal et autres styles (metal ou non). Costaud et lourd, mais jamais bas-du-front.

Presque quatre ans, une pandémie et une multitude de concerts se sont écoulés depuis le second album de Karkara ! Une attente longue d’autant plus que le groupe avait tapé dans nos oreilles et fait vibrer nos petits cœurs avec deux opus, aux ambitions très différentes, de grandes qualités. Après avoir sillonné de long en large la France et propagé la bonne parole du rock français en Europe, le trio toulousains composé de Karim Rihani (guitare / chant), Hugo Olive (basse / synthé) et Maxime Marouani (batterie / chant) sont de retour avec un nouveau projet ambitieux nommé All is Dust.
Sur des thématiques plus que actuelles comme l’effondrement de notre société, la résilience ou l’émancipation, All is Dust se pose dans un monde au bord de la disparition et suit le cheminement d’un personnage qui cherche à le fuir et à rejoindre un eden ayant survécu (synopsis ayant quelques point d’accroche avec Le Livre d’Eli, ce qui est déjà une qualité). Produit par Olivier Cussac, compositeur de musique de film et responsable du son énorme des deux derniers albums de Slift, l’album se compose de six chapitres dépassant tranquillement les cinq minutes chacuns. On embarque donc pour un grand voyage porté par le même rock psychédélique Karkarien, c’est-à-dire aux ambiances orientales, kraut voire même stoner.
Musicalement, All is Dust se prend comme un savant mélange des deux premiers albums du groupe. En témoigne le premier chapitre de l’album qui, après une mise en contexte par la voix du personnage portée par une ambiance très shamanique à la Crystal Gazer, démarre avec la même énergie acide et psychédélique que Nowhere Land. On est tout de suite submergé par les mélodies orientales, les vagues de guitare wah wah et la boucle infernale du riff de basse. A tout cela vient se juxtaposer le chant de Karim oscillant entre une légère presque naïve et de longs cris désespérés. La première partie de l’album semble suivre ce schéma avec cette sensation d’urgence qui monte crescendo sur “The Chase”. Cependant, et c’est là une des qualités principales de l’album, Karkara va compléter sa recette psychédélique avec une dose de lourdeur inédite (même si certaines ambiances de leur premier album laissaient à penser qu’il finirait par intégrer cet ingrédient) ! A force d’accélérer, le chapitre “The Chase” va exploser dans un délire chaotique porté par un rythme aux accents stoner-doom du duo basse/batterie et où les wah wah de la guitare vont se confronter à un saxophone déchaînés. A cela s’enchaîne parfaitement “On Edge” qui surfe sur cette ambiance stoner en ralentissant le tempo de l’album. Les notes de guitare et le riff de basse posent un décor chaud, désertique puis les vagues de wah wah suivi par une mélodie très cinématographique laisse imaginer un duel à mort dans une scène western sombre.
La fin de “On Edge” marque aussi l’interlude entre les deux gros morceaux de All is Dust en se terminant par des notes de synthés accompagnant les pensées du personnages. Le second acte de l’album nous décrit le voyage intérieur du personnage et ses visions d’un el dorado immaculé à travers des titres plus légers et moelleux, notamment avec le chant de Karim qui redevient miel. Sur “Moonshiner” on retrouve retrouve sur ce titre les ambiances kraut du groupe et des effets de guitare plus rond, moins nerveux. L’envoûtement de ce titre passe aussi par cette flûte, bien plus douce que le saxophone de “The Chase”, qui vient subtilement s’additionner à la guitare. “Anthropia” s’enfonce encore plus dans le rêve avec ses mélodies de guitare dansantes, véritable marque de fabrique de Karkara. Plus accessible et direct, “Anthropia” est le tube ultime de l’album et devrait nous faire vibrer en concert ! Enfin, “All is Dust” vient conclure l’histoire en symbolisant l’espoir déçu … car oui, l’eden tant convoité n’existe pas et ce sera au personnage de le bâtir ! Ce dernier morceau éponyme est le plus sombre du récit, avec sa basse bourdonnante, ses cris rageurs et sa fin plongeant à nouveau dans le stoner-doom. La lumière vient cependant de cette trompette aux accents western jazzy qui vient percer à deux reprises l’obscurité pour nous redonner courage !
On entreprend avec All is Dust un véritable voyage spirituel, parsemé d’embûches, c’est donc un pari plus que réussi pour Karkara qui réussit ici à mêler ses différentes influences, en intégrer de nouvelles tout en conservant une cohérence sur l’ensemble de l’album. Les titres se font échos entre eux et même la fin de “All is Dust” vient boucler avec “Monoliths” de sorte à ce que l’on puisse recommencer l’histoire sans avoir à rembobiner (quel plaisir de ne pas avoir à sortir de stylo !). L’album est un vrai délice à écouter, notamment par son mix impeccable et l’apport de cette patte cinématographique associée aux divers instruments à vent… Je regrette juste l’absence de didgeridoo, mais c’est uniquement mon amour pour le morceau “Proxima Centaury” de leur premier album qui parle… Après Slift en janvier, Il est désormais clair que le psyché français aura cette année une couleur occitane !

En 2018, gageons que High on Fire avait pour objectif de développer son aura dans le paysage musical avec son très bon Electric Messiah, un album certes peu aventureux, mais qui poussait tous les curseurs à fond, sur tous les marqueurs emblématiques du groupe : puissance, riffs, soli… Seulement le COVID est passé par là, et leur démarche de propagation virale a pris un sale tacle dans les genoux. Se contentant de quelques tournées sporadiques, le groupe n’a pas pu défendre comme il le souhaitait son brulot, même s’il est toujours resté actif dans l’intervalle, en pointillés, en live. Sur scène, le trio s’est démené pour démontrer sa totale maîtrise dans la délivrance de titres brutaux, quitte à ce que la démonstration de puissance dépasse souvent les bornes (un mur sonore qui venait obérer toute possibilité de profiter des nuances pourtant aussi maîtrisées par le groupe). A l’arrivée de ce Cometh The Storm, plus de cinq ans après son prédécesseur, on se demande s’ils vont encore appuyer sur le champignon, pour donner un indice sur là où ils veulent emmener High on Fire pour la suite de leur carrière.
Comme toujours avec HoF, le disque est factuellement massif (encore une fois presque 1 heure au garrot), et long à digérer. Évidemment, pour le néophyte (après plus de 25 ans de carrière, existe-t-il encore des gens qui sont passés à côté ?), la première approche peut suffire, et à ce titre Cometh the Storm ne dévie pas : les premières écoutes peuvent se résumer à une succession de claques au visage, enchaînées à une série de coups de pied au sol. Et c’est très bien… mais c’est aussi le facteur qui rend HoF de plus en plus difficile à rattacher à nos styles de musique de prédilection (illustré avec la programmation du groupe sur la main stage du Hellfest cette année, et non plus sous la Valley…). Nous avons donc évidemment un regard particulier sur la tonalité de ses compositions, et à ce titre, un bon paquet d’écoutes sont nécessaires pour aller voir ce qui se cache derrière ce mur metal robuste.
Pour simplifier, on retrouve trois tendances stylistiques qui s’enchevêtrent un peu dans ce disque. On l’a dit, il y a d’abord, en frontal, cette furie metal emblématique, portée par des titres comme « Lightning Beard » (son riff thrash emblématique), « The Beating » (comme son titre le laisse présager, une véritable baston, un mollard metal torché en 2min30 de brutalité froide, porté par deux riffs basiques, où Pike trouve la place pour caler un solo impeccable), « Trismegistus » (l’occasion d’accueillir Coady Willis le nouveau batteur, en grande forme sur ce titre)… « Hunting Shadows » apporte un peu de nuance : honteusement catchy et enjoué, voire (scandale !) mélodique, il repose sur une ligne de basse (sacrilège !) quasiment groovy ! Sans parler de son refrain où plus que jamais l’ombre vocale de Lemmy est omniprésente… Le titre le plus représentatif de cette tendance est probablement l’introductif « Lambsbread » et ses échos slayer-esques occasionnels et son riff gracieux sur le refrain.
Ce dernier titre illustre aussi le second aspect musical de ce disque, car il porte en son sein deux inclusions de musique orientales dont Jeff Matz est clairement le porteur au sein du groupe. Grand fan de musique turque en particulier, il trouve aussi sur « Karanlık Yol » une plage entière dédiée à ce style ; même si ce titre tombe un peu comme un cheveu sur la soupe au milieu du disque (on dira « une parenthèse ») il montre un visage rafraîchissant du combo, et démontre son audace.
Enfin, HoF (et Matt Pike en particulier) garde une trace de ses attaches Stoner doom, à travers une poignée de titres symptomatiques de l’hybridation réussie du groupe. Si en première écoute ces titres s’incorporent bien dans la continuité « metal hargneux » du disque, ils se démarquent un peu, et voient le groupe développer une rythmique plus pesante, généralement mid-tempo, qui ne sacrifie rien à l’efficacité. On prendra pour illustration des titres comme « Burning Down », où la paire Pike/Matz déroule quasiment le même riff sur six minutes non stop, parfait berceau pour accueillir un déluge de leads emblématiques du style Pike. Même topo pour le morceau titre (dont en outre l’atmosphère particulière est bien supportée par un excellent travail batterie/percus). Plus loin, « Sol’s Golden Curse » voit le trio évoluer sur la fine frontière entre une envolée thrash metal qui n’arrive jamais vraiment, et une redondance doom emblématique jamais non plus totalement installée (car ponctuée de breaks, soli…) – avec cette impression paradoxale d’un titre qui ne « décolle » jamais complètement, alors qu’il maintient un intérêt continu en développant pas mal de séquences bien foutues. Quant à ce « Darker Fleece » de 10 minutes en clôture, il a beau être écrasé par un monstrueux mur de guitare hargneuse, on aurait du mal à le qualifier différemment de « doomy as fuck » ! Ce riffing en fond est parfait et, arrangé différemment, ne dénoterait pas sur un album de Sleep.
Difficile de positionner qualitativement ce disque par rapport au reste de la discographie de HoF (une question d’ailleurs probablement sans intérêt). Ce qui est sûr, c’est qu’il représente probablement l’image la plus complète du paysage musical du groupe : il couvre l’ensemble du spectre stylistique entre le stoner doom et le thrash metal (et fait le lien au passage), il démontre à nouveau l’excellence de l’exécution musicale du trio, il fait preuve d’innovations et démontre sa capacité à incorporer des éléments externes (musique turque) sans se départir de son identité… En tant que tel, il peut faire figure d’album de référence. Un fort bel objet, et une belle promesse pour l’avenir – en espérant que cette ambition soit correctement retranscrite dans la production live, pour vraiment transformer l’essai et assoir le groupe à la place qu’il mérite.

Il nous aura fallu attendre plus de cinq ans après l’excellent Terminal pour se mettre dans les oreilles une nouvelle livraison du quatuor de Chicago. Quelques rares opportunités de voir le groupe sur scène aurons confirmé la pertinence de cet album, prouvant aussi toute son efficacité en live (en particulier « Slow », sa première moitié, souvent jouée en entier). Empty nous arrive aujourd’hui, avec quelques différences de forme : 66,6 min environ (soit plus de 20 min supplémentaires par rapport à Terminal), pour quatre morceaux cette fois (dont les titres constituent comme toujours chez Bongripper un bout de phrase cohérent : Nothing – Remains – Forever – Empty) – fondamentalement, rien de très surprenant au regard de leur discographie.
Les premières écoutes viennent confirmer ce constat à chaud : pas de révolution à l’horizon a priori, on retrouve les marqueurs du groupe, à savoir ce doom instrumental monumental, toujours aussi lent que possible, emmené par un son énorme et une rythmique de mammouth. On entend même ici ou là de vrais échos en mode « clins d’œil » à leurs productions précédentes. Cette chaleureuse zone de confort incite à faire tourner la galette en boucle, encore et encore, et permet d’en dévoiler les facettes un peu plus « cachées ».
Ça commence par « Nothing », une belle pièce de plus de 20 min, qui se lance sur un feedback de guitare (qui fait écho aux intros live du groupe) dégénérant progressivement pour faire émerger la trame mélodique clé du morceau (ça nous rappelle l’intro de « Slow »). Évidemment, la bête évolue et le premier gros riff écrasant intervient quelques minutes plus tard, enchaîné à des plans plus « aériens » (avec ces leads emblématiques du groupe) puis plus tortueux, voire lourds. L’outro se prépare gentiment autour d’un break qui rappelle cette fois celui de « Endless », pour clôturer la séquence sur un riff « de une note » évident. Boum, l’intention est claire : Bongripper propose en intro rien moins qu’un best of de ses derniers faits d’arme.
« Remains » qui lui fait suite est moins marquant, proposant un condensé là aussi de leurs compétences, moins optimisé (voir ce riff certes dévastateur, mais un peu trop tiré en longueur sur la fin du titre).
L’une des pièces maîtresses du disque intervient ensuite avec « Forever », qui tient tout entier (pendant 12 minutes !) sur une phrase mélodique unique ! Ça commence très lentement, déroulant progressivement son fil, avec un pattern mélodique qui tourne ad lib pendant 5 min, auquel viennent se greffer quelques harmonies à deux guitares puis, progressivement, une basse discrète et une batterie toute en subtilité. La tension monte avant l’inéluctable et fatal break Bongripper-esque, où l’on se fait littéralement écraser par un riff-montagne reprenant exactement le même enchaînement de notes que la mélodie lancinante du début. La même séquence vient ensuite se retrouver, ralentie, étirée, en mode crushing-doom pour nous amener jusqu’à l’inéluctable fin du morceau. Bien plus qu’un exercice de style froid et stérile (maintenir un titre en tension(s) sur la durée, avec une séquence mélodique unique), « Forever » trouve immédiatement sa place dans les plus grandes compos du groupe.
On croyait alors le point culminant du disque atteint… avant de se faire écraser par « Empty » et ses plus de 20 minutes de beauté doom, monumentale dernière pièce de la galette. Comme son prédécesseur, l’introduction est subtile et gracieuse, touchant même à la majesté par le truchement notamment de ce splendide arrangement de cordes (en réalité toujours à la guitare) à 2min30 qui vient transcender l’émotion de cette intro. Le titre parcourt progressivement un chemin sinueux, mène à un passage de gros doom pachydermique, pour mieux préparer le terrain à un break speed / extreme metal purement écrasant à la fin du premier tiers de la chanson (non sans rappeler le déferlement de violence de l’intro de « Satan »). La seconde moitié du titre, plus « classique Bongripper », vient le renforcer en le ramenant sur l’autoroute du doom le plus lourd, avant une redescente progressive, véritable sas de décompression, bien nécessaire pour reprendre ses esprits…
Il fait peu de doute au final que Bongripper vient de sortir sa pièce maîtresse, même si Empty suscite moins de « surprise » que certains de ses prédécesseurs, pour des raisons différentes. Il vient d’abord, et de manière flagrante, faire la démonstration de leur maîtrise absolue d’un genre qui devient leur marque de fabrique unique (difficile de nos jours de citer plusieurs groupes qui sont les uniques porteurs d’un genre musical entier – or, à y réfléchir, c’est bien le cas de Bongripper), un genre qu’ils poussent ici dans ses retranchements en termes d’efficacité. Et si cela ne suffit pas, Empty apporte aussi des perspectives plus qu’enthousiasmantes pour l’avenir : sans jamais dénaturer leur style, ils y injectent des reflets novateurs, des idées fraîches, qui vont au-delà de l’apport de l’expérience. C’est le signe encourageant et enthousiasmant d’un groupe à la créativité vivace, qui en a encore sous la pédale, et dont il nous tarde d’entendre les prochaines productions. Dans cette (déjà insupportable) attente, nous devrons capter la moindre opportunité de voir le groupe en live pour y découvrir des incarnations encore plus puissantes de ces nouveaux morceaux.

Un trio de spacerock instrumental venu d’Italie dénommé Red Sun, sur le papier cela ne semble pas nécessairement annoncer d’emblée le truc le plus original de l’année . Mais après dix ans de travail, quelques plaques cousues main et bon nombre de jam sessions, on se retrouve potentiellement avec un bon album entre les cages à miel. C’est du moins ce qu’on espère en déballant From Sunset To Dawn, accompagné d’un bel artwork chatoyant de lumières, chassant les nuages lourds et gris environnants. L’objet est sorti chez Subsound Records, chez qui on peut notamment trouver du Bongzilla ou quelques albums de M. Bison. Des gens de goût donc, qui ont sans doute déniché là une pépite à ne pas négliger.
En 43 minutes et une jam instrumentale psychédélique, Red Sun propose les instruments pour un beau voyage. Les titres et la production sont cohérents, rien à redire, on se laisse porter par un parfait exemple du genre. On détecte ici et là quelques facilités dans la redondance de riffs un peu pesants, mais rien qui n’entrave réellement la réécoute. On pense parfois à My Sleeping Karma, notamment avec “A Violent Dusk”, un peu dans la veine de Monkey3 (actualité oblige), surtout lorsque la guitare soliloque et devient rauque sur “The Coldness of The New Moon”. Les passages gentiment kraut, comme ceux de “The Shape of The Night”, trouvent toute leur place en écho aux échantillons spatiaux de “Toward The End of Darkness”, qui en surjoue presque et rate l’occasion de glisser quelques chœurs suaves à la Floyd qui auraient pu appuyer le propos.
L’écriture de l’album est bien pensée, les titres parlent d’eux-mêmes, introduisant la plaque avec “Where Once Was Light”, puis “The Sky Turns Purple”, avant une poignée d’autres tout aussi parlants, et un final sur “The New Sun”, délivrant en conclusion son expérience d’inspiration hindoue où la batterie simule les tambours et la guitare le sitar. On a entre les oreilles une belle intention narrative et avouons que le propos est clair, on se laisse prendre, on incline la tête en arrière et on laisse la musique nous éclairer comme lorsque le soleil réchauffe l’aube.
Red Sun réussit avec From The Sunset To Dawn le pari de faire voyager l’auditeur de l’ombre à la lumière. Un plaisant détour dans une ambiance psychédélique plus mystique que spacerock au final, mais on passe là un beau moment d’écoute. Ce serait mentir que de dire que le trio ne réussit pas ici ou là à nous saisir par les sentiments, et on a plutôt envie d’être franc : Red Sun nous a fait vibrer plus d’une fois.

La musique comme catharsis on s’en persuadera vite après une écoute de Fabrizio Monni, chanteur et guitariste de Black Capricorn, au travers de son expérience solo, Ascia. Ce One Man Band italien devenu trio a priori pour le live sort une compilation remasterisée de ses démos précédentes au sein d’un album intitulé The Wandering Warrior, diffusé par Perpetual Eclipse Production.
Sur le produit, pas de doute, l’emballage vend la sauce avant même que la galette ne commence à tourner, avec un guerrier à cheval en contre-jour servi par un grain de photo qui révèle ce qu’il faut de rugosité et qu’on retrouvera dans le chant.
Les armes d’Ascia sont fourbies au doom velu. Ça tourne des boucles rythmiques comme des coups de marteau sur l’enclume, un coup de “Blood Bridge Battle”, un autre coup de “Serpent of Fire”, un coup de “Last Ride”. À chaque frappe, ça fait gicler des étincelles, qu’elles soient dans la veine la plus traditionnelle du doom à papa ou bien giclant quelques phrases bien senties dans le plus pur ton d’un Conan ou autre High On Fire, dont la voix et la rythmique se rapprochent franchement.
Ascia et se fait plaisir et livre “The Wandering Warrior” au galop. Les compos sont pleines de fougue et chevauchent le riff au clair. Elles fracassent des crânes avec “Ruins of War” ou le très épique “Samothrace”, faisant tournoyer le doom ad nauseam tout en agrémentant l’acte de quelques passages de gratte qui viennent enjoliver le tout en montant dans les aigus pour accompagner la beuglarde chansonnette
On pourrait croire qu’on va assister à une accalmie lorsque démarre “The Path Of Eternal Glory” mais que nenni, à peine passée l’intro, Ascia ressort la masse d’armes et revient aider l’auditeur à se mettre sa musique dans le crâne et ne retrouvera que peu de temps pour reprendre son souffle avant la fin de la galette
Avec “The Wandering Warrior”, on est en possession d’un album sans prise de tête et presque bas du front. Ascia fait figure de bon défouloir et après quelques écoutes, on aimerait bien aller ovationner tout ça, les pieds campés dans un sol collant à l’ombre d’une scène, tout en éructant de joie et de bière.

Les Athéniens d’Acid Mammoth ont fait émerger du permafrost une grosse bête doom en 2015 avec l’aide seule de leur passion pour Black Sabbath. Saluons le retour de nos archéologues ces temps-ci avec une nouvelle production signée une fois de plus chez Heavy Psych Sounds et intitulée Supersonic Megafauna Collision. Gageons que le quatuor aura su graver de puissants sillons dans la plaque, à en juger par l’excellente réputation qu’ils se sont taillée avec seulement trois albums et un split assortis d’une tournée encore récente en 2022-2023, laissant les sols de quelques clubs tout vibrants d’émotion.
Batterie pour rythmes tribaux d’entrée de jeu, riffs de basse joués ad nauseam tout au long de l’album, chant nasillard à l’extrême d’une piste à l’autre. Ce n’est pas l’excès d’originalité qui nous aura poussés dans les bras d’Acid Mammoth, mais plutôt la hype (toute relative) qui entoure le groupe. À la première écoute, il faut bien avouer que cela ne semble pas délirant. Devons-nous parler d’un préjugé grec ou d’une illusion auditive consistant à nous faire croire que les groupes issus du pourtour hellénique sont systématiquement supérieurs aux autres ? Je ne sais pas. Attention, je ne nie pas l’excellence de certains d’entre eux ; pour autant, il semble un peu court de vue de croire que tout ce qui vient d’une région du monde suffit pour garantir la qualité.
C’est donc avec beaucoup de sérieux qu’il nous aura fallu nous y reprendre à plusieurs fois pour écouter l’album d’Acid Mammoth. C’est là que la magie opère, on se surprend à chantonner l’air de “Fuzzorgasm” après seulement deux ou trois écoutes. On finit par occulter les passages les plus attendus pour savourer l’incursion acoustique sur “Garden of Bones” et la sensualité des 12 minutes de “Tusko’s Last Trip” où le chant entreprend de notables mélodies. Et puis après tout, si les thèmes sont d’un classicisme évident, tout ceci n’en est pas moins efficace, et on accepte jusqu’à la piste éponyme, “Supersonic Megafauna Collision”, qui s’incruste insidieusement dans les replis de la cervelle pour devenir un de ces titres qui, dès les premières notes, se rappellera à notre bon souvenir pour nous faire dire “hey, cool ! C’est Acid Mammoth !”
Ami lecteur, s’il te prend de vouloir te laisser aller à quelques plaisantes évidences épaisses et lourdes, cet album est fait pour toi. Pour les plus rigoureux des autres, Supersonic Megafauna Collision sera à ranger parmi les albums de doom moderne consciencieux et de bonne facture. Soyons francs, il n’a honnêtement rien à envier à un paquet de jumeaux issus du genre.

Désœuvré face à la faillite artistique d’Eyehategod ces dernières années, le fan de sludge old school se trouve à court d’options. Dans ce cadre, la re-naissance imprévisible des anglais d’Iron Monkey il y a un peu plus de cinq ans pouvait apparaître comme une lueur d’espoir (façon de parler pour un album aussi glauque que ce 9-13). Activité scénique quasi-inexistante malgré quelques lueurs d’espoir en 2018, zéro communication ou presque… on ne donnait pourtant pas cher de la peau du désormais-trio. Sans prévenir (évidemment), ils reviennent se rappeler à notre souvenir, toujours chez Relapse (qui continue vaillamment d’essayer de faire rentrer leur comportement anti-commercial au possible dans leurs process de marketing rodés aux pratiques du XXIème siècle), avec ce Spleen & Goad, emmené par un artwork hideux (c’est dit avec une certaine tendresse – d’autant plus que la pochette serait l’œuvre de Jimbob Isaac ? Difficile en tout cas d’y reconnaître sa patte…).
Côté musiciens, du line-up originel on ne retrouve plus désormais que Jim Rushby ; même Steve Watson, resté accroché aux branches dans l’album précédent, a disparu du paysage. On notera néanmoins le retour de Dean Berry, qui avait ponctuellement officié dans le groupe du temps de Our Problem (note : au vu de la cacophonie générée par la paire Rushby/Berry, on ne prendra pas la peine de détailler si ce dernier est en charge d’un complément de guitare, ou uniquement de lignes de basse ; sachez juste que c’est l’un ou l’autre, et probablement les deux). A la batterie, « Ze Big » (Steve Mellor) est maintenu, lui qui avait été recruté en 2018 après la sortie de 9-13. Bref, on continue à recruter l’underground anglais, aux limites de la consanguinité.
C’est avec une certaine sorte de confort (!!) que l’on accueille les premières salves de cette galette de neuf titres pour plus de cinquante minutes, car Spleen & Goad continue clairement là où 9-13 nous avait laissé (exsangues), à savoir sur un sludge d’école, emmené par un groupe à la dynamique d’innovation au ras des paquerettes. Et on n’en attendait ni moins, ni plus ! On se laisse défoncer par ces saillies sludge hardcore metal, avec un filet de bave au bord des lèvres. Le chant, désormais assuré par Rushby suite au décès de Johnny Morrow, démontre une maîtrise dans le braillement glaireux qui ne fait plus débat : c’est plus sale que nécessaire, et on ne se rapproche heureusement jamais d’un semblant de mélodie. Rushby chante comme il vomit : c’est sale, malaisant, et ça ne fait pas plaisir. Nickel. Musicalement ensuite, on est dans le rudimentaire, ou plutôt le juste-efficace, avec une prod assez massive. Y’a du riff, du son de guitare crade, du feedback mal maîtrisé, ça suinte juste comme il faut… Que demander de plus ?
Élément le plus bluffant de ce bruyant retour aux affaires, l’efficacité des compos est redoutable, et même si l’ensemble du groupe est crédité aux compos, on imagine que Rushby est à la manœuvre derrière la plupart de ces riffs de colosses. Qu’il pioche ses racines dans le hardcore (« Misanthropizer », le très énervé « Rat Flag »), le doom (« CSP » ou le riff scandaleusement WTF d’un « Off Switch » d’outre-tombe), ou le metal au sens large, il amène à ce disque un riffing 3-étoiles qui fait clairement la différence. Et ce “Off Switch”, bon sang… Quelques morceaux sont un peu en deça (et on s’interroge sur l’efficacité d’une version plus ramassée, écourtée d’une poignée de titres…) mais globalement, le niveau est là.
L’intention musicale rudimentaire, la musicalité plombante (du gras, du lourd, des accordages dangereux), et des paroles d’un négativisme confondant (un champs lexical neurasthénique, où se mêlent sordide, dépression, violence et cynisme) sont les principales composantes du « Iron Monkey nouveau » qui, finalement, n’est pas très différent du « Iron Monkey de toujours ». Cette stabilité les rend attachants. Spleen & Goad est finalement un disque hors de son époque, intemporel, qui ne vient pas morde les mollets du reste de la discographie du groupe, mais y trouve une juste place, comme un nouvelle jolie pierre dans le sentier boueux bien dégueulasse que représente leur plan de carrière.

Christian Peters est un homme prolifique. Il suffit de constater le nombre de ses sorties, que ce soit sous le nom de Fuzz Sagrado, Soulitude ou bien Surya Kris Peters, pour se rendre compte de l’imagination débordante du bonhomme. On le connaît bien sûr pour avoir tenu de guitare et main de maître le merveilleux trio qu’était Samsara Blues Experiment (yummy yummy que ce Long Distance Trip, on vous conseille de vous y replonger). Le six cordiste n’avait pas son pareil pour nous plonger dans des états de transe à force de moults solis et autres cavalcades de manche.
Que penser donc de son projet Surya Kris Peters et de ce nouvel album, There’s Light in the Distance ? Oubliez la force du feu-power trio et de ses jams bluesy à souhait, Peters nous invite ici à un voyage plus proche d’une BO de John Carpenter que d’un jam avec Cream.
On est saisi dès l’amorce par un arpégiateur lointain et le synthétique de la production. Les paysages post-apocalyptiques défilent à mesure que l’autoradio de la Dodge rouillée et cabossée déverse les vignettes sonores mâtinées de guitares à la réverbération toute 80s et l’acide des synthétiseurs. Pas totalement synthwave mais plus franchement rock, les compositions étonnent et peuvent aisément rebuter pour qui s’attendrait au Peters du Blues Experiment. Non, Surya Kris Peters pose des ambiances par strates simples plus qu’il ne parle au travers de sa guitare. Une fois le constat accepté et pour qui se prendrait au jeu, on peut tout à fait se laisser porter par les dix compositions jalonnant ce road-trip à mi-chemin entre les guitares testostéronées de Harold Faltermeyer et les expérimentations électroniques des néerlandais de Kong.
Reste un projet surprenant, ne correspondant plus aux canons développés par notre webzine, mais porté par un artiste touchant et riche de sa capacité à explorer et se ré-inventer. Un objet de curiosité qui pourrait piquer l’envie des moins obtus d’entre-nous.
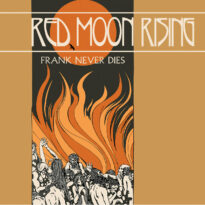
Venus d’influences aussi variées que le Punk, le Ska, la Funk ou le Rock Psyché, les quatre musiciens de Frank Never Dies assemblent leur savoir-faire depuis 2018 dans une musique qui se présente comme un paysage cinématographique constitué de guitares seventies, de synthés vintage et de chants diffus. Les ingrédients semblent pour le moins alléchants et propices à une balade déboussolée en terres inconnues, direction Red Moon Rising, le dernier album en date du quartette italien Frank Never Dies qui est signé chez Argonauta Records
Peu de chant, peu de guitare, mais un peu de tout en abondance. Des sonorités indéfinissables et un genre qu’il serait vain d’essayer de cerner. On pourrait aussi bien penser à Pink Floyd, les Doors ou Jello Biafra (au fond, pourquoi pas ?). Frank Never Dies, c’est un peu ce genre de choses que l’on pourrait classer dans les inclassables, dire que c’est de l’expérimental comme on dit c’est de la World Music, bref, lui coller un qualificatif alors que cela n’est pas vraiment pertinent.
Il serait compliqué de parler pendant des heures d’un groupe qui livre tout à la fois un psychédélisme éthéré sur “Peep Show” et “The Fortune Teller”, adossé à un chant scandé et incantatoire sur des rythmes tribaux lors du titre “Red Moon Rising”. Frank Never Dies part dans tous les sens et finit au-delà de nos frontières avec un morceau sorti tout droit du versant confidentiel de la pop gavée de synthé des années 80 avec “Know My Name”, qu’on pourrait également relier au jazzy “Living Spell” par un fil conducteur Trip Hop. On passe par une palette complète d’interprétations, chaque morceau ayant sa propre couleur, comme lorsque derrière des couches de reverb et une basse venue de l’Acid jazz des années 70, on perçoit d’étranges nappes de synthé. Quand on se laisse couler avec Audrey pour un voyage inquiétant et grave, c’est sur les berges du Post Rock que l’on finit. On y reste à se prélasser jusqu’à la piste suivante, “One of These Nights”, et on y revient goûter à “The Fortune Teller” une fois de plus. Au final il semble plus pertinent d’aller écouter l’œuvre que d’en discourir longuement.
L’effet que produit Red Moon Rising est assez curieux, à la fois linéaire et déroutant. Linéaire car les morceaux s’imbriquent les uns dans les autres et se succèdent parfaitement; déroutant car faisant appel à tant de genres qu’on ne sait pas bien sur quel pied danser, trop habitués sans doute que nous sommes à écouter des albums bien sagement monomaniaques. Quoi qu’il en soit, Frank Never Dies signe ici une belle escapade qu’on vous recommande chaudement.

On commence à s’y perdre un peu avec les innombrables ramifications et emberlificotages de toutes sortes entre les musiciens du desert rock “de la source” ces dernières années, ces légendes (pour la plupart) en droite provenance du haut-désert californien. Qu’il s’agisse de simples projets ou bien de groupes « en dur », on voit défiler les participations des mêmes musiciens à travers différentes incarnations, qu’il s’agisse de la carrière solo de Brant Bjork (ou même de Nick Oliveri dans une moindre mesure), du groupe Stöner, des différents projets emmenés par Gary Arce, Fatso Jetson, des hybridations qui invitent d’autres musiciens (Yawning Balch, Big Scenic Nowhere…), etc… Avec à chaque fois, derrière les « têtes de pont », des sections rythmiques qui passent de l’un à l’autre, agiles et efficaces. Ces projets trouvent presque toujours un label conciliant et peu farouche pour sortir leurs productions qui sont, on le sait, qualitativement… « disparates », dira-t-on poliment.
C’est cette fois le tour de Mario Lalli, parrain de la « scène » bien plus que d’autres, musicien génial et inspiré, peu carriériste, d’assumer son propre projet, derrière son nom. De manière assez surprenante, en plus de quelques lignes vocales au début, c’est à la basse et non à la guitare que le gaillard choisit sa place dans ce projet. Depuis plusieurs années, de nombreux musiciens amis viennent épauler Lalli derrière ce projet essentiellement live, et le line-up ici présent voit le copain Brant Bjork s’emparer de la 6-cordes, le batteur attitré de ce dernier, Ryan Güt, aux baguettes, et le vieux partenaire Sean Wheeler au micro. Cette formation a déjà opéré sur scène (notamment en « pièce rapportée » de certains des projets sus-mentionnés) sous des formes musicales plus ou moins structurées. Fidèle à cette approche peu orthodoxe et peu rigide, la formation de copains a profité d’une tournée australienne de Stöner (où l’ensemble des membres de ce chatoyant aréopage officiait en tant que zicos, tech, ou autre partenaire de voyage) pour assurer un set dans une réputée salle de la banlieue de Brisbane. Jamais avare d’un disque live produit à peu de frais (ça devient malheureusement leur marque de fabrique), Heavy Psych Records a tout simplement récupéré les bandes d’un enregistrement produit par la salle afin de générer cette sortie vinylique (note : la vidéo du set est dispo sur youtube gratos, autrement plus intéressante que sa version disque…).
Sous sa forme ici présentée, le concert n’est rien moins qu’une grande impro de 40 minutes, une jam live parfois décousue, découpée plus ou moins artificiellement en 4 plages (de manière parfois presque absurde : voir le « cut » entre les deux premières plages, où il est bien difficile de distinguer un morceau qui se termine et un autre qui commence).
Musicalement, on est sur quelque chose qui va du jam rock groovy aux plans plus planants, qui se positionnera (de manière absolument pas surprenante) entre le boogie-jam groovy à la Brant Bjork, l’énergie de Fatso Jetson, et les plans aériens de Yawning Man (le son de guitare irritant en moins). Ça ne riffe pas vraiment, la grosse structure rythmico groovy est tressée par Lalli (bien supporté par un Güt très efficace, toujours sobre dans son jeu, ne saturant jamais l’espace sonore comme trop de batteurs dans ce type d’exercices), avec quelques incursions funky-soul-bluesy de Bjork à la guitare. Mais on est quand même largement sur un jam rythmique. Le chant de Sean Wheeler est en réalité plus proche du spoken word déclamé, probablement pour partie improvisé, en mode slam. En tous les cas, même s’il sait s’effacer assez souvent au profit des instrus, ce chant vient apporter un vernis bien spécial au projet.
Comme on vous laisse l’imaginer, la nature musicale du dispositif n’est pas très propice à faire émerger un titre ou un autre : en tant qu’objet musical global, Folklore From The Other Desert Cities est ambiances, lignes mélodiques, leads de guitare, séquences rythmiques,… empilés les uns aux autres avec plus ou moins de bonheur. On ne reviendra donc pas particulièrement vers une séquence ou une autre pour reprendre tel riff ou fredonner tel refrain (quoi que le gimmick de paroles autour du morceau-titre, structuré autour du standard folk US « Where Did you Sleep Last Night », aussi popularisé par Nirvana, retient inévitablement l’attention). Mais l’ensemble se porte très bien, et on ne s’y ennuie pas (ce qui n’est pas toujours le cas avec tous ces projets sus-mentionnés). La fraîcheur de ce line-up, qui détonne un peu avec les set-up les plus traditionnels dans ce genre musical, apporte quelque chose de différent. Avec en outre un talent musical et mélodique remarquable, l’ensemble s’écoute et se réécoute sans effort et avec même – soyons fous – un certain plaisir !
Alors certes, on ne dépasse jamais fondamentalement les limites de « l’agréable » et on ne s’aventure jamais en territoire « jouissif » non plus, mais ce premier disque a le mérite (non négligeable pour le format) de proposer un contenu autoporteur sans trop de points faibles, charmeur (d’où le nom du projet ?), pas ennuyeux. Un bon moment, intéressant, même si fondamentalement un peu anecdotique, car ne laissant pas de trace marquante.

Après une tentative d’écriture en 2018-2019, le projet avait subi une léthargie forcée. Le nouvel album de Iota, Pentasomnia aura donc dû attendre 5 ans pour voir le jour sous la houlette bienveillante de Small Stone Records. Le trio de Salt Lake City a une carte de visite bien chargée et cela explique sans doute pourquoi cet ensemble n’a à ce jour livré que deux galettes dont la présente rien que seize ans après la précédente! Pour autant malgré l’attente, le trio n’annonce pas plus de prétention que la fois précédente; une musique honnête par des gens honnêtes dit leur bio. On ne demanderait qu’à les croire, mais on va quand même dépasser les bornes du marketing pour en juger par nous même.
Plongeant dans l’univers de Pentasominia, on est dès le démarrage enveloppé d’une ambiance teintée de blues, qui accompagne l’auditeur vers des voyages psychédéliques d’un Iota dont les artworks rendent hommage à l’esthétique lysergique dès le premier regard. La guitare, jamais agressive mais toujours prête à s’aventurer dans des territoires épiques, comme en témoigne “The Returner”, offre une expérience proche d’une jam session, avec ses solis , comme dans “The Witness” ou “The Time Keeper”. Cependant, au-delà de ces prouesses guitaristiques (Parfois un peu lourdes à digérer), c’est la basse qui donne réellement du corps à l’ensemble ( sans jamais pour autant venir totalement sur le devant de la scène), dépassant ainsi le simple rôle de la section rythmique pour apporter des nuances plus profondes à chaque morceau, soutenue habilement par une batterie qui structure définitivement l’ensemble.
Quant au style, bien que l’aspect psychédélique soit indéniable, il serait réducteur de le limiter à cette seule dimension. Après l’écoute de morceaux tels que “The Time Keeper”, qui explore un répertoire plus vaste, et “The Great Dissolver”, dont les harmonies oscillent entre le hard rock, (notamment à travers son solo) et une structure doom on se convainc aisément qu’il y a un peu plus derrière tout cela qu’une errance hallucinée. Le chant est particulièrement appréciable lorsque sur la dernière piste il est repris en chœur ce qui permet de quitter l’album avec une nette sensation de satisfaction.
Iota ne sort pas souvent du bois, à vrai dire on l’avait oublié et on le regretterait presque car de l’honnêteté il y en a indéniablement dans les idées développées au sein de Pentasomnia et il est à présent certain que ces idées sont également portées par d’honnêtes artisans. Il n’y a plus qu’à espérer que l’emploi du temps de ces derniers leur offre la possibilité de se faire plus assidu dans la fréquentation de nos conduits auditifs, pardon mais 32 minutes tous les seize ans, c’est un peu chiche.

Tiens, un live de Bongzilla ! Quelle étrangeté pour un groupe qui s’est déjà adonné à l’exercice du disque live en 2003 (même si Live from the Relapse Contamination Festival était plutôt un EP qu’un LP) – ça date certes, mais on ne peut pas dire que le groupe soit connu pour la profusion de son activité scénique. Pas forcément sur un temps fort de sa carrière depuis sa reformation en 2015 (avec deux derniers albums entre le « pas mal » et le « vraiment bof »), l’opportunité de briller à travers une captation live ne se faisait pas forcément sentir a priori… sauf à vendre quelques vinyles multicolores supplémentaires ? Ne soyons pas médisants et voyons ce que la bête a dans le ventre…
Premier constat : la production / mix sonore propose un son d’une clarté remarquable… mais laisse une sale impression d’un groupe qui joue en studio, un peu comme ces « live COVID » qui pouvaient fleurir pendant le confinement. Côté bruit d’ambiance, c’est le néant pendant les chansons (même si on sait la foule plutôt silencieuse sur des concerts de doom), et à la fin des chansons on entend parfois quelques bruits du public au loin, très loin… probablement captés indirectement par le micro chant. On se retrouve avec une prise de son aseptisée, 3 instruments et 1 micro chant ajoutés les uns aux autres. Le chant de Makela, rare heureusement, vient écraser le tout en surnageant dans le mix, noyant tout le reste de sa glaireuse bile sludge à chaque intervention… La formation en trio désormais de Bongzilla (Jeff Schultz seul à la gratte) ne permet pas, du coup, de compenser cela par une couche de gras… pardon, « par une ligne de guitare » supplémentaire, pour mieux équilibrer la mise en son. Apparemment le mix a mobilisé un ingénieur du son + 2 assistants… probablement d’excellents techniciens, mais niveau feeling, ça souffre un peu. A côté, leur live de 2003, imparfait, sentait le souffre et la saleté, pour un feeling bien plus immersif.
Pour rendre le tout un peu plus “désincarné”, le disque est capté sur trois concerts différents. La set list est plutôt correcte, avec une plus forte représentativité des derniers albums du groupe (deux titres pour chacun des deux derniers disques depuis leur reformation – même s’ils ne sont pas les meilleurs, leur label actuel n’est pas maso et cherche à valoriser les titres édités à la maison…) puis un titre à peu près de chacune de leurs productions antérieures. Pas de vraie surprise, on est sur une set list de référence de Bongzilla ces dernières années, pour leurs rares concerts.
Niveau interprétation, on peut rendre hommage aux musiciens : même si on n’est pas sur du Dream Theater, la clarté du mix retranscrit tellement bien les parties instrumentales qu’on note bien qu’elles ne souffrent pas de problèmes de jeu ou d’approximation. Si on voulait être méchant, on dirait que le fait de piocher dans trois concerts différents permet de ne sélectionner que les titres impeccablement interprétés… mais ce serait être mauvaise langue, et Bongzilla n’a pas la réputation de manquer d’efficacité en live.
Fondamentalement, pour un groupe aussi rare en concert, on pourra s’étonner de retrouver dans leur discographie déjà 2 albums live. La valeur ajoutée de celui-ci, à ce titre en particulier mais aussi de manière générale, est questionnable. En tant que best of, il tient à peu près la route (on aurait préféré plus d’anciens titres), mais en tant que live, il ne parvient pas à retranscrire efficacement l’énergie lourde et poisseuse d’un concert du trio.

Avec des origines Punk Hardcore et une carrière débutée en 2014 sous les auspices du gras et de la weed, une poignée de galettes d’un sludge de bon aloi, cinq zicos qui tiennent le pavé et la bénédiction de Magnetic Eye Records, voilà de quoi dessiner les contours de Leather Lung, un groupe qu’on pourrait croire venu d’Alabama ou de Louisiane mais qui officie en fait sur la côte est des États-Unis, dans le Massachusetts. Il y a donc eu pas mal de curiosité à la barre de la découverte de ce dernier opus, Graveside Grin.
Il ne faut pas plus de quelques mesures pour se faire une idée d’où on a foutu les pieds. Dèja la pochette à gros nibards et giclée de bière laiteuse sonnait comme un avertissement. Ça tabasse d’office, un pied dans le bayou, un autre dans le sable du désert. “Spit In The Casket” dit tout du chant dans un simple mot, “Bitch” craché à la gueule de l’auditeur entre deux harmonies des gratteux qui la jouent tout en agressivité et mélodie soutenues par une batterie enveloppante.
Que ce soit “Big Bad Bodega Cat” ou “Empty Bottle Boogie”, la sautillance des morceaux donne envie d’une part de laisser la musique emporter son corps puis de casser des briques avec sa tête. Tout le long de l’album, le chant reste l’élément majeur des compos avec un style sludge mais presque toujours sans excès, ce qui ravira autant les amateurs du genre que les plus rétifs de ce style glaireux. Les esprits les plus chagrins n’auront qu’à faire abstraction et attendre la mélodieuse introduction au chant de “Twesting Flowers”. Cependant, quel que soit son goût, l’auditeur aura tout intérêt à se concentrer sur des cordes qui ont su synthétiser différents horizons du metal, comme lorsque le gras d’un growl d’outre-tombe de “Guilty Pleasure” cède le pas à des grattes qui virent hardcore. Un autre bref aperçu de la large culture du groupe se fait jour sur “Macrosdose (Interlude)” qui donne à entendre d’autres étendues que celles de nos habituels terrains de jeu, y compris lorsque la piste suivante “La La Land” fait glisser quelques riffs subtils et presque orientalisant. On ne s’ennuie pas avec cette belle plaque qui pourrait faire croire au distrait qu’il s’agit d’un album un peu simplet de plus dont le seul intérêt serait d’être un défouloir. Il n’en est rien, Graveside Grin s’écoute et se réécoute, il y a de bonnes idées à la pelle et elles ne sont pas toujours si évidentes que cela.
Alors que certains pontes du genre sludge déclinent gentiment dans les brumes parfumées de leurs cigarettes à rigoler, Leather Lung délivre avec Graveside Grin un album jouissif, un album de métal, un album auquel il est bon de s’abandonner totalement. Bas du front, on fonce, pour ce qui est de l’intelligence, la musique s’en chargera.

Moins de deux ans après leur premier disque (Early Moods, meilleur disque de 2022 que personne n’a écouté), le quintette angeleno aura suivi notre précieux conseil de battre le fer tant qu’il était chaud : après quelques séries de dates live nord-américaines, le fougueux combo s’est immédiatement attelé à la composition de ce nouveau disque et s’est engouffré en studio pour sortir cette nouvelle galette, toujours chez les brillants et décalés Riding Easy Records.
Son écoute attentive confirme la furieuse passion de ces jeunes californiens pour ces influences complètement surannées qui avaient fait le charme de leur première galette : une sorte de doom metal nerveux, absolument ancré il y a 3 ou 4 décennies plus tôt, l’ensemble teinté d’une énergie qui emprunte beaucoup aux groupes de la NWOBHM. A cet égard, l’alchimie déjà entendue sur leur première rondelle est toujours là.
Qu’est-ce qui distingue ce disque du précédent ? On serait tenté de dire “rien”… et on n’aurait pas tort, en un sens. Est-ce que l’écriture est meilleure ? Oui parfois, mais les meilleurs titres de Early Moods restaient meilleurs que les moins bons de ce second opus, donc franchement, on est dans une belle continuité. On pourra mettre en avant une plus grande maturité (quelle surprise…) avec un groupe qui s’assume et se complait dans ce style musical. Mais pour le reste, pas de révolution : ils font toujours brillamment ce qu’ils faisaient super bien avant.
“Ce qu’ils font”, donc, c’est en quelque sorte faire reprendre vie au Pentagram des années 80 (son chant hanté, ses riffs mêlés d’occultisme et ses leads malaisants), lui injecter le riffing du Sabbath des années précédentes, et emmener le tout sur des rythmiques issues du metal des années 80. Jamais proche du plagiat, Early Moods développe plutôt son style si enthousiasmant à travers 8 compos de plus de cinq minutes (minimum syndical pour du doom metal traditionnel) qui ne se dispersent jamais. Mentions spéciales à “Unhinged Spirit” (pour son riff délicieux bien sûr, mais surtout son groove prodigieux sur ce break rythmique emmenant la fin de la chanson sur une cavalcade metal de haute volée), le très occulte “The Apparition” et son riff en droite lignée du 1er Sabbath, les soli roboratifs de “Walperguise” ou de “Hell’s Odyssey” sur sa seconde moitié…
A Sinner’s Past se déguste comme une petite pastille hédoniste, un plaisir coupable et extrêmement régressif. Il y a une vraie satisfaction à écouter un groupe talentueux et inspiré jouer une musique que l’on pensait morte, contenue exclusivement dans une pile de vieux disques poussiéreux : voir ce style musical prendre vie, animé par tant de talent et d’inspiration est un sentiment particulièrement vivifiant. Quand, en outre, l’intégrité et la passion mènent la barque, alors il devient difficile de ne pas succomber et tomber en fol amour avec ce groupe de jeunes loups inspirés. On attend déjà leur troisième méfait, et on se dit que maintenant qu’ils se sont affirmés en totale maîtrise de ce style, ils ont probablement le potentiel de transcender le genre et l’emmener vers des champs inédits, pour l’installer complètement dans ce nouveau siècle. Croisons les doigts pour qu’Early Moods soit ce groupe – ou l’un d’entre eux.
En attendant, on se repasse encore le disque.
|
|