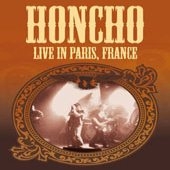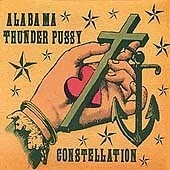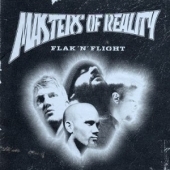|
|
 J’avais bien accroché sur ‘Gravity X’, la première livraison de la bande d’Örebro. ‘Phi’, qui lui a succédé m’avait un peu plus laissé sur ma faim et à vrai dire, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre lorsque ‘Mania’ a débarqué dans ma boîte aux lettres. Le groupe m’avait très positivement impressionné en première partie de Fu Manchu. Je leur avais fait part de mes interrogations quant à la longueur des titres sur scène qui s’étiraient bien au-delà de leurs versions discographiques et sur le style que eux préféraient. Cette nouvelle plaque lève le doute avec des titres qui s’étalent longuement avec une bonne dose de grande classe mondiale.
Un setlist de huit nouvelles compositions m’a d’abords fait prendre Truckfighters pour des petits bras, mais force est de constater que je me suis carrément mis le doigt dans l’œil. Cette nouvelle plaque dépasse les cinquante minutes et, croyez-moi, c’est du meilleur tonneau ! Dozer a du pain sur la planche car, avec une sortie de ce type, leurs compatriotes leur tient la dragée haute. Un fuzz d’enfer est au rendez-vous sur des réalisations comme ‘The New Hight’ ou ‘Loose’ qui sont tout bonnement imparables. Tous les ingrédients sont réunis ici pour que cette plaque squatte de longs mois nos platines laser. Un groove enivrant à base de riffs distordus, de basse vrombissantes, de percussions carrées et de chants lancinants accompagnés de backings bien en place.
Ozo et Dango ont produit eux-même cette galette que Dango a mixée tout seul comme un grand après que les chansons furent mises en boîte au Bombshelters Studio de leur vielle natale. La bande avait donc carte blanche pour la réalisation de ce skeud. Ils pouvaient se lâcher comme bon leur semblait et ils se sont même payé le luxe de propulser une compo de treize minutes, ‘Majestic’. Cette chanson est un modèle de réussite au rayon du gros riff qui tourne, tourne et retourne autour de lui-même avec brio sans lasser l’auditeur.
Du tout bon au pays du fuzz suédois à mettre au crédit d’un groupe a fort potentiel qui peine depuis ses débuts à trouver un public qui le soutienne autant qu’il soutient d’autre formation du même acabit n’ayant en définitive pas grand chose de plus à offrir, enfin, les Truckfighters s’apprêtent à tourner au sud de leurs fjords et ce serait pas mal de se bouger pour eux ; ils le méritent amplement !
Vous avez tapé « album de l’année 2008 » dans votre moteur de recherche préféré et vous êtes tombé sur cette page. La première conclusion que l’on peut en tirer c’est que ce moteur de recherche est très efficace, la deuxième, c’est que j’ai adoré cet album et la troisième c’est que je rêve un peu, c’est vrai.
Glowsun existe déjà depuis plusieurs années, mais comme tout bon groupe qui a choisi un style de musique à mille lieux du mainstream poisseux, il leur aura fallu attendre avant de pouvoir sortir leur premier album. Comme tout vient à point à qui sait attendre, les chanceux patrons de Buzzville (chez qui on trouve Monkey3, Cabron, Generous Maria et d’autres) ont eu la bonne idée de les signer voilà quelques mois et de leur permettre de sortir la galette que voici. Elle reprend des titres de leur EP sorti en 2005 ainsi qu’une majorité de nouvelles compositions.
Alors que beaucoup d’albums se contentent d’un ou deux bons titres pour ensuite faire du remplissage, les trois lillois nous donnent ici un album particulièrement homogène, sans aucune faiblesse au niveau des compos ; bref, c’est que du bon. Les neuf titres sont autant de perles qui passeront l’épreuve du temps sans sourciller et c’est bien là le meilleur compliment que l’on puisse faire à un disque à mon avis. Rien ne semble avoir été négligé ; tel riff à tel moment, tel changement de rythme, et ce solo ou encore cet effet, tout, absolument tout semble être le résultat d’un long travail d’écriture, de réécriture, de discussions et répétitions interminables. Mais tout ce travail sur les compos ne tombent pas dans le piège de la surabondance d’effets, du trop plein d’idées mal agencées car l’ensemble reste fluide et les titres s’enchaînent parfaitement. Et puis il faut le dire, ce disque est très agréable à l’écoute. Lorsque l’on voit le nombre de disques gâchés par une production et/ou un mixage moyen, on ne peut que souligner le travail sur cet album. Point de son de batterie qui sonne creux, de basse trop lointaine ou de guitare en carton.
Alors oui, ce disque, je vous l’annonce, ne sera pas n°1 du billboard US, non, il n’a pas été produit par le dernier producteur R&B à la mode et ne bénéficiera pas d’une campagne publicitaire planétaire de quelques millions de dollars. Mais si vous êtes sur ce site, c’est qu’un tant soit peu vous appréciez la même musique que nous et dans ce cas là, oui, ce skeud est pour vous. C’est du 100% stoner certified, avec d’excellents riffs, de superbes envolées destructrices de tympans et des passages à vous mettre la chair de poule, sans rire.
Il ne reste plus qu’à souhaiter au groupe de voir son premier album accueilli comme il se doit par les fans de stoner, de rock ou que sais-je encore. J’attends déjà la suite avec impatience.Le stoner en France qui peine encore et toujours à trouver son public a trouvé son disque de référence ; c’est The Sundering de Glowsun.
Une demi décennie après leur dernière offrande, le quintette de Mike Amott sort son nouvel album, après le départ de JB : son hurleur au coffre remarquable a préféré se concentrer sur son propre combo, Grand Magus. Il est remplacé ici par un clone efficace, un inconnu au sobriquet grec, sans relief particulier, mais sans lacune non plus.
Après 3 semaines d’écoutes, ce dernier Spiritual Beggars me laisse un sentiment mitigé, que j’ai du mal à objectiver complètement ; ce qui est assez normal avec un groupe que l’on suit depuis plus d’une décennie, auquel on s’attache évidemment. Après diverses tergiversations intra-moi-même, je pense que l’on peut mettre en avant trois postes d’évaluation pertinents sur ce disque, qui se complètent et apportent un regard que je pense complet sur ce « Return to Zero ».
– Premier point : les compos. Mike Amott s’y connaît dès lors qu’il s’agit de composer un hit de hard rock plombé. Pas d’ambiguïté ici, il signe 95% des titres (chant et musique), et ça fonctionne. Les morceaux sont catchy, on trouve plusieurs « hymnes » tout à fait typiques du combo. Après quelques écoutes, on assure les backing vocals comme un seul homme, on joue de l’air guitar à la moindre occasion, et on adore les passages de claviers « very 70’s ». Du très heavy « Lost in yesterday » au sautillant « Star born » (typique SB en tous points !), en passant par les super efficaces « We are free » et « Dead weight », il y en a pour tous les goûts, et Amott touche juste à chaque fois.
– Second point : le genre musical. Ici le bât blesse un peu. Est-ce la lassitude, ou bien la profusion d’albums excitants écoutés ces derniers mois ? Toujours est-il que le virage (très fortement consommé aujourd’hui) vers un gros hard rock 70’s, et ce détachement inexorable des influences « spacy » des premiers albums, me lasse un peu. Il n’y a pas grand-chose d’original sur ce disque, que l’on n’ait pas entendu sur les deux précédents. Le groupe s’enfonce dans ce genre et n’en sort plus grand-chose d’excitant. Il contente ses fans, perfectionne son style, mais perd peu à peu de sa fougue.
– Troisième point d’évaluation de l’album, crucial et primordial : la chanson « The road less travelled » qui conclut l’album. Cette bluette minable, pauvre vieux slow sans âme (on dit même pas poliment « balade » pour ce genre de daube), où le nouveau chanteur Apollo révise son Coverdale à coups de trémolos débiles et de larmoyantes tirades poussives, porté par un son d’orgue Bontempi arrangé dans des toilettes publiques, est indigne du pire album de variétoche française des années 80. Cet immondice, qui porte haut l’étendard du ridicule, lorsqu’il ne pousse pas à vomir son plus récent repas, incite très fortement à appuyer sur la touche « eject » de son lecteur CD dès qu’il pointe le bout de ses piteux premiers accords. Comment un compositeur de la trempe de Amott peut laisser un étron aussi pitoyable sur l’une de ses galettes me dépasse complètement. Pire chanson de la décennie, probablement. La pire dans ma collection de CD, assurément.
Difficile d’apprécier sincèrement et complètement un CD qui se termine aussi piteusement. Mon professionnalisme sans faille et mon objectivité quasi-journalistique prennent toutefois le dessus pour conclure cette chronique par une lapalissade de bon aloi : si vous avez aimé les derniers Spiritual Beggars (et que vous pouvez programmer votre lecteur CD pour zapper la plage n°12), achetez ce disque sans hésitation. Si les années passent et que la nostalgie des premiers albums du groupe vous gagne, vous pouvez envisager de dépenser votre argent ailleurs, c’est pas les occasions qui manquent.
Un DVD qui “nous” intéresse, fans de rock péchu, chaud et aride, c’est en soi un phénomène assez rare pour être noté. Quand en plus il concerne l’un de nos groupes favoris, Honcho, qui a sorti l’année dernière l’une de nos galettes préférées, et que, cerise sur le gâteau, il a été tourné sur nos terres (France), on ne peut que baver d’impatience en enfournant la galette.
Premier feeling : c’est du travail de pro. L’interface est soignée, les basses font vrombir la stéréo (bon c’est pas du 5.1, mais quand même), et on se lance avant même le concert dans les bonus : un making of “fait maison” très sympa remplit parfaitement son office de mise en bouche, et une fois passé rapidement sur la galerie photo et quelques infos, on lance le concert.
Le concert se déroule donc au Batofar, petite salle “nautique” bien agréable parisienne. La taille de la salle semblait a priori rédhibitoire à la “captation” live d’un groupe rock (habitués que nous sommes aux DVD musicaux reflets de festivals ou concerts avec des dizaines de milliers de spectateurs). Finalement non, très vite on est rassuré sur deux points : le public, dense, est bien présent, et surtout la quantité de caméras (et donc d’angles de captation) rend l’événement très “vidéo-génique” : cette multitude d’angles de vue (allant de la vue d’ensemble à la caméra “sous le nez” des zicos, avec des plans du public et des plans fixes sur les instruments) rend l’expérience de ce concert filmé particulièrement agréable, car jamais rébarbative. Un très bon point.
Concernant le concert en lui-même, la part belle est légitimement faite au dernier album de Honcho, “Burning in water, drowning in Fire”, sans oublier quelques incursions dans leur premier album. Honnètement, la set list est irréprochable, se permettant même d’aller piocher dans le répertoire de Kiss, en déterrant un “Watching you” parfaitement adapté.
Le son est très bon. Chaque instrument est bien mis en valeur, le mix est tout à fait homogène. Chaque musicien se fait donc plaisir, et on discerne clairement les deux grattes, la basse, la batterie, et le chant de Lars Erik Si. Ce dernier reste l’un des plus gros atouts du groupe, encore plus en live, où le bonhomme se révèle non seulement un vocaliste impeccable (si la prestation n’est pas parfaite, une ou deux légères “fausses notes” en début de set, à froid, la dynamique et la puissance du hurleur est inattaquable), mais surtout un frontman tout à fait efficace, ce qui se révèle un fort atout pour Honcho, groupe un peu “statique” sans lui. Non seulement il s’adresse au public systématiquement entre tous les morceaux (dans un anglais irréprochable), mais surtout il attire tous les regards.
Au final, en toute sincérité, ce DVD est sans doute l’un des meilleurs dans le genre musical que nous affectionnons ici. Manifestement fruit d’un travail de passionné, honnête et néanmoins professionnel en tout point. Une initiative aussi louable que remarquable. A ne pas rater.

Si ça part sur un morceau aux accents fortement indus que ne renierait pas un Trent Reznor ou encore un Al Jurgensen, on discerne néanmoins un son moins métallique et une certaine tendance à rechercher la mélodie sans utiliser de dissonances et autres tournures noircies.
On se laisse gentiment emmener vers des refrains plus pop US mais avec une touche résolument rock et un son de guitare épais et travaillé qui flaire bon l’avant-dernier album de QOTSA (Lullabies to Paralyze). Le groupe prend même des allures triomphantes et profondes que l’on devine sincères et, entre 2 pilonnages de fûts, nous démontre des constructions réfléchies et des breaks puissamment maîtrisés.
Pas de répit pour les braves… le nom du groupe et à l’image de leur musique: pas de temps morts, des bridges bien remplis et des structures intenses qui laissent poindre ça et là des refrains à balancer entre le chant et le hurlement. Et ils n’en démordent pas, les bougres! On se retrouve quelques petites saccades musicales plus tard dans un riff haché menu non sans rappeler les furieux de Helmet. Que de références diverses, me direz-vous. Mais bon, ne pas s’y tromper: No Rest 4 The Brave possède une réelle capacité de digérer ces tendances et d’accoucher de chansons plus perso. On leur souhaite de continuer dans cette voie.
Un plan un peu trop FM dans le 5e morceau me murmure que les musicos prennent des risques qui pourraient rapidement faire basculer le groupe dans le tartuffe, mais pas suffisamment longtemps pour lancer une telle affirmation. D’ailleurs, la 6e amorce me rassure en prouvant la parfaite maîtrise du mid-tempo si cher à notre exercice préféré. On navigue tantôt sur le velours tantôt sur la lame de fond, mais toujours sous une houle pouvant rapidement virer au vent de tempête. Le groupe doit encore affiner sa touche personnelle mais le souffle et la patate sont déjà au rendez-vous. A suivre toutes voiles dehors, ce quatuor français a déjà largué les amarres…
Probablement las d’attendre qu’un label se manifeste pour sortir leur musique, les membres de Mr Mama et plus particulièrement Jelle, leur batteur, ont pris le taureau par les cornes en créant leur propre structure, Guru Gonorroe Records, dont on tient aujourd’hui entre les mains la première sortie, ce split sur lequel ils convient leurs potes de Pablo Diablo. Avec dix titres au compteur pour une durée totale qui frisent les 25 minutes, n’attendez pas de cette galette de longues compos épiques ou une quelconque volonté de révolutionner quoi que ce soit, les deux groupes délivrant chacun cinq brûlots bien enlevés aptes à mettre le feu à tous les mosh pits de Belgique et d’ailleurs.
Pablo Diablo ouvre les hostilités avec son punk’n’roll à la Zeke en filiation direct avec le Hard Core old school qu’ils ont eu la bonne idée de mâtiner de quelques influences metal, histoire de tempérer les tempos poussés dans le rouge, comme c’est par exemple le cas avec le break tout en lourdeur qu’on retrouve sur Pick Up The Phone. On songe d’ailleurs parfois au Suicidal Tendencies des débuts pour le mélange d’énergie brute et de plans de gratte typés metal, même si une première écoute ne laisse pas apparaître clairement toutes ces influences parfaitement assimilées. La charge est franche sur les trois premiers titres avant que F.U.E.F. n’apporte un peu de nuance grâce à un riff plus posé et une rythmique sur laquelle le batteur démontre qu’il est capable de faire autre chose que battre des records de vitesse. Thanks for the Ride clôture la première partie du cd en remettant la pression mais se distingue par une ligne vocale plus mélodique et un refrain presque sing along si cher aux punks à roulettes.
Avec Mr Mama, chez qui on retrouve également Roel, l’imposant mais très sympathique guitariste de Pablo Diablo, on poursuit dans l’agression sonore d’un autre type même si certaines influences sont communes. Bien que le premier titre fasse le lien avec ce qui précède, la suite lorgne plutôt vers un metal barré plus moderne qui rapproche Mr Mama d’un groupe comme Mastodon (pour qui ils ont d’ailleurs ouvert), l’extrême précision technique en moins mais avec un petit grain de folie en plus. Certains titres, comme l’excellent Domestic Violence s’appuient sur une structure complexe faite de changements de rythme incessants et d’un empilement de riffs tantôt math-rock, tantôt franchement metal qui s’agencent pour vous faire perdre tout repère, le tout délivré avec cette énergie propre au Hard Core. Seul faute de goût, le dernier titre, Okapi 91, probablement censé apporté une touche de fun mais qui au final est surtout gonflant en raison de ses rires forcés difficilement supportables.
 Beaucoup de gens s’accordent à reconnaître la place fondamentale qu’occupe The Obsessed et son héraut, Wino, dans le développement du heavy rock. D’où l’importance de ce disque. Neuf titres. Neuf pierres angulaires qui reposent sur l’héritage sabbathien, qui elles mêmes soutiennent la production que l’on qualifie aujourd’hui de stoner. Un maillon essentiel donc, trop rapidement devenu chaînon manquant puisqu’introuvable (Hellhound l’avait sorti en Europe). C’est Tolotta Records (Spirit Caravan) qui a eu l’excellente idée de le rééditer. L’étincelle jaillit dès les premières mesures. Du groove indolent et pénétrant de « Tombstone highway » et de « Ground out » au heavy boogie de « Freedom » en passant par le doom métronomique de « The way she fly », le talent ne se dément jamais. Avec en outre des moments qui préfigurent déjà de l’esprit que l’on retrouvera chez Spirit Caravan, tels que « Forever midnight » et « River of soul », on s’aperçoit que la somptueuse tension mélancolique de la voix de Wino est déjà fort bien en place. On échappera pas à quelques gimmicks guitaristiques propres aux années 80 qui n’ôtent rien à la qualité de l’objet (il est à signaler que ce disque a été enregistré en 84 et n’est sorti la première fois qu’en 89). Hormis le fait qu’il offre une re(co)nnaissance largement méritée, ce disque présente également l’intérêt de voir Wino avec un look assez new wave d’inspiration teutonne (rimmel, cheveux longs et frange ébouriffée). Il est par ailleurs tout à fait considérable qu’aient été ajoutés à ce disque neuf titres live supplémentaires datant de 84. Le son n’est certes pas d’une qualité extraordinaire et leur intérêt réside surtout, à mon sens, dans le fait que l’on y retrouve quatre titres qui figureront dix ans plus tard sur le fabuleux « The church within ». On peut s’étonner que ces titres aient mis autant de temps à sortir, non ? Je ne connais pas suffisamment la biographie du groupe pour expliquer ce décalage, désolé. En tous les cas, ce disque est un must pour tous les curieux de l’œuvre d’un groupe majeur et d’un guitariste-chanteur immense. A quand la réédition de « Lunar Womb » ?
Plus connue pour ses groupes black metal, la Norvège vient de nous livrer un superbe power trio au service du doom psychédélique : Gate 9. Crépusculaire, mélodique et hypnotique à la fois, nos trois lascars ont mis au point une combinaison particulièrement attractive qui, dès le premier album, frappe fort et juste. Aussi froid qu’il puisse faire dans leur pays d’origine, il se dégage de Gate 9 une énergie torride et solaire, dont je reste persuadé qu’elle est en mesure de déclencher des aurores boréales. Leur manière de réciter ce qu’ils appellent un « mantra of doom » pousse à se convertir au brahmanisme dans l’instant. Plus sérieusement, ce disque se situe dans un courant doom non dépressif. Lent et groovy. Un pur régal. Aussi agréable que relaxant.

Forts des critiques positives qui accueillirent ‘Gran Poder’ à sa sortie en deux-mille-six, la formation andalouse est de retour avec un nouvel opus qui pousse leur vice encore plus loin. Non-contents de persister dans un style plutôt difficile d’accès, le groupe y a ajouté quelques lignes de clarinette, de trompette et de contrebasse.
S’étalant sur une cinquantaine de minutes, les sept nouvelles compos qui garnissent cette plaque vont combler d’aise les fans de Boris et SunO))) et faire fuir les amateurs de rock plus traditionnel. On attaque dans le vif avec un titre très progressif intitulé ‘Con Sangre De Quien Te Ofenda’ qui s’inscrit quelque part entre le rock désertique de formations comme Ten East et les délires sous acides de groupes comme King Crimson. ‘Mesto, Rigido E Ceremoniale’ suit dans un style nettement plus abordable à première vue puisqu’il évolue dans un registre bien doom, mais quelques incursions dissonantes ayant plus à voir avec la musique expérimentale viennent désordonner cette plage pour lui donner un rendu un peu déconcertant.
On passe ensuite à un titre plus rock, Solemne Triduo’ qui, avec ses lignes de voix, nous offre quatre minutes de doom bien plombées. Deux brèves plages dispensables viennent faire le joint – une dans un style vent du désert, mais sans la reprise d’Ennio et la seconde à quelques encablures des œuvres écrites par le compositeur contemporain Dmitri Chostakovitch – avant le voyage résolument expérimental Templos’ qui évolue tout en légèreté avec ses touches de slide et de nappes synthétiques qui se posent avec volupté sur une ligne de basse entêtante.
Pour clore les hostilités, on assiste à un grand retour dans le doom bien couillu avec ‘Parte II. Apogeum’ qui est balancé avec force hargne : les guitares saturées graillent à fond, la basse attaque magistralement et les lignes vocales transpirent la rage. Un excellent titre bien brutal pour nous réconcilier avec un album quelque peu diffus.
Mon Dieu… Si je m’attendais… Le dernier album de COC est violent, brutal, aventureux, couillu… Et pourtant j’adore COC, mais leur virage plus “gentillet” (tout est relatif) abordé avec le pourtant excellent “America’s Volume Dealer” ne pouvait pas laiser présager un tel revirement de situation. COC est revenu énervé. TRES énervé.
Première écoute de l’album : “bon sang, mais qu’est-ce qui leur est arrivé ? Pourquoi Pepper hurle-t-il ainsi ?”.
Seconde écoute, passé le premier choc : “mais bon sang, COC s’est mis au stoner ??”
Et dès la 3ème écoute, on se prend déja à chantonner plusieurs chansons, déja engrammées dans nos petites cervelles…
Enfin, regagnons nos esprits, et parlons un peu de cet album. Le 1er titre “Stone breakers” porte bien son nom, tant les frappes de Stanton Moore (qui remplace Reed Mullin : pas en mieux, mais il s’en tire pas trop mal) martellent des caillases imaginaires que finissent d’entâmer des riffs massifs et incisifs. A propos de riff, on comprend bien vite le titre du morceau suivant, “Paranoid Opioid”, hommage (à peine) caché au grand Sabbath Noir : ce riff (simple et accrocheur) et ce son de gratte, le père Iommi ne les renierait pas… On passe ensuite à “Is it that way” (oui, celle qui figurait surla compil stoner “High Volume”, un peu remaniée ici) qui, avec sa rythmique lente et sa basse ronflante, rappelle quelques bons morceaux de doom (si si !). Hallucinant. Enchaîne ensuite un “Dirty hands empty pockets” absolument épique, et “Rise River Rise” au lick de guitare absolument infectieux, tendance orientale, une vraie réussite… Et hop, en 5 chansons, COC nous montre son potentiel en terme d’originalité et d’appropriation de genres qu’il met à sa sauce sans pour autant opérer de grand écart malheureux. Black Sab, Led Zep, Voivod, ZZ Top, Down, les sonorités passent et disparaissent sans jamais que l’on ne reconnaisse la “touche COC”.
“Never turns to more”, le morceau suivant, est du COC plus “classique” (tendance “gros metal qui tâche” quand même…), au même titre que “Infinite War” (avec Mike Dean au chant !) ou “World on fire” (un morceau que le groupe proposait déja sur la version japonaise de “America’s volume dealer”, ré-enregistré ici). On dirait ensuite que le jeune Ozzy (pas le légume actuel) chante sur “Backslider” ou “Crown of thorns”. Le tout se conclue par un “In the arms of God” qui commence par un tonnerre de batterie pour devenir un furieux baroud heavy.
Les musiciens sont fidèles au rendez-vous, Keenan confirme sa main-mise sur le groupe, avec des vocaux reconnaissables entre mille, et débitant les riffs avec une aisance remarquable, bien épaulé de Woody Weatherman, qui se fend occasionnellement de quelques soli somptueux de feeling (on dirait Billy Gibbons sur le solo de “Dirty hands…” !!). Mike Dean reste un bassiste génial, s’illustrant de manière remarquable par exemple sur l’intro groovy de “Dirty Hands…”.
Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins : après une semaine d’écoute à peine, In The Arms Of God est en train de remonter, dans mon estime, aux niveaux atteints par Wiseblood et Deliverance. C’est pas peu dire. Probablement le meilleur album de COC, et assurément l’une des meilleures sorties de cette année jusqu’ici. A se procurer sans la moindre hésitation.
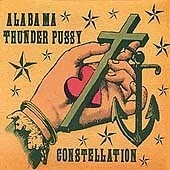 Encore un disque œcuménique. Celui qui réconciliera les hardcoreux de la ville avec les graisseux de la campagne. Evidemment, des deux parties, il en faut un qui fasse un pas en direction de l’autre. Le sens commun voudrait que le premier des deux soit le plus intelligent. Evidemment, je penche pour les ruraux. Je reconnais avoir été un peu désarçonné par mon tracteur à l’écoute de ce disque. Alors que leur dernier album laissait entrevoir une orientation heavy qui dégageait une forte odeur de Sud des USA, il émane de « Constellation » un esprit largement teinté de hardcore, soit, orienté plus au Nord. Oh bien sûr, on y retrouve toujours quelques titres à la Lynyrd Skynyrd ou Allman Bros, avec, comme eux, l’ambiance plutôt agréable du piano de saloon. « Ambition, Obsari, Fool Play et 15 minute drive » (magique) sont représentatifs de ce côté redneck très plaisant et original. « 6 shooter » incroyablement heavy, et « Negligence » sont plus représentatifs de ce qui faisait leur marque de fabrique sur le précédent album. Le reste, soit sept morceaux (plus de la moitié) sont comme je le disais plus haut d’obédience hardcore. Plutôt que de perdre mon temps à me demander stérilement s’il était vraiment nécessaire de faire un album aussi long, s’il n’aurait pas mieux valu virer sept morceaux (vous voyez lesquels), il me semble plus fécond de suggérer ceci : les ATP viennent d’inventer le heavy hillbilly hardcore. La démonstration est imparable et pour la renforcer encore, je vous suggère de prendre une carte des USA. Repérez New York, puis Tuscaloosa. Ok ? Richmond, ville dont sont originaires les ATP est coincée entre les deux. Mais plus près de New York tout de même. Et voilà.
 Je pourrais vous faire une chronique en deux mots (achetez le !!) mais attardons nous un peu plus longuement tout de même car c’est du bon, du tout bon, du Eddie Glass 100% pur jus, sans additif ni conservateur, fabriqué à l’ancienne (le premier titre est pourtant assez surprenant avec son arrière goût AC/DC assez prenant).
Après avoir quitté Fu Manchu, Eddie Glass et Ruben Romano formaient Nebula et sortait en 1997 leur premier EP (Let It Burn). L’expérience étant concluante, le groupe poursuit sa route en enchaînant deux séances d’enregistrements coup sur coup (dont une avec Jack Endino) qui permettront au groupe de sortir consécutivement deux autres EP.
Un peu comme Fu Manchu et son « Return To Earth 91-93 », Nebula décide de nous sortir « dos EP » qui, comme son nom l’indique, regroupe ces deux EP (sortis chez Meteocity et Mans Ruin à l’époque). Le groupe nous offre en bonus trois titres enregistrés trois ans plus tard et nous voilà donc avec un cd qui contient pas moins de onze titres, un album quoi !
Les onze titres ayant été enregistrés dans des endroits et à des moments différents, on peut être étonné de trouver autant de cohésion dans ce disque, preuve que l’identité du groupe est déjà bien enracinée. Cette homogénéité est d’autant plus surprenante que le niveau est très élevé. Chacun des onze titres est excellent et je cherche encore un point faible. On atteint parfois même la perfection avec Full Throttle (et son intro hallucinante). Chaque titre à une particularité, une sonorité, un riff, un truc, un je ne sais quoi qui le fait sortir du lot. Chaque titre sort du lot finalement.
Bref, que vous soyez fan de la première heure ou que vous veniez juste de découvrir le groupe, « Dos EP » est un investissement à mon avis indispensable. J’irai même jusqu’à dire que ceux qui possèdent déjà les deux EP peuvent acheter ce disque, ne serait-ce que pour les trois titres bonus.
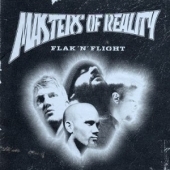 Masters Of Reality, ou Chris Goss si vous préférez, aura attendu pas moins de cinq ans pour nous donner un successeur au magnifique album live « How High the Moon ».Pour cela, il ne fait pas dans le détail puisque pour ce concert il s’entoure de John Leamy à la batterie, de Josh Homme à la guitare et de Nick Oliveri à la basse. Bien sur, un casting de rêve ne suffit pas car il faut avant tout que les différents talents s’accordent, mais ne tournons pas autour du pot, ici c’est même de fusion des talents dont on peut parler ! On pourrait jurer que ce concert a été enregistré au terme d’une longue tournée bien rodée, par un groupe jouant ensemble depuis des dizaines d’années tellement les chansons sont jouées à la perfection. La qualité d’interprétation est exceptionnelle et on est là en présence d’un album live qui fera date. Ajouter à cela une qualité de son particulièrement agréable à l’écoute et vous l’aurez compris, Flak’n flight est un « must have » comme on dit chez nos amis anglophones.Si vous ne connaissez pas Masters of Reality, pourquoi ne pas découvrir ce groupe formidable grâce à ce superbe album ou un autre d’ailleurs.
 Fondé en deux-mille-un, cette formation suédoise propose un rock très orienté hard hérité des années quatre-vingt qui me rappelle en vrac Borgo Pass, Mustasch, The Quill, Honcho ou Spoiler par certains aspects de leurs compositions et de l’exécution de celles-ci.
Très facile d’accès à mes yeux, cette production qui sera suivie d’ici peu du deuxième volume, s’étale sur près d’une heure pour onze compos dont une reprise de ‘In-A-Gadda-Da-Vida’ d’Iron Butterfly.
Assez aérienne dans son ensemble, outre la cover citée plus haut qui est nettement plus plombée, cette galette est nettement dominée par les riffs des guitares et les chants heavy. La section rythmique sort parfois de sa réserve sur certaines plages plus lentes et nettement plus originales comme ‘Dragged Down’ et ‘Sin Of The Century’ le plus long morceau au menu de cette sortie.
Les nostalgiques de Kiss se contenteront des deux premiers titres qui ne me touchent guère avec leur touche très ripolinée et ceux de Soundgarden devraient être touché par ‘Deep Water Black’ dont le côté sombre est particulièrement abouti. Nettement plus fuzz, ‘Space Mammoth’ ainsi que l’imparable ‘Superseded’ sont les titres qui m’ont le plus séduit sur cette première production du quatuor scandinave qui s’est déjà produit sur scène avec des groupes aussi différents que Tool, Motörhead, Danko Jones, Opeth et Soilwork.
Je me réjouis de pouvoir mettre la main sur la suite de leurs aventures discographiques qui devraient débarquer sous peu.
 Rouge. Rouge sang. Ce disque constitue l’écoulement organique le plus saisissant du moment. Ces trois sujets de la Couronne d’Angleterre ont signé de leur sang un pacte avec le Diable. Vont-ils ramasser un max de brouzoufs ? Devenir célèbres ? Probablement pas. Non, leur deal à eux c’est de pouvoir distiller le ‘Maximum riff mania’. Ce power trio se saigne pour nous le procurer. On se gargarise de ce sang/son lourd et épais. Il a un goût qui rappelle celui des Who, des Grand Funk, voire de Sabbath. Un goût de fuzz. Noble. Racé. De celui dont on fait les Souverains. On saisi mieux, à l’écoute de ce disque somptueux en tous points, que les riffs ont une couleur. Un riff, c’est rouge. Pourtant, malgré ses atours revigorants, ce groupe porte en lui une dimension dramatique. Hérauts d’un rock tel qu’il se ciselait à la fin des sixties, ils sacrifient leur place de winners des temps modernes sur l’autel du vintage. Enregistrent leur disque en analogique (défendant ainsi la plus haute idée que l’on puisse se faire de l’enregistrement). Portent des fringues et des coupes de cheveux rétro. Ils sont magnifiques. Des rebelles des vrais. Ce disque EST le rock’n’roll. Plutôt que d’attendre qu’ils se vident de leur sang, exsangues, offrons leur le nôtre de manière à ce qu’ils puissent continuer de nous régaler à ce point. Leur force vitale est la nôtre. Soutenons-les.
|
|