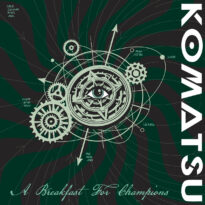|
|

Tiens, un nouveau groupe de stoner doom… Les plus avertis auront en réalité suivi les circonvolutions de ce projet étrange depuis quelques années, initié dans une démarche expérimentale et dénuée de toute ambition, en termes de carrière en tout cas. Derrière cette hydre à trois têtes (!) se cache surtout l’initiative d’un grand activiste de la scène rock underground protéiforme de Los Angeles, Collyn McCoy (ex-bassiste associé à la démarche solo de Ed Mundell, bassiste actuel de Unida, initiateur de nombreux projets, bassiste/contrebassiste renommé). Choisissant de s’emparer de la guitare (et du micro), il s’associe notamment à son amie Mariana Fiel, par ailleurs bassiste de High Priestess. Le résultat ? Probablement la rondelle de stoner doom la plus enthousiasmante depuis fort longtemps.
La démarche est complètement débridée, ne s’embarrasse pas d’une vision trop rigoriste et castratrice du carcan trop conventionnel de ce genre musical (les codes, le respect, la tradition, l’héritage…), tout en s’inscrivant dans un faisceau d’influence complètement assumé, rigoureusement appliqué. Dans une démarche tout à la fois premier et second degrés, le groupe reprend à son compte tous les marqueurs du genre, les exagère, les digère et les recrache sur vinyl : le nom de groupe (« le sorcier de la vape »…), les surnoms/alter ego des musiciens (le compte, la duchesse, le baron), les inserts sonores de bruits de bong (et autres samples d’incantations ou vocaux très… inspirants), les titres de chansons (« Satan’s Succubus », « Meth Slave », « Bongmaster General »…), le titre du disque (traduisible par « … et je fabriquerai mon bong à partir de son crâne »), etc… Tous les ingrédients sont là (et encore, ils vous ont épargné le glorieux artwork initialement prévu…).
Dès les premiers tours de piste de ce sinistre objet, le premier sentiment est celui qui devrait naturellement émaner de tous les bons disques de stoner doom : le dégoût, évidemment. Le son est honteusement sale, la prod est rudimentaire (on dirait une vilaine démo, et le mastering n’aide pas), le chant est glaireux, la guitare et la basse s’emmêlent la plupart du temps de manière indistincte dans les mêmes riffs baveux… Bref, du bonheur en rondelle. Ça joue lent, très lent, les titres sont longs et se traînent de manière indécente (cinq titres / 42 minutes, on est bien), ça fait tourner les riffs jusqu’à l’absurde…
Les riffs, puisqu’on en parle, ne sont pas en reste : le trio s’inscrivant bien dans l’école du stoner doom traditionnel (un riff = une chanson), il a soigné ce point, proposant de belles pièces à briser des nuques. Côté compos, donc, on est assez loin de l’indigence : même si parler de « soin » apporté à l’écriture peut apparaître un peu abscons (au vu de la teneur bien foutraque de l’objet), on ne peut s’empêcher de noter de véritables petits trésors d’écriture stoner doom, avec des riffs absolument dévastateurs, donc, mais aussi des plans plus audacieux, qui rendent l’ensemble jamais ennuyeux. On mentionnera aussi quelques artifices de production, comme l’incorporation de passages en chant clair (le refrain étrange de “Bongmaster General”), de plans de synthétiseurs complètement saugrenus (l’intro du morceau-titre, doublée par une sorte de kazoo électronique ridicule… qui s’intègre parfaitement !), etc…
Dans tous les cas, étayer plus avant la démonstration est vain : ce disque est fait pour les profonds amateurs de stoner doom, capables d’appréhender l’intégrité et le respect du style, mais qui savent aussi apprécier un état d’esprit plus léger, voire potache. L’humour se mêle en continu à ce stoner doom âpre et sordide, pour un mélange aussi inédit que délectable. Un bonheur pour amateurs éclairés, une horreur pour le grand public.
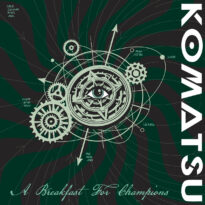
C’est la tête basse que nous avons constaté que depuis quelques années nous vous avions pas parlé de Komatsu. Mais redressons le museau, truffe au vent : nous avons capté le dernier opus du (désormais) trio batave (la dernière fois que nous vous en avions parlé, ils étaient encore quatre). Ce groupe, flaggé pur stoner et patate musicale, sort donc un album au sobriquet de A Breakfast For Champions. Outre une équipe resserrée on aura aussi noté au passage le changement de chef de la brigade Komatsu, passé sous la responsabilité de la prod multi étoilée Heavy Psych Sounds. On espère donc en passant à table se retrouver avec l’estomac bien plein et les sens ravis en fin de service.
On retrouve vite ses petits, pas de doute c’est bien du Komatsu qu’on a sur la table, gros blasts de “Fatcamp Workout”, acidité de “Welcome to The Underworld”, la gratte ne fait pas dans le détail et ne laisse pas beaucoup d’occasions de s’appesantir. Elle est grasse et agressive, juste ce qu’il faut pour insister sur le qualificatif stoner de la musique du trio. À côté de ces six cordes, la basse, omniprésente sur chaque morceau, sonne aussi profonde qu’une de ses contre-homonymes sous-accordée. “A Breakfast For Champions” ou “What Lies Underneath” suffisent à se convaincre qu’elle est le marteau qui enfonce le clou de la musique de Komatsu. Il ressort de cette association des cordes que l’ensemble ouvre la voie à des titres comme “Climb The Vines”, qui vient clore A Breakfast For Champions avec l’apport en vitamines nécessaire pour bien commencer la journée.
On passe le brunch avec une voix traînante et gavée d’écho, qui vient taper quelque part entre un poussif Monster Magnet et les morceaux les plus calmes de Duel. Mais ne nous y trompons pas, c’est bien le produit d’une gamelle composée de rigoureuses mélodies et saupoudrée d’une juste pondération de la présence instrumentale.
Malgré un enthousiasme moins saisissant avec un “What Lies Underneath” moins aromatique, il faut admettre que les fioritures qui émaillent la galette tombent à point nommé. Que ce soit la clochette sur “The Devil’s Cut” ou le solo typé prog de “Savage”, peu de choses viennent contredire le rouleau compresseur de la section rythmique.
On sort de table avec juste ce qu’il faut de lourdeur digestive pour se dire que A Breakfast For Champions est un album de qualité, et que la pelletée de riffs qui le compose doit nous inviter à garder Komatsu en ligne de mire. Rien qui ne soit d’une finesse folle, mais au final un brunch comme on les aime : de bon aloi et service compris.

Avec sa vingtaine d’années d’expérience maintenant, Lo-Pan peut être considéré comme un groupe « vétéran » du stoner américain. Né sur les cendres à peine refroidies de cette scène en ébullition sur la fin des années 2000, il ne s’en est toutefois jamais complètement revendiqué, s’inscrivant plutôt dans une veine musicale largement emmenée par le génial label Small Stone records. Constituée de groupes de metal / heavy rock solide et fuzzé, pour la plupart issus de la scène – hérésie – du Nord des U.S.A. (et en particulier Nord-Est), portés par des influences qui couvraient un large éventail : allant du stoner californien jusqu’au grunge en passant par toutes les nuances charpentées du gros rock US, cette vague aura laissé pas mal de cadavres sur le bord de la route sur les deux dernières décennies. S’il est l’un de ses survivants, Lo-Pan n’est pas pour autant un hyper-actif musical, avec une discographie famélique, et des tournées rares. La sortie d’un nouvel opus de leur part est donc en soi un événement.
La recette Lo-Pan est inchangée, et c’est tant mieux : pour simplifier à outrance, ce mélange d’un socle musical puissant avec la voix de Jeff Martin apporte une identité si marquante qu’il est absolument inutile de développer un registre différent. Dans ce cadre Get Well Soon, comme on pouvait s’y attendre, s’inscrit dans une sorte d’amélioration continue de leur style, une maîtrise encore une fois réaffirmée sur ce sixième opus. Pour rentrer un peu plus dans les détails, en particulier pour celles et ceux qui ne connaissent pas le quatuor de Columbus, Ohio, attendez-vous à un ensemble de compos soignées mais costaudes, reposant sur une solide alchimie entre riffs massifs, breaks ambitieux et sens mélodique prépondérant. Mais le facteur X du groupe, l’élément qui émerge inéluctablement dès les premières secondes d’écoute, c’est le chant de Martin : l’imposant vocaliste développe littéralement une voix d’ange dans un environnement (musical) de brute. Son chant, clair, aérien, subtil et puissant à la fois, surnage non seulement dans le spectre musical du disque, mais emmène surtout les compos déjà excellentes du groupe dans des sphères musicales que les autres formations ne peuvent pas atteindre (parce qu’il n’y a qu’un seul Jeff Martin, tout simplement).
La recette Lo-Pan, donc, est inchangée, reste à appréhender cet assemblage de chansons. Les neuf titres proposés ont le bon goût de présenter le quatuor sous toutes ses coutures, avec un échantillon de rythmes et de sons qui, s’ils restent évidemment dans la trame instrumentale du groupe cultivée depuis vingt ans, couvrent l’ensemble de ses « compétences ». On a du refrain mémorable (« The Good Fight » et son petit lick de guitare catchy, « Wormwood » transcendé par Martin), des leads tranchants (impeccable séquence sur « Rogue Wave », « Stay with the Boat »…), des plans accrocheurs (« Ozymandias » et son petit pattern de guitare aux accents sudistes comme les affectionne Clutch)… Quant aux performances de Martin, si l’on devait en rajouter une couche, il suffit de voir ce qu’il apporte à des titres comme « God’s Favorite Victim », « Wormwood » et ses modulations parfaitement efficaces, ou encore « Harpers Ferry », apportant une ligne vocale qui vient se caler tout du long, comme un instrument en tant que tel, développant parfois son propre apport mélodique en complément de celui de la chanson. Et côté riffs, on est (bien) servis aussi (on vous orientera sur un petit échantillon pas piqué des vers avec par exemple “The Good Fight”, “Wormwood”, “Harpers Ferry”, “Stay with the Boat”…). Pièce maîtresse du disque, « Six Bells » vient le clôturer sur huit minutes de séquences aussi intéressantes les unes que les autres, passant de plans sombres et doom lents, à des passages plus rapides et plus dynamiques ; le titre nous prend par la main et nous emmène où il veut sans jamais nous brusquer, ni non plus en faire des tonnes.
Attention toutefois, par sa densité musicale et instrumentale, par ses choix d’écriture atypiques (en termes de structure notamment) ainsi que par son positionnement musical jamais franc (Lo-Pan finalement évolue dans un style qui lui est propre), l’absence de repère rend la digestion du disque plutôt lente : si le style musical séduit assez vite, il faut un bon nombre d’écoutes pour intégrer les compos, les mélodies et cerner les touches de grâce qui émaillent finalement ce disque. Mais l’effort est largement récompensé par la profondeur de ce Get Well Soon qui, sans jamais être prétentieux ni exigeant, vient faire honneur à la discographie du groupe, et au genre musical au sens large.

Après le confidentiel « Delirious Rites » en 2023 et le remarqué – ainsi que remarquable – « Amber Eyes » en 2024, le trio fleurant bon l’eau de Cologne se rappelle à notre bon souvenir en balançant « Sub Rosa » au rayon frais de votre disquaire préféré. Incarnant merveilleusement bien la bonne santé de la scène rock teutonne militante, le trio de Rénanie-du-Nord-Westphalie aligne les sorties ainsi que les apparitions – toujours délicieuses – bien placées sur les scènes des principales manifestations européennes dédiées aux registres musicaux en orbite autour du stoner.
Engagée politiquement et vindicative sur les planches, la formation allemande se positionne clairement dans un univers musical souvent fort éloigné de ce type de considération exception faite de Valient Thorr qui firent figure de loups solitaires durant de longues années. Antifasciste et féministe, Daevar poursuit la longue tradition de la scène underground germanique militante et cette dimension secoue un peu une certaine neutralité dans le propos de la scène stoner pourtant constituée par des musiciens très clairs au niveau de leurs positions rarement neutres (hé oui c’est le cas).
Musicalement, le groupe de Cologne se colle les étiquettes : doom, stoner et grunge ; tout un programme autour de la lourdeur en fait. Noire, sombre, psychédélique, lourde ainsi que lente, la musique déployée est propice à toucher un large public de rockeuses ainsi que de rockeurs de tous poils (voire chauves) amateurs de vocaux féminins aériens et délicats qui viennent se poser sur des riffs plombés et des rythmiques de pachydermes en rut.
Peu de surprise avec « Sub Rosa » qui reprend les ingrédients, les marqueurs et la recette déjà éprouvée par ces Allemands pour mettre en orbite 7 nouvelles compositions pour un peu plus de trente minutes, mais un plaisir certain de se repasser ces 7 nouvelles compositions qui évitent le piège du troisième album avec un brio certain. Il faut dire que malgré la jeunesse certaine du combo, il y a un putain de level question technique ainsi qu’au niveau de la qualité des compositions. « Mirrors » est une démonstration du genre : un mur de guitares distordues bétonné par une rythmique impeccable servent d’écrin à des vocaux éthérés presque mécaniques qui se déploient lentement et très lourdement avant un solo overdrivé bien senti qui répond durant un second temps aux chants soutenus par des coeurs ; c’est imparable et la nuque ne peut rester immobile sous ces coup de boutoirs brutaux.
Des premières mélopées sur fond de basse déployées par Pardis Latifi sur l’ouverture « Catcher In The Rye » aux larcens marquant le point final de l’album sur « FDSMD », les Germains nous entraînent dans une succession de titres à la fois oppressants et captivants menés à la baguette par le métronome Moritz Ermen Bausch – à la batterie – qui nous joue d’intéressantes partitions notamment sur le très grungy « Daughter » empreint de changements de rythme bien sentis. Le grunge est aussi perfusé sur le missile « Siren Song » qui rappelle agréablement Soundgarden de la grande époque avec une déclinaison à la guitare par l’orfèvre Caspar Orfgen qui vient se superposer au mur déployé par lui-même afin d’apporter un côté dissonant de derrière les fagots.
Bref, Daevar ne révolutionne pas Daevar avec ce troisième opus réunissant les mêmes protagonistes auprès de la même écurie, mais Daevar évolutionnne Daevar avec un troisième album d’excellente facture qui tape très juste et bénéficie d’une production au poil pour le registre musical dans lequel s’inscrivent les Allemands. Je vous conseiller vivement d’aller jeter une oreille attentive sur le concis « Wishing Well » qui synthétise en 3 minutes et 4 secondes toutes les qualités de ce nouvel épisode dans les tribulations musicales de la triplette de Cologne.
Point Vinyle :
Qui achète encore de la musique physique en 2025 ? A part moi, il doit exister un marché puisqu’outre le digipac de circonstance, cette production est gravée dans des vinyles aux couleurs aléatoires. Etant daltonien et la proposition peu prolixe quant aux déclinaisons question colorimétrie, je vous envoie avec plaisir vers les bandcamp du label ou du groupe (ça tombe bien, générosité oblige : il n’y a qu’à cliquer ci-dessous pour écouter la chose ainsi qu’en savoir un peu plus sur les fameuses rondelles). Faites vous plaiz les enfants !

Si le stoner fait souvent écho aux déserts arides et aux ambiances chaudes, c’est bien souvent du nord de l’Europe, bien plus au nord, que nous arrivent les bûches les plus brûlantes. Rien de mieux pour imager cette phrase d’introduction que les finlandais de Kaiser et leur second album intitulé 2nd Sound. Il est presque étonnant de voir les finnois resurgir car les nouvelles étaient rares, malgré un bon et déjà chaud premier album sorti en 2018, 1st Sound, et un split avec Planet Caravan estampillé Turned to Stone en 2022 (responsables entre autre des associations Merlin/Wizzerd ou encore High Desert Queen/Blue Heron).
Passons rapidement de l’étonnement à la joie de retrouver le stoner nerveux de Kaiser. Car oui 2nd Sound reprend exactement là où le groupe nous avait laissé en 2018, c’est-à-dire avec une énergie bouillonnante et une pelletée de gros riffs ! Mise en situation dès le premier titre “Brotha” qui colle à cette description jusqu’à ce gros break à mi morceau qui va donner sa couleur à toute l’album. C’est comme si tout d’un coup on se mettait à écouter en simultanée un album de Lowrider, d’Elephant Tree et de Sleep !
Vous en redemandez ? Parfait ! C’est exactement là où nous emmène 2nd Sound qui enchaîne les uppercuts avec des titres comme “1,5 Dozen”, “Awaken Monster” ou “Meteorhead”. Le groupe déploie une puissance sonore et un groove assez impressionnants, flirtant régulièrement avec le stoner/doom, et l’allie parfaitement avec ce rythme plus old-school qui donne envie de retourner son salon ou le wagon du métro. Forcément les guitares brillent par la qualité des riffs et solo mais ce serait une grave erreur de ne pas mettre en avant le duo basse/batterie au vu des dégâts qu’ils causent tout au long de l’album sur nos tympans. Impossible aussi de passer outre la qualité du chant qui vient se caler avec brio sur ces 50 nuances de stoner. Tantôt John Garciesque, Tantôt hurlé, voire un peu plus, sur les passages les plus ardents, il sait aussi se faire envoûtant sur les ambiances à la Monster Magnet de “Stood Still” ou proche d’un Chris Cornell sur “Oversized Load”.
Au milieu de cette tempête viennent se caler de malins moments plus calmes, plus groovy, comme cette intro de “A Clockwork Green” ou les passages plus rock de ce même morceau ou de “Brotha”. Ces parties, en plus de nous autoriser une brève reprise d’air, servent surtout à mettre encore plus en avant les massives lignes de basse et riffs qui nous pètent à la gueule jusqu’à cet “Aftershock” qui résume parfaitement les 45 minutes de bonheur/sueur que l’on vient d’encaisser avec un bonus lourdeur comme si les finlandais mettaient toutes leurs forces restantes dans la bataille.
Difficile de bouder son plaisir devant ce 2nd Sound qui ravira les paresseux comme les amateurs de duels en fosse ! Il ne reste plus qu’à espérer que Kaiser passe prochainement près de nos contrées pour défendre cet album, et surtout à espérer que l’on aura un nouveau parpaing à se mettre dans les dents sans attendre 7 ans !

Caboose, voilà un nom bien trouvé pour ce jeune groupe de Stockholm. Caboose (la cambuse en français), c’est un wagon de queue. Les quatres mecs derrière ce blaze se positionnent sur le créneau du stoner 90’s pour sortir leur premier album, Left For Dust, avec le soutien de Majestic Mountain Records. On aurait pu passer à côté de l’écoute, mais, habitués aux bonnes prods de Majestic, on a poussé la curiosité jusqu’à l’écoute. Et comme vous le savez, si on a décidé d’en parler, c’est qu’on n’a pas été déçus.
L’auditeur doit tout de même être averti qu’avec Left For Dust, on n’empruntera pas des chemins d’une folle originalité. On s’aperçoit vite, une fois passé le très indie “High On You “d’intro, que Caboose a poncé ses classiques du stoner californien, et en particulier Fu Manchu et Nebula. D’ailleurs, à ce sujet, “Cement Surfer” est presque confondant de similitude, et les inflexions vocales de “Feedback City” ne font qu’enfoncer le clou.
Alors, les grincheux passeront peut-être à côté de Left For Dust, mais ils y perdront une galette bien faite et à l’écoute flash (même pas 30 petites minutes). Quelques riffs méritent qu’on s’y arrête plus d’une fois, notamment ceux de “Spacerod” (au passage on s’amusera des respirations du chant qui sont quasi celles de Scott Hill) ou encore les arpèges de l’introduction bluette de “For So Long”, avant que cette même piste ne joue ce que la Scandinavie a de plus joyeux mais lourd. Une particularité que l’on retrouve souvent chez nos voisins du Grand Nord : un heavy mélodique et bienveillant, où l’on peut se laisser aller, le sourire aux lèvres, comme c’est le cas ici avec “Sophie’s Sushi Wok”.
C’est sans doute ce qui fait que Left For Dust fonctionne si bien. Un brin de nostalgie pour les grandes années stoner, une admiration à visage découvert pour ce que la West Coast a fait de plus cool, une méticulosité indéniable et une volonté de s’adonner à un plaisir simple mais efficace. Voilà, c’est dit : Caboose livre un bon album avec ce premier Left For Dust, et il n’y aura rien de coupable à s’en fourrer plein les esgourdes.

La vague est lancée.
Dans le sillage d’un Slift amiral et de ses envolées pleines de wha-wha et de réverb, navigue une flotte de pêcheurs prête à se sacrifier au Dieu Psycheidon.
Aux Karkara et autre Stronger than Arnold vient s’ajouter The Baptized, trio Lillois coupable cette année d’Exilion, premier long format capturé en prise directe.
Huit titres instrumentaux à l’orée du heavy-psych et du space-rock. En sous-régime quand la guitare narre un peu trop son propos, la musique de The Baptized prend tout son sens quand les musiciens s’octroient des plages de liberté.
Arpèges sur “Jerry’s escape” ou riffing à la limite de la noise sur “La Malterie”, l’alchimie opère quand les trois musiciens s’écoutent et tissent d’égales intentions. L’objet est déroutant car il peut tout autant nous emporter dans de délicates et éthérées ambiances que nous perdre par le truchement de soli un poil longuets.
On est tout de même curieux d’écouter ce que The Baptized sera capable de nous offrir par la suite, tant cet Exilion regorge de bonnes idées et de petites trouvailles intéressantes. Avec une production plus égale et massive, un propos plus précis, nul doute que les lillois feront mouche !

Portant une livrée passable (coté pochette, on est pas sur l’arwork du siecle), Nightstalker, le quintette thessalonicien dans la fleur de l’âge (30 berges tout de même), revient avec un album que l’on espère un peu supérieur à son prédécesseur, qui n’a pas bien résisté à l’épreuve du temps (6 ans déjà). Return from the Point of No Return sort une nouvelle fois chez Heavy Psych Sounds et il nous tarde de découvrir ce que ce jeunot a encore à offrir à une scène stoner qui, à vrai dire, ne lui rend sans doute pas toujours hommage, bien qu’une frange d’auditeurs, sous le charme, constitue une fanbase indéfectible, attendant cet opus la bave aux lèvres.
Nightstalker ouvre avec le tonitruant “Dust”. Un retour fracassant aux affaires ? Une remise en jeu du coup de poing façon Dead Rock Commandos ? Encore quelques pistes et on sait que non, il n’en sera rien. Alors, quoi ? La redite de The Great Hallucinations, un album tout en modération ? Peut-être bien, si l’on s’en tient à “Heavy Trippin'” ou “Shipwrecked Powder Monkey”. Mais la vérité, comme toujours avec Nightstalker, se situe quelque part entre ces deux mondes.
Return from the Point of No Return contient tout le sel du groupe, avec pour banger le titre éponyme qui marquera l’esprit de l’auditeur grâce à ses riffs gras et sa rythmique enveloppante. Puis c’est “Shallow Grave” qui prend la suite. Ce morceau, qui dans un premier temps se rapproche plus du blues que du rock, joue sur le velouté de la basse d’Andrea. Sa seconde partie ensuite valorise la guitare de Tolis qui vient ajouter ses gémissements à la piece. Cette fluctuation nous incite même à augmenter le volume pour un pur instant de plaisir. Les mecs confirment en deux titres que le groupe n’a rien de manichéen.
Return from the Point of No Return est une véritable plaque de Nightstalker, qui puise sa force autant dans ses faiblesses – la voix éraillée d’Argy, la mise en retrait de la guitare là où elle pourrait enflammer – que dans ses qualités – un sens aigu de la distorsion, un groove implacable et un storytelling qui touche juste.
Du tambourin de “Flying Mode” au final déjanté de “Return From The Point of No Return”, du riff parfait du pont de “Shipwrecked Powder Monkey”, aussi massif et attractif qu’une supernova, au groove implacable de “Falling Inside”, on ne peut que saluer l’équilibre d’un album, toujours fourmillant de mille astuces, qui viennent titiller l’oreille de la plus belle des manières.
On ne peut qu’espérer voir ces nouveaux titres enrichir les setlists de Nightstalker. On ne prend pas grand risque à dire que la puissance du live donnera un essor encore plus grand à des morceaux comme “Dust”, “Uncut”, ou même le plus posé “Heavy Trippin’”. Return from the Point of No Return ne sera peut-être pas le nouvel album phare de Nightstalker, mais plus probablement celui que les fans pouvaient espérer : un album syncrétique, un condensé de trente années de sacerdoce au service du rock.

Qu’il est difficile de définir Warlung en quelques mots. Comme un OVNI dans la scène stoner, le groupe produit depuis maintenant 4 albums une musique aux allures d’un funambule fou bondissant sur plusieurs câbles, ne se souciant guère du gouffre chaotique dans lequel il pourrait tomber. Stoner, Doom old school aux relents occultes, Heavy, Hard Rock, voici grosso modo tout ce que l’on peut retrouver chez ces texans avec en bonus une tendance à éparpiller une dose de psyché sur toutes ces influences. 2 ans après un réussi Vultures’s Paradise, le groupe revient avec un cinquième album intitulé The Poison Touch et autant vous dire que nous étions aussi curieux qu’heureux de revoir ces étranges acrobates !
Avec The Poison Touch, Warlung pousse encore un peu plus loin la fusion de ses influences. Et pourtant, on se laisserait penser qu’avec des titres comme “Digital Smoke”, “White Light Seeker” ou “Rat Race” le groupe nous quitte définitivement vers un monde plus heavy speed… Trahison alors ?! Pas vraiment, même si le fait d’apprécier les envolées heavy à la Enforcer aidera à savourer pleinement l’album, car derrière cette ardeur se cache un monde bien plus dense où refrains rock bien catchy viennent côtoyer riffs sabbatiens et rythmes stoner.
Saillant et gentiment occulte par endroits, psychédélique et avec un vrai sens de la mélodie ailleurs, l’album pourrait se situer à mi-chemin entre Green Lung et Kadavar. Un petit plus pour ce dernier sur le chant qui fait vraiment penser à Lupus (notamment sur ces fameux refrains). On ressent particulièrement les ambiances plus psychédéliques sur l’astucieuse transition “Mourning Evil”, qui vient couper un élan heavy presque épique, ou sur “Spell Speaker” avec son intro qui finit loin dans l’espace, son ambiance plus doom moelleuse et son solo de guitare déchirant (qualité que l’on retrouve sur chaque solo de l’album au passage).
Comme une cerise sur un gros layer cake, “29th scroll, 6th verse” nous offre le moment, le riff, la grosse bûche que l’on attendait (avec en bonus, une petite référence à la planète des singes). Morceau presque frustrant car on aurait quand même apprécié un peu plus de cette épaisseur stoner, mais difficile de faire la fine bouche au vu de la qualité technique et mélodique de The Poison Touch. Encore une fois, Warlung aura réussi à nous emmener dans son univers multicolore, dosant avec justesse ses influences pour rendre une musique originale et fraîche dans un monde où parfois les choses ont trop tendance à se ressembler. Bref, cette touche de poison est des plus délicieuses, on en redemande !

Traçant son chemin dans une attitude underground (!) depuis une dizaine d’années maintenant, Year of The Cobra en est à son troisième album, un disque que l’on attendait avec impatience après avoir en particulier beaucoup apprécié Ash and Dust, un disque mal né (2019, salut l’année COVID !) et certes imparfait, mais plein de bonnes idées… et de promesses ? Quoi qu’il en soit, 6 années sont passées, et même si ce nouveau disque sans titre a été enregistré il y a un an, il ne sort que maintenant (dans une « fenêtre d’écoute » plus favorable que la redoutable année 2024).
Dans l’intervalle, Amy a largement contribué (en tant que chanteuse, puis chanteuse-bassiste) au projet Slower initié par Bob Balch – projet qui, s’il n’a pas suscité un enthousiasme démesuré, a permis à un public différent de se familiariser avec le très intéressant timbre vocal de la chanteuse.
Résolument duo, YOTC, composé de Jon (batterie) et Amy (chant, basse) – mariés à la ville, fin de l’instant people – a, sur une petite décennie, construit son style musical sur une assise bien plus large que le doom expérimental perçu sur ses premiers tours de sillons à l’époque. Au vu de la composition instrumentale du combo (un duo… vous suivez ?), et du fait de l’ambition stylistique qu’il porte, le son développé est crucial, et à ce titre, la production du disque est redoutable. Sans artifice ni chichis, le spectre sonore est parfaitement exploité, pour chaque chanson, avec des aérations ici ou là selon le style de certains titres, et à l’inverse un mur de son en béton armé sur les titres les plus massifs. Tandis que le jeu de Jon marque bien le style du groupe, sa frappe « charpentant » chaque titre, le jeu de basse d’Amy vient absolument dessiner chaque compo, lui inspirant évidemment la trame mélodique, mais aussi le spectre de puissance visée, avec une diversité de sons parfaitement à-propos. Evidemment, on a du mal à imaginer certains plans retranscrits à l’identique en live – c’est aussi la magie d’un enregistrement studio – mais en étant parfaitement honnêtes, on n’entend jamais de « triche » et à l’instar d’un Mantar dans un style bien différent, ils jouent la carte du duo avec intégrité et goût du challenge.
En outre, la production depuis Ash and Dust s’est améliorée, certes, qualitativement, amenant aussi le son du groupe vers quelque chose d’un peu plus propre, ce qui pourrait décevoir certains intégristes résolus.
Côté compos, l’assortiment proposé ne tombe jamais à côté (il y avait quelques titres plus faibles que d’autres sur son prédécesseur), offrant à l’écoute un ensemble diversifié mais solide. Stylistiquement, le groupe incorpore toujours quelques bonnes rasades doomy (« Full Sails », « The Darkness », « Sleep »…) mais en bons Seattelites n’hésitent pas à se prévaloir d’un certain héritage grungy (« 7 Years », « War Drop »…). Pour le reste on est sur une tendance heavy où les plans sludgy sont tout aussi présents, avec des passages psych, presque pop parfois dans le travail mélodique très catchy (le chant d’Amy se prêterait bien à des passages aux confins du trip-hop – facile de se projeter via par exemple le couplet de « Daemonium »). Même le presque-indolent « Prayer », tout en lancinance mélodico-émotive (!) déroule posément pour conclure le disque avec légèreté.
Sans ambigüité, si ce n’est pas l’album le plus direct et « brut » de YOTC, ce troisième album est probablement leur meilleur, en premier lieu au regard de la qualité d’écriture démontrée, et de sa mise en son, propre et impeccablement appropriée aux ambiances développées. Ainsi armé d’une belle galette sous le bras, espérons que le duo puisse développer son activité scénique, n’étant pas habitué des grosses tournées, et encore moins en Europe. Puisse cette situation évoluer en ce sens pour voir le duo prendre enfin un essor mérité.

Möuth est un jeune trio suédois, sans signe particulier en apparence, en activité depuis moins d’un an, sortant un album à l’artwork un peu clichesque, sur un label tout à fait confidentiel… Dans un monde normal, la probabilité que l’on accorde plus de 5 minutes à un tel cas est extrêmement faible. Pour autant, l’alignement des planètes fut favorable… et le talent du groupe a fait le reste.
En droite provenance de Stockholm, Fredrik Aspelin, Erik Nordström et Martin Sandström (so cliché) se sont rassemblés derrière ce sobriquet à tréma, et moins d’un an plus tard, direct, ils ont enregistré ce disque. Quelques concerts ici ou là, dont un Duna Jam, et Paf ! Un album. 40 minutes, huit morceaux et demi – limite prétentieux, les jeunes. Enfin « jeunes » : en grattant un peu cette image d’Epinal, on comprend que les musiciens sont en fait de vieux amis, qui sont plus proches de la quarantaine que de la vingtaine, et qu’ils ont tous traîné leurs guêtres dans plusieurs formations suédoises, peu connues toutefois. Möuth se veut donc un vaisseau de leurs intentions musicales convergentes, une plateforme leur permettant de mêler leurs appétences et un soucis d’efficacité, les années et l’expérience aidant.
Il ne faut pas attendre longtemps avant de déceler qu’on a là quelque chose d’atypique, et finalement d’extrêmement qualitatif.
En revanche, la musique du trio est difficile à décrire simplement : les pieds sont bien ancrés dans une base de heavy rock assez énergique, avec des emprunts assez massifs à tous les sous-genres du stoner, du psyche, voire du grunge ici ou là… Tandis que le socle musical est très instrumental, le chant de Nordström vient apporter un élément bien distinctif à la musique du groupe… avec des passages parfois un peu nasillards (« Mantra » par exemple) qui pourront en première approche déstabiliser un peu. Mais globalement, le bonhomme sert bien les compos, ses lignes de chant s’appliquant efficacement et sans outrance à des sections où l’instrument se sert quand même la part du lion : une structure rythmique riche qui sait délivrer de bonnes portions de groove lorsque nécessaire, et des plans de guitare en apport mélodique à la rythmique, ou via des leads efficaces et sans outrecuidance.
Sur le papier, c’est du vu et revu maintes et maintes fois, ça donne pas forcément envie. Mais à l’écoute, il se passe quelque chose : non seulement ce disque est blindé de petites perles de composition complètement addictives, mais il est traversé de véritables moments de grâce. Au rayon efficacité, difficile de faire mieux que « Holy Ground » : gros riff nerveux (5 notes de musique, la base), refrain court et percutant, break / leads avec solo flamboyant mais pas flambeur en final… Du travail d’orfèvre. Parfois, le trio se pare de ses plus beaux atours psyche, allant jusqu’à se vautrer dans des plans aux confins du kraut rock, pour un résultat absolument impeccable (« Dirt », le remarquable et léger « Alike » qui convoque les groupes de kraut old school mêlé à des reflets presque… surf rock, puis garage rock !). On ne détaillera pas chaque titre, chacun apportant une nuance supplémentaire à un disque qui n’en manque pas, mais on pourra zoomer sur probablement le point culminant de ce disque, « Sheep » : sous ses atours de mid-tempo un peu dark, le titre se dévoile sur sa dernière moitié toute instrumentale à travers une succession de plans de pure perfection musicale : leads glorieux (jamais d’enfumage technique) avec renforts impeccables de wah-wah, riffs acérés, contre-riffs (!), le tout arrive couche après couche, pour mener à un final jouissif.
Difficile de prédire de quoi seront faits les lendemains de Möuth : peu exposés (label confidentiel, peu de médias en parleront…), peu présents sur scène (en outre ce ne sont plus de jeunes loups capables de passer des mois en tournée), il est à craindre que le trio suédois reste un petit secret de niche. Ça ne diminue pas la qualité de ce Global Warning, une petite perle dans un paysage musical qui parfois tourne un peu en rond.

Et hop, comme tous les deux ans envion, il est temps d’accueillir un nouveau Mantar ! Toujours dans leur veine résolument « chill & feel good », la production du jour s’intitule Post Apocalyptic Depression, encore un signe d’un disque s’annonçant acidulé et onctueux à l’oreille.
S’il est un groupe qui se prête mal à la sur-intellectualisation, c’est bien Mantar – pour autant, une analyse très basique permet de faire émerger le premier constat sur ce disque : 12 chansons pour 35 minutes au total, on est sur une moyenne de moins de trois minutes par chanson (plus de quatre minutes en moyenne sur son prédécesseur Pain Is Forever and This Is The End), l’évolution est brutale… dans tous les sens du terme d’ailleurs. Tandis que leur album de 2022 les représentait dans une sorte d’aboutissement en terme d’écriture, avec des morceaux denses, riches et bien pensés, cette nouvelle production ne propose donc que des titres « maigres », avec uniquement la chair et le muscle sur les os, pas de gras : du riff, du couplet-refrain bien accrocheur, des mini breaks… ça ne va pas chercher plus loin ! Lorsque l’opportunité d’un solo intervient, il ne dure que quelques secondes (voir pour rire celui de « Pit of Guilt », joué sur 3 notes simplement). L’intention musicale est clairement dans une veine punk sur ce disque : pied au plancher, droit au but, pas mal de rythmiques binaires… Le tout baigne dans une mixture sludge metal tout à fait classique pour le groupe (voire extreme metal, cf. « Axe Death Scenario » et son break aux relents death metal), mais sans l’enrobage d’une production bulldozer. Le duo a affiché cette intention de proposer un disque brut de décoffrage, élaboré et enregistré rapidement, se reposant sur l’instinct et l’intention musicale, sans trop réfléchir. On peut dire que le contrat est rempli.
Côté compositions, il est difficile de faire émerger quelques titres de ce maelstrom d’ultra violence, et au bout de quelques écoutes, on se prend à entonner tous les refrains, qu’il s’agisse du mid-tempo groovy « Rex Perverso », du heavy « Principle of Command », des grungy « face of Torture » et « Dogma Down », du punky « Halsgericht », du rapide « Pit of Guilt »… Ne parlons pas des très accrocheurs « Church of Suck » (2 minutes de la parfaite hybridation musicale entre tous les style susmentionnés) ou « Axe Death Scenario »… N’en jetez plus ! Un titre = un hymne au sludge metal chanté le poing vers le ciel.
Mantar continue son parcours avec ce Post Apocalyptic Depression, sans lasser, avec cette fois un twist rafraîchissant qui rend ce punk-isant cinquième album studio assez attachant. Les compos sont certes basiques, par nature et par intention, mais d’une efficacité et d’une homogénéité que le duo a rarement atteintes jusqu’ici, ce qui rend l’écoute répétée de ce disque jamais lassante.
Evidemment, Mantar s’éloigne encore un peu plus de nos accointances musicales, ici à Desert-Rock, mais on s’y est habitué, et s’il se détachait encore plus de ses racines sludge, il n’est pas impossible qu’on coupe une bonne fois le cordon ombilical bientôt… Mais en attendant, on en reprend quand même volontiers une bonne tranche.

La Charente-Maritime, territoire rock par excellence, qui a enfanté tant de groupes légendaires… Ah ben non, en fait. Sur ces terres peu propices, Walnut Grove DC trace sa route depuis un bon paquet d’années, avec quelques rondelles autoproduites sous le bras et quelques rares incursions scéniques selon une ligne temporelle mal définie. Difficile, dans ce contexte, de percer véritablement sur la scène française, bien que nous ayons déjà eu l’occasion d’apprécier leurs prestations, notamment dans le sillage de Mudweiser, avec qui ils ont partagé plusieurs dates. Deeper, leur nouvel album, vient ainsi nourrir l’espoir d’un palier supplémentaire à franchir pour mieux ancrer le groupe dans notre paysage musical. C’est dans cet esprit que nous l’avons abordé.
Musicalement, la table n’est jamais renversée, mais l’identité du groupe reste solidement affirmée : dans la veine heavy rock fuzzé, Walnut Grove DC déroule son gros stoner dans les mêmes sillons tracés ces quinze dernières années par Orange Goblin. Testostérone, fuzz, saturation, énergie : ça transpire Motörhead, et il serait malavisé de faire la fine bouche. On retrouve tout cela dans une poignée de titres fédérateurs comme “Tumble Weed” ou le très rock sudiste “Room 330”. Quoi qu’il arrive, l’intention de prendre du plaisir est toujours palpable, qu’il s’agisse des chœurs de “Have a Break” ou des riffs musclés de “Turn Around”.
Le quatuor, disons-le sans ambages, se heurte aux contraintes de l’autoproduction : le groupe est son propre client, et son son évolue peu. On en retiendra la cohérence, mais on regrettera l’absence d’un petit vent de fraîcheur. On aurait notamment aimé un travail différent sur le chant : les vocaux de Vinvin sont efficaces, puissants et percutants comme il faut, mais peut-être trop en avant dans le mix. Résultat : l’accent anglais, parfois perfectible, nous sort un peu du trip par moments. Cela dit, pour un auditoire franco-français habitué au minimalisme linguistique, ce n’est pas un gros problème. Espérons même qu’au-delà de nos frontières, cela apporte une touche d’exotisme et de fraîcheur à l’oreille anglophile.
Au final, Deeper s’impose comme un album à toute vitesse, qui malgré une production en dessous de ce que l’on pourrait attendre, consolide la position de groupe rock et stoner qui joue la sécurité. Vu l’engouement pour un style sans fioriture et le plaisir qu’on peut éprouver à se laisser aller à cette galette, il ne serait pas surprenant que cette dernière vienne se faire une belle place dans les playlists d’un nombre certain d’auditeurs. Espérons même qu’au passage le groupe y gagnera un label qui le valorisera comme il se doit. C’est bien tout le mal qu’on leur souhaite. Exit les charentaises : on enfile son cuir et ses bottes de moto pour une virée à dos de Deeper.

On pourrait écrire des pages et des pages sur la situation de Pentagram, sur comment on en est arrivé là… Alors on va faire court : après une tournée d’adieu (!) l’an dernier, passée par l’Europe, tous les musiciens du groupe, sauf Bobby Liebling, ont annoncé les uns après les autres quitter la formation… Quelques jours avant la fin de cette tournée, on apprenait que le label Heavy Psych Sounds avait signé le « groupe » et comptait sortir leur nouvel album (!) et quelques rééditions au passage. Un line up était annoncé un mois plus tard à peine, pour épauler Bobby dans l’élaboration de ce nouveau disque, et une poignée de concerts a été montée rapidement à l’automne pour tester cette nouvelle formation et quelques nouvelles compos sur les planches… En quelques mois, la carrière de Pentagram a repris un virage bien WTF… et ce n’est pas le premier de leur histoire !
Le line-up bricolé pour l’occasion ? La fine fleur du mercenariat stoner doom, avec Henry Vasquez à la batterie (vieux baroudeur du doom metal old school : Saint Vitus, Spirit Caravan, etc…), Tony Reed de Mos Generator à la guitare (et à la production du disque, on en reparlera), et son bassiste au sein de Mos Generator, Scooter Haslip.
Dès les premières écoutes, on comprend très vite que tout est fait pour capitaliser sur Bobby Liebling – mais pas forcément sur son talent ou sa créativité, plus sur son personnage : pochette de disque immonde dominée par son regard torve, divers artworks nases dévoilés ces derniers mois où il figure aléatoirement… Plus significatif encore, il semble quasiment déifié sur le disque tout entier : la production de l’album repose sur la sonorisation de ses lignes de chant, cristallines, parfaitement intelligibles, prépondérantes… Jusqu’ici le chant de Liebling n’a jamais été mis en avant sur ses disques, souvent en retrait derrière les sections instrumentales, valorisant des musiciens qu’il avait le talent de très bien choisir. Et pour cause (attention blasphème) : il n’a jamais vraiment été un grand vocaliste (ce qui n’enlève rien à ses nombreuses qualités).
Musicalement, les repères sont compliqués à cerner sur ce Lightning in a Bottle – ce qui en soit n’est pas si confusant pour les habitués de la carrière de Pentagram. Bon courage pour faire émerger une véritable identité à ce disque ! Les compos semblent venir de tous horizons, dont certaines sentent bon les chutes de studio de Mos Generator (« Live Again », franchement…), ou pire, sont littéralement des titres de Mos Generator recyclés sans effort (« I Spoke to Death »). En même temps, avec un album enregistré (et composé ?) en si peu de temps, on ne peut pas s’attendre à autre chose qu’à du pragmatisme. C’est le cas aussi pour les paroles, avec moins de la moitié des titres crédités à Bobby (beaucoup ont été écrits par Vasquez, manifestement arrivé en studio avec son petit calepin bien rempli…).
Bref, tout ça fleure bon la catastrophe annoncée, tous les ingrédients pour un raté sont réunis. Et pourtant… Ce disque est loin d’être mauvais. Et il faut probablement, largement, en attribuer le mérite à Tony Reed, musicien génial (que peu de monde écoute) et producteur talentueux. Le gaillard est une machine à composer, productif à outrance, que ce soit via la pléthorique discographie de son bébé, Mos Generator, ou bien via ses projets plus ou moins liés au stoner. En tant que musicien, le bonhomme n’hésite pas en outre à prêter main forte à ses amis pour des tournées ou des enregistrements, à la basse ou la guitare. Ce bagage lui permet de développer une science remarquable de la musique fuzzée, et sa capacité à écrire « à la manière de » est un des éléments clés de la relative réussite de ce disque (ne soyons pas dupes : malgré ce qui est dit dans les crédits, c’est manifestement lui qui a composé 95% de la musique de la galette). En tant que producteur enfin, sa réputation de technicien n’est plus à faire ces dernières années. Pour résumer son CV, Reed est un musicien surdoué, qui sait s’adapter à toutes les situations. Bref, le candidat parfait pour bricoler quelque chose vite fait / bien fait dans un contexte aussi tordu…
En résultat, on se retrouve avec 11 compos (assez courtes : 41 minutes en tout) variées, par leur style ou leur qualité. On y retrouve du heavy rock nerveux (« In the Panic Room », “Thundercrest”…), du hard rock gentiment stoner (“Dull Pain”, “Solve the Puzzle”…), du lent « doomy & creepy » (« I Spoke to Death”, “Walk the Sociopath”…). Il y a du bon, mais aussi du mediocre (ce “I Spoke to Death » assez téléphoné, « Lady Heroin », entêtant mais énervant, à l’instar du mielleux « Spread your Wings »…). En revanche la « patte Reed » permet à chaque titre, à sa manière, d’être très efficace, par un travail mélodique qualitatif, à défaut d’être renversant d’originalité. On retrouve donc une poignée de riffs remarquables sur ce disque (« Lighting in A Bottle » par exemple) qui ont un vrai potentiel.
A noter que rien moins que trois titres bonus sont proposés : deux titres qui sonnent encore beaucoup comme du Mos Generator et ne feront probablement pas date, et une version alternative de « Lady Heroin » dont on a du mal à voir la pertinence (c’est soit un excès égotique de Reed-producteur « regardez comme je peux faire sonner ce titre différemment en touchant ce bouton et celui-ci sur ma table de mixage », soit un excès égotique de Reed-compositeur « ce titre est tellement accrocheur que je vous en remets une couche en changeant un peu le son, je ne sais pas choisir la meilleure version »).
Le constat sur ce disque est donc mitigé : alors que tout semblait mis en œuvre pour générer un incident industriel d’ampleur, Lightning in A Bottle n’est pas raté. Il contient quelques compos intéressantes, qui ne déshonorent pas la réputation et la carrière de Pentagram (encore une fois, prenons un peu de perspective : rares sont les disques du groupe qui ne contiennent que de bons titres !) et qui permettront d’injecter un peu de nouveauté dans des set lists qui commençaient un peu à tourner en rond (et oui, on peut s’attendre à ce que la « tournée d’adieu » de l’an dernier ait été une simple « tournée d’au revoir »…). Reste ce goût un peu amer d’un disque créé pour de mauvaises raisons, dans des conditions peu louables, pour capitaliser sur la personnalité de Bobby, ce dernier devenant paradoxalement une sorte de marionnette dans son propre groupe. Pentagram est -il devenu un groupe en viager ?

Le groupe au nom le mieux trouvé de sa génération sort enfin une galette qui nous donne l’occasion de jacter un peu autour de leur rock psychédélique de qualité. Ce quartette limougeaud ne fait pas grand bruit, bien qu’un travail de sape méticuleux en live fasse parfois bruisser leur nom aux oreilles des amateurs de trips sonores. Stronger Than Arnold sort donc, avec la seule aide de ses bras musclés, Odd Structures Lost In The Depth Of Space.
Odd Structures Lost In The Depth Of Space est un album aussi kraut que délicieusement inspiré par les débuts de Slift. Ça tricote dès les premières notes de “Vibrations From Another World” et livre une masse compacte de mélodies (basse, guitare, batterie, chant et même saxo ) tout au long des 14’30 de “Citadel”, qui trippe sans déraisonner. Un exercice de style passé haut la main, ce dont on se convainc dès les riffs échevelés de “Sulfate”.
On gonfle aussi un peu les muscles sur “One Vision, One Key, One Mind”, et plus encore sur “Mapterra”. Et même si ce n’est pas le Arnold de “Conan le Barbare” qui a pris la tête de l’escouade, mais plutôt celui de “Jumeaux”, on ne tombe jamais dans le travers saumâtre de “Un flic à la maternelle”. Rien n’est prétexte ni opportunité ; l’art est maîtrisé. Stronger Than Arnold chasse le riff comme son homologue de celluloïd chasse le Predator.
Odd Structures Lost In The Depth Of Space, c’est un album de bonne humeur à rebondissements, digne d’un remake Space opera de Last Action Hero, dont on ressort avec le sourire et un peu de rêve en plus dans la tête. On ne pourra certes pas remettre de palme à Stronger Than Arnold pour son œuvre, mais à défaut, un bouquet de cactus devrait jouer le même rôle.
|
|