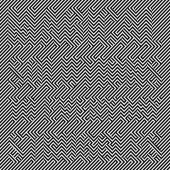|
|
 (2015) (2015)
Neurococcyx est un trio né en 2012 en région nantaise. C’est à peu de choses près tout ce qu’on sait de ce combo, discret et peu affable. C’est dans ces cas que le gratte-papier au rabais (que nous savons être dans nos moments de faiblesse) opte pour la figure de style traditionnelle, en dégainant le fameux « ces mecs-là préfèrent faire parler la musique »… Dont acte, on se plonge dans la salle d’écoute virtuelle mise à disposition par le groupe et on lance l’enchaînement des morceaux de ce « Friches et bestioles », album autoproduit sorti fin 2015.
Les premières écoutes sont distraites, et la musique du groupe semble distante. Pourtant c’est de l’instrumental, c’est donc pas de la musique d’ambiance ?! Et bien non, sinistre erreur : les compos de Neurococcyx sont chiadées, élaborées et… efficaces ! En effet, dès que l’on daigne y prêter l’oreille, on se laisse vite convaincre et embarquer. Le groupe décrit lui-même sa musique comme « metal instrumental progressif »… Forfanterie ? Aveuglement ? Méthode Coué ? Or ils nous signalent qu’on leur dit parfois que leur musique sonne comme du desert rock… Diantre oui ! Il se trouve que les gars font du stoner sans le savoir (ni le vouloir) ! Alors pas du stoner « Fu Manchu meets Truckfighters » hein, c’est sûr… En revanche, les titres qui défilent rappellent de manière assez vive certains grands noms de la scène stoner : certains breaks de « Back to the Prelude » s’appuient sur des riffs à la Karma To Burn, et le morceau peut sonner parfois comme les premiers Glowsun ; « Dead Tong », lui, rappelle furieusement Fatso Jetson dans ses parties les moins saturées ; « La Décolleuse » convoque immédiatement My Sleeping Karma, sans la moindre hésitation, sur les trois quarts du morceau ; « Lapin-Tigre » et « Beach Corpse », eux, sonnent plus comme du Yawning Man… Et à chaque fois on croit de bonne foi le groupe qui ne semble pas nourrir d’influence de ce côté-là du prisme musical. Bizarre, vous avez dit bizarre ?
Quoi qu’il en soit, on ne gâchera pas l’authentique plaisir rencontré à l’écoute de cet album prometteur, œuvre d’un groupe jamais très loin du troisième degré (« Dead Tong » ? « La Décolleuse » ? Leurs clips 100% décalés ?…) mais apparemment bien doué. Dans quelques années, avec un travail de synthèse plus abouti (on est quand même dans des montagnes russes stylistiques au fil de l’album…) et un même soin apporté au travail de composition, on pourrait bien voir le combo prendre du galon… A suivre (de près).

La triplette de frenchies expatriés à Londres nous avait gratifié d’un premier effort (chroniqué dans cette gazette virtuelle) en 2012 et nous en avions pensé le plus grand bien. Après quelques tournées, les réfugiés – bienvenus – en Grande-Bretagne nous livrèrent Shaman l’an passé. Ce deux titres dématérialisé est toujours disponible en téléchargement sans délier bourse (sauf si vous désirez passer par le site marchand de la pomme) pour ceux que ça intéresse et qui auraient loupé cet épisode. Le trio nous déballe aujourd’hui le grand jeu avec le long format Before The Shore qui sort ce printemps.
Ce fameux long format, longtemps attendu, débarque en grande pompe (voir le point vinyle plus bas) sur le label HeviSike. Produit par le groupe ainsi que JB Pilon, les sept titres de cet opus mature tapent dans un registre stoner apaisé tirant parfois sur le doom classieux d’une manière fort agréable. Les rythmiques, assurées par Max Ternebring (le petit dernier à avoir rejoint l’aventure) à la basse et Zacharie Mizzi à la batterie, abattent leur boulot tels des métronomes et laissent pas mal de champ au frontman du trio Romain Daut. Le type en charge des guitares et des parties vocales profite plutôt bien de cet espace à sa pleine et entière disposition pour placer des petits soli bien sentis et surtout mettre à profit ses compétences de vocalistes. Ca change de certaines formations estampillées stoner qu’on imagine presque tirer au sort lequel des membres se collera derrière le micro. Les aptitudes au chant du garçon s’avèrent un élément central des compos de ces citoyens de la Grande Europe et lui permettent de varier les styles tout en restant pertinent. J’en vois sourciller dans l’assistance et je les rassure : Bright Curse ne fait pas que dans la vocalise. Loin s’en faut.
Bright Curse pratique un savant mélange de doom à l’américaine (pas un truc visqueux et glauque pour bourrin donc) et de jams psychédéliques tournant parfois à quelques encablures du blues. Certains titres, comme “Northern Sky” nous rabibochent avec les compos calmes en flirtant avec l’héritage de Deep Purple. La présence d’un orgue sur ce titre renforce d’ailleurs ce rendu et la montée en puissance qui intervient au milieu du morceau vient saisir l’auditeur avant une redescente tout en douceur ponctuée en version feu de camp avec guitare acoustique. D’autres, comme “Lady Freedom” – qui est une excellente entrée en matière pour ouvrir l’album – sont nettement plus pugnaces avec des riffs aussi simples qu’efficace. Un petit je-ne-sais-quoi sympathique me rappelle agréablement Dozer sur ce titre furieux qui s’annonce comme étant une véritable boucherie en live.
Ma préférence va clairement à “Walking in a Graveyard (Bloody Witch)” qui, une fois passée l’intro groovie, est une compo lourde juste comme il faut pour les inconditionnels des deux premiers Kadavar. Très représentative de ce disque, cette plage a le curseur juste bien placé entre lourdeur overdrivée et jam psyché. Une livraison d’excellente facture qui devrait aider ce groupe à se retrouver en première division du stoner européen : une place qu’ils méritent amplement !
Point Vinyle :
C’est compliqué : une édition ambassador (pas celui qui distribue des chocolats) en crystal clear limitée à 50 copies doté d’un artwork différent numéroté à la mimine avec un médiator et une photo retro du trio, 50 copies du même tonneau sans extra et 200 copies bone white ; chacune de ces trois éditions étant accompagnée d’une version CD pour les gens modernes.

On s’excuse d’avance. C’est une certitude, tous ceux qui ont déjà lu quelque chose concernant Witchthroat Serpent ont nécessairement eu affaire aux lettres suivantes : Electric Wizard. On s’excuse alors de vous rabattre une nouvelle fois les oreilles avec cette comparaison, mais rien n’y fait, elle est inévitable. Alors, à toi, lecteur désabusé face à un tel manque d’originalité qui s’apprête à cliquer sur la croix de cet onglet pour aller plutôt lorgner une énième fois sur ton maigre fil d’actualité Facebook, préférant le reflet d’une vie sociale à un discours maintes fois ressassé, je dis STOP ! Promis, la bande de Jus Osborn sera proscrite de cette chronique. Enfin, le plus possible. Et puis tu verras, comme on dit en Italie, Sang-Dragon en vaut la penne.
Deux ans après leur premier album, les toulousains de Witchthroat Serpent rebranchent les amplis et ressortent les baguettes pour ce nouveau Sang-Dragon. Le Sang-Dragon est un encens très puissant utilisé pour combattre les énergies négatives, et qui peut s’avérer légèrement psychotrope si employé en grande quantité. Simplement placé sous l’oreiller, il combat aussi l’impuissance. Mais c’est seulement en tant qu’encens que Witchthroat Serpent en a fait l’usage, du moins à notre connaissance, puisque leur album a été entièrement enregistré sous l’influence de ces émanations hallucinogènes, en une journée s’ il vous plaît.
Seules quelques secondes d’écoute suffisent pour comprendre que l’encens en question ne joue pas dans la même catégorie que la bougie parfumée à la vanille de Madagascar. Le premier titre « Hydra’s Bewitchment », avec sa wah-wah hypnotique sur fond de discret larsen, nous plonge sous un clair de lune obscurci par les nuages, et on ne serait presque pas surpris si de la fumée venait à jaillir de nos enceintes, peaufinant ainsi une atmosphère parfaitement sinistre. Puis vient le riff, le gros riff qui dégouline tellement de graisse que l’on ne sait plus trop si il est joué par la basse, la guitare ou les deux. « A Caw Rises from My Guts » ou « Lady Sally » sont de beaux exemples en la matière, véritables uppercuts de sumotori façon Isio 4. Sang-Dragon oblige, l’album est teinté d’un psychédélisme qui ensorcelle. Après une implacable intro à la basse sur « Siberian Mist », des volutes de guitares viennent habiller délicatement le morceau et baignent l’auditeur dans une ivresse suave. De même avec « Behind Green Eyes » (clin d’oeil aux Who?) et son long passage solo est digne des meilleurs charmeurs de serpent.
Si la formule reste la même que son prédécesseur, Sang-Dragon est bien mieux produit. La voix très plaintive qui était auparavant un peu étouffée sous un tel amas de gras est maintenant mise en avant grâce à une légère reverb, la rendant à la fois plus présente et plus lointaine. Côté instru, la batterie est d’une précision assommante, et le duo guitare/basse est affûté à la perfection, pouvant trancher une côte de bœuf de la main gauche sans effort. Tout est donc plus propre, jusqu’à la pochette de l’album, où les gribouillis violets (suis-je le seul à voir un cheval au centre?) ont disparu au profit d’une impeccable esthétique entre les pulps magazines, les vieux slashers des années 80 et la filmographie de Gerard Damiano version cobra.
Certes, nos trois toulousains n’ont pas inventé la machine à défriser le persil : tout chez eux rappelle leurs ainés anglais. Si vous avez l’occasion de les voir en live, vous verrez également que la ressemblance va au delà de la musique, et que le chanteur et guitariste Fredrik Bolzann, Gibson SG bordeaux au niveau du nombril, fait indéniablement penser à vous-savez-qui. Pourtant, il serait idiot de bouder notre plaisir puisque Sang-Dragon est une vraie réussite, pour toutes les raisons évoquées plus haut.
Sur leur premier album subsistait l’amer constat que n’était pas Electric Wizard qui voulait. Cette fois-ci, nous sommes bien obligé de revoir notre jugement.

L’écurie Ripple s’agrandit de jour en jour. En véritable nouveau cœur battant de notre (nos) genre(s) de prédilection, le label rassemble sous ses ailes bienfaitrices pour nos esgourdes des pointures comme des jeunes loups assoiffés de riffailler nos entrailles. Et la meute peut s’enorgueillir aujourd’hui de compter parmi ses nouveaux membres BoneHawk. Nous tairons la bio longue comme… un bras… qui en synthèse vous ferait comprendre qu’il y a eu des hauts et des bas, des allers et venues, des trios et des quatuors, mais une envie toujours intacte d’invoquer les Anciens par d’enchanteresses mélopées développées par une paire de guitares.
BoneHawk ça peut être un faucon avec en lieu et place de sa tête son crâne à nu. Ou en argot le fait de reluquer avec plus ou moins d’insistance les parties intimes d’un môssieur, et ce pour différentes raisons : la beauté de la science comparative aux pissotières ou pour faire comprendre que les intentions de la soirée ne se limitent pas à prendre un… verre… Et des duels de manches ils ont dû en mater les petits. Outre la section rythmique qui donne envie de se lover dans son confort ouateux de groove tout en rondeur, c’est bien à une débauche de six-cordistes à laquelle on a affaire. Pas d’exhibition sans queue ni tête, mais un juste enchevêtrement de parties en harmonies ou en contrepoints qui donne toute la saveur aux dix titres de ce premier album.
Les américains ne réécrivent pas de nouvelles pages au kamasutra guitaristique mais font une juste relecture des premières orgies des années 70 où, de Thin Lizzy à Judas Priest en passant par Led Zep, le Sab (of course) et autres Iron Maiden, foisonnaient d’épiques mais non moins torrides passes de licks et autres gimmicks. Si le risque était de faire l’amour comme Papa et Môman, BoneHawk a eu la pertinence de lubrifier tout cela d’une huile toute stonerienne avec son grassouillet et voix en retrait détaché. Si les premiers ébats peinent à emporter l’adhésion aux premiers coups, la deuxième partie déroule très vite une débauche de plans jouissifs. Les premiers minutes de chaque morceaux sont comme autant de préliminaires parfois redondants et déjà vus. Presque obligatoire mais que l’on aimerait abréger quand seul nous intéresse les échanges plus coquins.
Parce qu’il y a de la coquinerie dans ces passes d’armes complices entre les membres du groupe. BoneHawk se délecte à parcourir de leurs doigts agiles toutes les touches de leurs instruments, faisant ainsi tressaillir de plaisir les auditeurs pourtant aguerris que nous sommes. Comme un petit plaisir inavouable avec quatre hommes, ce Albino Rhino ne vous fera pas virer votre cuti musical mais vous prendrez sagement votre pied. L’écouter ce n’est pas se tromper.
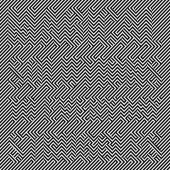
Telstar Sound Drone, groupe originaire de Copenhague, se propose de nous fournir quelques solutions magiques pour en finir avec nos tracas quotidiens. Avec une intention pareille, on ne va pas faire les farouches et on va de suite essayer de comprendre de quoi il retourne.
Le premier contact avec la musique du groupe n’est pas celui qu’on pourrait croire. On se rend vite compte que la pochette se veut le prologue physique de la musique. L’artwork représente une sorte de labyrinthe géométrique créé à l’aide de droites blanches ou noires. On pourrait déjà proposer quelques interprétations évidentes et y discerner des indices quant à ce que réservera l’écoute ; le fait que regarder la pochette plus de quelques secondes soit impossible, sous peine d’émettre des litres de baves, et de voir ses yeux se révulser, n’étant pas la dernière. Si toutefois vous êtes bien accrochés, alors vous discernerez le titre de l’album, camouflé du premier regard par une illusion d’optique. Autant de mots clés que je pourrais plus ou moins directement réutiliser pour parler de la musique du groupe. Car leur nom n’est pas trompeur et l’atmosphère oppressante et psychédélique est bien définie par un minimum de variations harmoniques et un maximum d’expérimentations. Au premier abord, une sorte de marasme sonore, pour autant construit sur des pans indéboulonnables pendant que d’autres, en superpositions, semblent aller et venir à leur guise selon une logique macroscopique qui nous échappe. L’oppression palpable est rendue possible par des sur-ajouts de sonorités électroniques, des enregistrements originaux (la rotation d’un disque dur sur « Dark Kashmir »), des guitares aux effets ingérables, mais ce qui m’a frappé, c’est l’utilisation du spectre sonore. Il paraît amputé dans le haut et le bas, alors les basses sont faussement absentes et les aigus claquants, mais aussi légèrement lointains, accentuant la claustrophobie générée par les instruments. Ce qui est remarquable néanmoins, c’est qu’avec tous ces éléments, l’ensemble reste suffisamment lisible pour ne pas perdre l’auditeur, certains passages étant d’ailleurs relativement accessibles. Une prouesse surement due au temps de travail accordé au projet avec quatre mois d’enfermement nocturne. Autre élément qui finit de définir le son du groupe, la voix de Sean Jardenbᴂk, nonchalante à l’extrême avec des mots qui ne finissent pas, parfois plaintive, parfois agressive, et finalement le prolongement évident de l’instrumentale.
Cette cohérence que l’on ressent dans le traitement physique et sonore du projet est en fait aussi son principal défaut. Car si chaque morceau est bien unique, l’homogénéité est telle qu’il est difficile de ressortir des éléments particuliers à postériori. Pas un tube, pas même un riff, juste une impression de lancinance globale, paranoïaque et tordue. Un parti pris plus qu’un défaut pour être exact, mais ce sera à vous de décider en fin de compte et le score risque d’être partagé.
Ce qui est certain, c’est qu’aidé par une remarquable cohérence artistique jouant sur les illusions d’optiques et sonores, la paranoïa, la claustrophobie et avec une forte identité musicale, TSD propose une expérience originale sans compromis. Et qui sait, peut-être encore une solution magique aux problèmes quotidiens qui s’avérera addictive !

Et si le Stoner Rock était né non pas dans le chaud désert californien mais dans la péninsule ibérique ? C’est ce que Miss Lava entend nous faire croire en revenant fraichement avec un troisième opus portant le nom de Sonic Debris.
Sur son aspect général, cet album propose plusieurs étiquettes sonores : grosse phase massive d’une lourdeur et d’une lenteur appréciable, ambiance moderne et vintage parfaitement bien entremêlées, des morceaux plus solennels et quelques titres plus classiques. Si on résume, on obtient une grosse omniprésence de mélodies envoutantes menées par une production très efficace. Le côté moderne/vintage apporte ainsi beaucoup de stimuli, mais refroidit un peu trop souvent la lourdeur et la massivité du son. Néanmoins, le groupe offre des riffs très riches, accompagnés d’une base rythmique très solide et d’une voix aux petits oignons (mais sans l’odeur). Un chant clair tout en puissance qui sait pousser la distorsion vocale au bon moment.
Sonic Debris propose des titres sans trop d’artifice, juste ce qu’il faut quand il faut. On y retrouve des influences très diverses et la volonté de s’ouvrir plus largement: un côté un peu Orgy (pour les connaisseurs), parfois un peu à la Korn, mais surtout de la grosse ambiance à la Alice in Chain. C’est parfois quasi cinématographique avec une première partie d’album plus intense que la deuxième, apportant tout de même un certain charme.
Si vous recherchez la sensation forte, avec du pont qui sent bon l’olive et la paëlla psychédélique qu’on se resservira avec appétit, vous vous laisserez donc bien tenter par les titres « Another beast is born » et « At the end of the light ». Par contre, si vous cherchez quelque chose de plus neuf tout en aimant le style rythmique des années 1970, alors vos oreilles opteront pour « The Silent ghost of doom » et « In the Arms of the freaks » (morceau rythmiquement excellent mais qui manque de gras). « Pilgrims of Deacay » n’est pas mal dans son genre, mais sera moins mémorisable, sauf à partir du pont bien rentre dedans. Puis « Planet Darkness » rentrera dans le tas des fans de Sludge/Stoner. Après on découvre quelques morceaux moins touchants comme « Symptomatic » par exemple, ce qui sera vite oublié avec la ribambelle de titres affichant une véritable personnalité. C’est le cas de « I’m a Asteroid » et de « I’m a sonic we shall we burn » : genre Iggy Pop en phase rock’n’roll acoustique à la western. Tout cela montre ainsi beaucoup de maturité comme l’atteste notamment « Fangs of Venom » avec son caractère à double facette : entre ambiance posée et psychédélique, rappelant parfois quelques influences à la Fu Manchu.
On peut donc affirmer sans peur que le nouvel album de Miss Lava est un condensé de très bonnes choses avec une véritable prise de risque en terme de son, et, c’est plutôt appréciable.

Il y a 4 ans, Verdun nous contait les aventures d’un astronaute japonais halluciné et perdu dans l’immensité effrayante de l’espace. Intitulé The Cosmic Escape Of Admiral Masuka, cette toute première pierre à l’édifice discographique des montpelliérains posait les bases des différentes planètes sonores visitées par le groupe, avec, en vrac, du doom, du sludge et du hardcore. Sur le magnifique artwork de leur premier album The Eternal Drift’s Canticles (œuvre de David Sadok, chanteur et parolier de l’époque, ayant quitté le groupe très récemment et maintenant remplacé par Paulo Rui), l’Univers semble être sous la domination de demi-Dieux brandissant d’étranges sceptres et ayant transformé l’espace en un sanglant terrain de jeu. Ces figures mystiques évoquant une Inquisition spatiale nous interrogent : après s’y être perdu, Verdun aurait-il finalement appris à dominer l’espace ? Une chose est certaine, le frêle et misérable Masuka n’est plus, et l’être humain a cédé sa place à des créatures bien plus fabuleuses et colossales.
Comme c’est souvent le cas avec les groupes qui en valent la peine, il est difficile de poser une étiquette sur le genre de Verdun, tant il se plait à brouiller les frontières qu’on voudrait lui imposer. Il tient du doom la lourdeur répétitive et l’inclination pour le riff le plus génialement rudimentaire, favorisant la puissance sonore et tout ce qu’elle peut évoquer plutôt que la complexité mélodique. Le chant est lui clairement hardcore, et se mêle parfois à une autre voix plus assagie et sereine. À cela, il faut ajouter une bonne accointance post-metal, faite d’accords à l’harmonie discutable et de passages atmosphériques côtoyant d’autres bien plus violents.
Sur cette base résumée succinctement, j’en conviens, The Eternal Drift’s Canticles livre une épopée sidérale d’où la noirceur ne démord pas une seconde sur les 54 minutes des 5 titres. Oui, oui, 54 minutes et cinq titres. On vous laisse calculer la longueur moyenne d’un morceau. Sur le premier, « Mankind Seppuku », un lugubre passage à l’harmonium glaçant le sang précède un déferlement de puissance sonore, qui va finalement s’éteindre et laisser la place à des arpèges cristallins et à un solo déchirant de mélancolie. On l’aura compris, Verdun a décidé de ne pas faire les choses comme tout le monde et compte bien nous le prouver. Sur tout l’album, le spectre de YOB plane, comme en atteste le poignant « Glowing Shadows », à l’écoute duquel il est impossible de ne pas penser à la bande de Mike Scheidt et à son post-doom du futur. D’autres morceaux, comme « Self-Inflected Mutalitation », au titre plutôt évocateur, ou encore « Dark Matter Crisis » nous assènent de grosses gifles plus directs et brutales.
L’apothéose est sans doute atteinte sur « Jupiter’s Coven », véritable summum de langueur et de tristesse qu’une guitare aux contours tranchants vient transpercer sans scrupule, et preuve sonore que Verdun excelle aussi bien dans la bestialité que dans l’humanité.
Mixé par Tad Doyle, il est inutile de dire que l’ensemble bénéficie d’un son monumental. Les guitares sont lourdes, la basse et la batterie sont très présentes, et l’ensemble est doté d’une légère résonance qui apporte une grande profondeur et sert ainsi parfaitement la dimension épique recherchée par le groupe, nous plongeant sans effort dans le vide et la solitude de l’espace.
La litanie « I was dead, Now I’m Alive / I was cold, I’ll surely die » est répétée plusieurs fois avant de clôturer l’album. La mort, la résurrection, la grâce, puis la mort à nouveau. C’est en somme l’effet que procure l’écoute de The Eternal Drift’s Canticles : à bord des montagnes russes du Sacré, vous côtoierez tour à tour le Divin et le Malin. Et on vous garantit que vous n’aurez pas une seule fois envie de descendre en marche.

Depuis 2005 les danois de Causa Sui développent patiemment un stoner instrumental coincé entre le prog psychédélique et de fulgurantes baffes de fuzz gorgées de soleil cuisant. L’identité du combo est forte, chaleureuse, reconnaissable entre mille et ne déroge pas à la règle sur la nouvelle galette à l’indice UV élevé, Return To Sky.
« Return to Sky Valley » serait-on même tenté de glisser, tant le nouvel opus fait la part belle à ces guitares fuzzées, grasses et typiques de la scène desert-rockienne. Non pas que les Danois abandonnent leurs circonvolutions progressives, mais ils continuent à tracer un sillon plus direct, à l’écriture plus linéaire, entrevue déjà sur le précédent opus « Euporie Tide ». On pourrait même s’amuser à une petite étude du champs lexical de la set-list pour s’en convaincre. « Sky », « Dust », « Source », « Mondo », autant de termes renvoyant plus à de la session désertique qu’au label Blue Note. C’est avec une émotion particulière que l’on sent même poindre le groove de Sungrazer par moment, sur « The Source » notamment, et l’on ne peut s’empêcher d’y entendre un hommage appuyé au regretté et génial Rutger Smeets, feu guitariste du feu combo.
Causa Sui n’oublie cependant pas ses fondamentaux et l’on retrouve tout de même les ingrédients qui lui sont propres ; ses aspirations jazz, son groove acide, ses instru/mentaux et étirés, mais parcimonieusement distillés le long des 45 minutes de la galette.
Ce nouvel album ne sera pas une pierre marquante de l’édifice Causa Sui mais il est certain qu’il ne se dépréciera jamais avec le temps. Les 5 titres passent, un sourire se colle forcément au visage, on s’imagine dans la bagnole, à bouffer du kilomètre ou sur une plage à contempler les grains de sable courir sur les courbes voluptueuses de naïades inconnues. Si un album doit accompagner votre été, nul doute que « Return to Sky » sera celui-ci.
 Nourri au sein de notre doom-mère à tous, élevé au grain enrichi en proto-metal, et maintenant offert à tous par le (nouveau) grand pourvoyeur qu’est devenu Ripple Music, voici le dernier rejeton de la famille: Red Wizard. 5 garnements qui en 2010 ont décidé de laisser parler leur amour pour une musique non actuelle et de le faire avec passion. Animés par cette flamme obscure, les voilà à écumer les bars et les divers scènes de San Diego pour marche après marche gravir l’échelle d’une reconnaissance non déméritée. Un premier EP en 2014 les vit s’affranchir des barrières régionales et ce premier album va de fait leur ouvrir les portes vers l’infini et l’au-delà. Il est grand temps de laisser les oiseaux quitter leur nid et les voir s’envoler sous l’apparence de ces funestes sorciers rouges. Nourri au sein de notre doom-mère à tous, élevé au grain enrichi en proto-metal, et maintenant offert à tous par le (nouveau) grand pourvoyeur qu’est devenu Ripple Music, voici le dernier rejeton de la famille: Red Wizard. 5 garnements qui en 2010 ont décidé de laisser parler leur amour pour une musique non actuelle et de le faire avec passion. Animés par cette flamme obscure, les voilà à écumer les bars et les divers scènes de San Diego pour marche après marche gravir l’échelle d’une reconnaissance non déméritée. Un premier EP en 2014 les vit s’affranchir des barrières régionales et ce premier album va de fait leur ouvrir les portes vers l’infini et l’au-delà. Il est grand temps de laisser les oiseaux quitter leur nid et les voir s’envoler sous l’apparence de ces funestes sorciers rouges.
Si toi aussi tu aurais souhaité entendre les premières reprises de Black Sabbath par l’un des big four du thrash au temps choyé des débuts des années 80, ton rêve pourrait se concrétiser avec cette album. La parenté avec les géniteurs de la scène est évident dès les premières chatoyances de la basse de “Tides of War” mais très vite on sent que Red Wizard n’a pas laissé la deloreane en 70, et a su adjoindre à cette influence (majeure) les épices des générations suivantes de défenseurs du riff lourd. La production bien léchée évite également l’écueil du groupe revival et propose un son rond et puissant à pouvoir décoller les tympans de tes voisins. Le groupe n’œuvre donc pas dans la simple copie (déjà difficile à maîtriser) mais par son culot et sa générosité arrive à creuser son sillon dans ces terres maintes fois labourées par des bucherons pourtant avisés.
Musicalement l’assise est solide. Prodiguée par une efficace paire basse/batterie qui, sans transpirer de facilité, défend massivement son bout de gras face au duo de guitares qui se révèle, au fil des riffs, charpentée pour tenir la route d’envolées solistes de première bourre. Tout ce petit monde offrant une literie king size avec renfort des lombaires pour la grosse voix du sorcier prédicateur. La messe (noire) ne saurait être dite et entendue au milieu des légions de doomeux/proto-metalleux sans les grasses cordes vocales légèrement râpées qui clairement distinguent Red Wizard. Les années feront certainement mûrir ce chant qui ne demande qu’à biberonner plus de jack que raison ne veut, pour en faire un vocaliste de renom. Mais déjà sur des titres comme “Temples of Tennitus” et “Blinded”, l’ombre des Grands se fait sentir et pas qu’instrumentalement.
Les californiens avec leurs trois premiers titres marquent leur territoire et démontrent leurs intentions: ils ne sont pas là pour faire de la figuration et préparent le terrain pour la conquête finale que sont “Cosmosis”, pièce maitresse de plus de 10 minutes avec son passage psychédélique qui laisse envisager des heures prometteuses de jams enfumés, et le triptyque “The Red Wizard Suite” qui sans lien fort entre les différents volets ouvrent également son champ de perspectives. Quand les mélodies bluesy rencontrent le matraquage de nuque, se révèle alors tout le potentiel du quintet. Car sans être un album essentiel ce “Cosmosis” de Red Wizard est un très bel acte de naissance. Groupe à suivre assurément le temps de prendre un peu de bouteille et à déguster dès maintenant sans modération.
 Deux ans que la dodge nous attend ici. Dans la pénombre du couloir qui nous mène à elle se dessine sa silhouette à la lumière du soleil passant sous la porte du garage. Les pilotes sont déjà installés, le duo (qui œuvre en trio) Valley of the Sun n’a plus qu’à lancer le moteur. Quelques cliquetis se font entendre et enfin la bête est lâchée sur la piste. “Eternal Forever” permet à la mécanique de se mettre en branle sereinement, le riff est bien huilé. Quelques tours de groove rutilant suffisent à rôder les nouvelles pièces. A l’image de la pochette l’aiguille du compteur est déjà dans le rouge, on ne conduit pas avec les petits doigts ici. La prise est ferme dans les breaks et la dodge démontre toute sa reprise et sa souplesse au détour de l’imparable refrain. La gomme des pneus marque le bitume du matraquage incessant de la batterie, le circuit gardera des traces du passage de la dodge… il est temps de s’échapper. “BTV” nous enfonce dans des routes plus sablonneuses. Sur cette longue autoroute traversant le désert, le lick de guitare double les trucks(fighters?) à leur propre jeu. Redoutable dans chaque virage que prennent les morceaux, les solos nous collent au cuir des fauteuils. Deux ans que la dodge nous attend ici. Dans la pénombre du couloir qui nous mène à elle se dessine sa silhouette à la lumière du soleil passant sous la porte du garage. Les pilotes sont déjà installés, le duo (qui œuvre en trio) Valley of the Sun n’a plus qu’à lancer le moteur. Quelques cliquetis se font entendre et enfin la bête est lâchée sur la piste. “Eternal Forever” permet à la mécanique de se mettre en branle sereinement, le riff est bien huilé. Quelques tours de groove rutilant suffisent à rôder les nouvelles pièces. A l’image de la pochette l’aiguille du compteur est déjà dans le rouge, on ne conduit pas avec les petits doigts ici. La prise est ferme dans les breaks et la dodge démontre toute sa reprise et sa souplesse au détour de l’imparable refrain. La gomme des pneus marque le bitume du matraquage incessant de la batterie, le circuit gardera des traces du passage de la dodge… il est temps de s’échapper. “BTV” nous enfonce dans des routes plus sablonneuses. Sur cette longue autoroute traversant le désert, le lick de guitare double les trucks(fighters?) à leur propre jeu. Redoutable dans chaque virage que prennent les morceaux, les solos nous collent au cuir des fauteuils.
Mais Valley of the Sun n’est pas revenu de son excellent précédent album, au volant du même engin, pour emprunter des chemins identiques. “Speaketh” s’engouffre sur un terrain plus lourd. Conduite plus appuyée, le vrai potentiel de la dodge se fait sentir pleinement. D’une qualité constante, ces nouveaux horizons font vrombir la carlingue à l’unisson dans ce mid-tempo puissant. “Land of Fools” finira pas mettre tout le monde d’accord. Si les paysages traversés ont été déjà vus (et revus), c’est avec une classe certaine, que les américains nous mènent. Ici encore les suiveurs n’auront que l’émanation des gaz d’échappements de riff/groove/efficacité dans leurs narines pour pleurer. Avec Volume Rock, Valley of the Sun va plus loin, plus vite et sans accroche.
Si la musique ronronne sévère, le chant propulse l’ensemble au delà d’une énième odyssée rock. “Breathe the Earth” ralentit un peu plus la cadence. Sur sable mouillée, les couches de grattes évitent tout enlisement. 2min24 d’un rock conduit toutes fenêtres ouvertes, “The Hunt” permet de lâcher les chevaux. Si dans ces moments d’accélération le groupe démontre un savoir faire tout assumé, il fait néanmoins plus mouche quand il lève le pied et joue plus sur la richesse de sa conduite plutôt que sur sa nervosité. “Wants and Needs” nous mène toujours plus loin dans ces horizons fait de fuzz, de rock, de grunge. Impression confirmée avec “Tour”, splendide de rouille toute soundgardienne. La dodge avale les kilomètres comme d’autres avalent les hot-dogs. Ca glisse, sans sourciller, et à ce petit concours Valley of the Sun vient de remporter un nouveau titre.
On pourrait craindre la panne sèche, le souci technique, à ce niveau de notre périple. Mais la dodge a été bichonnée, préparée, tunnée, pour ses routes sinueuses et variées. Porté par une production impeccable et avec au volant deux instrumentistes (et vocaliste) de talent, l’album défile à toute vitesse. “Noodle” en est encore un exemple flagrant. Ce même mélange parfait avec les mêmes ingrédients qu’Unida mais avec un vrai avenir devant eux. “Solstice” ne signifie le retour au garage que pour peu de temps, tellement une fois arrêté on n’a qu’une envie: repartir en virée avec ces gars là au volant de cette voiture là. Ne cherchez plus un concessionnaire de Rock digne de ce nom, il est tout trouvé avec Valley of the Sun.

Étrange projet que celui de Philiac. Le trio, « actif » depuis 2007 semble s’être formé sur les collines de San Carlos, dans l’arrière pays d’Ibiza. Un endroit qui, convenons-en, n’est pas forcement réputé pour la qualité de sa musique. Décidé à verser dans l’aridité stoner kyussienne, Sawn, Derrick et Nricco s’exportent et s’envolent pour la Californie et le Rancho De La Luna afin d’y mettre en boite This Appallin Ocean, leur premier album. Il y a, à mon avis, deux façons de comprendre Philiac : soit le groupe joue la carte de l’énigme la plus opaque, soit il fait preuve d’un handicap certain lorsqu’il s’agit de parler de sa musique. Jugez plutôt : S’il est impossible de trouver une quelconque information sur le combo via leur site ou leur… Myspace, même avoir le LP entre les mains ne suffit pas à comprendre ce qu’il s’y passe. Des musiciens cachés sous des pseudonymes ? C’est désormais chose courante. Des pochettes où s’entremêlent les crédits au milieu de l’artwork ? On n’est pas contre, mais lorsque les titres des chansons sont eux-mêmes illisibles, surement pour faire de l’album une entité indivisible et unique, comme le suggère la présence des mentions « Act One » et « Act Two » sur le disque, autant vous dire qu’il faut derrière que la musique soit d’une rare qualité. Et ce n’est malheureusement ici pas le cas.
D’inspiration clairement désertique, reprenant les thèmes psychédéliques de Fatso Jetson et le son plombé de Kyuss, Philiac vit le rêve Californien à fond. Avec Mathias Von Schneeberger aux manettes et Paul Powell (Masters Of Reality) en invité d’honneur, le groupe joue à fond la carte de la crédibilité stoner. Malheureusement le résultat manque d’originalité et voit ses morceaux les plus intéressants plombés par la voix de Nricco, manquant terriblement de relief.
Il est toujours difficile d’enfoncer le disque d’un groupe inconnu (m’ayant en sus généreusement envoyé un véritable LP), mais force est de constater que Philiac, suffixe anglophone signifiant « ayant une attraction anormale pour » (coprophiliac, etc.) en français n’est malheureusement qu’un mot incompréhensible, pas loin de rimer avec foutraque.
Point Vinyle :
Le LP existe en trois versions : Clear, Hot Pink et Black in Blue même s’il m’est impossible de vous donner le volume de tirage, que l’on suppose aisément réduit, autoproduit oblige. Doté d’un artwork soigné et livré avec toutes les options (180g, Download Cart, Vitre teintées…), il aura de quoi ravir les collectionneurs, surtout de bizarreries.
Infos : http://www.philiacband.com/propaganda.html

En voilà un nom obscur qui échappe à mes capacités d’analyse étymologique. Pygmate donc, est un groupe originaire de Saguenay – Lac-Saint-Jean au Québec. Après un premier EP en 2014, ils sortent fin 2015 l’EP « Le cœur poilu » avec l’aide d’un nouveau chanteur. Et oui jeunes gens, vous l’aurez compris, on est ici confronté à un chant francophone.
Il est assez saisissant de s’apercevoir cependant, que l’on est tout de suite conquis par la voix de Jeff Ménard et par les paroles écrites en partie par Matt Cook, le guitariste et ex-chanteur. Les textes sont remplis d’ironies, malins, restent en tête à l’instant où ils vous pénètrent (lorsque vous avez ingérez l’accent certes), et prodigueraient même des messages dans « Le Continent en plastique ».
Côté instrumentale, il suffit d’entendre le premier riff du « Cœur poilu » pour savoir qu’on ne va pas s’emmerder. La popote est nette, du rock classique avec des touches de stoner et de grunge pour un résultat simple et efficace mais qui distille un petit truc en plus. Avec ça, on est confronté à une bonne production sans chichi qui met bien la voix en valeur, mais où il manque tout de même un peu de puissance générale. Alors avec ces trois morceaux comme bonne base, il faut maintenant s’essayer au long format.

Le revival seventies compte un nombre croissant d’adeptes – ce qui, au passage, aide passablement notre scène de prédilection – et les formations nourrissant ces (néo-) convertis se sont engouffrées dans la brèche que les Graveyard et autres Kadavar avaient rouverte. Brutus, qui n’est pas le dernier venu dans cette galaxie, propose la suite – assez logique – de « Behind The Mountains » sa production précédente déjà sortie chez Svart Records. Sous influence totale des années septante, les Scandinaves se sont donné pas mal de longueur de champs (de cannabis) pour étaler leur noble art et les neuf pièces qui constituent cet opus sont déroulée sans inhibition.
Le quinté (plus) occupe les trois quarts d’heure que dure cette plaque de manière brillante. Le travail de production est de l’orfèvrerie de haut vol : c’est hyper limpide, hyper en place et du coup je me demande si je n’aurais pas aimé quelques larsens ou un rendu davantage grailleux sur certains riffs ; par exemple sur le véloce « Axe Man », qui sera une tuerie sur scène lorsque qu’on connaît ces gaillards, mais qui du coup sonne un poil trop propret. A vrai dire, c’est pas d’une gravité extrême, mais l’exercice est tellement bien réalisé qu’il faut bien y retrouver quelque chose à dire d’autre que se plaindre de la pochette qui est moche comme trente-six culs !
En débutant cette album sur le titre éponyme, cette bande de jeunes propose un zapping des forces de cette pièce : rythmiques entêtantes, riffs overdrivés efficaces, basse ronronnante confortablement mise en avant, chants clairs et groove d’enfer sur un tempo assez rapide pour la formation. Le tempo est certainement un des éléments clé de cette production qui oscille entre titres rapides suintant le hard rock de dessous les aisselles – « The Killer » : un titre parfait que j’aurai rendu inécoutable à force d’user la bande de ma cassette dans mon baladeur s’il était sorti à l’époque – et titres beaucoup plus lent à l’instar de « My Lonely Room » qui devrait rapidement devenir un standard des pièces enfumées par les cigarettes rendent nigaud.
Deux compositions sortent très clairement du lot et elles sont toutes deux disponible au rayon calme. Il y a tout d’abords le torride « Whirlwind Of Madness » – les fadas de Led Zep vont kiffer la chose – qui dépasse les six minutes de jeu langoureux ; c’est clairement un titre qui pue la baise et c’est monstre bien foutu ! Ensuite, il y a « Blind Village », une réussite du genre vintage avec une longue progression autour d’un riff central qui envoie un peu à mi-morceau avec soli et tout ce qui va bien ; cette plage est tirée du même tonneau que le premier extrait « Drowning » dont le clip est tout foufou. Une confirmation de la part d’acteurs dans la place depuis un paquet d’année à qui devrait profiter l’aura dont bénéficie le trio allemand à la mode depuis quelques années.
Point Vinyle :
Les gars ont bien fait les choses pour les adeptes du microsillon avec 500 exemplaires noir, 350 speak orange et surtout 150 splatter rouge et blanc dispo uniquement auprès du groupe ou du label. Il n’y en aura pas pour tout le monde !

Originaire de Lyon, Fuzzcrafter, groupe de Fuzz-Rock instrumental, nous livre son premier album studio sorti en 2015 avec huit titres bien ficelés.
Le premier constat est de féliciter le groupe pour sa prestation studio puisqu’en effet il a réussi à transposer son énergie en optant pour un enregistrement « live studio sessions ». Comme il l’est indiqué sur la pochette arrière de l’album : « l’imperfection fait également partie de la musique ». Il est quand même difficile de trouver une certaine imperfection tant la bande lyonnaise envoie les watts, et, surtout nous fait découvrir des artistes d’un très bon niveau à travers une musique de qualité. Les huit titres de cet album éponyme entendent ainsi proposer des ambiances bien riches : du stoner bien lourd au morceau plus acide folk&fuzz. Les fanas de démonstrations rythmiques et instrumentales en auront pour leur argent.
En soit, Fuzzcrafter est donc un très bon album qui mérite qu’on s’y arrête un instant, voire même deux !

Troisième album de Beastwars, The Death of All Things est la conclusion de la trilogie post-apocalyptique entamée en 2011 par les néo-zélandais avec leur premier effort éponyme. La patte velue de la bête se dévoilait alors à l’époque aux oreilles de tous avec ce stoner-metal empruntant aussi bien à Mastodon et Soundgarden, qu’à Unsane et Kyuss. Blood becomes Fire avait suivi en 2013 et avait inscrit plus profondément dans nos chairs les marques des griffes acérées du quatuor. Bien que passé quelque peu inaperçu de ce côté du globe, dans l’hémisphère sud le groupe jouit d’une certaine renommée. La réédition en 2014 des deux albums suscités avait offert une exposition plus large (et méritée) mais les contraintes du quotidien liées à celles de la géographie ont toujours freiné Beastwars dans sa conquête de nos espaces vierges de son passage. Si 10 ans après sa genèse le groupe annonce clore cette trilogie avec ce nouvel opus, il fait également planer le doute sur la conclusion pure et simple de leurs aventures, un des membres déménageant pour la capitale britannique. Chacun tâche d’y voir l’opportunité de pouvoir soumettre l’Europe à leur massive musique, c’est tout le mal que nous nous souhaitons.
The Death of All Things, s’il ne finit donc pas par être l’épilogue d’une carrière, a déjà la lourde tache de passer derrière deux pièces de premiers choix. Autant tuer le suspense dès maintenant, ce troisième effort remporte ce défi et avec manière. S’est-elle sentie acculée aux parois de sa caverne, que la Bête a poussé ses limites pour cet (ultime) assaut. Beastwars c’est d’abord un son, marqué, personnel, qui l’identifie presque d’une traite. La section rythmique porte les morceaux (logique vous dirons certains) sur ses robustes épaules, charnues et poilues. Le son de la basse s’assimile à un moteur de tracteur tirant 15 tonnes de bourbon en côte et sa place plus que prépondérante dans l’architecture des titres, la situe dans un rôle entre guitare rythmique et basse. La six-cordes ayant à proprement parler principalement une approche faite de nappes, d’arpèges, d’appuis sur les parties les plus riffus. Évidemment les mélodies (et elles sont aussi nombreuses qu’entêtantes) ne seraient rien sans le travail d’arrangement et de production effectué par la gratte mais l’édifice sans le gras saturé de la basse ne saurait supporter la pierre angulaire qu’est le chant. Toujours au bord de la rupture, les parties vocales rapprochent l’ensemble d’un concept album où toutes les émotions contées seraient tantôt hurlées, tantôt susurrées.
Ainsi les titres vont chercher toute la rage-mélancolique contenue dans vos tripes. Une colère contenue parce que désabusée de se sentir bien vaine face à ce monde dans lequel nous subsistons. Beastwars n’a jamais été un groupe pour vous coller la banane et son écoute nécessite d’être dans l’humeur adéquat. Ouvrant sur “Call to the Mountain” et son intro aux portes du rock n’ roll, très vite le morceau évolue vers les bas fonds de la montagne où résonne la voix arrachée écrasée par le poids du monde instrumental qui s’abat autour d’elle. Car la force de “The Death of All Things” réside dans la capacité qu’à eu le groupe à varier ses morceaux et à créer de la variation en leurs seins même (“Devils of Last Night”, “Holy Man”). Instants plus posés se retrouvant souvent poutrés sans faillir, riffs pêchus évoluant vers gimmicks délicats. Beastwars est une Bête aux abois qui face à l’inéluctable fin transgresse les genres, rageant de la douceur, pleurant de la violence. Effets décuplés par la richesse des lignes de chant, par cette façon si particulière de les poser aussi bien en relai qu’en contrepoint de l’émotion développée par les instruments. “Black Days” pourrait ainsi presque paraître guillerette et “The Devil took Her” tout en acoustique et en flûte sonne comme une dictée de l’épitaphe de l’être aimé.
Si vous n’avez jamais posé une oreille sur Beastwars, un conseil déjà: posez les deux et laissez vous porter par ces troubadours désenchantés, ces bardes déchirés, ces conteurs de l’apocalypse. Pour bien appréhender la Bête il vous faudrait l’attaquer par son début mais même si commencer une trilogie par la fin n’est jamais souhaitable, vous ne serez pas déçu pour autant. The Death of All Things est un immanquable de l’année.
|
|
 (2015)
(2015)