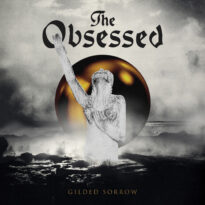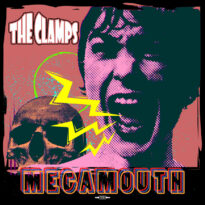|
|

Le label américain Small Stone Records a beau ne plus être que l’ombre de lui-même en termes d’activité (nombre de sorties) depuis quelques années, on peut lui faire confiance pour maintenir son roster à un haut niveau qualitatif, et garder son soutien (vraisemblablement désintéressé) pour les groupes qui le méritent. C’est donc avec une certaine bienveillance que l’on appréhende le troisième disque des bostoniens de Sundrifter, leur second chez Small Stone, après un Visitations que l’on avait bien apprécié, il y a presque six ans. Le groupe s’est fait discret depuis, sans actualité ou activité significative, à part quelques disparates prestations scéniques.
On imagine à peu près à quoi s’en tenir en lançant les premières rotations de ce An Earlier Time, qui sans surprise propose un heavy rock charpenté, où stoner et grunge viennent se tirer la bourre (on pourrait penser à un mix de QOTSA-milieu de carrière et de Soundgarden, grossièrement), avec deux composantes clés propres au trio étasunien : un travail sonore, harmonique et mélodique très marquant, et le chant de Craig Peura.
Le premier point est vraiment le driver principal qui emmène le groupe dans des territoires inaccessibles à la plupart des groupes (pas le territoire du succès pour le moment, apparemment). Il se traduit avant tout par un goût du riff « hybride », où les patterns mélodiques sont courts et répétitifs et viennent renforcer la rythmique. On pense à l’intention musicale post-rock… sans le son post-rock ! Car ici la mise en son est travaillée, la production est mature, efficace, finement ciselée : des arrangements classieux (discrets claviers, discrets effets guitare & voix…) viennent apporter un clinquant bien particulier à chaque titre. Cet état de fait participe à ce très agréable contraste qui définit la musicalité du groupe : souvent enclins au riffing sec et froid, Sundrifter n’hésite pas à l’enrober d’une subtile nappe de claviers, de soli mélodiques, de chant aérien… (voir le dernier tiers de « Begin Again » par exemple).
Puisqu’on parle de chant, on notera que Craig Peura a encore développé son spectre vocal sur ce disque, apportant à chaque titre un relief particulier. S’il évoque souvent Chris Cornell (par exemple sur « Prehistoric Liftoff ») il trouve aussi sa place dans des plans plus nerveux, ou à l’inverse plus aériens encore (son chant sur « Want Your Home » évoque plutôt Bono de U2 !).
On a donc là une galette de belle qualité. Pour faire la fine bouche, on pourra un peu gloser sur le running order, qui voit trois titres lents (mid-tempo au mieux) clôturer le disque, ce qui donne une « fin de bouche » un peu surprenante, et qui ne reflète pas la tonalité globale du disque. Mais la première moitié étant un exemple d’efficacité, on appuiera simplement sur « repeat » (ou on tournera la galette pour les vinylistes) pour se replonger à fond dans cet excellent disque.

Voilà quelques temps que nous n’avions pas discuté de Clouds Taste Satanic ici, sans doute trop occupés par une mission supérieure lors de la sortie de leur précédent album l’an passé. Je suis cependant persuadé que le quartette psychédélique de New York nous pardonnera (comme s’ils pouvaient en avoir cure) avec l’écoute attentive et dévouée de leur nouvel opus 79 A.E.
Coutumiers de la piste à rallonge, les Américains ne nous ont pas laissé d’autre choix que d’invoquer en préambule de l’écoute le fameux “Pas ce soir, chérie, j’ai Clouds Taste Satanic”. A plus forte raison lorsqu’on s’attaque à 79 A.E., un album de 45 minutes divisé en deux pistes d’égales longueurs. Autant vous dire que pour aborder l’œuvre, on ne peut pas s’y prendre à plusieurs fois. Il faudra disposer de temps et d’une totale capacité de concentration.
On aurait pu s’attendre à deux fois 22 minutes de redites, mais ça aurait été sans compter sur l’ingéniosité des quatre gonzes de New York. On navigue ici entre un psychédélisme intersidéral et du stoner pur jus. Le tout est 100% instrumental et fait la part belle à une section rythmique où la basse écrase tout sur son passage mais laisse tout de même aux six cordistes l’opportunité de s’exprimer avec subtilité, comme lorsque sur “Collision” la saturation s’atténue pour un peu de légèreté électro-acoustique ou les envolées lyriques d’un solo tout floydien qui conclut la piste avec force majesté.
Cet esprit issu de Pink Floyd, poncif du genre, on le trouve en redites perlées tout au long de la seconde piste, “Reclamation”, durant laquelle le groupe effleure même des sonorités post-rock en alternant avec de bien plus méchants riffs grassement metal et mid-tempo. On est bien loin d’un bloc musical, plutôt l’enchevêtrement d’idées variées qui se répondent les unes aux autres au sein d’un même grand tout délicat à digérer au final.
Clouds Taste Satanic livre avec 79 A.D. un opus captivant mais bourratif. Casse dalle sans doute nécessaire pour explorer les confins du psychédélisme et du stoner en naviguant entre influences évidentes et parties instrumentales de choix. C’est une expérience immersive qui impose une écoute attentive et prolongée pour en saisir la profondeur. Un disque à réserver aux amateurs de sonorités progressives et de voyages musicaux intenses.

La dernière fois qu’on vous avait causé du trio Italien Mr Bison, le monde de la culture se mourrait (Oui ça se dit, c’est vilain à l’oreille mais ça se dit!), ses droits braqués par un vilain virus dont je me refuse à écrire le nom encore une fois. Comme à son habitude le groupe avait offert à nos oreilles un beau collier de perles progressives. Ils reviennent cette fois bras dessus, bras dessous avec Heavy Psych Sounds pour porter leur nouvelle œuvre, Echoes From The Universe et elle n’a pas eu à nous faire de l’œil longtemps pour qu’on aille passer du temps avec elle.
Du prog en veux-tu en voilà, encore une machine à remonter le temps pourrait on se contenter de dire. Mais voilà ce serait bien trop réducteur et surtout aller un peu vite en besogne. Echoes From The Universe c’est 41 minutes et 7 pistes taillées sur mesure pour les oreilles les plus sensibles à ce qui est beau et entraînant. Le chant en chœur se met à porter le thème, qu’il s’agisse de “Collision” ou de “The Veil” et on a envie de reprendre avec lui dès la seconde écoute. Les riffs montent lentement pour ouvrir “Dead In the Eye”, palpitent sur “Fragments” et en quelques notes on se retrouve happé par la piste. A titre personnel je retrouve des sensations que j’ai quelques fois avec Elder mais sans la lassitude que ce groupe finit toujours pas susciter en moi (Oui, je suis un hérétique et je n’en ai cure). Mr Bison fait de la qualité, c’est beau, c’est bien pensé, c’est entraînant et malgré tout parfois ça manque un poil d’aboutissement. J’ai trouvé à ce titre “Staring At The Sun” un peu trop frêle comme conclusion, allez savoir pourquoi. J’ai également trouvé déplacée la clôture de “Collision” qui semble du coup un rien bâclée après la joie toute personnelle qu’elle m’avait apportée. Non, il faut le dire cette plaque n’est pas parfaite et ne viendra probablement pas vous chauffer l’encéphale à blanc MAIS c’est important qu’elle ne soit justement pas parfaite car ce sera un prétexte tout à fait licite pour venir se jeter sur la prochaine production du groupe pour voir s’ils ont remonté leur niveau d’un petit cran tout à fait facultatif. Car au final, c’est chipoter que de relever ces anicroches dans un album qui n’a aucune vraie faille.
Si au détour de votre ennui vous ne savez que faire, venez découvrir Mr Bison si vous étiez passé à côté et pour celles et ceux qui se doutent de quoi il retourne, ne tardez pas à venir écouter cette prolongation de la carrière d’un groupe qui en l’espace d’une grosse dizaine d’année s’est installé dans un standard des plus respectables. Echoes From The Universe est une plaque complémentaire des précédentes, une prolongation et une évidence nécessaire.

En 2019, les Helvètes ont commis Sphere que nous avions – en commun et démocratiquement – élu album de l’année vu les qualités intrinsèques de cette production prodigieuse. Même si, en majorité, nous sommes plutôt bon public lorsqu’il s’agit de partager notre avis au sujet du quatuor de Lausanne – que nous chroniquons depuis leurs débuts vu qu’ils partagent avec nous une certaine longévité dans notre microcosme – c’est avec un peu d’appréhension que je me suis lancé à la découverte de cette nouvelle sortie qui débarque 5 années après la précédente réussite.
Mon appréhension trouvait ses fondements dans deux éléments bien précis : le premier était la lecture du fameux press-kit qui comptait les influences cinématographiques marquées sur cette production, toutes au rayon science-fiction (lequel ne m’attire franchement pas du tout) et le second tenait de la perception du bonhomme qui s’interroge lui-même (en tant que fan) sur la capacité de ses compatriotes à rééditer l’exploit commis avec la précédente livraison interstellaire (on n’est pas calviniste pour rien par ici). Pour spoiler le lecteur d’entrée, je peux lui dire qu’il s’agit d’un authentique produit de Monkey3, qui contient tous les marqueurs de la cuisine du groupe et que c’est pas un megamix des bandes-sons des films de Kubrick et compagnie : c’est de la bombe les enfants !
Tout d’abord, les artisans de cette réussite sont les mêmes que ceux qui ont œuvré sur son prédécesseur sauf pour ce qui est du bassiste, Jalil, qui rôde déjà sur scène depuis 2022. On reprend donc Walter à la batterie, Boris à la guitare, dB aux bidouillages électro et Raphaël Bovey derrière les manettes, on confie le mastering à Lad Agabekov et la pochette à Sebastian Jerke en demeurant, esthétiquement parlant, dans la lignée de Sphere, et, au final, on obtient une production dans la droite lignée de Sphere.
Ensuite, pour ce deuxième album concept de la discographie du groupe, le processus d’Astra Symmetry (qui n’est pas mon album préféré de nos potes) a été inversé en ne partant pas du concept pour composer, mais en composant pour converger vers le concept, ce qui fait une sacrée différence.
Alors, je vois s’élever des voix sceptiques au fond de la salle qui qualifient le quatuor de flemmards en sortant un album de « seulement » 5 titres, qui se déploient « seulement » sur 45 minutes, à qui je réponds bien volontiers que l’écoute de cet album dans l’ordre, même si elle est brève, est une expérience monumentale, à laquelle ne rend pas vraiment hommage la livraison en amont des deux singles « Rackman » et « Collision », isolés de l’ouvrage comme si on abordait un bouquin en lisant les chapitres de manière aléatoire. Je dis aussi à ces pisse-vinaigres que rarement la quantité fait la qualité d’une œuvre (allez voir la taille des tableaux de Vermeer).
Comme c’est un concept album et qu’il s’agit d’un tout, en voiture Simone, c’est moi qui conduit c’est toi qui klaxonne ! L’auditeur débute son voyage (qui dure le temps d’un épisode d’une série en vogue sur les plateformes de streaming) par « Ignition » avec des bidouillages à base de voix insérées dans des nappes de synthé posées sur une rythmique électro et, à peine installé dans le siège de son vaisseau spatial, il se prend, en pleine poire, une accélération jouissive de rock pur sucre. Ce morceau rapide superpose les riffs et les nappes traditionnelles du quarté gagnant en variant sur un thème central qui voit tour à tour la machine prendre l’ascendant sur les hommes, puis le contraire, puis, comme pour un happy end, l’homme et la machine avancer conjointement. C’est un truc de guedin que cette entrée en matière avec des déluges de guitares aériennes qui me laissent bouche bée (avec un filet de bave qui pend) avant un retour frontal de l’armada du rock qui ponctue le titre vigoureusement pour laisser place à « Collision » après 10 minutes. Déjà défloré sur la toile, ce single de 6 minutes aux textures jungle débute avec les basses en première ligne. Il illustre parfaitement le titre de cette production jusqu’à sa moitié et son titre propre aussi en se déployant en deux parties distinctes qui se collisionnent au milieu du chemin.
A mi-parcours du disque, c’est « Kali Yuga » que les petits veinards ayant assisté aux prestations récentes du groupe ont déjà dégusté live. Titre d’une dizaine de minutes, aérien dans son ensemble, mais pachydermique dans son exécution, ce morceau pourrait s’apparenter à un condensé de l’album à lui tout seul car il recèle tous les ingrédients dispensés durant l’écoute, avec un petit plus généré par le rendu très floydien et l’incursion de la guitare acoustique en tomber de rideau.
L’avant-dernier, déjà ? Ben ouais fallait suivre aussi, c’est « Rackman », le deuxième single, qui transpose le concept dans un territoire sombre, voire lugubre, sur une rythmique lente. La marche funèbre est en route jusqu’à un shift biomécanique induit par les machines qui accélèrent le tempo afin que les parties de guitares distordues viennent se déployer en première ligne avant un final rassemblant tous les protagonistes. Finalement, c’est « Collapse » qui vient conclure cette sortie en dépassant les 12 minutes au compteur (on est encore loin des plus de 14 minutes d’« Icarus »). D’abord tout en douceur, la clôture de rideau monte en intensité en cohérence avec ses prédécesseurs ainsi que, pour tout dire, avec la discographie complète de la formation. S’inscrivant dans la plus pure tradition des morceaux longs de Monkey3, cette dernière pièce a tout le potentiel de constituer un futur morceau de clôture de set hyper-bandant ! Il s’agit en tous cas d’une fin magistrale apportée à une production très homogène, qui ne s’adresse pas particulièrement aux zappeurs.
2024, l’odyssée du space-rock a un nom et c’est Welcome To The Machine, un disque homogène qui se savoure dans son intégralité et dans l’ordre. Plus qu’un énième album de la galaxie stoner, ce monolithe constitue une expérience musicale bipolaire entre les machines des musiques actuelles et un quatuor de rock aguerri ; c’est en tous cas une réussite de plus à mettre à l’actif d’une formation musicalement et humainement au top, qui est là pour durer ! Merci les gars !
Point Vinyle :
Le précieux sera décliné à sa sortie en trois versions différentes en plus de sa version digitale moderne ou cd passéiste. Tout d’abords le bon vieux vinyle noir, dans son gatefold, qui est sensé ravir les puristes du son. Une rondelle orangée synchro avec le parallélépipède rectangle de l’artwork, aussi dans un écrin gatefold, limitée à 300 unités qui ravira les puristes de l’astre solaire. Enfin une version Die Hard tirée à 200 exemplaires en vinyle transparent cristal avec slipmat et artwork au format 30 par 30 ce qui est assez pratique pour y loger un 30 centimètres sensé ravir les collectionneurs qui auront de toutes manières commandé la trilogie !

Nous avons pu assister à la démonstration scénique des tout jeunes doomsters de Witchorious lors du Westill 2024 et soyons francs, c ‘était sans aucun déplaisir. Le jeune trio parisien (de Chelles précisément) y avait déroulé un doom bien fait mais monté sur des pattes encore peu assurées tel le faon sortant du bois, c’était à la fois beau et touchant. Alors que leur première galette sort chez Argonauta nous saisissons l’occasion de reprendre notre observation de l’animal.
Il faut admettre que l’écoute de la plaque éponyme de Witchorious s’avère plutôt plaisante. Un travail bien fait, des chœurs qui se présentent à point nommé et qui avaient déjà su nous séduire en live. L’ambiance est sombre à l’instar de “The Witch” qui s’ouvre sur un thème des plus classiques et nous joue les bandes son de film d’angoisse à grands coups d’arpèges et de remontées de fûts tout en souplesse. La lancinance du chant d’Antoine le guitariste sur cette piste est particulièrement réussie ce qui tranche avec d’autres morceaux et des tentatives criardes sans doute encore un peu frêles. Ce fait est particulièrement marquant lorsque les deux genres s’enchaînent sur “Watch Me Die”. Pour autant c’est le carton plein lorsque la bassiste Lucie prend le chant comme sur “Eternal Night” en toute sensualité ou que les deux voix s’adossent sur “Monster” et “Why”.
D’excellentes idées il y en a plein la galette, une sorte d’épiphanie où chacun trouvera sa fève. Des riffs qui sonnent comme des évidences et une batterie soutien indéfectible de chaque titre excusent le titre “The Grave” que l’on pourrait presque considérer comme une sortie de piste trop lumineuse sur un album aux tendances sombres ; sans doute une tentative trop empreinte d’originalité en regard d’un album qui égrène les classiques du style.
Au final il faudra retenir de Witchorious une envie de faire les choses bien. Gageons qu’un travail approprié ne manquera pas de les mettre en avant parmi les jeunes formations hexagonales. En attendant la suite et jouant sur des bases classiques tout en apportant la touche de séduction suffisante à chaque titre, le combo délivre ici une première œuvre long format de bonne facture. Une affaire à suivre donc.
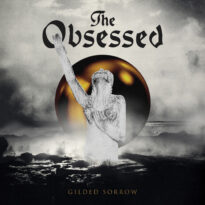
Quand Sacred est sorti en 2017, on n’en croyait pas nos oreilles : 23 ans après son prédécesseur (The Church Within), The Obsessed était bel et bien vivant. Même si imparfait (quelques morceaux de moindre intérêt) Sacred comportait néanmoins une palanquée de titres remarquables, signes d’un groupe non seulement fonctionnel, mais surtout inspiré, qui semblait en avoir encore sous la pédale ! Dès lors, l’annonce de la sortie de ce nouvel album n’a pas été une si grande surprise, mais elle charrie son lot d’enjeux pour le groupe : confirmer la continuité d’une discographie honorable jusqu’ici, et surtout maintenir l’aura culte que porte toujours The Obsessed.
A ce titre, les errements récents de Wino pouvaient nous inquiéter (avec, entre autres signes alarmants, un documentaire hagiographique hallucinant dont nous avons choisi de ne pas vous parler). En outre, l’instabilité du line-up ces dernières années ne montre pas le signe d’une dynamique de groupe très équilibrée derrière Wino, frontman et leader incontestable : autour de son batteur Constantino, présent depuis Sacred, ça valse côté bassiste… En revanche, l’incorporation de Jason Taylor en second guitariste confirme l’incarnation de The Obsessed en quatuor (sous la forme vue en live ces derniers mois, notamment au dernier Hellfest). Cerise sur le gâteau, cette pochette immonde, dont on pourrait parler des heures, coche à peu près toutes les cases de ce qu’il ne faut pas faire (couleurs moches, collage approximatif, symbolique hermétique, bras tendu questionnable, qui vient en outre interférer avec le logo – Qbsessed ?…) et inquiète plus qu’elle n’excite. Bref, dans ce contexte incertain, c’est un peu anxieux que l’on aborde cette nouvelle offrande…
Musicalement on n’est pas trop déphasé : The Obsessed reste le groupe de Wino, ses vocaux sont mis en avant (plus que sur Sacred), et la baraque tient sur ses riffs. On notera néanmoins que Taylor l’assiste sur la composition, proposant quelques bribes d’accords ici ou là… mais la “patte Weinrich” est bien présente sur toute cette galette, à travers ces riffs lourds et gras et ce très subtil groove nonchalant si caractéristique. On passe un vrai bon moment à dodeliner sur les riffs de “Daughter of an Echo” ou “Wellspring-Dark Sunshine”, clairement, de même que sur le doom old school lugubre de “Stoned Back to the Bomb Age”… Le morceau-titre “Gilded Sorrow” s’en tire aussi fort bien, avec de vrais moments de grâce, dont des soli déchirants et un break/conclusion vraiment dark très intelligents…
A côté de ces belles pièces, quelques titres ont un peu plus de mal à surnager, même s’ils sont parmi les plus accrocheurs de la galette… paradoxal ? Toujours est-il que des titres comme “Realize a Dream” ou “It’s not OK” (déja joué en live) vous resteront longtemps en tête, mais Wino joue la facilité avec ces titres catchy manquant un peu de profondeur, d’originalité et d’inventivité. C’est aussi le cas d’un “Jailine” particulièrement enjoué, mêlant americana un peu appuyé et riffing peu subtil aux relents redneck un peu patauds.
Après une petite demi-heure de nouvelle musique (on zappera vite cette nouvelle version de “Yen Sleep”, mieux produite mais sans réelle valeur ajoutée – mais ce n’est pas la première fois que Wino nous fait le coup) le bilan est un peu mitigé. Gilded Sorrow n’est pas un mauvais disque, il est assez homogène, et apporte une pièce solide et intéressante à la discographie du groupe. En revanche il souffre d’avoir trop peu de titres locomotives, des compos puissantes et inventives dont Wino a le secret, susceptibles de devenir des classiques instantanés : n’émergent de ce disque aucune chanson que l’on est sûrs de retrouver dans les prochaines set lists du groupe (alors que des chansons comme “Punk Crusher” ou “Sacred” sur son prédécesseur ne faisaient pas débat). Il n’empêche qu’y figurent quelques belles pièces qui s’inscrivent pleinement dans l’héritage Wino/The Obsessed, recelant de vrais moments de bravoures. Pas si mal finalement.

Lord Dying était déjà un bel exemple de groupe difficilement « cataloguable », et ce n’est pas ce Clandestine Transcendence qui va changer cela. Tandis qu’on était tenté de positionner le groupe de Portland sur une sorte de doom sludge progressif et subtilement déviant (déjà assez loin des étiquettes classiques) sur la base de leurs deux premiers LP, leur troisième album, Mysterium Tremendum, avait un peu rebattu les cartes : le groupe s’y permettait des excursions musicales plus audacieuses, pour un aspect expérimental qui venait enrichir et complexifier leur musique. Un peu confusant, mais cela a apporté une profondeur supplémentaire à ce disque qui continuait à distinguer Lord Dying du « tout-venant ». Il semble que le groupe ait maturé cette vision, qui vient (dé)structurer fondamentalement son nouvel opus.
En effet, il est vraiment difficile de faire émerger la tonalité musicale de Clandestine Transcendence. Les racines sludge-doom du combo sont bien là, elles constituent même en réalité le fil rouge musical du disque… mais ce n’est plus son socle désormais, chaque titre proposant une « couleur » particulière. Les lister serait stérile, mais le propos peut très bien s’illustrer avec quelques exemples. Prenons le bourrin « I AM NOTHING I AM EVERYTHING », qui opère comme un répertoire par le menu du doom-metal extreme : plans sludge, funeral doom, post-metal, black metal, le tout introduit par un stoner doom lourd et martial (à la sauce des premiers Conan)… Tout y est, naturellement amené, et parfaitement exécuté. Un peu plus loin « Final Push Into the Sun », s’il évoque Mastodon en bien des points (l’aspect démonstratif en moins), voit débarquer un break en mode chant crooner à-la-Mike Patton, puis des évocations de musique circassienne (ce n’est pas la seule fois où l’on pense à Mr Bungle – voir aussi « A Bond Broken by Death ») et un long final où viennent s’enchevêtrer des leads de guitare épiques et envoutants. On notera aussi la paire de titres qui clôturent la galette (« Swimming in the Absence » / « The Endless Road Home »), deux mid-tempo très mélodiques, chacun foisonnant d’arrangements divers et variés (guitares, chœurs féminins…) apportant densité ou finesse selon les besoins… (l’occasion de saluer la production de Kurt Ballou, ici bien efficace) Et c’est la même histoire sur tout le reste de l’album : on pense à QOTSA avant d’entendre du High on Fire, un peu plus loin un refrain fait penser à Faith No More, balayé par un riff Power Metal, qui introduit un break à la Bell Witch…
Le duo créatif à la tête de la bête (les guitaristes Erik Olson et Chris Evans) s’est entouré d’une nouvelle section rythmique avec les locaux Kevin Schwartz et Alyssa Mocere (madame Pike à la ville – c’était l’instant tabloïd), deux musiciens qui, s’ils n’ont pas beaucoup contribué aux compos, apportent une belle matière à l’ensemble, à travers un jeu de batterie riche et dynamique, et un jeu de basse efficace et robuste. Il fallait en tout cas trouver les bons instrumentistes pour soutenir un tel fatras musical, et c’est chose faite. Mention spéciale au chant de Olson, qui déploie un spectre vocal remarquable (en gros il peut passer par toutes les nuances de bourrin entre les borborygmes vocaux les plus extrêmes jusqu’au chant clair chaleureux type crooner), élément clé de la musicalité déployée par ce Clandestine Transcendence.
Alors, génie ? fraude ? disque en avance sur son temps ? branlette intellectuello-bordélique ? S’il est difficile de prendre de la hauteur, fions nous à notre intuition : Clandestine Transcendence est un disque vers lequel on revient, longtemps, souvent et un peu inéluctablement. Un disque qui, une fois terminé, laisse son auditeur convaincu qu’il y a « quelque chose d’autre à gratter », déclenchant, encore, une nouvelle écoute. Sa densité musicale, la diversité de ses propositions, contribuent beaucoup à cet état de fait, en cela qu’elles évitent l’impression d’avoir jamais fait le tour du disque. Mais fondamentalement, les compos sont efficaces, le travail mélodique en particulier est remarquable, et c’est avec envie qu’on souhaite ré-entendre ce disque. Une minuscule réserve : deuxième segment d’un triptyque entamé avec Mysterium Tremendum, sur la thématique de la mort, Clandestine Transcendence est si « bariolé » qu’il est difficile de faire émerger un sentiment de fond autour d’une même thématique (même si avec le prisme des paroles, le filigrane est plus clair). Bref, un très bon disque. Un grand disque ? Les années le diront.

Le Trio romain The Black Flamingo signe un premier LP chez Subsound Records, An-Nûr. Le groupe instrumental s’est rangé dans la case du stoner atmosphérique. Le label ne parvient pas souvent jusqu’à nos esgourdes et cette fois-ci on compte bien se saisir de cette production pour vous en dire beaucoup de bien.
“An-Nûr” c’est un verset du coran aux interprétations variées mais après écoute on retiendra celle qui parle de lumière car c’est le sentiment qui nous a saisi dès la première audition. La marque d’une musique forte et lumineuse.
On aura tôt fait de découper cette plaque en deux et si ami auditeur tu n’as pas le temps mais la curiosité nécessaire tu pourras te faire une idée du talent de The Black Flamingo tout au long des 13 minutes 46 de la dernière piste “Ayahuasca”.
Pour les moins sollicités d’entre vous, il sera possible d’apprécier les frasques d’un stoner entrelardé de samples allant du cri de Flamand rose à des murmures en langue arabe. Oh attention on est pas sur un stoner velu et sale mais plutôt sur quelque chose qui atteint une apogée mid-tempo au milieu de l’album sur “Due” et qui jamais ne cherche la cavalcade. Au pire on trouvera un peu de swing sur “An-Nûr”, mais aussi et surtout des riffs psychédéliques où la gratte se pare d’effets à base d’écho pendant que déroulent des samples qui finissent d’habiller la composition, à l’image de “Solaris” qui vient ensuite convoquer de belles lignes basses à la limite du post rock comme d’ailleurs sur la clôture saccadée de “Tredici”.
Se poser et allumer sa lumière intérieure. C’est en substance ce que l’on peut retenir de An-Nûr de The Black Flamingo. Un album méditatif et aérien qui accompagne paisiblement les rêveries de l’auditeur. On espère vite de nouvelles productions pour poursuivre le voyage avec eux et pourquoi pas fermer les yeux et se laisser porter collectivement dans la moiteur d’un club d’ici ou d’ailleurs.

Deux lettres qui résonnent comme un défi aux inquiétudes du moment, I.A, voilà le sobriquet choisi par Greengoat pour signer sa première plaque long format. Ce duo madrilène guitare/batterie qui enchaîne les singles depuis 2021 et vient nous gratifier en ce début d’année d’un album complet chez Argonauta Records avec la promesse de titiller nos envies de doom et de stoner.
De prime abord la plaque est plutôt séduisante avec un son stoner aux orientations atmosphériques. La voix mélodieuse d’Ivan associé à la frappe maîtrisée de Ruth offre un paysage léger non dénué de passages plus massifs comme quand sur le titre éponyme “I.A” ou “Naraka II” s’enchaînent thèmes instrumental et passages chantés.
Avec I.A il faut saluer la capacité de Greengoat à proposer des compositions en recherche d’équilibre et évitant de tomber dans l’excès gueulard et un peu facile, même si glissant parfois vers quelque chose de plus classique comme pour “The Seed” et “Burn The End” qui rentrent dans le standard du stoner un peu facile.
Et là tout est dit, parce qu’une écoute ne suffit que trop rarement à appréhender un album. I.A est sait faire la part belle aux mélodies et cherche l’équilibre mais le soufflé a tendance à retomber après quelques écoutes. On use assez facilement les pistes une fois passée la fraîcheur de la nouveauté et frôle l’exaspération en rejouant encore l’enchainement “Awake” puis “Naraka I” qui finissent par sembler poussives en regard du reste de la plaque. C’est peut-être parce que la galette est introduite par l’énumération des lois de la robotique que l’on accorde à Greengoat une première écoute bienveillante en attendant les riffs dénonciateurs et les avertissements sonores face aux dangers potentiels de l’automatisation.
Quoi qu’il en soit nous ne pouvons qu’encourager la curiosité face à cet album qui fait résonner un entrelac d’influences stoner, doom et psychédéliques choisies parmi les formations les plus contemporaines. L’arrangement des pistes est agréable, l’écoute facile et il ne serait pas étonnant que bon nombre d’auditeurs y trouvent leur compte.

Côté concept, on est probablement sur le projet le plus incroyable depuis longtemps. Bob Balch, le suractif guitariste de Fu Manchu (il accumule ces derniers mois les projets musicaux, contributions diverses…) a eu l’idée farfelue un jour qu’un groupe doom reprenne des titres de Slayer – les champions et précurseurs du thrash/speed metal – en les ralentissant, sous le très-bien-vu patronyme de “Slower” (“plus lent”, en anglais). Après quelques années d’hibernation de cette idée saugrenue, il décide de piloter lui-même ce projet, et s’acoquine en premier lieu avec Esben Willems, le batteur de Monolord, qui ne tarde pas à poser l’ensemble des lignes de batterie du disque. Côté basse, on va chercher Peder Bergstrand (Lowrider) pour la plupart des titres, et rien moins que Scott Reeder (feu-Kyuss, ex-Unida, etc…) sur un titre. Pour le chant – c’est un parti pris significatif – le guitariste s’oriente sur des vocaux féminins, assurés pour la plupart par Amy Barrysmith (bassiste et chanteuse de Year of the Cobra), et Laura Pleasants (feu-Kylesa) sur un titre. Le line-up est pour le moins bigarré, mais le cumul des lignes sur tous ces CV file des frissons quand même ! Dire qu’on s’est jetés sur le disque est un euphémisme…
En théorie, la chronique aurait pu s’écrire toute seule : les zicos se sont accordés cinq tons plus bas, ont divisé le tempo par cinq, et ont ré-arrangé les standards de Slayer en configuration doom extrême. Jackpot. Sauf que non, l’intention est plus nuancée. Premier constat : les tempi ne sont pas SI lents. En gros (après mesure d’huissier), on est sur une réduction d’un facteur de 1,5, voire 2 maximum par rapport à la vitesse d’exécution d’origine. C’est pas mal et remarquable, mais les gros doomeux bas du front qui sommeillent chez certains (je plaide coupable) auraient bien apprécié l’expérience en mode funeral doom absolu, tant qu’à faire mumuse… L’autre travers de cette réduction “relative”, est que les riffs sont très reconnaissables… trop ? Franchement, même s’il est ralenti, vous vous prenez systématiquement à fredonner le riff de “Dead Skin Mask”, et en conséquence la chanson perd l’occasion de prendre une vraie “autre” dimension, sa propre identité. Dit autrement : le concept aurait pu transfigurer les chansons, les “dépiauter” pour faire émerger la substantifique moelle du RIFF nu, froid, désossé, mais malheureusement on reste dans le registre de la reprise ralentie de Slayer. Ce n’est pas un échec en tant que tel (après tout, c’était le projet !), mais on garde toujours dans un coin de l’esprit cette question : “et si… ?”
Un autre facteur nous amène à cette réflexion : la (bonne) idée de confier le chant à des chanteuses traduisait une volonté de transformation profonde des chansons, de réappropriation stylistique complète et radicale. Cette transformation a lieu… mais elle n’est pas “radicale”. Plus généralement, musicalement, vous l’aurez compris, la surprise “waouh” n’est pas au rendez-vous : on a un guitariste qui doit effectivement kiffer de jouer ces riffs très bien arrangés et ralentis, avec ce son stoner doom assez remarquable, c’est quand même un peu jouissif reconnaissons-le ; une sorte de modeste réappropriation culturelle. Côté rythmique, l’exercice ne met pas forcément en avant la virtuosité des protagonistes, qui tiennent la baraque, sans relief particulier. On regrettera même certains arrangements, à l’instar de cette double grosse caisse sur le couplet de “War Ensemble” qui involontairement et inconsciemment nous ramène au speed metal et nous fait à nouveau sortir du champ instrumental emblématique du doom. Pour revenir au chant, au vu du casting, on n’est pas sur du chant de soprano non plus, ces dames ayant un timbre assez neutre voire modérément grave par nature. Les lignes de chant sont un peu dissoutes sous les effets ou dans des choeurs pour donner une tonalité aérienne un peu dissonante avec le style pratiqué, ce qui appuie le constat décrit en tête de ce paragraphe : l’intention de “rupture” était bien là, mais elle ne va pas beaucoup plus loin que ce choix (très intéressant, répétons-le).
Le track list retenu laisse aussi une petite impression de “ni fait, ni à faire” : cinq chansons seulement (une de Show No Mercy, le morceau titre de South of Heaven et rien moins que trois de Seasons in the Abyss !), même si elles tournent autour de 8 min en moyenne, ça laisse une impression de trop peu pour ce qui reste un album de reprises. Il y avait quand même de quoi aller piocher d’autres morceaux dans la discographie pléthorique des thrashers californiens (en particulier dans le classique Reign in Blood, mais pas que) pour remplumer un peu cette galette un peu légère (38 min, minimum syndical vraiment).
Depuis de très nombreux mois on scrutait ce projet avec le secret espoir qu’il pourrait faire date, tant il réunissait toutes les conditions pour faire parler de lui : il mêlait respect, ironie bienveillante, second degré et légitimité musicale, le tout mâtiné d’une intention musicale inédite. Au final, l’effet obtenu est plus proche du “pschiit” que du “waouh” – un brin de déception, donc. Non pas que le disque soit mauvais : il pourra être vu comme sympathique pour les amateurs de Slayer, et étonnant pour les amateurs de doom. Mais il aura du mal à trouver une place de référence dans la discographie d’une de ces deux catégories, ne dépassant jamais le statut d’anecdotique. Slower est un disque que l’on aurait adoré adorer, on y était préparés : on aime toutes ses composantes (ses musiciens, son intention…) mais au final la magie n’opère pas comme prévu ou espéré. On en est les premiers déçus.

Si vous changez quelques lettres à Seattle, ça fait Toulouse.
Les têtes pensantes de Sub Pop devaient savoir que le trio à la chevelure lisse né en 2016 au fil de la Garonne ferait honneur à l’histoire de ce label précurseur des premières heures du mouvement grunge. Point de chemise à carreaux et de power chord dépressif pourtant chez le trio toulousain, mais une envie furieuse de repousser ses limites et de s’affranchir des codes du/des genre(s) dans lesquels il évolue. En cela, Slift s’inscrit pleinement dans la ligne directrice du label.
C’est donc sous l’égide du mastodonte américain que le trio sort son nouvel album, Ilion. Succédant au non moins immense Ummon (je passe volontairement sur le 2 titres précédent), le nouvel opus soutient-il la comparaison avec son grand frère ? Transcende t-il les frontières des genres ? S’affranchit-il des balises et autres jalons stylistiques posés consciencieusement par l’album-révélation le précédant ? Afin de ménager le suspens et de pousser un peu plus le curseur de l’envie, je vais écrire juste ci-dessous trois petits points qui ne manqueront pas de susciter votre curiosité.
…
Ce qui marque d’emblée chez Ilion, c’est sa propension à repousser, à repenser la notion de mur de son. Tout y est plus vaste, plus grand, plus fort. C’est l’immensité de l’espace qui sert de scène au trio et toutes ses idées se retrouvent catapultées vers l’infini et au-delà, boostées par mille trouvailles de production, comme autant de moteurs Raptor collés au cul de la fusée Slift.
La première et géniale idée est d’avoir mis plus en avant la basse de Rémi Fossat. Le gonze déploie des merveilles de lignes, soulignant la fureur quand elles le doivent mais surtout transcendant des parties chant quelques fois en deçà du reste. Pour le coup une écoute de « The words that have never been heard » vous convaincra sans problème du haut degré de talent du bonhomme.
Le travail de composition fait montre d’une précision plus ciselée que de la ciboule chez Thierry Marx. Certes, il faut avoir une appétence pour le progressif mais les titres fleuves déployés ici ne souffrent que très rarement d’ennui ou de redite. Allez, on va dire que « Ilion » et « Nimh » semblent calqués sur le même schéma, ce qui ressort d’autant plus que les titres se suivent. Mais le reste est une pépita d’écriture atteignant son apogée avec des morceaux tel que « Confluence ». Le groupe manœuvre son vaisseau amiral avec une aisance insolente entre jam solaire et riffs Crimsonien en diable.
Canek Flores, le batteur, mérite à ce titre son petit chapelet de louanges. En délaissant les rythmes répétitifs du Kraut très présent sur Ummon, en s’octroyant des espaces de libertés plus conséquent, il permet à la musique de Slift de prendre une dimension bien plus large et psychédélique qu’auparavant. C’est plus ouvert, plus technique, l’écrin rythmique plus solide est une formidable rampe de lancement pour la guitare supraluminique de Jean Fossat.
Ce dernier continue son travail de recherche et d’expérimentation tous azimuts avec sa six cordes et ses claviers. On le savait capable d’atteindre des sommets de notes liquides ou poisseuses comme le pétrole, voilà qu’il nous prouve qu’il est capable d’écrire du rock poussiéreux et dépressif, « Uruk » ne manquant pas de rendre hommage à quelques illustres pensionnaires de la maison Sub Pop.
Le chant mériterait peut-être un peu plus de considération dans la production de Ilion, l’album. Tout y est tellement massif que la voix, traitée elle aussi de cette manière, se retrouve cantonnée au rôle de couche supplémentaire. En résulte une lassitude légère, tant on aimerait parfois que cet instrument nous parle plus directement, avec moins d’artifices et de subterfuges. J’en veux pour preuve « The story that has never been told » où la voix narre enfin et se pare de beaux atours mélodiques. Après, je suis vieux, je fatigue plus facilement… Allez savoir où se situe la frontière ?
De frontière justement, il n’en est pas question sur le nouvel opus de Slift. On traverse des paysages sonores, on y rencontre des personnages étranges, on se questionne sur l’immensité de la solitude, sur sa beauté aussi. On est happé par leur volonté de grandir, de changer, d’évoluer. De ne jamais s’endormir sur ses acquis. Le trio tente de nous faire comprendre que le voyage est plus important que la destination. Car tel est le propos de Ilion. Un grand album, dense, riche, difficile d’accès parfois mais par combien malin et surprenant. Un véritable tour de force qui place Slift parmi les très grands de la scène actuelle.

Bismut est un trio hollandais dans la catégorie basse/batterie au service d’un guitariste omniprésent. Du coup, qu’est ce qui distingue ce groupe des autres dans un milieu hyper saturé ?
Bien difficile de trouver les arguments sauf à vous dire que vous devez absolument leur donner une chance car les ignorer c’est risquer de passer à côté d’un groupe que vous pourriez adorer.
Bref, sur le papier, pas grand-chose de différent avec la pléthore de trios du genre. La section basse/batterie est impeccable et fait le boulot. Pas trop mis en avant, le bassiste et batteur n’en sont pas moins très solides et si on se concentre sur l’un ou l’autre, on découvre même de jolies lignes de basse par-ci par-là et quelques envolées de batterie franchement sympathiques.
Mais bien sûr, le grand attrait du groupe c’est son guitariste. Le bougre est fichtrement talentueux et régalera certainement les plus exigeants des auditeurs amateurs de ce style de performance.
Mais à part cela, vous me direz… Car là encore, je coche ce que valident déjà pas mal de combos.
Et là c’est bien plus subjectif. Les compos sont excellentes. Nik Linders car c’est son nom, multiplie les riffs, enchaîne les variations et si vous aimez quand c’est copieux, vous allez être servis. C’est très difficile d’expliquer pourquoi un riff vous touche, pourquoi cet enchaînement de notes plus ou moins court vous fait frétiller les oreilles et inconsciemment bouger la tête. Et là, c’est le cas pour moi. Chacun des 5 titres contient ces petites merveilles, ces petits riffs qui vous vrillent le cerveau illico. Et je suis très sérieux en plaçant certains d’entre eux parmi les plus efficaces que j’ai entendus depuis bien longtemps.
Ne vous inquiétez pas, la machine à riff est tout aussi capable de vous balancer des solos d’une dinguerie stratosphérique et qui viennent compléter le tout majestueusement.
Finalement, Ausdauer est un album à mettre dans le haut du panier. Objectivement aucun défaut et tout pour plaire.
Alors oui, certains iront jeter une oreille et se diront que cette chronique est trop dithyrambique. C’est le côté subjectif. Mais d’autres se diront, ah oui, quand même, c’est méchamment bon ce truc. Et ils seront nombreux.
Ensuite, que vous soyez dans la première ou seconde catégorie, n’oubliez pas une chose, ce genre de groupes, c’est en live que ça prend tout son sens. Si vous voyez leur nom en festival, allez les voir, je vous assure que vous serez comblés et je parle en connaissance de cause.
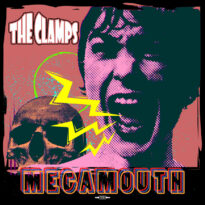
Trois italiens à la touche cuir et lunettes de soleil, tout droit sortis du bourbier de 2020-2021 souhaite encore faire entendre sa hargne et purger les derniers relents de pandémie dans une troisième galette soutenue par l’omniprésente boite de prod Heavy Psych Sounds. La chose s’appelle Megamouth, tout un programme qui avec un patronyme pachydermique si usé qu’il peut faire craindre le pire comme le meilleur. N’écoutant que notre devoir, nous avons saisi l’objet du bout des doigts sans nous pincer le nez et avons approché une oreille attentive.
Moins subtil que Orange Gobelins, un rien plus délicat que Motorhead voilà en quelques titres voici comment The Clamps pose son œuvre. Le trio se la joue bas du front, pieds dedans. Ne s’encombrant pas de fanfreluches les italiens vont directement à l’essentiel et devraient vous faire hocher la tête et peut-être même un peu bouger les pieds. On retrouve dans ses compositions une guitare à toutes berzingues et une basse roulant et ronflant tant qu’elle peut derrière une batterie qui elle, joue vite, simple et efficace sur base de caisse claire et de cymbale crash.
Une voix crasseuse qui pue la clope et le whisky bon marché, Il y a des moments où on se croirait chez les Australiens de Mammoth Mammoth. La production est dans le même esprit et mise tout sur le très gros son, mais quoi d’étonnant quand on sait que le groupe est signé chez HPS qui aime l’efficacité et s’adonne assez peu à l’originalité pur jus.
Je dis que l’album parait bas du front et ne s’encombre d’aucune subtilité mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt (entendez par là: A la première écoute). une écoute plus attentive et le son sur 11 sera nécessaire pour permettre à l’auditeur de découvrir ici et là quelques anecdotes musicales assez réjouissantes. Qu’il s’agisse de l’éphémère guitare rock country Sur “Forty-Nine” (Qui, non n’est pas une reprise de Karma To Burn), des sautillants patterns de batterie sur la dernière piste “Slippin’ Away”, de la musique qui démarre au rythme effréné du moteur de dragster de “Bill Jenkins’”, de l’intro Fu Manchuesque de “CuboMedusa” ou encore du classicisme des riffs de basse sur “Bombs” on trouvera ici et là toujours quelque chose d’intéressant où s’arrêter.
Megamouth n’est pas un album aussi basique qu’il semblerait, il est en inox et pourra être resservi, poncé, essoré un nombre de fois certain avant que vous en veniez réellement à bout. The Clamps signe ici un album à servir en toute occasion, que ce soit pour un apéro sur le pouce avant de partir en bamboche où pour animer une longue conférence sur les postiches. Soyez malins, il paraît que l’hiver sera rude et si jamais faute de moyens vous vous retrouvez en panne d’électricité, posez simplement la galette Megamouth sur votre platine, il se pourrait bien que vous vous retrouviez avec un groupe électrogène à peu de frais.

Volume est un groupe stoner fuzzé californien, contemporain des Fu Manchu et autres combos fuzzés évoluant entre acid rock et space rock, à une époque et dans une région où vagues épiques et volutes hypnotiques se mêlaient généreusement. En réalité quasi one-man band, Volume n’a en réalité jamais émergé comme un grand groupe, ni même un groupe culte, et son frontman Patrick Brink (qui fut un temps vocaliste volatile pour Fu Manchu – dont le batteur Scott Reeder officie ici derrière les fûts… vous suivez ?) n’a jamais rebondi dans sa carrière musicale.
Ce Requesting Permission to Land, décrit comme un EP (5 titres pour 33 minutes, certains ne s’embarasseraient pas pour considérer cela comme un LP…) est le (vieux) fruit d’un groupe décédé depuis longtemps, le disque étant originellement sorti il y a plus de vingt ans sur un obscur label australien, uniquement en CD. C’est à l’occasion d’un vingtième anniversaire (que – soyons honnête – personne n’attendait vraiment) que Volume voit l’occasion de ressortir ce disque en vinyle, s’appuyant sur rien moins que… cinq labels complémentaires !
Les premières écoutes transmettent avant tout cette sensation de musique un peu surannée : même si le culte Jack Endino s’est chargé du re-mastering, les bandes sonnent comme des vieilles démos, et le son ne prend jamais l’ampleur qu’il mérite. Ça manque de puissance, c’est noyé dans une fuzz un peu sale et lointaine et ça sonne comme si ça avait été enregistré dans la cabine de douche d’une hôtel Formule 1. Dommage.
Musicalement, on comprend aussi un peu pourquoi le groupe n’a jamais vraiment émergé après ça : il y a beaucoup d’excellentes choses sur ces cinq titres, en particulier une poignée de riffs vraiment sympas (très Fu Manchu-esques) et cette énergie punkoïde des premiers groupes du label SST, vraiment fraîche et enthousiasmante. Malheureusement les compos manquent de clarté, et partent trop souvent en vrille, au gré d’un break capillotracté ou d’un “morceau dans le morceau” (voir “Habit”), sorte de poupée russe musicale qui détache l’auditeur plus qu’il ne maintient son intérêt. Ne parlons pas de ces dilutions un peu factices, notamment sous forme d’arrangements parfois un peu grotesques (cf. les délires bruitistes du beaucoup trop long “Headswim”), qui n’ont comme résultat que d’éloigner le groupe de cette tendance des groupes sus-mentionnés à produire des compos simples, efficaces et directes.
Requesting Permission to Land est un témoignage sympathique d’une période bien précise et d’un bassin musical très ciblé (le sud de Los Angeles). Musicalement, Volume était un groupe intéressant, porteur d’innombrables bonnes idées, mais qui aurait eu utilité à travailler son propos dans le temps, développer son style, maturer… Chose qu’il n’a jamais eu le temps de faire.

Le trio italien a beau faire ce qu’il peut, dans les esprits il est toujours un peu engoncé dans son concept légèrement infantile (Humulus = Houblon), dont il aura toujours du mal à se dépêtrer, nonobstant l’ambition musicale qu’il a commencé à dessiner avec son album précédent. Revenus au bercail (Go Down records) pour leur ici-présent troisième long format, le groupe y intronise aussi Thomas Masheroni, rien moins que son troisième guitariste/chanteur ; un par album ! Pas un détail quand même, de voir un line-up tenir la distance porté par sa section rythmique seulement, quand on connaît l’influence du jeu de guitare sur ce style musical.
Du coup, l’identité du groupe s’en trouve secouée, légitimement, et l’on a du mal à retrouver nos petits – tout chamboulés que nous étions déjà (rappelons-le) par le step entre les deux premiers albums. Pour ce nouveau disque, le trio s’est appuyé sur une longue période de jams visant à intégrer le petit nouveau et constituer le « nouveau » son Humulus, et a sollicité rien moins que Stefan Koglek, môssier Colour Haze, pour superviser la production du disque. Voilà qui fixe une ambition.
L’écoute du disque révèle, effectivement, une facette plus complexe et mature de Humulus. Cet ensemble de compos (7 chansons, 43 minutes – rien à redire) est riche et diversifié, intéressant de bout en bout, couvrant un stoner rock de large spectre, à la sauce transalpine. L’apport de Masheroni est significatif, une large part de la musicalité du groupe reposant sur ce travail de guitare, et en particulier sur cette dualité entre des riffs bien charpentés (« Secret Room », « Black Water »…) et surtout des arpèges disséminés à la moindre occasion (lead d’intro sur « Shimmer Haze » ou « Buried By Tree », la plupart des leads sur le gros « Operating Manual… », le solo tout en feeling sur « Black Water »…). Evidemment, la section rythmique n’est jamais prise en défaut, et les nombreuses séquences largement instrumentales permettent d’en mesurer l’importance dans le spectre rythmique et mélodique.
Si l’on devait identifier quelques morceaux remarquables, on orientera en première écoute vers le curieux « Secret Room » (son intro de pure hargne hard rock punkisant amenant à une section groovy-jazzy sur nappe de leads de guitare aérienne) mais surtout ce somptueux « 7th Sun », belle pièce de psych rock aux volutes presque orientales, qui voit son dernier tiers développer un groove quasi irrépressible. Le groupe a bien vu la qualité de cette compo, et a demandé à Koglek d’y glisser quelques parties de guitare bien senties qui emmènent encore plus haut la chanson. Point bonus pour « Operating Manual for Spaceship Earth » qui déploie lui aussi sur une dizaine de minutes une belle série de séquences musicales, convoquant occasionnellement les grands My Sleeping Karma ou les maîtres du stoner old school pour un final où wah-wah et fuzz se partagent la vedette.
Bref, ce Flowers of Death est une réussite de la part de ce groupe intéressant, un peu trop sous-estimé et qui se fait trop discret (en particulier sur scène). Ils méritent mieux que ce traitement silencieux, penchez-vous sur leur cas vous ne devriez pas être déçus si vous aimez le bon stoner rock.
|
|