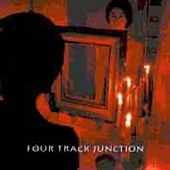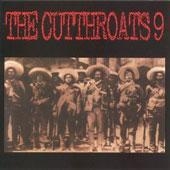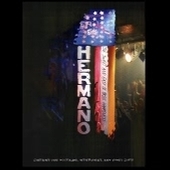|
|
 La formation de Bologne emmenée par sa vocaliste Alice s’est payé le luxe d’embaucher le mythique Steve Albini pour produire son cinquième album mis en boîte en février deux-mille-huit de l’autre côté de l’Atlantique. Il va de soit qu’au niveau du son on joue dans la cour des grands même si certains rendus flirtent dangereusement avec l’indie rock débridé US et perdent par conséquent un peu de leur patine fuzzy.
Historiquement, la formation créée en nonante-sept a déjà au compteur un nombre honorable de concerts qui les virent partager la scène avec tout ce que le rock énergique compte de grosses pointures tous styles confondus. Derrière sa frontwoman qui assure le tambourin en plus du chant, nous retrouvons Pippo à la six-cordes, Franco à la quatre-corde et Andrea aux baguettes. Partis en tournée avec Dozer et Pawnshop il y a quelques années, les influences de ces deux formations venues du froid se font sentir sur cette plaque qui ravira les fans les fans de Misdemeanor (essentiellement à cause du rendu des vocaux).
Composée de dix titres, cette galette fait dans le fuzz originel très propret à l’exception d’un blues et d’une longue plage de huit minutes qui mixe habilement les influences désertico-acoustique d’ODD et les plans alambiqués à la Pink Floyd. Plutôt abordable par un large public, cette nouvelle production du groupe transalpin contient quelques pépites qui groovent en diable à l’image de ‘Good One’, ‘The Sweet Smelling Road’ ou de ‘Solid As A Stone’.
Cette sortie qui se distingue dans ce monde de brutes par ses chants féminins est une agréable surprise qui propose un programme concis et foutrement bien huilé même si le son rutilant manque au final un peu de spontanéité dissonante.
 En dix ans d’existence, le quatuor suédois considéré par les spécialistes du genre comme une des références du stoner, ne m’a jamais déçu et ce n’est pas en alignant des pépites comme en contient ce quatrième album qu’ils sont prêts à le faire. Enregistré dans l’austérité d’une ex-forteresse de l’armée soviétique dans la baie d’Helsinki, le Seawolf Studio, par Miko Poikalainen, cet album est direct, incisif et sans artifices inutiles.Produite par le groupe, cette œuvre est la plus aboutie de toute leur discographie (ce qui n’est pas peu dire). Sans jamais relâcher la pression, Dozer aligne titre sur titre avec une facilité déconcertante et retranscrit sur disque l’intensité scénique qui a largement contribué à l’estime qu’on lui porte aujourd’huiLa rythmique est bien plombée avec la frappe métronomique de Daniel et l’appui de Johan et de sa basse dévastatrice ; cette lourdeur rappelle d’ailleurs plus les concerts du groupe que ses précédents albums (ou split mythique). Frederik n’a pas changé son style vocal, mais l’appui d’effets plus ou moins bien senti, moins en ce qui concerne ‘The Roof, the river, the revolver’ – sur la voix permet au groupe d’élargir un peu le spectre habituel. Tommi le guitariste solo, accompagné dans sa lourde tâche par le chanteur, assène des riffs pas forcément très élaborés, mais ô combien efficaces dans un registre très rentre-dedans.Durant quarante-cinq minutes environ, cet album propose dix titres dont la plupart sont dans la veine de ce que le groupe peu faire de mieux à mon sens : huit compos proche de ‘Supersoul’ ou de ‘Rising” ! Que ce soit le rock rapide de ‘Man on fire’ ou le presque langoureux ‘Days of the future past’, les compos réunies sur cette galette très homogène ont toutes ce petit plus inexplicable qui différencie un bon morceau d’un morceau tout court et ce petit plus doit, dans ce cas de figure, être dû au talent du groupe. Les deux titres restants sont un très long morceau qui dépasse allégrement les huit minutes intitulé ‘Big sky theory’ lequel évolue dans un registre entre le Dozer habituel et le rock progressif et un chef d’œuvre nommé ‘Until man exists no more’ avec la contribution de Troy Sanders qui est une énorme baffe dont j’ai de la peine à me remettre ! Débutant dans un style assez habituel pour la formation, ce morceau s’achève dans une débauche de son qui porte une envolée lyrique toute en noirceur du bassiste de Mastodon. Que du bonheur !Cet album frise la perfection et je ne me lasse pas de le faire tourner et tourner encore dans tous les lecteurs possibles.
Glasspack, comme 95% du roster du brillant label ricain Small Stone, m’avait laissé l’impression d’un groupe qui bastonne sévère, les pieds sévèrement encrés dans un hard-stoner crasseux “à l’américaine”. Etonnamment, cet album confirme tout ça !
Ben oui, “Dirty Women” est le genre d’album qui rue dans les brancards, chargé de grattes poisseuses sur fond de base rythmique saturée et déchaînée. Le power trio mené par Dirty Dave Johnson reste donc bien à l’aise dans son genre de prédilection. Ca joue bien (c’est pas du Dream Theater, mais les gars s’y entendent pour tomber un instru parfaitement jouissif, cf. “Fastback”), ça éructe dans le micro (la voix de Johnson pourra en énerver certains, nasillarde et glaireuse, mais elle sied parfaitement à la musique), ça groove (finalement c’est quand même à ça qu’on reconnaît un bon trio, voyez le break sur “Ice Cream”, avec son passage d’orgue), c’est globalement impeccable. Pour ne rien gâcher au paysage, le père Johnson sait composer, et ses chansons fonctionnent bien, et n’ennuient jamais : se détachant du trop systématique enchaînement couplet-refrain-couplet-refrain-break-couplet-refrain, il n’hésite pas à prolonger des parties instru si le chant n’apporte rien, ou bien encore à couper après moins de 3 minutes ses chansons : pas de gras, que de la barbaque ! Des relents punk bienvenus parfois.
Bref, cette excellente galette vous procurera une bonne rasade d’americana bien tassé (Kentucky-power), le tout bercé par des tonnes de gratte bien saturée, de soli dissonants et de riffs impeccables. Ou alors vous avez Dream Theater.
 Fascinante Italie. A peine leur avons-nous renvoyé Paolo Persechetti qu’ils nous dépêchent OJM. Composé des collaborateurs habituels de Paul Chain, aucun d’entre eux ne semble avoir d’accointances avec les Brigades Rouges. Toutefois, sitôt plongés dans leur heavy-psych-garage poisseux, ces rockers honorables (en surface) laissent transparaître les substrats d’une force subversive gorgée de fuzz dont la capacité de nuisance devrait inquiéter Berlusconi et ses fantassins. Redoutablement efficace, la musique d’OJM distille un venin qui se répand insidieusement dans l’organisme. L’excellente reprise du « TV Eye » des furieux de Detroit donne à penser que l’anticorps est connu de longue date. Inoculation. Et pourtant. Dans sa foulée, « As I know », fulgurante épopée powerpop laisse entrevoir une accalmie. Le poison est maîtrisé. Du moins est-on tenté de le croire. C’est sans compter qu’il reste trois morceaux. Nouvel embrasement des chairs. La menace resurgit. Ce disque vous estourbi. Vicieux et maîtrisé, l’art perfide d’OJM est d’imprégner votre conscience de sa beauté glauque. Ciguë post-moderne dont on se délecte sans la moindre lassitude.
 Le cinquième effort de Brant Bjork est enfin là. A moins que l’on ne considère cet album comme étant le deuxième du groupe Brant Bjork And The Operators. Peu importe en fait puisque ici il s’agit des deux ! En effet, Mr Cool et sa bande ont choisi de nous offrir non pas une mais deux galettes. La moitié des titres ont été enregistrés par Brant seul comme à son habitude et l’autre moitié par tout le groupe. La première chose à dire c’est que l’homogénéité de l’ensemble est étonnante et qu’il est même difficile de véritablement distinguer les titres enregistrés seul par Brant des autres enregistrés avec Dylan Roche (basse), Cortez (guitare) et Michaël Peffer (batterie). Le résultat de tout cela est que l’on se retrouve avec l’album le plus abouti depuis Jalamanta, c’est peu dire. Le sang neuf apporté par les Bros est flagrant et même si c’est Brant qui continue à écrire les chansons, on sent bien que ces « frères » ont du lui suggérer quelques petites idées. Je pense en particulier au jeu de basse bien plus riche que sur les albums précédents même si j’avais noté d’énormes progrès de Brant à ce niveau sur Local Angel. Mais l’apport de Dylan est indéniable et son jeu de basse exceptionnel apporte un petit plus incontestable. Les 19 titres de Saved By Magic balayent de manière impeccable tous les courants musicaux chers à nos amis. On retrouve des influences multiples mais la plus flagrante reste le rock des années 60 ; la reprise de Sunshine Of Your Love de Cream est là pour le confirmer. On a aussi le droit à quelques titres « jammesques » du plus bel effet et qui trouveront assurément une place de choix lors des concerts du combo. D’ailleurs, l’ambiance que crée ce double album est tout à l’image des concerts du groupes, une alternance de titres courts et efficaces (Get Into It, Lil’ Bro) et de titres calmes et planants (Dylan’s Fantasy, Paradise On Earth). Brant Bjork a indubitablement pris la bonne décision en choisissant de s’associer pleinement avec les Bros pour ce double album et le résultat est d’une qualité telle qu’il saura à coup sûr renouveler l’expérience pour un prochain opus que l’on attend déjà avec impatience.
 L’homo sapiens est à n’en point douter un mammifère étonnant. Un exemple parmi d’autres. Equipez-le d’une guitare, d’un banjo, d’un slide, d’une grosse caisse et de cordes vocales. Et voilà qu’avec un peu de talent, ce même homo sapiens est capable de vous pondre un disque. Voire un très beau disque. Pas mal pour un mammifère. Non ? Il se trouve que c’est exactement ce à quoi s’est employé William Elliott Whitmore. Fort de son charme rustique si caractéristique du Delta du Mississippi (bien qu’il soit originaire de l’Iowa), le gars Whitmore combine esthétique du dépouillement et de la mélancolie avec une élégance forçant le respect. A la croisée d’un Skip James, de Lynyrd Skynyrd et de PW Long’s Reelfoot (ex-chanteur des fabuleux Mule ayant sorti quelques perles sur Touch and Go au siècle dernier), Sir Whitmore vous colle des frissons de bonheur dans l’échine. Sobre, sa musique est terriblement touchante. De quoi se réconcilier avec le monde. Tant qu’il y aura des vertébrés supérieurs qui produiront des disques de cet acabit, tout ne sera pas totalement fichu dans cette vallée de larmes.
Ce disque aurait pu passer complètement inaperçu, or il s’est finalement retrouvé dans le top de ma playlist de ces dernières semaines. Ce groupe australien partage le même label que Masters Of Reality, ce qui a commencé à me mettre la puce à l’oreille. La qualité intrinsèque de cette production, même si elle ne se situe pas franchement dans un courant directement dérivé du stoner pur jus, m’a incité à en parler ici.
Musicalement, la musique du trio est très difficile à catégoriser. N’allez pas pour autant croire que le groupe part dans tous les sens et expérimente à tout va ; simplement, la musique de Tracer est une sorte de mix de 2 décennies de gros rock, une synthèse que seuls certains groupes australiens peuvent produire (les combos australiens sont souvent des groupes aux démarches très indépendantes, peu liées aux modes). En l’occurrence, l’on retrouve ici pas moins de 12 titres de très gros heavy rock rocailleux, évoluant en gros entre le hard rock tendance sudiste (à l’image d’un Black Stone Cherry, voir le single « Too Much », bien burné et garni de soli) et le grunge le plus heavy (tendance Tad, voyez). Factuellement, les influences sont assez éparses et balayent large, même si elles sont facilement observables. En premier lieu, ce qui se remarque le plus c’est les intonations du chant qui parfois poussent très très fort du côté de Chris Cornell ou Layne Staley (« Dead Inside » propose une sorte de mélange des sonorités de ces deux grands vocalistes). Connaissant les accointances entre les fans de stoner et les amateurs de ces excellents groupes que sont Soundgarden et Alice In Chains, ce point ne devrait pas paraître rédhibitoire, au contraire. Au-delà du chant, le trio se vautre aussi parfois sur les plate bandes musicales de Soundgarden (sur des titres comme « Spaces in between », « All in my head » , « Save my breath ») et d’Alice In Chains (le refrain de « Won’t let it die »). Occasionnellement, les sonorités « QOTSA-esques » pointent le bout de leur très gros nez, notamment à travers l’insolent couplet de « Push » (mettez un peu de QOTSA dernière période avec du Them Crooked Vultures et un zeste de Masters Of Reality) ou la rythmique de titres comme « Devil Ride » ou celle du couplet de « The Bitch ».
Au final, cette diarrhée de name dropping pourrait laisser croire que le groupe se complaît dans l’ersatz musical, se cantonne à copier des groupes illustres. Sauf que ce disque, sous format power trio (= droit au but), respire quand même la franche sincérité, et, sans jamais verser dans la copie, suscite un vrai plaisir d’écoute. Un groupe (paradoxalement) qui peut dégager une réelle originalité sur la durée de l’album. Une écoute saine et réjouissante, une appréciation décomplexée sont les composantes d’une sympathique découverte musicale. Même si Tracer ne changera probablement pas le monde musical tel que l’on le connaît, ce disque donne envie d’en entendre plus et de les voir en live.
 Mmmmh, aucun doute, dès les premiers accords on voit à qui on a affaire : un bon gros groupe de rock sudiste ! On est d’abord un peu désorienté par le côté terriblement ‘contemporain’ de l’ensemble toutefois, un son énorme, peu coutumier des très traditionalistes groupes du genre, et l’explication nous saute à la gueule dès que l’on parcourt le livret du CD : ce groupe, qui n’est autre que la dernière sensation du rock sudiste mondial, le rejeton survitaminé d’un milieu sclérosé depuis une bonne décade, est… suédois ! Les terres scandinaves ont encore enfanté un groupe hors normes, et personne ne se décide encore à intervenir, où va le monde ?? Les influences (mêmes vestimentaires !) du quintette sont donc fermement ancrées dans le sud-est américain, mais on pourra citer plus précisément les Allman Borthers, mais surtout, et c’est limpide dès la première écoute, ZZ Top, eux-mêmes ‘rebelles’ (car originaux) dans le milieu du rock sudiste : le chant (sur ‘See you burn’ par exemple), la batterie (sur ‘El Rancho’) ou ce son de guitare (comme sur ‘Goddamn man’ ou toujours sur ‘El Rancho’ !) ne trompent personne, Backdraft est bel et bien l’enfant caché du trio texan barbu, à un point tel que ça en est parfois indécent. N’évoluant ni dans le plagiat (ils débordent d’originalité) ni dans le pur hommage (ils savent injecter bon nombre d’autres influences dans leurs compos), Backdraft sort grandi de la comparaison : si ZZTop était ‘né’ trente ans plus tard, et qu’ils avaient bénéficié de plus d’influences ‘metal’, ils auraient été Backdraft. Un point c’est tout. Génial, indispensable.
 Découvert à la faveur d’un concert enthousiasmant, Dexter Jones’ Circus Orchestra s’était lentement imposé comme l’une des heureuses découvertes de 2005 grâce à un premier album sorti dans la confidentialité qui apportait un grand vent de fraîcheur au sein des sorties dédiées à l’énergie brute et l’électricité. Le genre d’album sur lequel on revenait inlassablement, séduit par ces mélodies obsédantes et cette façon de faire unique qui offrait un contrepoint bienvenu face au déluge sonore auquel nous avions habitué nos oreilles meurtries.Pour nous faire patienter avant la sortie d’un nouvel opus prévu pour l’automne, le « Swedens best kept rock secret » comme ils se définissent eux-même revient avec cet EP de quatre titres qui s’inscrivent dans la continuité de leur précédente production, réussissant une fois de plus à pondre des morceaux variés et immédiatement mémorisable. Pas de grande révolution dans le chef de nos cinq suédois atypiques, que l’on rapprochera de Mammoth Volume dans la volonté d’offrir une espèce de Stoner Pop (sans que cela ne soit péjoratif), le côté progressif moins présent. Malgré la présence de trois guitares, DJCO se distingue en effet par un son très clair, dépouillé de tout effet, mettant en relief le charme discret et l’aspect mélodique de la voix de Tia Marklund, parfois emprunte d’une légère mélancolie. Pas besoin de pousser les potentiomètres à fond pour groover, tout est ici exécuté avec une certaine retenue, laissant l’auditeur apprécié la qualité des arrangements plus complexes qu’ils n’y paraissent tout en préservant l’impression de fluidité qui se dégage des compos. Chaque titre a son identité propre et bien que la qualité soit omniprésente, on pointera plus particulièrement « I Do My Best » à la rythmique plus enlevée pour son refrain accrocheur et son solo lumineux. « Morbyn Outtakes » ravira tous ceux pour qui le groupe n’est pas inconnu et permettra aux autres de découvrir un groupe unique et très éloigné des canons stoner auxquels la Scandinavie nous a habitué depuis longtemps.
Si Mogul tire son nom d’un projet militaire visant à trouver des formes de vie extra-terrestre, on a le plaisir de vous annoncer qu’on les a trouvées en Belgique sous la forme de 5 musiciens intenses et passionnés. Les 2 premières plages vous mettent tout de suite en confiance (la 2e sous le titre Return The Blues est d’ailleurs une tuerie) et la suite ne peut qu’aboutir au constat suivant: il n’y a aucune faute de goût.
Une voix perçante et sincère se faufile tout au long des morceaux pour surplomber l’édifice savamment orchestré par les 2 gratteux et la section rythmique. C’est incisif, c’est tranchant, c’est rapide, c’est lent, c’est calme, c’est envolé. Tous les sentiments y passent et les émotions ne tardent pas à vous submerger. Les refrains sont imparables et les breaks révèlent de sublimes atmosphères. On sent le travail de longue haleine et la symbiose entre les musicos.
Tiré des profondeurs du blues et des meilleurs parties du heavy metal en évitant soigneusement les plans kitsch et puffés, Mogul distille un stoner de toute bonne facture qui s’inscrit parfaitement dans l’évolution que ce genre musical subit depuis le début de ce millénaire. Le groupe tente également une incursion surprenante mais réussie dans le post-rock instru à la 6e plage. Cet essai transformé a le double avantage de ravir les oreilles et de souligner la prise de risques par le groupe.
Au final, la plaque donne un sentiment de maîtrise et de confiance. Le dernier envoi (Outro) met déjà l’auditeur en appétit pour la sortie suivante. On l’attend déjà avec impatience. En attendant, profitez de cette toute belle sortie de fin d’année!
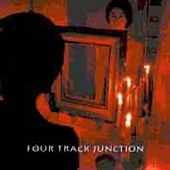 La capitale succombe enfin aux sensations fortes du stoner rock. Après Low Vibes, voici Four-Track Junction. Ces derniers nous relatent, au travers de ce cinq titres, leur initiation au peyotl. Expériences lysergiques vécues au Nouveau Mexique qu’on ne peut s’empêcher de mettre en parallèle avec les expériences de Carlos Castaneda. Si la musique des FTJ est supposée refléter une expérience du type de celle qu’a vécu Castaneda, nous sommes loin du compte. Seuls Eyehategod sont en mesure de retranscrire cette incroyable expérience hallucinatoire. Et encore. Par contre, si le propos des FTJ consiste plus modestement, à mettre leur vision du désert en musique, ils sont prêts d’atteindre leur dessein. On retrouve sur ce disque des accents propres aux Desert Session ou encore à ceux qui illustrent l’album solo de Brant Bjork (« Ticket for subway »). On sent une vraie chaleur traverser ce disque. L’harmattan y souffle fort sur ses sillons numériques brûlants. Les morceaux sont dans l’ensemble solidement construits. Mention spéciale pour la voix de Lo, magnifiquement grave. Mélange subtil de Mike Johnson et de Josh Homme avec quelques incursions (un peu maniérées) du côté de chez Andrew Eldritch et des miaulements furtifs à la Jeff Buckley dans « Girl ». Subtil je vous dis. Un premier essai réussi qui augure d’un bel avenir pour ces probables étudiants en ethnologie. On attend la suite du voyage.
Attention, les ‘Neuf coupe-gorges’ font pas dans la dentelle ! Ca démarre très fort avec un ‘Dirty’ limite punk tendance hard core, et ça continue sur quatre morceaux du même acabit, au chant écorché en retrait derrière des guitares acérées, le tout sur un rythme soutenu. Pas de prisonniers ! Les morceaux sont bien foutus, accrocheurs, pas de problème. Et puis que se passe-t-il ? Tout d’un coup, on passe à un morceau plus lent, servi par une gratte lap steel du meilleur effet. On vogue ainsi par la suite entre des morceaux aux textures et rythmes différents, mais possédant toujours comme dénominateur commun ce chant torturé et ces guitares tranchantes et heavy. Ca finit sur le très heavy instrumental ‘Sludge’ (qui porte bien son nom), et l’ensemble laisse une bien agréable impression après écoute. Très bonne musique, pour un groupe original, et définitivement à surveiller à l’avenir !
 Brant Bjork, le mythique batteur de feu-Kyuss, monte son propre groupe, dont il devient chanteur/guitariste. Pour s’occuper de la batterie, ce tordu recrute le second batteur de Kyuss, Alfredo Hernandez ! Cherchez l’erreur. Enfin, en l’occurrence, on va pas se prendre la tête, mais plutôt se concentrer sur la musique. Et quelle musique ! Si vous n’y connaissez rien en ‘stoner-rock’, que vous pensez toujours que c’est de la musique de crétins fumeurs de joints qui jouent la nuit autour d’un feu de camp, c’est probablement l’un des albums qui vous fera changer d’avis. Pas trace de Kyuss dans les compos du trio, mais plutôt sept brûlots rock bien poisseux, maintenus par un tempo assez rapide (ce n’est pas toujours le cas parmi les groupes de stoner), et bien sûr servis par une section rythmique jubilatoire (superbe batteur). Le plus étonnant dans l’histoire, c’est cette aptitude de Bjork à écrire des riffs aussi énormes, des compos aussi bien gaulées, taillées pour le headbanging, sans fioriture (avec seulement trois musiciens, c’est direct à l’essentiel) : en vrac, l’ultra-groovy ‘Adelante’ (cette basse !!), le frénétique ‘The Knife’ ou l’entêtant ‘Pray For Rock’ ne pourront décevoir personne. Une seule critique pourtant: l’album est trop court, on en aurait apprécié des heures comme ça sans sourciller. Enfin, on préfèrera ces presque quarante minutes jouissives à plus d’une heure de merde comme on s’en gaufre par douzaines de CDs tous les mois.
Quelques mois après nous avoir offert leur premier album live, Hermano nous délivre ici leur tout premier DVD, « The sweat and easy of brief happiness ».
Tout d’abord, et c’est un détail important si vous ne voulez pas être déçu, il ne s’agit en aucun cas d’une version vidéo du « Live at W2 » comme beaucoup l’ont cru lors de l’annonce de cette sortie. Nous sommes plutôt ici en présence d’un documentaire agrémenté de titres live et c’est une énorme différence. Ce DVD est en fait composé de quatre parties que je m’en vais vous détailler.
La première partie est ce que l’on appelle désormais un « rockumentaire ». En un peu moins d’une heure on découvre le groupe grâce à un mélange très intéressant d’interview, d’images de studio et d’images prises majoritairement durant la tournée européenne. Petit détails qui peut avoir son importance, les interview ne sont pas sous titrées, mieux vaut donc avoir quelques notions d’anglais pour pouvoir en profiter pleinement.
Il est assez difficile de juger de l’intérêt réel de ce genre de documentaire puisque son impact déclinera forcement au fil des visionnages. Mais il est certain que le contenu riche ravira les amateurs de ce genre de choses.
Ensuite on trouve le segment intitulé « Live at W2 » qui nous offre huit titres filmés dans la fameuse salle hollandaise lors du concert qui donna naissance au premier album live du groupe. C’est à mon avis le point fort de cette galette. Pour résumer mes impressions en une phrase, je dirai que c’est superbement filmé, que le son est puissant et qu’avant toute chose, la prestation du groupe est excellente. On se mort les doigts de ne pouvoir en voir plus et on se demande d’ailleurs pourquoi avoir pris la décision de ne pas mettre le concert en entier. Mais qu’importe, voir John Garcia sur scène est un plaisir incommensurable et David Angstrom est à lui seul une véritable attraction. A moins que ce ne soit moi qui ai atteint un stade avancé dans l’admiration, je peux vous dire que certains plans vous donneront des frissons et que malgré la durée excessivement courte, c’est une totale réussite.
Le troisième segment est constitué de trois clips dont la réalisation vaut à elle seule le détour. On sent bien que tout cela a été fait avec des bouts de ficelles et le tout a un arrière goût kitsch instantané. Non pas que ce soit mauvais, mais il est clair que le budget alloué à ces vidéos devait être bien mince pour ne pas dire réduit à zéro. Mais ne boudons pas notre plaisir car voir un clip de Hermano, même lors d’une émission rock sur une très célèbre chaîne musicale, relève de l’exploit.
Pour finir, on trouve une petite vidéo de quelques minutes composé d’images du groupe en coulisse et sur scène lors de leur venue au Festimad en mai 2005. Rien de bien extraordinaire.
Au final, ce premier essai du groupe est une belle réussite même si on reste un peu sur sa faim et on se prend à rêver de l’annonce prochaine d’une nouvelle sortie, cette fois-ci d’un véritable DVD live. En attendant, profitons de celui-ci à sa juste valeur.
 Issu de l’association de Twiggy Ramirez (Marylin Manson, NIN), Chris Goss et Zach Hill (batteur fou de Hella, combo post-hardcore comme on dit dans les magazines branchouilles) épaulés par une série d’invités dont Dave Catching, Goon Moon débarque avec ce EP 10 titres qui flirte avec les 25 minutes. Difficile de cerner cet ODNI (Objet Discographique Non-Identifié) à la première écoute. Les choses ne s’arrangent d’ailleurs pas après la quinzième.
L’album s’ouvre sur un riff bien gras soutenu par une batterie en partie repassée à l’envers qui introduit le morceau suivant, du même acabit et sur lequel Goss essaye de nous effrayer avec ces hululements de fantôme. La fin dégénère en bruitages et c’est là que les choses commencent à se corser sérieusement. ‘Inner Child Abuse’ et ‘The Smoking Man Returns’ forment un ensemble indissociable de collage de larsens, bruitages électroniques, claviers lugubres et accords de basse minimalistes, le tout soutenu par des roulements de batterie chaotiques dont Zach Hill s’est fait le spécialiste. Alors qu’on commençait à être vraiment désorienté, ‘Rock Weird (Weird Rock)’ nous permet de retrouver nos repères malgré un vocodeur et des sons de synthé digne d’un casio offert à votre petit neveu pour sa Noël. Et puis là, surprise ! L’album se termine sur trois excellents morceaux à la structure classique (si on fait abstraction de ‘I Got a Brand New Egg Layin’ Machine’ où Goon Moon repart dans ses délires bruitistes) pour lesquels les bidouillages se font beaucoup plus discrets et la batterie plus disciplinée. ‘Mashed’, avec sa guitare et sa basse acoustique, séduit par son côté entraînant tandis que sur ‘No Umbrellas’, Goss nous fait enfin profiter de sa voix si chaleureuse tout en délivrant un riff bien enlevé que ne renierait pas Qotsa. ‘Apartment 31’ clôture l’ensemble de façon mélancolique pour nous laisser sur un sentiment mitigé.
Cet album est certainement ce que Goss a fait de moins abordable et il faut une belle dose d’ouverture d’esprit pour l’apprécier à sa juste valeur. Si malgré tout vous n’êtes pas réfractaires aux morceaux les plus bizarres de Earthlings? (pour citer une référence), tentez le coup, vous ne serez pas déçus.
|
|