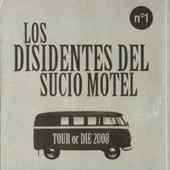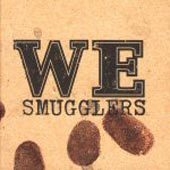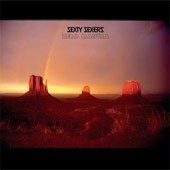|
|
Ces maniaques sexuels nous arrivent de la ville de Leeds où ils officiaient jadis dans un groupe répondant au nom de Vorhees, lequel évoluait dans un registre hardcore (ses membres sont actuellement actifs sous le nom de The Horror & The Mercy Suite pour les amateurs de ce style). Sous le joli nom de Sex Maniacs (très pratique quand on recherche de l’info sur ce groupe via les moteurs de recherche du ouèbe on obtient 66’300 liens, c’est vous dire la popularité du groupe) le groupe pratique du rock’n’roll survitaminé très influencé par le punk rock binaire. Les douze plages composant ce disque s’enchaînent en moins de vingt-deux minutes en passant de morceaux dans la plus pure tradition de groupes comme Anti Nowhere League (‘Time To Rock’), les Hellacopter (‘Sabretooth’), les Ramones (‘Broken Down Clown’) ou Circle Jerks (‘Prick’). Cet album ravira donc les rebelles en cuir noir qui hantent les salles de concert en quête de rock couillu.
 Enfin ! Plus de deux ans après leur premier album, High On Fire daigne nous gratifier d’une dose supplémentaire de leur ‘heavy-stoner-doom’ essentiel. La bande à Matt Pike (souvenez-vous, les légendaires Sleep, c’était son groupe) revient donc en grande forme sur un label (Relapse) qui, décidément, prend un tournant très excitant. Décrire la musique du POWER (désolé, dans ce cas là, le minimum est de l’écrire en majuscules) trio n’a pas beaucoup de sens, dès les premiers riffs, vous serez abasourdis, tout simplement, et la vie aura une nouvelle signification pour vous. Vous aurez enfin compris. Peu de groupes sont aussi ‘heavy’ (au sens premier du terme), et pourtant aussi percutants que HOF : les compositions sont accrocheuses, les riffs plombés, le son dantesque, le chant terrifiant, les rythmiques variées. HOF est d’ailleurs probablement le seul groupe ‘affilié doom’ dont il est courant de fredonner les chansons sans s’en rendre compte après avoir écouté l’album. Un vrai coup de maître, donc, dans un genre que d’aucuns croient déjà moribonds ; belle démonstration en tout cas.
 C’est affreux ! J’étais tel le gamin sous l’arbre de Noël un vingt-quatre décembre. Mes yeux brillaient de milles et un feux et mes mains, fébriles, osaient à peine toucher l’objet désormais en ma possession : le successeur de ‘Salvation’ par un groupe venu des froides contrées de Scandinavie qui évolue dans un style proche d’Isis. Véritablement conquis par les deux dernières livraisons des sept Suédois qui excellent dans l’art de construire de longs morceaux un peu comme Pink Floyd le faisait en y posant des textures tout en douceur qui sont brutalement interrompue par des déluges qui blastent tout sur leur passage, je me mis donc dans les meilleures dispositions possibles pour entamer ce nouveau trip musical. Tout débuta avec l’atmosphérique ‘Marching To The Heartbeats’ qui s’égrainait tout en volupté pour mon plus grand plaisir lorsqu’une voix masculine déclama sur un ton des plus neutres dans la langue de Shakespeare que j’étais en train d’écouter ‘Somewhere Along The Highway’ de Cult Of Luna qui était sorti sur Earache Records. Nom de Dieu ! Je ne suis pas encore complètement sénile et j’avais bien lu sur la jaquette en carton de cette édition promo qu’il s’agissait de ce groupe que je connaissais bien et qui s’appelait Cult Of Luna. J’étais aussi au fait que cet album avait été baptisé ‘Somewhere Along The Highway’ et comme je m’étais enquis de la sortie de cette production, j’avais remarqué sur le site du label que le groupe demeurait chez eux vu qu’ils annonçaient cette sortie. Echaudé par cette douche britannique, je poursuivis la dégustation de cette galette puis le même type qu’avant, qui ne s’est pas présenté au passage, cru bon à nouveau de me répéter qu’il s’agissait du nouvel album de Cult Of Luna et qu’Earache se chargeait de la commercialisation de celui-ci. Bon ben j’avais compris la première fois machin ! Quelque peu décontenancé par cette mésaventure, je décidais d’aller plus avant dans la découverte de ce qui ressemble à un petit chef d’œuvre pour m’en imprégner. A ce stade-là de l’écoute, j’avais déjà compris qu’il me faudrait attendre la sortie de cette production chez mon épicier favori parce que pour ce qui est d’être transcendé il faudrait repasser vu les incursions du malotru anglophone. Tout de même me dis-je à moi même en catimini : ‘Je veux bien qu’on protège les intérêts de gens qui allongent des billets pour que des groupes pareils puissent venir à nous et qu’on ne vole pas non plus nos amis les artistes en distribuant sur la toile des morceaux avant la sortie des disques’ et même après tant qu’on y est…, mais de là à me gâcher le plaisir d’écouter Cult Of Luna il y a un pas quand même non mais des fois je vous jure’. Alors que je philosophais donc avec mon meilleur pote, qui ne me contredit pas trop lorsque je suis vert comme ça commençait à être le cas, l’espèce de type au discours vachement pas varié du tout m’a resignifié que je n’avais toujours pas changé de disque ! Hé connard, j’étais au courant, j’écoute le dernier Cult Of Luna qui sort chez Earache Records ces jours ! Pas me chier dans les bottes non mais j’en ai maté des plus coriaces que toi rosbif !Dans le dernier Cult Of Luna, qui sort chez Earache Records si jamais vous n’êtes pas encore au courant de la bonne nouvelle, il y a absolument tous les ingrédients qui ont fait que je suis resté scotché par ce groupe : des ambiances atmosphériques envoûtantes produites avec maestria, des lignes de basse bien en avant, des nappes synthétiques en soutien à l’ensemble et des vocaux posés tel un instrument sur cette texture wagnérienne. Il y a aussi cette retenue et cette mesure qui perdure sur certaines compos rendant les incursions métallique presque jouissive tant le processus d’élaboration des morceaux frise la perfection dans ce style. Il y a aussi dans la version promo un découpage des morceaux en nonante-neuf plages qui rend déjà le travail plus ardu aux faussaires de tous poils et en plus de ça un drôle de zigoto qui m’a confondu avec Jeanne Calment en me répétant le titre de l’œuvre que j’écoutais ainsi que son promoteur et son géniteur. N’empêche que même avec ce travail de sape délirant, j’ai été conquis par les sept compositions qui se succèdent sur ce nouvel opus. ‘Thirtyfour’ est tout simplement génial et est une des meilleures choses que ce groupe ait composé à ce jour. Vivement la version débridée de la chose qui me permettra d’apprécier en toute quiétude l’intimiste ‘And With Her Came The Birds’ ainsi que le progressif ‘Back To The Chapel’. La version définitive de cet ovni musical sort sur le label Earache dans sa version cd ainsi que dans sa version vinyle ; le titre de l’album est inscrit dessus ainsi que le nom du groupe comme quoi mon pote rayé comme un disque n’avait pas besoin de gâcher son énergie à me rappeler ce fait dont j’allais me souvenir jusqu’à la fin de ‘Dark City Dead Man’ sur lequel le groupe se lâche vraiment.
 Mais qu’est ce qui a bien pu pousser Psychedoomelic à signer ce groupe ? Un pari perdu, un excès de nostalgie, une envie de flinguer sa réputation ? Merca est un trio hollandais « issus des cendres de Shylock, la magnifique légende underground » dit la promo. Il y a une part de vérité dans tous çà, surtout en ce qui concerne l’aspect underground, mais alors très très underground. Tellement underground que j’en cherche encore la moindre trace sans résultat. Une des particularités du groupe est de posséder une fille derrière les fûts qui répond au charmant surnom de Animal. Si le chanteur se faisait appeler Kermit, ce qui lui conviendrait assez bien, çà aurait pu être marrant, on aurait pu penser que ce groupe excellait dans l’art de manier le second degré, mais malheureusement on doute que ce soit le cas.
Merca fait du doom très old school en parvenant à sonner comme du Obsessed des tous débuts, quand Wino inventait presque le style au début des années ’80. Et même si ces rares enregistrements ont gardé un certain charme, force est de constater que tenter de remettre ce son au goût du jour n’a pas grand intérêt. On se farci donc sept morceaux de doom assez lent ponctués de croassements insupportables qui n’apporte absolument rien de neuf. Je me suis tapé les 33 minutes (une chance !!!) de l’album une dizaine de fois pour en ressortir un seul élément positif, sans succès. Comme on dit dans ces cas-là pour pas être trop méchant, c’est pas franchement mauvais, il y a quelques riffs intéressants mais aucuns morceaux n’est vraiment accrocheurs. Cà pourrait éventuellement plaire aux amateurs d’un doom originel débarrassé de toute influence superflue, genre puristes qui considèrent que Metallica n’a plus rien fait de bon après Kill’em All où que la mort de Brian Jones a marqué la fin des Stones, mais là on est passé au XXIème siècle depuis quelques temps, on est dans l’ère du métissage en tout genre et de l’évolution à tout-và, ce que Merca ferait bien de comprendre s’il ne veut pas disparaître.
Je suis à la bourre pour rédiger la chro de cet album sorti fin 2005 sur le label batave Drunken Maria mais on me pardonnera vu mon adhésion récente à l’équipe de Desert Rock. Borehole est un quatuor hollandais en provenance d’Eindhoven Rock City. Il s’y distingue en singularité par leur fuzz rock dans un ville où le public est acquis (ou vendu, c’est selon) à la cause du punk, du rock moule-bitte et du speedrock.
Borehole a la particularité d’alterner les morceaux au tempo plus modéré (sans tomber dans le down tempo propre au doom ou au sludge) avec des plages au tempo plus engagé et plus “in your face” (traduisez par “dans ta gueule”). Les titres se succèdent de manière fluide et étudiée au long de cet opus riche de 9 petites perles.
Le son de la gratte sent bon la Big Muff (pédale fuzz) sur le grain du légendaire JCM800 de Marshall. Loin de moi l’idée de faire de la pub mais c’est un fait que l’on retrouve très souvent ce duo de choc dans le courant musical auquel ce site est dédié. Ayant pu rencontrer le gratteux lors d’un concert en septembre dernier, il s’avère que ce dernier est ingénieur du son dans un studio d’enregistrement et qu’il lui a fallu plus de 10 ans pour modeler le son qui sort de ses amplis.
La basse effectue avec la batterie un exercice de soutien sans faille avec également de belles couleurs lorsque les passages péchus font suite au calme teinté légèrement de psychédélisme. La batteuse (oui oui, c’est une charmante demoiselle) possède une frappe posée et un jeu aérien dans des effusions de cymbales particulièrement appropriées avec les riffs sans retenue.
C’est dans cette construction rigide mais non dénuée de groove que l’on retrouve une voix haute perchée couplant émotion et rage. Ici, pas question de braillard hurleur ou encore de dégorgeur à sec, on a bien à faire à un vocaliste talentueux au chant travaillé et maîtrisé. Pas question non plus pour lui de monopoliser l’espace, la voix qui évolue dans les spectres vocaux tooliens peut faire silence pour laisser les atmosphères musicales s’exprimer pleinement.
Bref, c’est rapide, c’est lent, c’est calme, c’est pétant, non sans rappeler un certain album légendaire du nom de Blues for The Red Sun. Les bataves de Borehole ont plutôt répété dans des caves enfumées que dans le désert, ils demeurent néanmoins des musiciens très accomplis nous délivrant ici une très belle performance. A fumer sans modération.
 Pas la peine de tortiller du cul. Mon cœur cholesterolémié a placé sans conteste cet ouvrage au firmament des disques de l’année 2002. Une fois encore, l’immense maïeuticien sonore qu’est Billy Anderson (Sleep, Cathedral, High On Fire, etc.) a contribué à accompagner la naissance d’un chef-d’œuvre magistral. Pas étonnant, étant donné la qualité inouïe des titres de Los Natas. Considéré à tort comme une simple version hispanisante de Kyuss, le trio argentin s’est définitivement détaché de cette filiation pour se livrer à des expérimentations extrêmement personnelles. Tout juste si l’on décèle ça et là une certaine perméabilité à Motörspycho et à Dead Meadow. Il serait plus juste de dire que Los Natas atteint avec cet album, le niveau de perfection incandescente de ces derniers. Une perfection granuleuse. Rugueuse. Imparfaite. Pas un mannequin anémié sur papier glacé, mais la voisine pulpeuse que vous croisez tous les jours. Celle qui ressemble tant à Claudia Cardinale. Celle qui rend vos genoux fébriles. Impétueux, vrombissant, ardent, épais, officiant souvent dans un registre instrumental, Los Natas est un volcan déroutant. Incontrôlable, fier et farouchement indépendant, ce disque a pourtant commencé par laisser circonspect l’imbécile que je suis. Rétif à me laisser submerger trop aisément par la symbiose originale du son, des compositions et de cette langue si exotique qu’est l’espagnol. Puis, comme toutes les grandes œuvres, sans forcer, son empire s’est répandu jusque dans la moelle. Les musiciens de Los Natas maîtrisent leur sujet autant qu’ils dominent leurs auditeurs. Attention donc. Aimer c’est succomber. Mais succomber de la sorte est prodigieux. Gracias amigos.
 Véritable icône de la scène dite doom, Candlemass revient après un (trop) long break puisque cette formation n’a à son actif que neuf long formats en presque vingt ans d’existence compilations et lives inclus. Vénéré par un public issus de plusieurs sous catégories de la grande famille du rock on croirait à l’écoute de cet album éponyme que les cinq garçons venu du froid ont tenté (en vain) de satisfaire tous leurs fans en produisant des morceaux assez différents les uns des autres. L’entêtant ‘Copernicus’ aligne sept minutes de doom epic du plus bel effet. ‘Assassin Of The Light’ est dans un style moule burne qui va sûrement ravir ses fans germaniques avec un son eighties périmé depuis longtemps. L’instrumental ‘The Man Who Fell From The Sky’ manque cruellement de relief dans un registre assez similaire au ‘Call Of Ktulu’ de Metallica. Le tabassage en règle de ‘Born In A Tank’ incisif en diable incite rapidement l’auditeur à se lancer dans une danse du coup d’enfer. D’une manière générale, cet album déçoit quelque peu par son manque de cohésion, ses envolées lyriques et ses voix sous mixées qui, si elles n’étaient pas si aigues, s’inséreraient mieux sur un album de doom. D’album de doom il n’est presque pas question ici tant le tout verse dans le heavy pathos.
Los Disidentes Del Sucio Motel est un groupe qui n’a pas encore explosé, et qui pourtant a installé une réputation solide dans le milieu étriqué du stoner rock français. Avant ladite explosion (inévitable), le groupe décide, en attendant de pouvoir sortir sa nouvelle galette, de nous faire patienter avec… un DVD ! Etonnante démarche…
Comme son nom l’indique, ce DVD est le produit de captations diverses et variées, durant la tournée du groupe en mai 2008 : 11 dates en 12 jours, on peut penser qu’à l’annonce de cette tournée de “guerriers de la route”, le groupe a senti le potentiel d’un road movie “fait maison”. Niveau qualité de filmage, ne vous attendez pas à du Full HD spectaculaire avec du 5.1 effet suround de la mort qui vous retourne sur votre siège. L’ensemble du document relève plus du reportage filmé par un “observateur mystère” que du reportage d’investigation par une équipe de filmage professionnelle. On se plonge dans la lecture d’affilée du DVD, durant lequel s’enchaînent en fait captations live et séquences backstage ou en voyage.
Passé ce postulat, on pourrait présumer que l’on se retrouve face à un doc amateur entre potes, ce qui pourrait en décourager plus d’un. Erreur ! Enfin demi-erreur, parce que c’est quand même pas mal un documentaire entre potes… Mais erreur quand même parce que ce reportage, à l’instar du dernier film de Anvil (la lose en moins) développe une empathie remarquable vers le groupe. Evidemment, ce capital sympathie est décuplé par les titres live, où on retrouve nos joyeux lurons débiter des riffs pachydermiques au cours de plusieurs extraits de leur répertoire live. Séquences live trop courtes en revanche, mais clairement ce n’est pas l’objet du reportage. Ce DVD ravira plutôt ceux qui veulent en savoir plus sur les “coulisses” des groupes rock français et des concerts organisés dans notre beau pays du fromage : voyages en camionnette (remplie jusqu’à la gueule de grattes, sacs de couchages, amplis et fringues crasseuses), avec un GPS alcoolique, clubs chaque jour différents, délires d’aires d’autoroute, blagues filmées diverses, montages et démontages de matos, nuits passées sur les banquettes des voitures ou dans des piaules approximatives, trips hippies ou sauveurs de chats égarés, porno (si si !), routes de campagne, attentes interminables avant les concerts, et tout ça sous l’oeil du shériff (il n’y a pas de shériff dans les Village People, bordel !)… Bref, de la grosse marrade, communicative.
Pour remplir encore plus cette délicieuse rondelle vidéo, le groupe y ajoute une série de séquences sans queue ni tête bien fendardes en bonus, ainsi que pas mal de photos. Ca mange pas de pain !
Bref, on a pas mal de plaisir à mater ce DVD, et on en prend plein les esgourdes au passage. On n’en attendait pas tant ! Surtout pour 5 EUR à peine… Une initiative originale et réussie de la part de ce groupe français qui gagne à être connu. Et puis du coup, ben c’est con, mais maintenant on a rudement envie d’écouter leur prochain album ! Salauds ! Allez, tous avec moi : “Laaaa téléportationnnnn…”
We a toujours été un groupe bien particulier dans la “sphère stoner”. Parce que c’est pas un groupe stoner, d’abord (bonne raison). Un groupe évidemment influencé, mais un groupe ambitieux dans son son, dans ses parti-pris, dans ses compos, dans les genres qu’il malaxe joyeusement pour un résultat toujours concluant, finalement. Une ambition qui lui joue des tours, toutefois, puisque le groupe se situe le cul entre deux chaises : un son et une “carrure” que l’on pourrait rapprocher de grosses pointures (commercialement) du rock, et pourtant un statut (hors Norvège) tout à fait modeste, avec des albums qui sortent sur des labels discrets, et des concerts plutôt confidentiels.
Mais avec tout ça, on ne parle même pas de musique. “Smugglers”, donc. Au vu de la claque reçue à l’écoute de “Dinosauric Futurobic”, on est en confiance lorsqu’on enfourne la galette. Impression renforcée au fur et à mesure que les titres se succèdent. Et les écoutes suivantes de l’album enfoncent le clou. Encore une fois l’accent est mis sur la qualité des compos, avant tout. Les titres sont entêtants, franchement, ils s’engramment via les cages à miel comme une bonne tartine de goudron bien chaud : une fois que c’est collé, ça bouge plus.
Deuxième remarque : la variété impressionnante des chansons, on passe de titres bien heavy, graisseux, dissonants, à des titres plus proches de la bluette mélodico-ambiante comme “Sassy Zazie”. A chaque nouveau titre, une nouvelle ambiance, et le tout baigne dans un son vintage 70’s tout à fait à propos. Le constat s’impose dès lors : Chriss Goss est un putain de bon producteur. Le son est souple, chaleureux, il caresse l’oreille, et devient plus grinçant, rèche, quand la tension doit monter d’un cran. Le tout dans une homogénéité remarquable. Chapeau.
Au final, on reste bluffé par l’homogénéité de l’ensemble en terme de compositions : toutes différentes, mais de qualité égale. Comment mentionner un titre plus qu’un autre dans ce cas ? On remarquera “Smugglers”, un titre délicieusement teinté 70’s, “Sulphur Roast Stomp” au break purement Masters Of Reality, ou “Crawling out of the wreckage” au chant très proche de Chriss Goss. “Lightyears ahead” propose une intro rock’n’roll bien jouissive et rappelle que le groupe sait envoyer du bois quand il veut, et “Catch electrique”, groovy à souhait, fait inévitablement taper du pied, un signe qui ne trompe pas quand on écoute un disque. Enfin, “On the verge to go”, qui commence de manière un peu soporifique, clôt l’album par un déluge de groove bien senti, presque totalement instrumental, entre space rock et rythmes orientaux.
Après de nombreuses écoutes, on s’aperçoit qu’il n’y a, objectivement, rien de mauvais à dire sur cet album. Et pourtant ce n’est pas l’album du siècle ! Le groupe mérite sans discussion un succès bien plus grand que celui qui est le sien, ça ne se discute pas. Néanmoins, il manque cette couche d’imperfection (avouez que ce genre de critique n’est vraiment pas objective), ce grain, ce “cachet” un peu typé qui rendrait ce disque un peu plus humain. Tout ça est remarquablement propre, et qualitativement irréprochable (en tous points, promis). Mais je ne comprends pas pourquoi ce n’est pas mon album de l’année : il a tout pour l’être. Une idée ?
 Après ‘The Light Album’ en deux-mille-quatre et juste avant de sortir ‘Under The Thunder’, le quatuor transalpin s’est payé le luxe de sortir ce redoutable deux-titres à l’artwork soigné. Limité à cinq-cent copies, cet ep d’une dizaine de minutes devrait rapidement être épuisé non seulement parce que ce groupe est une formation de stoner au potentiel énorme, mais aussi grâce au featuring présent sur le morceau de la face A.
Monsieur Brant Bjork est en effet présent aux chants et à la guitare sur le morceau éponyme qui évolue dans un registre très proche des dernières livraisons de ce poly instrumentiste. Les aficionados de Brant devraient y trouver amplement leur compte avec cette plage qui a plus à voir avec ce que délivre habituellement l’Etasunien qu’avec le style des Italiens.
Changement de décors avec le second titre intitulé ‘Stars Shine’qui débute de manière très rock’n’roll avec un riff garage, une rythmique basique et des vocaux saturés ainsi que des backings féminins bien sentis dans la veine de ce qu’Hermano nous a proposé lors de sa dernière tournée. Une fois passée les deux premières minutes de cette plage, la basse ralenti le tempo en devenant presque hypnotique pour attaquer la suite de cette composition qui se mue en chef-d’œuvre psychédélique et planant. Exit les gros riffs et bienvenue les envolées dissonantes de six-cordes avec quelques lignes de chants étouffées au loin. Une excellente surprise au pays du desert rock très empreint de l’esprit des sixties.
 Après avoir redoré son blason avec l’excellent « We Must Obey » sorti en 2007, Fu Manchu allait il transformer l’essai ou retomber dans une faciliter trop évidente avec ce très attendu « Signs of Infinite Power » ? Voilà la question que je me pose avant d’écouter la galette. Et à la sortie des 34 minutes d’écoute, force est de constater que cet album aurait pu s’appeler « We Still Must Obey » tant il est semblable au précédent opus. On sent de la part du groupe une véritable envie de continuité au détriment parfois d’une évolution salutaire. Mais la stagnation a parfois de bons côtés.
Tout d’abord la production et le mixage sont monstrueux. Que vous ayez une chaîne hi-fi flambant neuve avec enceintes à taille d’homme ou un petit poste cd 2 x 0.5 watt, le son est génial. C’est un réel plaisir de s’en prendre plein les oreilles à coup de grosse caisse et basse magnifiquement mises en valeur. Les compos sont aussi particulièrement bien travaillées niveau arrangements.
Alors forcément, Fu Manchu n’est pas un groupe réputé pour son audace et son gout du changement radical et cela s’en ressent dans les compositions mais ce serait bien dommage de bouder son plaisir car comme à chaque fois on a la dose idéale de riffs de guitare en intro, de batterie partant dans tous les sens et de lignes de basse imparables. Et malgré tout, cela reste un album varié et qui, avec une très courte durée, passe tout de même en revue joyeusement tout ce que le groupe a comme possibilités.
Bref, vous l’avez déjà compris, si vous aimez Fu Manchu, ce disque est indispensable, en particulier si le retour en grâce de « We Must Obey » vous a touché.
 Il était impossible de prévoir la portée d’un tel album ; les trois précédents LP du groupe et les brouettes de EP / Split CD et autres ne pouvaient en aucun cas nous y préparer. Alabama Thunderpussy était déjà un groupe excitant, quintette ricain bien imbibé, mariant la puissance du thrash à la liberté instrumentale du stoner, le tout baigné de quelques influs doomesques bien senties par moments. Original et très bon. Mais de là à franchir un tel pas, je n’en reviens toujours pas : sans jamais renier leur genre à aucun moment, ils affinent leur tir en s’appuyant sur leurs points forts, et se permettent de développer leur style dans des mesures insoupçonnées (jamais on aurait cru les présumés ‘gros bourrins de Virginie, USA’ capables d’autant de subtilité dans leur jeu). Le riff est percutant, la rythmique groove et cartonne, l’assaut de guitare est indécent (deux guitaristes qui sonnent comme une douzaine), et le chant (probablement l’élément le plus linéaire des anciens LP du groupe) prend une dimension incroyable, grâce aux progrès déments de Johnny Throckmorton. Négliger l’influence du son massif de la prod’ de Billy Anderson serait aussi une erreur, tant il apporte du relief à ce chef d’œuvre. Toutes les chansons sont brillantes dans leur genre, inutile d’en citer une plus qu’une autre (allez, pour info, le plus grand riff de tous les temps fait office d’intro de ‘Hunting By Echo’). Dix chansons variées, dix étapes de la renaissance d’un groupe devenu référentiel.
“Flores de sangre” est le premier album de Greatdayforup que j’ai l’occasion d’entendre, et je pourrai conclure cette chronique ainsi : ça me donne envie d’en écouter plus.
Avant de conclure, je vais essayer de vous décrire la musique de Greatdayforup. Les premières minutes les voient lorgner franchement vers le côté Metal de la Force. Ce qui n’est pas forcément déplaisant d’ailleurs : c’est heavy, bien balancé, ça dépote de manière assez remarquable (rarement trouve-t-on morceau plus catchy que “Taste of the wasted”), c’est très bon. Et puis petit à petit, le quintette ricain lorgne vers des sentiers franchement plus stoner. Rien de franchement psychédélique ou doomesque, mais du bon stoner “à l’américaine”. D’abord par touches insidieuses, puis par morceaux complets, aux penchants atmosphériques, lancinants, fuzz parfois, de plus en plus présents. “To the limit” est à ce titre assez éloquente, lente mais lardée d’assauts guitaristiques graves et poisseux, que l’on croirait issus du premier album de Down ! D’autres morceaux penchent furieusement vers le hardcore new-yorkais qui a certainement en partie bercé les jeunes années de nos lascars, le punk parfois (“Deme Su Coolo”), mais au final, le fil rouge reste stoner : toujours un retour vers ces rythmiques lancinantes, ce son de gratte bien crade, qui deviennent typiques du stoner “américain” (finalement le moins “orienté 70’s”, si on y réfléchit bien).
GDFU navigue clairement en eaux connues, balisées, sous influences assurément, mais finalement avec une assurance qui force à l’admiration. Ca joue bien, très bien même, et la prod est nickel (voir la variété de sons de grattes, qui apporte une identité propre à chaque morceau). J’ai parfois un peu plus de mal avec les vocaux : Mike Langone n’est pourtant pas manchot, il est doté d’un organe aux multiples facettes, qui feraient pâlir plus d’un chanteur. Pourtant l’abus d’effets sur sa voix rend certains morceaux difficilement digérables (“R.I.S.E.”), c’est dommage.
Mais le reste est nickel. “Flores de sangre” est un album plaisant, de ceux qui se dégustent encore après plusieurs rasades, qui se découvre avec le temps. Il ne révolutionnera sans doute pas les courants de musique que nous apprécions ici, et pourtant il surfe dessus de manière insolente, et propose simplement une douzaine de bons titres. Je recommande chaudement.
Small Stone a beau être l’un des labels les plus bandants de ces dernières années, il y a quelque chose d’un peu amer derrière le fait qu’ils soient les distributeurs du dernier Greenleaf (tout comme Dozer il y a quelques mois). Souvenez-vous : Greenleaf est cette sorte de “all-star band” du stoner scandinave, monté par Tommi de Dozer et ses potes de Demon Cleaner, Lowrider, Stonewall Noise Orchestra,… Voir tous ces talents accoucher d’une galette de cette trempe, et la voir sortir chez un label américain, ça en dit long sur sa qualité, certes, mais aussi sur la frilosité des labels et distributeurs européens.
Bref. Greenleaf, projet temporaire qui dure, donc (6 bonnes années au compteur, quand même, et troisième album déjà), et toujours pas l’ombre d’un faux-pas ! “Agents Of Ahriman”, comme ses prédécesseurs, dépote sévère. En même temps, ne comptez pas sur l’effet de surprise : le genre est connu, balisé, maîtrisé sur le bout des doigts. On parle ici de stoner “à la scandinave” : le riff est cinglant, percutant, crasseux mais jamais poisseux. La basse, énorme, se cantonne avec sa copine la batterie à assurer une base rythmique groovy, sur laquelle Tommy s’y entend pour coller quelques nappes de soli (voir la deuxième moitié de “Highway Officer”). Bref, jusqu’ici, le concept musical n’apporte rien de nouveau sous le soleil suédois (qui est fort rare, rappelons-le). A noter quelques merveilleuses incursions d’orgue Hammond viennent caresser les oreilles ici ou là (voir le très Spiritual Beggars “Ride Another Highway”). En revanche, le chant, lui, est passé cette fois au hurleur des Truckfighters, le très impressionnant Oskar Cedermalm : hantant la plupart des pistes de ce CD (quelques invités viennent le seconder ponctuellement), il apporte par la puissance et l’originalité de ses vocaux, la touche de nouveauté qui rend l’écoute de cet album si délectable.
Au final, on prend un plaisir fou à écouter ce disque, plaisir manifestement partagé par les membres de ce projet, qui vit uniquement “pour le fun”. Pour tout dire, la variété des compos, leur qualité, m’empêche après chaque écoute de retirer le disque du lecteur CD, ce qui, quand on a une demi-douzaine de nouveautés en attente à écouter, finit de démontrer à quel point ce disque fait du bien. Devrait figurer dans toutes les chaumières.
De manière assez étonnante, Sexty Sexers provient du Pays Basque (du côté espagnol quand même). Etonnant, car ça fait bien longtemps que cette région forte en caractère n’avait accouché d’un groupe de rock marquant ! J’ignore si Sexty Sexers sera ce groupe, mais une chose est sûre, il en a la trempe.
Même si le groupe n’évolue pas dans un stoner très traditionnel, ses influences piochent dans les 3 décennies passées (si si !) pour en extraire le meilleur du rock’n’roll, la substantifique moelle. Le résultat explose dès les premières notes : ça déboîte. En effet, musicalement, on se situe biend ans un gros hard rock 90s (le furieux “Rotten my Casiopea”) teinté de relents 70s (ce riff de guitare sur “Tetsuo Edo Melquiades”, et ses backing vocals volés aux Stones), de soli et de jams implacables (la fin épique et aérienne de “So we died”), qui s’enchaînent sans jamais lasser. Le plus surprenant je crois : la production. Difficile de s’imaginer le quintette enregistrer sa rondelle dans une grotte quelconque paumée en plein coeur de l’Euskadi, quand on entend ce son énorme, cette prod de groupe multimillionaire. Une pêche énorme, et un modèle du genre.A noter : la plupart des titres sont chantés en basque, le reste en anglais, ce qui ajoute une teinte franchement originale à l’ensemble.
Bref, une grosse mornifle que cet album, qui ravira tout de même plus l’amateur de hard rock non sectaire que le pur afficionado de stoner atmosphérique traditionnel. Dans tous les cas un album de qualité.
|
|