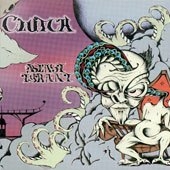|
|
Vicieux, cet album l’est autant que son géniteur, Joe Preston. Que dire du dernier effort “solo” (sauf quand c’est spécifié, l’animal est le seul maître à bord, et il joue de tous les instruments), si ce n’est qu’il est insidieux, malsain, tordu… Voilà, comme Preston, en fait. Ze Preston, celui de High On Fire, Sunno))), les Melvins. Un mec qui s’y connaît en chanson d’enfant et en flute de pan. Tiens, d’ailleurs c’est son pote O’Malley de Sunno))) qui a assuré le design du livret, simple mais original.
En tous les cas cet album n’est certainement pas à mettre entre toutes les esgourdes ! Par exemple, très rapidement on tombe sur un morceau comme”Algol”, une contine-rengaine accompagnée de chants d’enfants qui vire aux lamentations quasi animales, en même temps que la guitare acoustique se fond dans une bouillie de clavecin, qui lui-même s’apaisera au profit de quelques vagues de gratte hyper saturée, pesante, le tout à deux à l’heure, of course “Silvery Colorado” un peu plus tard nous propose une chanson “traditionnelle” (je miserai pas 10 kopecs là-dessus quand même, vu comme Preston est farceur) violemment dissonante, à la mélodie rébarbative, maladivement lancinante, qui, doublée du chant avec résonance à fond et bruit blanc, donne un ensemble littéralement glauque, maladif. Mais vraiment maladif ! Et puis l’air de rien, un blast beat plus loin, on tombe sur un “Coal Sack” limite death-doom, devenant totalement accrocheur sur sa seconde partie, presque épique dans sa montée en puissance, pour mieux retomber ensuite dans l’abyme doomesque d’où il était parti. Et puis même, au détour d’un “Young Savage”, on tombe même sur une chanson construite comme… comme une chanson ! Si si !
Le reste ? On retrouve des morceaux de tous styles et de toutes époques (issus de sessions datant de 1996 à nos jours, inédits ou sortis sur d’obscures compils, singles) et puis aussi bon nombre de reprises, du Rush, du Blue Oyster Cult, du Who. Et un bon point à qui retrouve la structure des originaux ! Plus que de reprises, on dirait plutôt le fruit du “Baron Frankenstein du doom” : il dissèque des chansons qui ne lui appartiennent pas, et les remodèle à sa guise. Du coup, comme le monstre de Frankenstein, elles sont boîteuses ensuite, elles sont moches, pleines de cicatrices, et elles font peur. Ben voilà, c’est ça qu’il fait Preston, et pas seulement sur ses reprises. Il prend des trucs qu’on connaît (des nappes de synthé, des breaks de batterie, de la gratte), et il fabrique avec tout ça une musique qui fait peur. Quelque chose de solennel, une recherche (qui peut paraître stérile) de l’ultime, où chaque accord de gratte sur-saturée et hypra-grave trouve sa place comme le dernier soubresaut de vie insufflé dans une chanson qu’on croyait mourante, où chaque note devient un baroud d’honneur.
Et c’est comme ça tout du long. Dix-neuf plages. Des trucs tout à fait insondables, ça part dans tous les sens, et parfois c’est même bien foutu ! Et oui, le gars est quand même un vrai musicos. Du genre passionné. Et les moments où c’est pas “bien foutu”, me demandez-vous ? Ben c’est étrange, barré, impossible à pénétrer. L’ensemble est vraiment disparate, mais l’impression qui s’en dégage est étrangement bonne. Parce qu’au final, c’est quand même le produit d’un mec connu pour son intégrité inébranlable. Et quand on y pense, même les morceaux les plus anti-conventionnels de l’album sont quand même très viscéraux. Ils vous touchent, en bien ou en mal, ils ne laissent pas indifférents. Et la musique, finalement, c’est quand même ça : trouver le bon son, la bonne note de musique, le bon arrangement qui va susciter une réaction, physique parfois, mentale la plupart du temps. Et ça, Preston le réussit admirablement : si on ne réfléchit pas, en écoutant cet album, on s’aperçoit qu’on en est “victime”, qu’on se laisse emmener, bercer ou maltraiter.
Décidément, le label ibérique Alone Records ne finit pas de nous surprendre. Après quelques coups de maîtres (Yawning Man, Orquesta Del Desierto, Viaje A 800, Fooz) et d’autres sorties plus dispensables (Ten East) ils nous balancent cette bien agréable galette, à savoir le second album de Glow, quintette madrilène ma foi bien excitant. Alone joue ainsi parfaitement son rôle, en alternant sorties de groupes internationaux, et profond soutien de la scène espagnole, qui le vaut bien, semble-t-il !
Glow, donc. Second album (jamais entendu le premier, désolé). Du tout bon. Du lourd aussi, genre early Sabbath rencontre the Obsessed ; les riffs lourds du premier, le son gras et rêche du second. 8 chansons, presque 70 minutes, pas la peine de chercher très loin : si vous n’attendez d’un album qu’un flot ininterrompu de notes balancées à 200 à l’heure, passez votre chemin. Si en revanche vous aimez le doom “accessible”, les vraies chansons, servies par des riffs tranchants et une rythmique solide et groovy, Glow me semble tout indiqué.
En effet, Glow finalement se détache avec bonheur du doom “pur et dur”, et trouvent leurs marques en s’inspirant de leurs anciens “classiques” (voir les 12 minutes du pachydermique “Doomdriver”, ses riffs lents et lourds), pour y injecter des touches bien à eux, un peu comme des groupes comme Solace peuvent aussi le faire. Exemple, cet orgue Hammond qui vient ponctuer les titres les plus pesants en leur donnant une fraîcheur inédite, presque décalée. Les influences ne manquent pas, et le groupe les assume le plus sainement du monde. Pourquoi tenter à tout prix de sortir de sentiers déjà empruntés par d’illustres prédécesseurs, au risque de tomber dans les travers de l’exercice de style stérile, alors que l’on peut se réapproprier un genre, le mener vers des chemins inédits, en l’enrichissant d’autres influences, d’autres idées.
Rendons aussi hommage aux musiciens, et notamment au chanteur, Ralph, dont le timbre délicieusement rocailleux et le coffre puissant apportent la touche finale à un ensemble par ailleurs irréprochable.
On a beau analyser, triturer le skeud dans tous les sens, au bout d’une dizaine d’écoutes, ce qui reste, c’est une poignée de compos passionnantes, dans le sens où l’on ne s’en lasse pas : on écoute et ré-écoute sans se lasser, en se laissant bercer et emporter par ces refrains mémorables et ces riffs qui tuent.
Bref, les extrémistes du doom (vade retro satanas) ne seront sans doute pas emballés par cette vague de fraîcheur et e naïveté apportée au genre. Les autres devraient être emballés par l’achat (peu onéreux, en plus !) de cette galette.
Ben voilà, je me suis fait eu. J’ai (je compte…) 11 CDs dans ma pile de skeuds “à écouter pour chronique sur le site”, dont 5 très récents ou à sortir. Et puis ben j’ai vu le dernier sHeavy chez mon disquaire (ze bon plan, je pensais même pas qu’il serait distribué en France). Ni une ni deux, j’achète la rondelle, et je l’enfourne dès mon retour chez moi. Grand mal m’en a pris, je peux plus l’en retirer.
Putain, quel groupe quand même. Vous pouvez leur cracher à la gueule autant que vous voulez : plagiat de Black Sabbath, manque d’originalité. D’abord, désolé si Stephen est né avec une voie si proche de celle d’Ozzy il y a 20 ans. Et puis plutôt que plagiat, si on parlait plutôt d’hommage ? Quant au manque d’originalité, déjà je suis pas forcément d’accord, tant le son et le sens de la compo des canadiens se sont affirmés, pour devenir impossible à confondre avec quiconque. Mais surtout, même si ce n’était pas le cas, des chansons aussi peu originales qui sont aussi jouissives, j’en veux bien tous les jours !
Parce que oui, sHeavy, c’est du bonheur en rondelle, de la salive qui dépasse du boîtier, du tapage de pied et du hochage de tête à ne plus savoir qu’en faire, l’un de ces groupes qui vous visse un sourire limite obscène à chaque couplet (vous savez quand on lance un “hell yeah” silencieux parce qu’on se dit que quand même, putain, c’est un sacré bon riff).
Mais qu’est-ce qui fait le secret de sHeavy ? Dur à dire, la voix de Hennessey, évidemment, entêtante, est “l’emblème” du groupe. Mais autour de lui, ça bastonne velu. Les riffs, déjà, lourds et nonchalants lorsque nécessaire (“Hangman”, l’intro/break de “Standing at the edge of the world”), savent être bien graisseux et sauvages dès lors qu’il faut balancer du bois (le reste de “Standing”, “A phone booth”) voire juste mémorables (en écoutant “The man who never was” on se demande forcément pourquoi personne n’a jamais composé ce riff si “évident” avant Dan Moore). Ils placardent chaque titre, un par un, direct dans la cervelle. Genre “pan ! celle-là elle restera entre tes oreilles pour un bon bout de temps”. Et puis sHeavy fait partie de ces groupes pour lesquels on se dit en les écoutant “ces mecs sont faits pour jouer ensemble”. La partie rythmique est juste brillante. Les lignes de basse groovent de manière quasi indécente, ça gronde, c’est chaud et rond, ça caresse le bas des tympans, et ça se fait saccadé, nerveux pour accompagner la gratte sans la “masquer”. Discret mais présent, toujours là où il faut et comme il faut. Le jeu de basse idéal, remarquable.
Après, qu’est-ce qui fait d’un album un coup de cœur ? Les musiciens assurent, la prod est sobre, sèche, “live” plus que tout (décidément, on reconnaîtra plus que jamais à Billy Anderson le talent de ne pas phagocyter les groupes qu’il produit), mais c’est quand même les chansons qui font un skeud. Et là, y’en a 12 impeccables. Tout simplement. Rien d’épique, rien de prétentieux, sHeavy ne pète pas plus haut que son coup et balance ce qu’il sait faire de mieux, 12 petites chansons bien écrites, blindées de petits breaks vicieux, chargées de riffs nerveux et entêtants, enrobées d’un groove chaleureux et accueillant (ah, le solo de “Imitation of Christ” sur fond de basse, l’intro et le break de “Stingray part III”).
On se sent bien dans ce disque, et le sentiment semble partagé : il a l’air de bien se sentir aussi dans ma platine CD. J’espère pour lui qu’il a pas besoin de respirer, j’ai pas prévu de l’en faire sortir de si tôt.
 En direct de Lausanne-Rock-City, Ärtonwall nous gratifie d’un petit joyau de stoner qui fait parler la poudre avec brio. Ce nouvel opus sort sur Ishii Kamikazi Records qui est une sous-structure de Red Eyes Production laquelle se profile comme un activiste du stoner francophone sur lequel il faudra compter à l’avenir.
Pratiquant un heavy rock juste crade comme il faut, la formation de la capitale vaudoise fait preuve d’une intelligence d’écritures bluffante en alignant des compos simples et décomplexées que la production a remarquablement mis en évidence sur cette plaque époustouflante. Le martèlement métronomique d’un batteur qui doit se taper du café en intraveineuse est allié à un bon gros son de basse qui écrase sa chatte ! Les six-cordes bien saturées sont omniprésentes sous forme d’un gros mur qui est dosé avec maestria pour ne jamais verser dans le gros déluge de décibels et les chants dans la plus pure tradition fuzz US restent à leur place sans déborder sur les autres acteurs de cette nouvelle galette du quatuor helvète.
Le mix final n’est certainement pas étranger au fait que je me passe ce petit bijou en boucle depuis quelques jours : ce disque envoie le bois, mais ne glisse jamais dans le bourrin. C’est la grande classe pour une production qui débute sur un délire sludge d’une minute intitulé ‘Gev’ qui flirte avec le post-tout. Une fois ce titre achevé, on part pour onze plages lourdes et incisives qui dépotent dans un registre très proche des premières productions de Dozer avec ça et là quelques gimmicks qui ne sont pas sans rappeler QOTSA à son apogée (il y a une paie donc).
Certains titres comme ‘Beyond’, ‘Every Rope’, ‘Plate’ et ‘One Shot’ sont de véritables pépites qui vont tourner en heavy rotation sous peu dans les baladeurs des amateurs de brûlots concis et couillus.
Bravo !
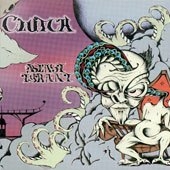 Avec Pure Rock Fury, Clutch a confirmé ce que l’on présumait en écoutant Elephant Riders : un groupe original, un style bien à eux, heavy, groovy, des vocaux hors normes, des instrumentistes sudoués… Et bien le très attendu Blast Tyrant enfonce le clou encore plus profond ! Blast Tyrant possède toutes les qualités de Pure Rock Fury (super compos, super son, super production), et les décuple tout simplement. Blast Tyrant est moins surprenant (l’effet de surprise est passé…), il peut donc paraître un peu décevant d’unpremier abord. Il m’a fallu en arriver à 3 ou 4 écoutes pour commencer à me rendre compte de la qualité de son contenu. Plus homogène, plus “rentre-dedans”, plus catchy, Blast Tyrant se révèle addictif, du genre à ne plus pouvoir quitter votre platine CD pendant quelques semaines de pur bonheur.Le groove est toujours bien présent (les superbes “The mob goes wild”, “Subtle Hustle” et “Cypress grove”), la puissance aussi (“Mercury”, “Army of Bono”), et Clutch, confiant, s’essaye même à des morceaux plus “lents” (essai transformé avec “Ghost” et “The regulator”).15 morceaux de pur bonheur (les albums contenant 15 chansons de cette qualité sans “bouche trous” sont rares !!) font de ce disque l’un des “must have” absolus de 2004, est très certainement le meilleur album de Clutch à ce jour (c’est dire…).
 Après deux démos, l’heure est venue pour la formation francilienne de sortir son premier véritable album. Omniprésent sur les scènes de la capitale, le groupe affiche une bio respectable pour pratiquer un style si éloigné de ce qui est en vogue auprès des masses de nos jours et il a fait les choses en grand pour ce ‘Songs From The Delirium Tremens World’.
Jouant la carte de l’éclectisme et évitant par là même les redondances musicales, le quatuor se laisse aller et traverse des univers musicaux d’ordinaire assez improbables pour un groupe évoluant dans un registre stoner à la fois lourd et aérien. Avant de passer au contenu, un détour par le contenant s’impose. Franck Roth s’est chargé, avec brio, de l’artwork de cette galette et le rendu dans la plus pure tradition du comic est du plus bel effet. Les héros d’Alcohsonic, le groupe lui-même, son entourage ainsi moulte créatures et références se croisent dans une mise en scène lumineuse assez proche des ambiances de Ben Radis. Les fans de bédé apprécieront le style, les autres parcourront rapidement le livret pour se pencher sur la musique qui, après tout, est quand-même le sujet central de cette production.
Comme expliqué plus haut, le groupe joue sur ce coup-ci la carte open minded en alliant son gros rock qui tache à des ambiances aériennes tirant sur l’ethnos par moments. Les dix titres font voyager l’auditeur durant presque trois quarts d’heure dans un univers marqué au fer rouge par les seventies et les ambiances du Sud des States. Ne vous fiez pas à l’intro et son style potache. Alcohsonic balance un bon gros son redoutablement bien produit sitôt les petits cris de farfadet fadés out !
De gros brûlots bien gras et saignants comme ‘Follow Me’ et ‘You’re Not Rock’Roll’ assurent la partie plutôt heavy dans un registre traditionnel avec des riffs bien comme il faut. Des invitations à l’oisiveté tels que ‘Stoned Morning’ ou ‘Delirium Song’ assurent le côté pas trop bourrin et soigné à l’extrême. Un instrumental magnifiquement planant nommé ‘Hanuman’Chest’ et qualifié d’interlude sur la pochette hypnotise durant cinq bonnes minutes et ‘Mojo Driver’ allie un peu tous les styles en faisant étalage de l’intelligence d’écriture du groupe qui se montre à l’aise dans tous les environnements musicaux.
Le point d’orgue de cet album est ‘The Cathodic Way Of Life’ qui débute en douceur presque de manière intimiste et évolue pendant six minutes en s’électrisant au fur et à mesure. L’ajout de hammond sur ce titre lui donne un rendu tout bonnement fantastique ! Du tout bon son au final que le groupe propage sur scène à travers toute la France avec un entêtement qui finira bien par payer, artistiquement parlant, un jour !
Avec Powertrip, la carrière de Monster Magnet a sans doute pris son plus gros virage : avant cet album, le groupe de Dave Wyndorf gagnait peu à peu une reconnaissance d’estime conséquente, à grands coups de salves stoner de qualité… Le groupe explose (tout est relatif !) avec cet album et change son fusil d’épaule : la prod prend une autre dimension, les compos reviennent à des basiques “rock’n’roll”… En gros Monster magnet devient avec Powertrip un groupe de hard rock à tendances stoner… et non plus l’inverse !
Alors au final, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Le puriste répondra que c’est la fin du groupe, l’amateur de musique préfèrera apprécier cet album pour ce qu’il vaut : un sacré bon album de rock !!! Ben oui, Powertrip déborde de bons titres, portés par de gros riffs bien lourdingues parfois (“Bummer”, “Crop Circle” en intro, excellent, ou encore le monstrueux “Tractor”), des refrains à entonner à pleins poumons (“Powertrip”), des tempos variés… Bref, de sacrément bonnes compos, servies de main de maître par une production à l’épreuve des balles, proposant le son parfait pour chaque chanson (Matt Hyde partage la prod avec Wyndorf himself).
La gratte a beau se tailler la part du lion (Ed Mundel, la grande classe), le chant de Dave Wyndorf, et son timbre de voix bien particulier, sont là pour rappeler quand même que c’est SON groupe et que ce sont SES chansons. Quelqu’un en doutait-il encore ?
Bref, un bien bon disque, finalement (faut jamais écouter les puristes…).
L’évolution musicale entre le précédent album de Sasquatch et celui-ci est à l’image de l’effort fourni pour lui trouver un titre (pour rappel, le précédent s’appelait « II »). Mais dès les premières écoutes, une chose est claire : on s’en contrefout de l’évolution. Sasquatch, avec cette nouvelle galette, défouraille comme jamais.
Evoluant toujours dans un très épais stoner bien heavy, le trio ricain écrase tout sur son passage. Amateurs de riffs souffreteux et de vocaux éthérés de rock indé à deux balles, partez en courant, ici pas de place pour les tafioles. Dès « Get out of here » tout est limpide : gros riff gras du bide, basse ronflante, et refrain définitif que l’on entonne à gorge déployée dès la deuxième écoute de l’album. Imparable, le ton est donné. Sans débander, le tout aussi impeccable « Took me away » (doté de superbes soli de Ed Mundell, en visite entre deux tournées de Monster Magnet), sur un tempo moins enlevé, se révèle tout aussi accrocheur. On tient le fil rouge de l’album : qualité des compos, superbement ficelées et efficaces. Cela ne signifie pas qu’il puisse exister une once d’ennui, car le groupe ne se répète pas pour autant : tempi changeants, lignes de guitare travaillées (lead et rythmique), rythmiques tour à tour super heavy (« Get out of here »), proche du doom (« Queen »), limites blues (« Soul shaker »), sautillantes (« Walkin’ Shoes »), groovy (« No more time »), et même limite indus (??) parfois (le couplet de « New disguise », promis !).
Sasquatch porte une certaine idée du stoner qui nous fait plaisir et que nous encourageons : cette idée que les chansons peuvent être parfaitement structurées, les riffs solides taillés à la serpe, les musiciens doués, et tout ça sans forcément donner une impression de musicos sous acides qui font tourner le même riff pendant 10 minutes en collant 3 coups de cymbales chaque minute. Sasquatch joue fort mais net, sans bavure. Les amplis crachent, les soli fusent, le chant crie, mais juste comme il faut. En tout cas c’est la formule pour vouloir le réécouter encore une fois dès qu’on arrive à la fin de la galette. Et ça le fait à chaque fois…
 L’album précédent de Milligram (“This is class war”) m’avait fait cette impression bien connue des fanatiques de musique que nous sommes, qui nous fait dire, en découvrant un groupe, “bon sang, j’ai dû passer à coté d’un paquet de bons albums par ce groupe”. Une vraie découverte.Belle occasion nous est offerte avec ce “Hello motherfucker” (un de ces titres définitifs…) de découvrir les premiers pas de ce poids lourd (d’où le sobriquet du groupe, sans doute !) du gros rock qui tâche… En effet, il s’agit ni plus ni moins de la réédition de leur premier album. Et, bien sympa, le groupe a voulu l’agrémenter de quelques reprises sympatoches, plus que du remplissage, ce sont bien des morceaux punkoïdes-métallisants du meilleur goût (Misfits, Fear, Black Flag… excusez !), en tout cas un très bon agrément à un disque déja excellent.Car oui, pour un premier album, on ne peut qu’être troublé par l’efficacité de ce disque. Une prod impeccable, un son irréprochable (de mémoire, je n’ai jamais entendu un son de guitare aussi impressionnant et “graisseux” depuis… le son de basse de lemmy dans Motörhead !), un chant bien mis en avant (il sera un peu plus mis en recul sur “This is…”, au profit des grattes justement), bref, un superbe coup de semonce.Mais au delà de ces considérations “vinyliques”, c’est bien la qualité des compos qui caresse l’oreille dès les écoutes suivantes : des chansons immédiates, du genre qui oblige à marteller tout ce qu’on a sous la main (je vous laisse imaginer l’état de mon clavier tandis que je tape cette chronique…) et à hocher la tête en rythme sans pouvoir se retenir… Un riff – pardon, je voulais dire un RIFF énorme par chanson (de ces riffs que l’on peut répéter en boucle sans autre accompagnement, sans même se dire une seule seconde que l’on s’ennuie), des chansons imparables… une véritable mine pour les amateurs de musique ! Car oui, au delà de la technique, c’est la musicalité qui surprend le plus avec Milligram : capables de composer des rythmiques puissantes comme une armée de semi-remorques lancés à plein régime, ils se distinguent ici par un break évident, là par un solo impeccable (et même dans ce cas, une demi douzaine de notes de musique suffisent à composer un solo redoutable !)…Bref, Milligram n’est peut-être pas un groupe que l’on peut qualifier de “stoner” à la première écoute, mais fait partie de ces combos (avec Alabama Thunderpussy, Mastodon…) que l’on est fiers de pouvoir y rattacher finalement…
 Les préjugés je vous jure.
Un groupe avec un tel nom, un titre d’album sans confusion possible et une pochette arborant fièrement une tête de mort sur fond de flammes, il n’en fallait pas plus pour répondre à la question qui me taraude à chaque fois que je mets un cd dans une platine pour la première fois : vais-je enfin avoir droit à mon instrument préféré, j’ai nommé l’épinette à l’italienne (clavecin en forme de pentagone pour les curieux) ? Il faut dire que nos frenchies d’Hellsuckers ne font pas dans le détail et la demi-mesure, j’en veux pour preuve ces quelques paroles extraits d’un de leur titre, « I don’t give a fuck if you don’t wanna rock! » Tout un programme. Et je peux vous dire qu’il vous faudra prendre au mot cette maxime qui semble être une devise pour nos cinq loustics qui nous ont pondu là un album complètement déjanté, carrément à l’image du groupe.
Disons le, ça tape dans tous les sens et c’est surprenant d’entendre ce qu’on peut faire comme bruit avec un minimum de conviction. Mais qu’on ne s’y trompe pas, tout cela est parfaitement contrôlé et les titres s’enchaînent à une vitesse hallucinante sans qu’on ne comprenne bien ce qui se passe. En tout cas, une chose est sure, c’est du pur rock’n roll old school parfaitement maîtrisé qui n’est pas sans nous rappeler les allumés de Turbonegro. Car attention, il ne faut pas se méprendre, à y regarder de plus près ces énergumènes ont bien l’air de parfaitement savoir ce qu’ils font et où ils nous mènent car taper comme des malades ça va bien cinq minutes, mais à force c’est lassant. Alors que là, on aurait plutôt tendance à en redemander ! Les compos sont bougrement efficaces et d’une qualité homogène, sans point faible et l’interprétation très solide.
Enfin bon, vous l’avez compris, si vous êtes à la recherche d’un album qui vous secouera l’arrière train et fera vibrer vos tympans à grand coup d’hymnes au rock et bien vous y êtes !
 Me voilà confronté à un dilemme cornélien : comment inciter des gens à se procurer un album qui ne ressemble certainement à rien de ceux qu’ils ont jamais écouté auparavant ? Oui, car cet album est exceptionnel, alors à quoi le comparer ? Comment le décrire ? La filiation avec les Queens Of The Stone Age (enfin, parenté plutôt, vu que MOR existait bien avant QOTSA) peut paraître évidente pour certains, elle ne l’est pas forcément musicalement. Les réminiscences Queensiennes, si elles existent, sont à mettre au crédit d’une variété musicale, de ton, de son, de genres abordés au cours de l’album, mais c’est maigre. On pourrait aussi parler de la ‘clique du désert’, un groupe de musiciens qui semblent passer leur temps à jouer les uns pour les autres (trop longs à lister, mais les Queens y sont en bonne place). Mais bon, au final on tourne en rond, car il est vain de tenter de comparer le bébé de Chris Goss avec qui que ce soit. Le colossal leader de MOR n’a jamais été un suiveur, au contraire, et il impose sa musique à grands coups de mélodies suintantes de bonheur, de sons savamment calculés mais empreints de feelings (énorme travail sur les guitares), le tout servi par des nappes vocales qui surprennent toujours par leur feeling et leur subtilité, surtout quand on voit la carrure ‘physique’ du bonhomme. Les compos défilent donc sans répit, sans faiblesse non plus, il y en a pour tout le monde, tous les genres, mais sans jamais ennuyer : tour à tour remplies d’émotion (‘Counting horses’, ou l’entêtant ‘Roof of the shed’ co-écrite avec Josh de QOTSA), de puissance parfois (‘A wish for a fish’, ‘Shotgun son’, qui mérite à elle seule l’achat de l’album), ou complètement décalées mais toujours jouissives (‘High noon Amsterdam’). Il est plus que temps que le grand public se réveille et reconnaisse au grand jour le talent de ce géant de la musique qu’est Chris Goss. Universel, tout simplement.
1991. Le stoner/doom ne veut encore rien dire, Kyuss fait encore joujou à trouver son son. Cathedral fait du doom death voir du death tout court et Jus Oborn fait de même avec Thy Grief Eternal. En gros, le riff sabbathien mixé au groove désertique, ça n’est pas encore à l’ordre du jour. Sauf pour ce quatuor de Brooklyn. Eh ouais. En 1991, ces 4 new yorkais viennent d’enregistrer une quasi-genèse de ce qui me pousse à me lever le matin : prendre mon pied sur un son lourd qui me fait secouer ma tignasse graisseuse au rythme d’accords binaires et occultes.
Le pire, c’est que ce disque n’est qu’une démo dont ils ne garderont que certains morceaux réenregistrés, qui paraîtront sur le premier album qui sortira sur le mythique HellHound. C’est Toreno de LeafHound qui la publiera des années plus tard et on n’ose y croire. Ça, une démo ? Le son est monstrueusement monolithique, grésillant et chaleureux, rond, massif. Des mecs ont réussi à sonner comme Dopethrone 10 ans avant ? Le beau prestige du trio du Dorset en prend un sacré coup.
Et il y a plus qu’un son, il y a les riffs. Ça charcle sec. A l’image de leur nom, c’est saignant comme dans les rigoles d’évacuation d’un abattoir. Tout le monde en prend pour son garde. Les morceaux avoinent pendant un quart d’heure en moyenne, malgré quelques torpilles de 5 minutes et on ne s’ennuie pas. On secoue la tête, hébété, la voix épaule la mélodie, pendant que les grattes aiguisées déversent des flots de soli affutés comme des lames de rasoirs. Ça du branlage de manche, ils en ont foutu partout, c’est plus pratique pour tailler la barbaque mais ça sait s’arrêter pour revenir au riff marteleur qui font la force de cette démo. Violent, malsain, insidieux, ça bourrine tout en restant dans une optique simple et claire, malgré les litrons d’hémoglobine : Elever un culte kitsch et boursouflé à notre idole à tous, Tony Iommi, l’apprenti boucher qui n’a pas hésiter à payer de sa personne pour vérifier la qualité de découpe de ses riffs sur son doigt. Une fois lui a suffit.
Au bleu, saignant, à point ou bien cuit, malgré nos préférences de cuisson, nous savourerons tous ce disque et son petit frère de la même façon, comme un morceau de choix qu’on a laissé bien trop longtemps au réfrigérateur, mais qui n’a rien perdu de son fumet.
Décidément, Clutch fait l’actu en ce moment : lives en veux-tu en voilà, albums, projets parallèles… Ainsi, pendant que ses collègues s’amusent dans leur groupe instrumental The Bakerton Group, Neil Fallon s’en va apporter ses vocalises à un nouveau projet, accompagné pour ce faire de potes issus de CKY, Fireball Ministry ou Puny Human : The Company Band.
Difficile de se faire une opinion tranchée sur un groupe à l’écoute de 4 malheureux titres sur cet EP dont le design rappelle avec émotion les “messages à caractère informatif”. Le premier titre, “The company man”, aux paroles gentiment cyniques, est celui qui ressemble le plus à Clutch, en plus direct, moins groovy. Excellent toutefois. “Fortune’s a mistress”, mid-tempo lancinant, ne fait pas baisser le niveau. Avec “Spellbinder”, le groupe propose probablement son titre le plus faible, avec un refrain un peu téléphoné (un clavier un peu dispensable sur ce titre). “Heartache & Misery” vient cloturer cet EP sur un tempo lent, emmené par un lead de guitare lancinant, et une ryhtmique un peu plus groovy (bien portée par la basse ronflante de Jason Diamond, de Puny Human).
Au final, le fan de Clutch appréciera cet EP sans forcément le trouver génial. On pourra décrire cet essai comme une version plus “propre” de Clutch, moins graisseuse, plus “rock indé” peut-être, même si l’étiquette n’a aucun sens. En tout cas une écoute bien agréable, et 4 titres très diversifiés, qui nous donnent envie d’en entendre plus.
 Bon sang, mais personne ne les a prévenus ? Qu’on était passés au Troisième millénaire ? Que c’est fini les 70’s ? Même la pochette du CD est ‘vintage’ ! Bon, c’est vrai, c’était la bonne époque, on les comprend de vouloir y retourner… Et puis le pire, c’est qu’en deux ou trois écoutes de ‘Deluxe’, on se prend à vouloir les y rejoindre, tout simplement ! La progression du groupe, dont c’est le second album à peine, est saisissante : leur précédent brûlot ne parvenant que difficilement à se débarrasser d’une étiquette stoner rock teinté de rock sudiste, ils s’affranchissent désormais vigoureusement de ce genre, et même s’ils évoluent en terrain connu, ils le font bougrement bien ! Il est donc question ici de rock 70’s pur jus, gonflé par des grattes plombées et une basse ronflante, ronde et chaleureuse, et un chanteur parfait, empreint d’émotion si nécessaire ou de puissance à d’autres moments. Véritable hymne à la guitare au sens large, on retrouve sur l’album des parties de lead crasseuses à souhait, des riffs remarquables, des soli sublimes, il y en a pour tous les goûts ! Rajoutez à ça quelques nappes d’orgues, de la slide guitar (tendance Raging Slab), et vous vous retrouverez sans faute projeté deux bonnes décennies en arrière, pour votre plus grand bonheur ! Car c’est bien ça qu’il faut souligner : l’album est une réussite totale, du pur bonheur en rondelle. Ah, si tous les fans de Limp Bizkit pouvaient se donner la main et aller acheter cet album, le monde n’en serait que meilleur !
Chronique ? Pas chronique ? On peut légitimement se poser la question à l’écoute de cet album de Creature With The Atom Brain. Parce que musicalement, c’est pas franchement stoner, ni affilié. Mais d’un autre coté, les musiciens font partie de Millionaire (demandez à un certain Josh Homme ce qu’il pense de ce combo…) et du groupe de Mark Lanegan. Alors forcément, on est vite curieux !
Alors à quoi ça ressemble ? C’est étrange, très expérimental, très “sec” et froid. La gratte est sèche, la basse est saccadée, les plans de batterie ressemblent plus à des percus ou aux tambours du Bronx, ya des loops partout et des samples en musique de fond. Ah oui, et il n’y a pas de chant (ou alors à travers des effets ou repris dans des samples). Beaucoup d’électro, pas trop de structures linéaires au niveau compo…
Est-ce intéressant ? Pour le fan de stoner puriste, inutile de se voiler la face : non. Par contre, le fan de Mike Patton, par exemple (période post-FNM et fin de Mr. Bungle jusqu’à aujourd’hui) y trouvera son compte, tant on dirait ce groupe le fruit improbable de la communion entre les sonorités indus de Nailbomb, les chansons déstructurées de Tomahawk, et la pop anglaise des années 80. Pour les curieux et les audacieux, ce n’est pas inintéressant…
|
|