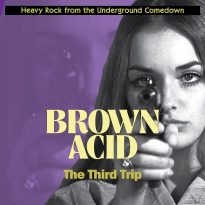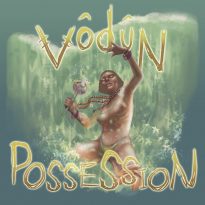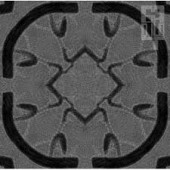|
|

Il y a peu de temps encore, Troubled Horse était « le groupe des dissidents de Witchcraft » : trois des membres fondateurs du classieux combo suédois (les frangins Jens et Ola Henriksson, avec John Hoyles – même si seul Ola figure toujours dans les effectifs de Witchcraft à l’heure actuelle) ont effectivement formé cette engeance. A noter que Simon Solomon, le guitariste de Witchcraft, a lui aussi occasionnellement joué en live avec le groupe. Ce statut un peu trouble (même si le groupe n’en a pas joué en tant que tel) a opportunément induit une certaine légitimité et un sceau de qualité présumé dont Troubled Horse a largement bénéficié à ses débuts, et ce même si musicalement le groupe n’a jamais complètement versé dans l’ersatz de Witchcraft. Or, ces dernières années, Martin Heppich, l’imposant frontman et vocaliste du cheval perturbé, a progressivement « aménagé » ses effectifs … qui ne comptent désormais plus aucun musicien rattaché de près ou de loin à Witchcraft ! On repart donc d’une page blanche, on laisse de côté les a priori, et on se penche sur ce Revolution On Repeat avec une oreille neutre…
En réalité, dès les premières écoutes les échos de Step Inside (le premier album du groupe, sorti il y a cinq ans déjà, lui aussi chez Rise Above) remontent : on n’est pas partis trop loin musicalement. Avec des atours un peu plus « enjoués » que son grand frère Witchcraft, le quatuor s’appuie toujours sur une base heavy rock / blues rock très typée 70’s, drapée d’une énergie presque power rock dont tant de combos suédois ont pu se faire les porteurs valeureux ces dernières décennies.
Pour le reste, on est dans la nuance… mais ça peut suffire à faire la différence avec la nuée de groupes s’inscrivant dans la même veine musicale. Surtout quand un combo apporte tant de soin à ses compos : 10 titres sans point faible, c’est remarquable en soi, mais 10 titres chacun efficace à sa manière, c’est pas fortuit. Dix titres bien distincts donc, balayant toute la palette de genres à disposition, du très « Kadavar 1ère génération » (« Which Way to the Mob ») au boogie rock vintage à la « Hellacopters dernière génération » (« Peasants » et son accompagnement piano, « Let Bastards know »), en passant par les tempo lents ou mid-tempo mélodiques (« Desperation » ou le très catchy acoustique « My Shit’s fucked up ») voire le heavy-prog-déjanté-WTF (« Track 7 »)… tout y passe ou presque, sans faute de goût, et avec quelques prises de risque rafraîchissantes.
Bref, Troubled Horse a beau s’inscrire totalement dans la mouvance vintage / rock 70’s qui fait tant d’émules ces dernières années, ils parviennent, comme une petite poignée de groupes, à surnager de la masse : en injectant un petit complément d’énergie typique, en variant largement ses compos et en invoquant des genres musicaux complémentaires, le groupe séduit. Revolution On Repeat s’avère une bonne surprise dans un créneau musical à la fois saturé de groupes et très balisé stylistiquement. Les scandinaves prennent leur liberté pour avancer et tracer leur petit chemin, sans prétention et toujours respectueux des codes et de l’héritage, mais avec de bonnes idées et une exécution sans faille. Un cocktail rare ces deniers temps, pour un album très plaisant. Reste à voir si l’énergie ressentie ici se transposera sur les planches à travers ce line-up renouvelé…

On ne compte plus de nos jours les duos guitare/batterie, habilités, dans ce simple apparat, à triturer le rock, démembrer le blues et en extraire sa plus séminale énergie. Derrière les White Stripes, Black Keys ou autres frenchies Inspector Cluzo, il y a, à bien moindre échelle, The Picturebooks. Deux Allemands ne jurant que par la moto, le skateboard, la musique et les incessantes tournées, dont le premier album Imaginary Horse contenait toutes les raisons de s’enthousiasmer outre mesure pour cette musique improbable, faite d’énergie percussive et de refrains à chanter à gorge et barbe déployées. Publié chez Riding Easy, qui prouvait une fois de plus à ce moment son (bon) goût pour un certain éclectisme, sous le haut patronage, soyons sérieux, de Sabbath ou Zeppelin. Qui pourrait s’en offusquer?
Le second album du duo sort chez Another Century Records en ce début d’année et reprend, coup pour coup, la recette à l’efficacité mitonnée lors du premier essai. C’est à dire une batterie presque tribale, faite de toms, sans cymbales et une guitare blues aussi distordu que possible. Entre incantations presque indiennes (« Cactus » « Home Is A Heartache ») et hymnes à la route (« On These Roads I´ll Die »), tout en tempêtes et accalmies (« I Need That Oooh », « Zero Fucks Given » deux grandes réussites), l’album s’écoule et s’écoute avec passion. On pense aux Black Keys dès les premières notes de « Wardance », évidemment dans cette volonté partagée de moderniser le blues mais là où les premiers s’échinent à le rentre accessible et dansant, les Allemands eux ont pris le pari du farouchement sauvage, pour notre plus grand plaisir. On retrouve bien sûr quelques ponts avec l’album précédent comme le rampant « Fire Keeps Buring » qui reprend les choses là où « Your Kisses Burn Like Fire » les avait laissées, soit au creux des lèvres d’une femme. Car c’est comme ça que cet album se consomme, entre amour et groove de mammouth, sur la route de préférence. Une route que The Picturebooks connaît par cœur à force de sillonner le monde pour y jouer, dans le moindre bar comme dans le plus grand des festivals.
Et s’il était là le dernier rêve hippie ?
Point Vinyle :
Collectionneurs passez votre chemin, Another Century Records a fait dans l’efficace : version noire classique, avec CD inclus. Ce qui n’empêche que la musique vaut bien l’achat.

Ne nous voilons pas la face : depuis la (salvatrice) reprise d’activité de Small Stone, on a du mal à cerner la ligne directrice du label américain, devenue peu lisible ces derniers mois. Même si l’ami Scott avait toujours soutenu les productions européennes, on a le sentiment désormais qu’elles occupent les premiers rangs de son roster – resserré aussi en terme de quantité, il faut le dire : Them Bulls (Italie), Miss Lava (Portugal), Captain Crimson (Suède aussi)… C’est donc avec un œil (et une oreille) toujours curieux mais circonspect que l’on aborde cet album des suédois de Långfinger – leur troisième, mais le premier sous le drapeau du label de Detroit.
Långfinger, donc, ou « doigt d’honneur » dans un suédois un peu simplifié. Mais point de rébellion acharnée dans cet opus, pourtant, contrairement à ce que pourrait laisser penser ce patronyme « contestataire » : sans baigner dans le consensuel gnan-gnan non plus, les 45 minutes de musique proposées (décidément, le format 45 min / 10 chansons est devenu le standard) tournent allègrement au heavy rock, parfois nerveux certes, mais on est bien loin du punk bave-aux-lèvres, ou même du high-energy rock que d’autres groupes suédois peuvent proposer (genre Hellacopters, Backyard Babies…). Ce n’est pas un indice qualitatif en revanche : ce que propose le groupe est intéressant et très bien fait.
Mais est-ce que ça casse trois pattes à un canard ? Pas vraiment non plus. Si le trio s’en tire bien, c’est effectivement dans sa qualité intrinsèque : compos soignées, exécution sans faille, prod exemplaire, mise en son impeccable… Même le format du power trio, le plus souvent un facteur de dénuement instrumental appréciable, est ici souvent aseptisé par un travail d’enregistrement recourant à des plans de guitare en plus, des claviers, percus… Assez loin du “raw and dirty” habituel chez les power trio. On est plus sur une autoroute stylistique qui balaye large que sur des sentiers de traverse à défricher de nouveaux territoires musicaux. On est aussi amené à la conclusion que le combo scandinave verse en fait vers un paysage musical complètement “américanisé”, sa spécificité géographique n’étant pas vraiment mise en avant. On pense occasionnellement à Van Halen (“Say Jupiter”) et plein d’autres groupes clés de l’americana / hard rock old school. Mais encore une fois, le trio ne rentre jamais franchement dans une case, et au final la synthèse prévaut.
En bref, Crossyears est factuellement un très bon disque, foutrement bien foutu et blindé de compos réjouissantes. Pour autant, et aussi méritant et talentueux que soit son trio d’auteurs-interprètes, on a du mal à l’imaginer laisser une trace indélébile dans l’histoire du rock. Ça ne l’empêchera probablement pas de donner sa ration de plaisir coupable à bon nombre de fans de gros rock graisseux (ils auraient bien tort de se priver) ainsi que sur scène où on imagine sans peine l’énergie déployée par leurs prestations.

Incroyable histoire que celle de Zeal & Ardor, l’EP de 23 minutes passé d’anecdote sur bandcamp à sensation metal de 2016 par le truchement d’un emballement médiatique tout sauf banal. A l’ère de la musique dématérialisée, noyée dans la masse et les niches, Manuel Gagneux, touche-à-tout suisse exilé à New York (et revenu depuis), jusque là (re)connu pour son électro pop chiadée avec Birdmask, a décidé de mixer black metal et negro spiritual et de voir où tout cela le mène. En moins d’un an, celui qui a tout enregistré, et programmé des sons de batteries pour faire l’affaire, se retrouve père d’un projet unique et innovant. Il a depuis monté un (vrai) groupe, va faire le Roadburn, de nombreux autres festivals et une jolie tournée européenne autour. Sa musique servira même prochainement de bande son à une série TV traitant de l’esclavage.
Et dire que tout ça part d’un tweet de Kim Kelly, journaliste chez noisey. De là découlent des articles chez Rolling Stone, Noisey/Vice puis un focus sur Tracks, l’émission d’Arte. Success story. Il faut dire que les 23 minutes de Devil Is Fine frôlent la perfection. Partant du constat que le black metal partage avec les musiques d’esclaves noirs américains l’idée d’un christianisme subi, Gagneux mixe leurs caractéristiques sonores, le tout sur fond de cultures religieuses (diverses) revisitées dans un esprit entre explorations théologiques et interrogations du blasphème. Entre son triptyque « Sacrilegium » (Le premier modifiant un appel à la prière coranique, ce qui est un sacrilège, le second jouant sur le traitement des intervalles, considéré comme un sacrilège par l’église catholique au moyen âge et le troisième, ritournelle électro enfantine est un sacrilège sur… un album de metal) et les saillies black metal dans les chants de coton (« Devil is Fine », « In Ashes », « Children’s Summon »), Zeal & Ardor pousse plus loin encore l’idée des cross-over musicaux et présage de nombreuses mutations futures. Rajoutons à cela les deux grandes réussites de l’opus : l’indéfinissable « Come On Down » et le magistral « Blood In The River », deux pépites qui vont, indubitablement, dans leur traitement moderne et esthétisant du metal et leur mariage parfait avec des traditions sonores d’un autre temps, changer durablement l’avenir du metal extrême.
L’un des albums les plus importants de la décennie, simplement.
Point Vinyle :
Publié chez Reflections Records dans un premier temps, l’EP Devil Is Fine est pressé en 650 vinyles black, 150 transparent green et 150 white. Un label Mvka semble avoir été mis en place depuis par Gagneux lui même pour gérer la demande. Un Picture Disc a été produit et gageons que de nombreuses nouvelles éditions vont suivre.

Ne vous fiez pas à la pochette, cet album est bien. Les trois remois de Dirty Raven en ont sous la caboche et le capot et nous le prouvent d’une manière très efficace avec ce Freaks & Idols.
Ici, le riff est sanctifié et la lourdeur vénérée. Ici, on préfère la puissance rythmique et la luxation de cervicales les cheveux dans le vent à un solo de guitare un peu longuet. Dirty Raven cherche l’essentiel avec un stoner/rock qui frappe dans le mile et un sens aiguisé de la mélodie. Dès le premier titre, « Catch The Train », on sent que le morceau va nous rester en tête un petit moment. Même constat avec le suivant, « Rockabilly Girl ».
Le très langoureux « First Miles » nous plonge directement dans un vieux strip club perdu de Californie, et on glisse volontiers un billet de 5$ sous la ficelle parce que la demoiselle est charmante. Évidemment, l’influence des grands du stoner est flagrante, mais Dirty Raven l’a assez bien digérée pour réussir à concocter sa propre recette, en y ajoutant une touche un peu pop.
Le morceau « Dumb » aurait complètement pu se retrouver sur un disque des QOTSA, période moderne : les arrangements vocaux, le refrain catchy, une section rythmique qui martèle des enclumes, tout rappelle la bande du grand rouquin.
Jusqu’au dernier morceau « Brainwashing », Dirty Raven fait défiler les riffs sans que l’on voit le temps passer. 5 morceaux, 5 tubes, 5 parfaites portes d’entrées dans l’univers du stoner pur jus, celui avec des grains de sables et beaucoup de soleil. Chapeau les corbacs!
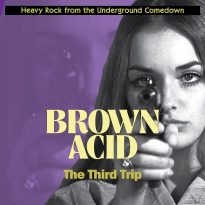
Brown Acid est le nom d’une série de compilations publiées chez Riding Easy Records regroupant de nombreuses pépites hard rock 70’s oubliées. Le postulat de Daniel Hall, boss du label, et Lance Barresi de Permanent Records, consultant sur la collection, est simple : réunir sur un même disque quelques titres qu’ils affectionnent, rarement parus sur album (souvent uniquement en 45T) et méritant, à leurs yeux, une seconde chance. Se côtoient alors morceaux oubliés, pépites mésestimées et parfois trésors remontés à la surface par le truchement du net, dans l’esprit initié par les fameuses compilations Nuggets. Autant de groupes à coté desquels on serait passé et à qui les séries Brown Acid donnent une seconde vie et un peu d’argent, puisque chaque participant touche un pourcentage de ces ventes, certes encore (trop) confidentielles pour le moment. Après nous avoir fait (re)découvrir Raw Meat, Bacchus ou Josefus sur le premier LP, Ash et Crossfield sur le second, voici venu le troisième volet d’une collection déjà indispensable aux nostalgiques de l’époque.
Constitué en général de groupes américains, implication locale du label oblige, Brown Acid fait toutefois quelques exceptions telles Chook (Australie) et Factory (Angleterre), formations aux places de choix sur cette troisième publication. Les premiers se présentent alors avec riff tranchant sur refrain imparable tandis que les seconds ont l’approche bien plus psychédélique, voix chevrotante et intentions futuristes pour un titre « Time Machine » parmi les plus percutants de l’opus. Soyons clair, il n’y a rien (ou presque) à jeter du long des 11 titres (pour 38 minutes de riffing 70’s) de l’album, que ce soit le proto heavy de Blown Free (« The Wizard »), le boogie rock de Cold Sweat (« Quit Your Feelin’ ») ou « Higway Song » d’Eliott Black qui, dans un monde parallèle, aurait été un hit en 1978 avec son riff galopant et sa flûte discrète à la Jethro Tull. Mais c’est bien Grand Theft avec « Scream (It’s Eating Me Alive) » qui s’en sort le mieux, nous servant un titre rageur, comme une rencontre tendue entre Led Zeppelin et Iggy pop, un mariage hard rock et punk publié en 1970 et qui sonne déjà comme les prémisses du grunge. Le groupe vient d’ailleurs de Seattle, coïncidence ?
Je ne saurais que trop conseiller au plus hippies d’entre vous de se jeter sur la collection Brown Acid dans son entier, et sur ce troisième volume en particulier, tant il regorge de perles hard rock 70’s, idéales pour garnir les plus exigentes discothèques. On me dit par ailleurs dans mon oreillette qu’un quatrième volume est déjà en route, prévu pour avril. Vivement.
Point Vinyle :
Notons que l’édition vinyle s’accompagne d’un texte explicatif sur la démarche et de quelques photos d’époque (en noir et blanc sur le back de la pochette), je pense qu’un insert avec des documents d’époque serait une jolie invitation au voyage ! Côté quantité, 1500 albums ont été pressés : 100 en clear, 400 en clear purple, 500 en black et 500 en olive green. Une bonne moitié de ces éditions sont déjà sold out.

Internet est une chose formidable permettant à un jeune trio blues fuzzé, originaire de Melbourne, Australie, de signer chez un label Allemand et vendre quelques centaines de disques en Europe et aux USA sans n’avoir jamais mis un orteil hors de leur île. Cette histoire c’est celle de pas mal de formations et c’est celle de Child, dont le premier album éponyme, sorti chez Kozmik Artifactz en 2014 avait ému de nombreuses paires d’oreilles, dont les miennes, avec leur son chaud et granuleux, leur blues sensible et fuzzé, galette parfaite pour les lendemains en forme de gueule de bois (sérieusement, infusez-vous le titre « All dried up » de toute urgence). Leur petite réputation faite, le groupe pu goûter à l’Europe en 2015 (Up In Smoke, Keep It Low, DesertFest et pour nous autres français pas moins de 3 dates au menu) et placer quelques titres sur des compils (Hommage à Hendrix chez Magnetic Eyes ainsi qu’une compil de leur label). Autant battre le fer tant qu’il est chaud, revoilà Child avec un second effort, début 2017. Sobrement intitulé Blueside, ce dernier reprend les choses là où Child les avaient laissées.
Le seul changement notable nous vient du personnel, puisque Danny J Smith, aperçu chez The Ovals, remplace Jayden Ensor à la basse. Pour le reste le trio reprend sa quête de fuzz sans pour autant sortir du cadre d’un blues rock lancinant et groovy. Impeccable dès « Nailed to the Ceiling », délicieusement désespéré avec la sublime « It’s Cruel to be Kind » (bien aidé par l’ajout, discret mais efficace de chœurs féminins), Child égraine ses ritournelles à grand renfort d’un dosage habile de sensibilité et d’explosions. Aussi court qu’efficace avec ses 40 petites minutes de musique, Blueside offre de bien beaux moments de rock et confirme que « Dirty Women » est décidément un titre de chanson qui fonctionne.
C’est donc du pays qui enfanté d’AC/DC ou de Rose Tattoo que nous vient l’album le plus bluesy de ces derniers mois. Well done.
Point Vinyle :
Kozmik Artifactz a pressé l’album en trois versions : 166 blue/white marbled (déjà sold out) et deux autres versions : une bleue et une classique, noire.

Tel un appel à l’hommage et aux valeurs pures et dures du son Stoner/Rock, Monsternaut débarque enfin avec son premier album éponyme. Il aura fallu attendre deux EP avant que le trio finlandais propose un opus complet de neuf titres que nous allons décortiquer comme il se doit.
On ne va pas se mentir, dès la première écoute, on pourrait croire qu’on s’est encore trompé de CD et qu’un Fu Manchu ou autre mets Californien s’est glissé dans la platine. Car il faudrait vraiment avoir été dans un coma de trente ans pour ne pas s’en rendre compte. Ici, il n’est pas question de réinventer quoi que soit, juste de compléter l’univers Stoner aux accents de Monster Magnet et autres Queens Of The Stone Age. Faut-il pourtant s’en plaindre ?! Oui et non, car en effet, les premières écoutes pourraient nous donner cet effet de tribute band. Mais la critique serait bien trop facile. Non, ce premier album recèle de belles surprises caractérisées par une recherche sonore bien originale et groovant entre le reflet des guitares fuzz style années 90 mais aussi des charmantes productions de ce début du XXIe siècle. Alors oui, cet opus n’est finalement qu’un rassemblement des deux premiers EP, mais il est clair que l’homogénéité globale est à ravir. C’est en soi un mélange de Stoner et de Desert Rock très classique sans artifice ou prise de risques, mais l’ensemble fonctionne très bien.
En même temps, pourquoi s’interdire ce qui fonctionne. Il suffit d’ouvrir la danse avec le premier titre « Dog Town » qui nous rappelle bien volontiers l’introduction de l’album Songs For The Deaf avec ses riffs accrocheurs, de la fuzz en veux-tu en voilà, un duo basse-batterie hyper rythmique et une voix qui pourrait faire la jonction entre Fu Manchu et le groupe français Rescue Rangers. Niveau ambiance métronomique, mettez-vous « Caravan » et vous comprendrez que le groupe alterne souvent entre rythmiques rapides et bien lentes, histoire d’accrocher sur les ponts. Pas de solos, pas trop de longueurs, juste un bon moment entre copains ! Puis pour le côté plus méchant et plus psychédélique, rendez-vous sur « Black Horizon » et « Mexico » : vous ne serez pas déçus, dans la mesure où ces deux titres sont certainement les plus originaux et donc les révélateurs d’un groupe en pleine ascension.
Ce premier opus de Monsternaut est donc une valeur sûre pour ceux qui veulent juste entendre du bon son fuzzy Californien des années 90. On attend maintenant que les Finlandais se lâchent un peu plus pour nous offrir quelque chose qui forgera leur identité, et il n’y a aucun souci à se faire, ils en sont clairement capables.

Le furieux trio texan, emmené par les frangins Juett, a jusqu’ici laissé une trace vinylique honorable mais plutôt timide en terme de visibilité (deux albums sortis chez Ripple Music), qui ne soutenait pas la comparaison avec leurs prestations live fiévreuses (qui ont notamment laissé pas mal de monde sur le carreau en première partie de Wo Fat il y a quelques mois). Ils sortent leur nouveau disque en parallèle sur Heavy Psych Records, ce qui surprend un peu (décidément ce label transalpin initialement dédié – comme son patronyme sans ambiguïté le laisse deviner – aux groupes les plus psyche, élargit son roster dans tous les sens et tous les genres !) mais pourrait peut-être constituer pour le groupe un rebond salvateur dans leur carrière… et aussi dans tous les cas un ancrage sur le vieux continent qui pourrait nous permettre de voir un peu plus souvent sur les planches le furieux trio texan, jusqu’ici très ancré sur son territoire.
Musicalement, on aurait du mal à leur reprocher cet attachement à leurs racines texanes, tant leur musique suinte la sueur et leurs riffs sentent la poussière et le sable chaud. L’empreinte territoriale dans ce qu’elle peut proposer de plus intéressant ! Pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, on décrira volontiers Mothership comme le croisement musical de plusieurs combos du cru : on y retrouvera des plans heavy et doom-psyche (version US) typés Wo fat, des passages blues rock fiévreux à la Dixie Witch, l’énergie redneck houblonnée de Honky, le groove lourd et glaireux de Egypt (même s’ils sont pas texans, eux… mais on se demande pourquoi !)… Franchement, de quoi aiguiser l’appétit. Rajoutez à ça l’effet de la « formule » texane, en particulier le dispositif du power trio (condition nécessaire mais non suffisante d’obtention de l’AOC « boogie rock » initiée par ZZ Top), et les différents éléments clés d’un cocktail réussi sont réunis.
Reste donc à évaluer le liant de tous ces ingrédients, à savoir les compos. Et là, on en a pour notre argent… et en même temps on aurait quand même aimé en avoir plus ! Plus de musique déjà : 33 minutes pour 8 morceaux (dont 2 instru pour 7 minutes en tout) ça fait quand même un peu léger en brulots pour nous rassasier – on a encore faim après écoute…
Qualitativement ensuite, le bilan est plutôt bon : le trio a trouvé sa zone de confort dans le « up/mid-tempo », intervalle rythmique béni des dieux du boogie rock où il cale son groove avec un talent d’artisan du rock – besogneux mais efficace. Les titres s’enchaînent donc dans cette veine, et heureusement finalement que l’album est court, ça évite la redondance d’une recette bien maîtrisée, mais roborative. Prenez un morceau comme « Ride the Sun » : lick de guitare groovy entêtant, aboutissement sur un riff bien fat, couplet accrocheur, et point culminant sur un solo de guitare jouissif avant un lâcher de chevaux dans les règles de l’art. Tout est là. Globalement le reste est à l’avenant, avec quelques morceaux de gloire tels « Speed Dealer » ou « Helter Skelter » (non c’est pas une reprise). On déplorera néanmoins quelques titres de moindre intérêt (« Crown of Lies » qui se perd un peu en chemin, « Midnight Express » – le refrain en chœur, c’est juste pas possible les mecs…), ce qui nous fâche quand même un peu : sur un album aussi court, ne pas avoir la perfection à tous les niveaux est forcément un petit regret…
Pour résumer, on aurait adoré que High Strangeness soit l’album de l’explosion, la révélation éclatante au « grand public », la preuve inattaquable de l’excellence de ce trio qu’on apprécie tant. Sans être raté, High Strangeness est (seulement) une nouvelle pierre apportée à la discographie déjà solide du combo, dans la continuité. C’est déjà très bien, certes, et ça constitue une très saine plateforme pour justifier de prestations live de haute volée. Objectif largement atteint sur cet aspect (et il nous tarde). Reste qu’on aurait aimé prendre une grosse torgnole avec un album référentiel, le nouveau mètre-étalon du genre, et nos espoirs sont frustrés. Mais bon, ça reste du haut niveau, et probablement parmi ce qui se fait de mieux dans le genre à l’heure actuelle.

Le “Live” de Saint Vitus sorti en 1990 apportait un témoignage de qualité à une première décennie de carrière marquante pour le quatuor culte, surfant en particulier sur l’apport notable de l’arrivée de Wino en ses rangs. Un son très propre pour l’époque (même si pas exempt non plus de reproche, mais on parle de 1990 hein !) et une set list impeccable.
Les désormais un peu vieillissantes gloires du doom U.S. se sont appuyées sur le label français Season of Mist pour sortir un nouveau live, sobrement et fort logiquement intitulé “Live Vol. 2”, qui vient couronner le retour en grâce (et en activité) d’un groupe à l’occasion de la tournée promotionnelle qui a accompagné la sortie du pas si mauvais “Lillie: F-65”.
Pas besoin d’analyse très élaborée du disque pour avancer que l’on est mitigés à l’écoute de ce témoignage. La set list d’abord n’apporte pas grande surprise (presque la moitié de titres en commun avec le premier live…) même si elle couvre une très large part de la disco du groupe, ce qui est fort appréciable. Le son en revanche, laisse à désirer : derrière le sempiternel “on a privilégié un son brut, sans overdubs” on peut quasiment traduire “on a enregistré le truc direct sur la table de mixage et on vous le livre tel quel”. Clairement, le bouzin a pas dû leur demander beaucoup de travail de mixage… Pour dire, le son semble moins bon quasiment que leur live de 1990 ! Public quasiment absent du mix, un son “froid”, une basse aussi présente que Mark Adams est dynamique sur scène… Bof et re-bof. On ne pourra en revanche pas critiquer l’exécution : c’est carré en diable, et la machine Saint Vitus n’a pas pris une ride en terme d’efficacité sur les planches (même si les mimiques de Dave Chandler manquent un peu sur un support audio).
En synthèse on retiendra un témoignage agréable de cette période (une période déjà un peu obsolète, étant donné le départ de Wino et le retour du débonnaire Scott Reagers au micro depuis plusieurs mois), gravée sur une rondelle vinylique qui ne sortira pas comme un élément majeur d’une discographie qui ne manque pas de points culminants. Disque agréable, en particulier pour les fans, mais dispensable pour les simple amateurs.
A noter : une édition limitée “deluxe” du disque contient en supplément “Marbles in the Moshpit”, un live de 1984 qui a fait son petit chemin en bootleg depuis pas mal d’années. On appréciera ce petit “plus” (et on s’abstiendra de critiquer l’incongruité éditoriale que représente cet ajout…).

L’année dernière, Endless Floods sortait un premier album éponyme (chroniqué ici même) tout en sobriété et évitant les détours inutiles pour aller droit au but. Pas originaire de la Canebière pour autant, mais de Bordeaux, le trio composé de deux membres de Monarch nous proposait alors un sludge dronesque teinté de passages ambiants à faire planer/pleurer un mormon, le tout dans une belle ambiance glauque et anxiogène. II décide de poursuivre l’ascension entamée sur les cimes du désespoir.
Les nouvelles compositions restent fidèles aux anciennes et sont toujours aussi efficaces et prenantes. Avec le moins d’artifice possible, Endless Floods va et vient entre ces décharges de violence soutenues par le chant haineux de Stéphane, entre ces passages qui laissent le champ libre aux instruments et à leurs fréquences graves, et entre ces éclaircies où le silence reprend doucement ses droits, mais jamais trop quand même. Le premier morceau, le monolithique «Impasse » de 24 minutes, résume parfaitement cet équilibre.
Si la formule reste donc inchangée, Endless Floods semble avoir voulu épurer un peu plus son nouvel album. Exit les feedbacks un peu trop présents et parfois inopportuns sur Endless Floods, exit les détails inutiles, exit aussi les titres de chanson de plus d’un mot. Sobriété, vous dit-on. L’album est divisé en trois titres seulement, dont la ballade acoustique « Passage » qui vient intercaler ses deux minutes au milieu du disque. Ce morceau aux résonances folk est un souffle d’air pur au milieu d’un paysage toxique, une bouffée salvatrice qui contraste sadiquement avec la laideur qui l’entoure, et qui n’a finalement d’autre dessein que de nous rappeler plus violemment à notre misérable condition. Après un départ sous stéroïde, « Procession » se calme rapidement et clôt l’album en une montée épique qui éclate dans un bordel bruitiste où l’on croirait que nos enceintes sont en train de rendre l’âme.
Comme l’illustre si bien la pochette du disque (d’une photographe dont je vous invite à voir le travail ici, parce que c’est bien), Endless Floods peint notre terne quotidien sous un ciel toujours couvert, mais nous prouve que toutes ces choses monstrueuses peuvent finalement donner naissance à quelque chose de beau, contre toute espérance.
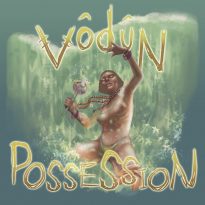
Je vais me mouiller (je l’avais fait à l’époque pour Kadavar et l’avenir m’a donné raison) : Vodun sera, dans 4 à 5 ans, l’une des formations les plus reconnues et demandées de la scène, et nous autres, habitués aux découvertes de l’underground, serons écœurés par le tapage médiatique autour du trio, comme dépossédés d’un énième diamant que l’on aura vu, album après album, se polir. Pourquoi ? Parce que la musique proposée par les londoniens est à la croisée de ce qu’une grande capitale européenne a à offrir : un son enrichi de cultures et de personnalités diverses.
Ogoun, Marasse et Oya, trois pseudonymes, trois déclarations d’intentions. Entre réminiscences tribales et hard rock urgent. Une batteur déchainée, un guitariste allumé et surtout Chantal Brown, ancien faire-valoir vocal de Do Me Bad Thing, obtenant là toute la place que ses cordes vocales et sa soul méritent. Bien sûr, comme la demoiselle est noire, talentueuse et ronde, les comparaisons avec Aretha Franklin fleurissent de partout. Pourtant, en dehors de ces trois critères, convenons qu’il n’y a aucun rapport. Brown s’époumone, harangue, module et livre une prestation vocale décalée (parfois un peu énervante certes), à la croisée entre soul et lyrisme. Là où ce mélange devient génial et unique c’est qu’il est associé à une musique plutôt violente métallique (« Possession », « Mawu », « Divinity »). Puisque la jeu des parallèles reste le mètre étalon dans la musique je dirai que le groupe est à la croisée entre Chrome Hoof pour l’audace, Goat pour le large spectre des influences et (un peu) Black Cobra pour le bazar sonore créé à deux instruments. Au rayon des grandes réussites de ce premier effort, citons « Loas Kingdom » et « Mawu » titres à l’efficacité redoutable ainsi que « Possession » portée par la folie vocale d’Oya/Brown et « Kanpay Rejete » en clôture d’album, synthèse de ce que le groupe explorera probablement par la suite.
Loin d’être parfait, trop long et parfois bancal, affublé d’une pochette franchement indigne, Possession reste un vrai bol d’air frais, original et maîtrisé, porté par une vocaliste unique et la volonté de faire du vacarme leur leitmotiv. Et dire que ce groupe, publié sur une petite structure londonienne balbutiante, a déjà les festivals spécialisés à ses pieds. Profitons, profitons, ils vont bien vite se sentir à l’étroit dans nos petits clubs sombres et mal famés.
Point Vinyle:
Riff Rock Records a (pour le moment) pressé uniquement 500 exemplaires de cette petite pépite, en résine orange. Ne trainez pas si vous aimez les first press.

Les allemands de Plainride voient leur premier album réédité par le label U.S. Ripple Music, dans l’attente de leur second album. Pas une mauvaise idée, étant donné que ladite galette était passée inaperçue à l’époque de sa sortie initiale en 2015, et mérite clairement un meilleur traitement.
Pas difficile de comprendre ce qui a incité le boss de Ripple Music à signer le groupe et à les incorporer dans (l’expansif) roster du label : le quatuor propose sur ce premier effort une sorte de synthèse de gros stoner rock tendance heavy rock fuzzé, qui balaie large, des Truckfighters jusqu’à Nashville Pussy, en gros (en très gros, oui, on est d’accord). Un si gros éventail dans un seul disque ? Ben oui, en fait, il y a de tout dans ce disque, et donc à boire et à manger : 13 titres pour plus d’une heure de musique, clairement c’est un peu trop. Ou dit autrement : le groupe, avec plus de maturité, aurait pu faire plus court et plus efficace en resserrant les lignes et en visant l’essentiel.
En même temps, peut-on décemment interroger la maturité d’un groupe sur son premier album ? Argument difficilement recevable, j’en conviens. D’autant plus que figurent sur ce disque des titres parfaitement recommandables, à l’image du furieusement riffu « Warpdrive », du basique « The News », du groovy (même si pas très original) « Return of the Jackalope », … et même des titres absolument remarquables, dont « Devil at your Heels » ou le somptueux « Grailknights », morceau fleuve d’une dizaine de minutes dont un premier tiers dispensable mais une montée en apothéose toute en soli explosifs et en riffs haletants, qui surnagent qualitativement au sein de ce disque.
En contrepartie, pas mal de titres plus dispensables viennent pénaliser l’efficacité de cette galette, comme le très Truckfighters « Dog », ou encore l’inconfortable « (The beards upon) Mt. Rushmore », qui a au moins le mérite de rappeler que n’importe qui ne peut pas faire du Clutch…. Quoi qu’il en soit, le rapport positif / négatif de ce disque est très favorable au quartet de Cologne, qui propose ici une galette certes imparfaite, mais hautement recommandable.
Dans son (vaste) champ d’action stylistique, Plainride apporte sa belle pierre à l’édifice, même si l’originalité n’est pas forcément au rendez-vous. A ce titre, on leur souhaite une carrière à la Lonely Kamel, qui eux aussi se sont toujours positionnés dans une synthèse experte d’une musique pourtant fortement connotée U.S., pour au final tracer leur route avec le talent qu’on leur connaît aujourd’hui. A suivre de près.

Depuis mois d’un an, un acteur atypique trace son discret chemin dans la scène stoner… Atypique par sa nature : il s’agit d’un magazine ! Un magazine anglophone, mieux vaut prévenir, car l’objet est édité par… des italiens ! Et oui, Fire est une émanation de l’édition transalpine du magazine allemand RockHard.
Rendu au numéro 4, le magazine a gagné en assurance et en renommée, et tandis que nous avions jeté un voile pudique sur le numéro précédent (pour des raisons que les connaisseurs comprendront vite), on ne pouvait passer à côté de ce numéro d’hiver (le magazine est calé sur un rythme de 4 sorties par an), dont la très belle couverture met en avant la dernière sortie de John Garcia.
On se jette vite sur l’intérieur du magazine, et on est d’abord étonné par la qualité esthétique de l’objet. Les habitués du fanzine imprimé en noir et blanc, de travers, agrafé à la hâte, vont être surpris : papier couleur classieux, mise en page franchement travaillée, parfaite lisibilité… Vraiment cool. Même si l’iconographie est essentiellement constituée de photos promo, de logos ou de pochettes d’albums, leur travail d’intégration est abouti, et adapté à l’esprit de chaque groupe.
Côté éditorial – car c’est quand même le juge de paix d’une telle initiative – le travail est impeccable. Les habitués de Rock Hard (par exemple à travers son édition française) ne seront pas déstabilisés par la très grande proportion d’interviews. Il s’agit d’entretiens assez travaillés, pertinents généralement, et adressant surtout une variété de groupes très appréciable : dans ce numéro 4, on passe par exemple de John Garcia à Crowbar, mais aussi Neurosis, Fatso Jetson, Boris ou Monkey3, tout en accordant un espace significatif à des groupes moins exposés (Hornss, Sun Dial, Slow Season, Mother Island, etc…). C’est un premier indice sur la vraie légitimité de l’initiative Fire, qui vise autant à trouver un format rentable (pérennité du support) qu’à proposer une plateforme à des groupes et acteurs plus discrets de la scène, mais tout aussi méritants.
En plus des interviews, on trouve des pans de vrais rédactionnel, allant du “traditionnel” (news, 12 pages de chroniques d’albums…) à des articles plus atypiques (un portfolio de l’artiste Costin Chioreanu, une analyse de l’œuvre de HP Lovecraft et son influence sur certains groupes doom en particulier, un article sur leur gloire nationale Lucio Fulci, réalisateur de classiques du film d’horreur – mais dont le lien avec la musique qui nous intéresse ne saute pas aux yeux…), mais aussi à des articles de fond plus fouillés, à l’image de ce dossier de 5 pages ciblé sur les premières années (1971-1976) de Pentagram raconté par Geof O’Keefe himself, bien foutu et intéressant, de cette page-résumé de la carrière et discographie de Sleep (n’apportera rien aux fans, mais amènera certains à se plonger dans leur œuvre) ou encore de cette petite analyse de la discographie de Cathedral.
Le tout est donc dans un anglais de niveau très correct, très accessible, et apporte un volume de lecture vraiment consistant (les lecteurs de presse “rock” française, qui finissent un magazine en une heure de lecture, sauront apprécier…). On vous encourage donc à faire l’acquisition de l’objet pour vous faire votre propre idée. On aurait pu vous dire de le faire “pour encourager cette initiative”, mais on préfère vraiment vous y inciter juste pour apprécier un vrai bon magazine (et juger le contenu éditorial de la presse rock francophone à l’aune de ce nouveau standard ?…). Bonne lecture !
Le magazine peut être commandé sur cette page pour 10 EUR port compris.

Révélé aux habitués des sombres caves parisiennes en 2013 avec son EP Chien Noir, référence à la métaphore de Churchill pour la dépression, DDENT creuse un peu plus encore son introspection sombre et désespérée avec آكتئاب, mot arabe aux évocations similaires. Dépression. Le ton est donné. Le post metal du quatuor, entre friches sonores industrielles et shoegaze tétanisé n’est en définitive qu’une longue descente dans les limbes de l’esprit dans ce qu’il a de plus négatif. Instrumental, surprenamment mélodique, ce premier album de DDENT n’en est pas moins heavy (« Kohol » et son riff imparable). Les titres de morceaux sont un appel à la découverte des cultures moyen orientales, à l’instar de « Julep », « Houri »et surtout la sublime « Ghazel » dont le titre renvoie à un type de poésie évoquant l’amour sur un rythme répétitif et envoutant. Je ne saurais trouver meilleure définition du voyage proposé par cet album qui, sans être un disque de doom à proprement parler, mêle appétence pour l’hypnose et science de la pesanteur. Deux qualités qui sauront, j’en suis sûr séduire bon nombre d’entre vous.
Disponible en CD et digital ; prions (Allah du coup ?) pour une version vinyle.
|
|