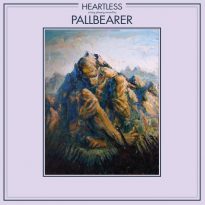|
|

C’est à l’Usine de Genève que j’ai, pour la première fois, fait connaissance avec le son du trio lausannois qui se payait le luxe – excusez du peu – d’ouvrir pour les Californiens de Fu Manchu. Sitôt le trio installé sur scène, je me remémorais avoir croisé ces quidams sur scène à de nombreuses reprises alors qu’ils officiaient pour d’autres formations à des années lumières de la planète stoner : Shovel ou Eastwood par exemple, voire à une formation carrément en lien avec la galaxie que nous explorons depuis une tapée d’années : !
Originaire de Lausanne Rock City, Hey Satan est – vous l’aurez capté – une nouvelle formation composée de lascars pas franchement nouveaux dans le circuit. Organisés en power trio avec une contribution vocale partagée, les Romands se sont rendu au Rec Studio de Genève (qui est une Rock City aussi si des fois vous l’ignoriez et je ne fais pas dans le chauvinisme !) pour mettre en boîte 10 plages qui font parler la poudre.
Ce premier album éponyme explore un territoire musical heavy rock pas franchement vierge avec, ça et là, une résurgence de leurs démons d’antan notamment sur « Bastardizer », une bombe de même pas 2 minutes poutrement efficaces à la croisée des univers de Rage Against The Machine et de Karma To Burn. La rythmique est métronomique et claque redoutablement, les riffs sont envoyés avec vélocité à grands renforts d’effets overdrivés et les parties vocales oscillent entre le cristallin et le saturé. Vous voyez le style quoi…c’est du bon gros rock qui tache et fait remuer de la nuque.
Intelligemment produit, ce disque – empreint de puissance et d’urgence – est conçu pour envoyer les aiguilles du VU-mètre dans le rouge sans en altérer le contenu avec sa répartition efficace des champs dédiés aux différents protagonistes de cette nouvelle aventure stoner dans la tradition de la vieille école. Au milieu de cette déferlante musicale plutôt orienté bourrin, quand le tempo se ralenti – par exemple sur « 1991 » – on se tape un retour dans le passé sur lequel plane l’ombre du blues pour le soleil rouge (très bon comestible donc). Mais n’ayez crainte les Lourds, cette sortie, issue de notre terroir local, est dopée aux amphétamines et elle accompagnera parfaitement vos prochaines sorties sur vos montures ou vos carrosses made in USA.
Point d’orgue de cet opus à mon sens, « In Cold Blood » est un déluge métronomique qui n’aurait pas dépareillé sur « Almost Heathen » – de qui vous savez – avec les voix en bonus. Une nouvelle bonne surprise donc au rayon produits locaux qui n’a pas à rougir une seule seconde de ses origines lorsqu’on la compare à certaines sorties promues par des majors à statures internationales !

Reece, Chris, James et Sammy nous rappellent à leur bon souvenir quelques jours à peine après la sortie du split partagé avec Greenleaf sur lequel chacune des deux formations proposait un titre unique (et pas franchement neuf pour ce qui est des Scandinaves). Cette sortie mise à part, les Londoniens n’avaient pas proposé de nouveau son depuis « Slab City » que Napalm avait propagé.
Les Anglais ont changé de crèmerie, ont opté pour un autre illustrateur toujours dans le registre du comics, mais ont-ils comblé le manque de personnalité que mon collègue – et ami – leur reprochait lors de la sortie de leur précédente prod ? Alors allons-y franchement comme un Normand : ça se discute comme disait feu Jean-Luc. C’est ni oui ni non, ni noir ni blanc, ni poire ni fromage, ni Marine ni Emmanuel (oups je m’égare).
D’un côté, une partie de l’opus nouveau se déploie dans un registre heavy rock assez commun et les quatre garçons n’ont pas inventé la poudre (de Perlimpinpin). On se rapproche clairement du meilleur de la glorieuse scène scandinave d’il y a une quinzaine d’années ; une scène qui nous avait fait sévèrement hocher du chef et taper du pied. « Living Like A Rat » en est l’illustration parfaite avec son gros son hardrockisant ainsi que son tempo trépidant. En rien monotone, cette production va s’égarer dans des registres peu empruntés par le groupe précédemment : le trip instrumental et acoustique avec « The Ebb » qui la clôture (la tournée avec Garcia a visiblement laissé des traces) et surtout « Rough House » qui renoue avec une certaine tradition du titre épique de leurs ancêtres de la nwobhm. Ce dernier morceau est, au demeurant, une réussite du style et je défie quiconque parmi l’assistance de lourdauds que vous êtes de demeurer de marbre durant ces 5 minutes de branlée aux tempi aussi retenus que puissants.
D’un autre côté, Steak fait du Steak et envoie du steak en se faisant plaisir (et en nous en donnant pas mal aussi par la même occasion). Ils ont certes élargi leur terrain de jeu de naguère, mais ont aussi gagné une énorme paire de couilles qui leur permet de nous asséner d’énormes baffes en travers de la gueule. Cette maturité se traduisant par une certaine audace qui les fait clairement sortir de leur zone de confort – sur « Wickerman » par exemple – et surtout par une puissance dans l’exécution qui saura scotcher les amateurs. « King Lizard » pourrait illustrer à lui tout seul la personnalité sonore du quatuor : une basse hyper présente, des riffs tonitruants qui prennent l’ascendant sur une exécution vocale pourtant irréprochable et surtout cette faculté à déployer des riffs entêtants ; c’est carré et ça tourne ! Certainement un des meilleurs extraits de cette rondelle, ce morceau est clairement une réussite tant au niveau écriture qu’au niveau interprétation.
Sacrément en confiance en ce qui concerne leurs capacités à conquérir de nouveaux auditeurs ou pour ce qui est de maintenir captifs ses fans, Steak a carrément opté pour la difficulté en ouvrant ce disque avec une pépite de presque 7 minutes intitulée « Overthrow » (le titre qui figure sur le split dont je vous parlais un peu plus haut pour ceux qui n’avaient pas zappé). Le pari est clairement gagné en ce qui me concerne. Les Britanniques se sont affranchis de leurs inhibitions et s’affranchissent peu à peu des lieux communs qui auraient pu hanter leurs précédents opus en réduisant leur présence sur « No God To Save » et en s’affirmant comme des créateurs car nous savions tous déjà qu’ils étaient des interprètes talentueux.
Point vinyle :
le steak nouveau se déguste, dans sa déclinaison vinylique estampillée gatefold, en édition limitée splatter (y en a pu !) ainsi qu’en version standard noire serrée et sans sucre.
 Depuis quelques années, la grande famille du Stoner au sens large s’est très largement développée. Des groupes nouveaux ne cessent d’arriver, les sorties se comptent chaque année par dizaines et il n’est pas exagéré de dire que notre scène musicale préférée se plutôt porte bien. Depuis quelques années, la grande famille du Stoner au sens large s’est très largement développée. Des groupes nouveaux ne cessent d’arriver, les sorties se comptent chaque année par dizaines et il n’est pas exagéré de dire que notre scène musicale préférée se plutôt porte bien.
Bien entendu dans le lot il y a du bon et du moins bon, des groupes qui durent et d’autres qui repartent aussi vite qu’ils sont arrivés. Ceux qui durent ne sont pas forcément ceux qu’on aurait voulus et inversement ceux qui partent nous font vraiment regretter de ne pas les avoir vu trouver leur public. Mais bon an mal an, le Stoner est un monde en perpétuelle évolution qui se renouvelle sans cesse et a depuis longtemps passé l’effet de mode pour s’inscrire dans la durée. Et puis il y a tout de même un bon paquet de groupes qui sortent leur épingle du jeu et font une belle carrière.
Et même parfois, il y a une pépite. Il y a un petit bijou brut, rare, qui se démarque franchement dans une scène pourtant riche et variée. C’est d’une de ces pépites dont je vous parle aujourd’hui.
Samsara Blues Experiment sort son quatrième album, One With the Universe et c’est sans la moindre hésitation que je vous annonce déjà que, sauf millésime particulièrement exceptionnel, voici mon album de l’année 2017 tout trouvé.
J’ai réellement adoré les trois premiers opus du groupe qui fait pour moi partie des excellentes découvertes depuis quelques années. Rock progressif, stoner blues, rock psychédélique, je vous laisse qualifier ce groupe comme vous le voulez car de toutes façons comme toutes les pépites, aucune étiquette ne sera jamais pleinement appropriée. Samsara Blues Experiment et en particulier ce dernier album c’est tout à la fois. C’est une œuvre, une pièce unique, inclassable, un mélange de tout, une agrégat monstrueusement réussi d’influences diverses et variées le tout produit avec une maîtrise absolument éblouissante.
Les cinq morceaux qui composent cet album sont autant de réussites. Tout, absolument tout pour moi est preuve d’une maitrise parfaite d’un style propre, influencé certes, mais à l’identité unique. L’écriture, l’interprétation, la production, rien, pas le moindre détail n’est à remettre en question. Non inutile de chercher, le trio allemand vient de sortir une pièce instantanément culte, immédiatement inscrite au panthéon de mes gouts personnels. Car oui, bien sur tout cela relève d’un avis subjectif, celui du chroniqueur que je suis et qui en fait peut-être un peu trop pour essayer de vous convaincre. Mais punaise, c’est le coup de cœur que je n’ai pas ressenti depuis un bail qui me tombe dans les oreilles alors vous me pardonnerez certainement cet excès d’enthousiasme.
Et puis après tout, de nous jours, un petit tour sur le bandcamp du groupe et vous pouvez écouter l’album dans son intégralité avant de l’acheter. Alors n’hésitez pas une seule seconde. Hybride entre un Colour Haze plus couillu et un Earthless un chouïa plus posé, Samsara Blues Experiment vient de sortir un album qui fera date. Un album monstrueux. Impressionnant.
Point vinyle :
2 500 galettes noires (gatefold) sont prévues pour une sortie le 26 mai

Autant battre le fer tant qu’il est chaud. Voilà ce que se sont probablement dit Tom Franck et ses acolytes au moment de retourner en studio, quelques mois à peine après avoir sorti Fears Of The Dead, leur premier opus et traversé l’atlantique le temps de 3 festivals. Un studio (le Red Nova Ranch) qui leur appartient et qui se trouve à quelques centaines de mètres à peine de la fameuse maison de Massacre à la Tronçonneuse (celle du fait divers pas du film). Inspirant. Il faut dire que Duel est un groupe dont le mot d’ordre n’est autre qu’« efficacité ». Dans une veine rappelant Pentagram convoquant Thin Lizzy ou Sabbath, le quatuor – au sein duquel ont trouvé refuge deux ex-Scorpions Child – sans pour autant inventer quoi que ce soit, casse littéralement la baraque. Leur soif de riffs directs et sans fioriture est une constante et ces derniers sont impeccables sur scène où ils sont capables d’une débauche d’énergie saisissante (les témoins, présents au DesertFest Anvers, Keep It Low ou Heavy Psych Fest ne peuvent qu’abonder dans ce sens). C’est dire quel était mon enthousiasme au moment où sort Witchbanger, leur second effort.
Le moins que l’on puisse dire c’est que le groupe reprend tout simplement les choses là où il les avait laissées : Riffs de bucherons, entre metal en formation et heavy rock fuzzé, refrains à brailler le poing en l’air, l’autre main sur la ceinture, le tout en moins de 40 minutes (ce qui dans ma bouche est un compliment, à l’ère du numérique et du retour du vinyle, quiconque décide de passer cette unité de temps doit justifier d’une musique impeccable de bout en bout tant l’offre est immense dans le paysage musical actuel). Rien de nouveau donc, rien qui n’évoque pas quelque chose que l’on aurait déjà entendu mais une maitrise absolue de la chose rock, de sa fièvre sonore, de sa décomplexion et de son efficacité. Un vrai disque de niche pour doomsters exigents ou mélomanes conservateurs. Un vrai disque à l’exécution parfaite aussi : avec sa paire de bretteurs toujours prêts à s’escrimer lorsque viennent les solii (ils ne s’appellent pas Duel par hasard) et un chanteur de haut vol (que la fainéantise intellectuelle pousse à rapprocher d’Hendrix ou Phil Lynott, puisque ce dernier est métisse), des qualités qui ne sont malheureusement pas l’apanage du péquin moyen dans ce microcosme fuzzé. Au rayon des grandes réussites, à placer en bonne place au sein des futures playlist du combo listons « Devil », « Witchbanger », « Astro Gipsy » et « Tigers And Rainbows » tandis que « Bed Of Nails » et « Cat’s Eye » sont les gros points faibles d’un disque qui décrasse, décoince et détend et c’est bien tout ce qu’on a besoin lorsque l’on se met ce genre de musique.
Point vinyle :
Heavy Psych Sounds est un label à taille humaine spécialiste des petits pressages à prix doux. A vous de voir donc entre le pressage black à 15 euros ou la série limitée (white purple black splatter) à 20€ à 250 exemplaires. Dans tout les cas vous ne serez pas ruinés !

De fraîcheur, il en est question avec le premier album des Suédoises de MaidaVale. Le quatuor, créé en 2012, évolue dans un blues-rock typique de la fin des sixties, début seventies. Les mises en place, les riffs, les plans rythmiques, tout concours ici à rendre hommage à la période, le tout protégé par l’ombre bienveillante d’un paternel Zeppelin.
Rien de bien original sur la totalité de la galette « Tales of the wicked West » en ce sens qu’on n’est jamais surpris par une idée ou dérouté par une prise de risque. Mais l’ensemble passe crème sur la durée et l’on se surprend même à le ré-écouter comme ça, par plaisir. Fou non ?
Et si la production possède ce ptit goût de « reviens-y » c’est par la grâce de ses accointances avec le psychédélisme et le particularisme de sa chanteuse. Psychédélisme car, quand les guitares abandonnent crunch et fuzz pour plus de délay et d’espace, les compos prennent de l’ampleur et sortent un peu du canevas classique dans lequel elles sont gravées. On appréciera tout particulièrement l’exercice totalement instrumental qui clôture l’album « Heaven and Earth ». Un mantra de 10min arpégé autour duquel gravite un véritable propos mélancolique, bien plus personnel que le reste des titres.
Le deuxième avantage qui extirpe MaidaVale de la masse, c’est sa chanteuse. Plutôt que de singer, à l’instar de nombre de ses collègues, les figures tutélaires du genre (Janis Joplin en tête bien sûr), la frontwoman raconte, narre ses histoires avec une vraie identité vocale où la puissance n’est pas la qualité première, où l’expressivité mène la danse. La sincérité de ce chant clair est de fait, le véritable fil conducteur de l’album et le pourquoi de notre attachement à ce combo.
Un premier album sympathique pour les suédoises, frais et agréable à l’écoute. Il faudra tout de même creuser un peu plus l’identité et les particularités à l’avenir pour que le quatuor puisse nous tenir en haleine musicalement mais ne boudons pas notre plaisir et ré-écoutons donc ce « Tales of the wicked West ».

On doit reconnaître à Sons of Apache une farouche force de caractère. Déjà chroniqué en ces pages voilà quelques années, il nous était apparu que le combo normand avait besoin de mûrir et de simplifier ses choix tant sa conduite musicale partait en tous sens. Quid donc du nouvel EP ?
On sent au bout de quelques minutes que le combo à bouffé de la route entre temps et que la rigueur du live a mis du liant dans l’appareil. Les tempos sont plus rigoureux, l’entente entre les zicos aussi. Leur jam-rock s’en trouve plus que ragaillardit, doublé d’une plus grande simplicité dans la construction des compositions. Bon point pour les deux premiers titres de ce nouvel EP donc.
Sons of Apache retombe dans ses travers en milieu de galette. Bon, pour ne rien vous cacher, et ce dès le début, nous n’étions pas fan de cette voix et ici encore elle n’apporte rien à l’ensemble et plombe les idées. Elle ne correspond pas du tout au style que cherche à développer le combo et plombe littéralement la musicalité des titres. Et puisque nous sommes dans les griefs, il convient de parler de la production dans son ensemble qui joue les montagnes russes, écrase tantôt la guitare, met trop en avant la basse un peu plus tard et n’arrive pas à soutenir les envies des musiciens.
Tout ceci semble dur mais Sons Of Apache doit maintenant apporter cette rigueur et ce caractère en acier trempé dans le traitement de sa musique. A l’écoute d’un titre comme « La Mort », beaucoup plus cinématographique, qui clôture le EP, on se dit que les gonzes ont les moyens de nous pondre une galette grasse et intelligente, étirée et éthérée, au propos très ciblé et à la production soignée. On reste à l’affût et curieux, une fois de plus, de la manière dont vont grandir ces surprenants normands.

Montecharge, quatuor parisien riche en testostérone et en en goudron chaud, sort son premier EP après une démo parue discrètement l’an dernier. Six titres seulement, donc, pour une petite demi-heure de gros stoner sans concession.
L’emballement ne nous gagne pas tout de suite à l’écoute de l’introductif “We Stand”, et son un peu trop cliché “We stand for rock’n’roll” : soit trop 2nd degré, soit pas assez 1er degré, en tout cas le titre se cherche un peu, même musicalement. Grosse rythmique et un vrai beau solo enthousiasmant toutefois. Allez, on prend quand même, c’est plutôt très bien fait, et on a envie d’écouter la suite. En tous les cas, la trame du disque prend forme, et les rythmiques burnées y occupent la meilleure place, bien aidées par quelques riffs fort bien torchés (“Let the Devil get in”, “BAMQ”, “Deep Dark Smoke”…).
Comme rien n’est parfait en ce bas monde, les vocaux ne sont pas (encore) à la hauteur du reste : est-ce par manque de confiance en soi que Walter voit tous ses vocaux chargés d’effets (ou doublés) ? Dommage, surtout qu’ils prennent une grande place sur certains titres – une place pas forcément utile dans cette proportion, d’ailleurs, quand on voit l’efficacité des excellents instru “Cauldron” et surtout le terrible “BAMQ” qui vient conclure cette galette avec fougue, groove et panache.
Alors que la petite planète stoner hexagonale court un peu dans tous les sens, Montecharge vient graver son nom dans la petite liste d’outsiders en capacité de prétendre à une bonne place dans le peloton de tête. Donnons-leur un peu de temps avant de nous prononcer définitivement… mais ça sent plutôt bon cette affaire.

Avec la régularité d’un métronome Clouds Taste Satanic nous proposent un troisième album en trois ans. Mais loin de se cantonner à la petite prouesse de leur premier effort « To Sleep Beyond The Earth », soit la capacité à pondre un unique morceau de 50 minutes (découpé en quatre phases peu tranchées), captivant de bout en bout, ils avaient dynamisé leur formule sur le second. « Your Doom Has Come » gagnait alors en profondeur et variations ce qu’il perdait en unicité. Quid maintenant de ce « Dawn Of The Satanic Age » ?
Et bien on est tout de même désarçonné lorsqu’après calcul, ce nouveau-né nous présente un total de six morceaux pour 37 minutes… Voilà pour l’évolution d’un format qui ne devrait plus se raccourcir par la suite (la réponse dans un an).
En ce qui concerne la sève : la base simple (voir simpliste), lancinante, lourde mais pure et suffisamment aérienne qui nous avait conquis à leur début est toujours présente, munis des surcouches et des tempos issus de leur première évolution. Les curseurs sont néanmoins poussés un chouille plus loin. S’y ajoute également un enracinage du son, qui semble léger mais que l’on ressent en réalité profondément tout au long de l’album et qui lui donne la petite différence.
Un phénomène qui ne doit pas être étranger à la production. Elle qui met ici bien plus en valeur la basse et la batterie, pour une dynamique qui faisait jusque-là défaut et un plaisir d’écoute qui s’en ressent, particulièrement sur le morceau qui semble tout droit sorti d’un film d’horreur « The Brocken ». On note aussi un travail plus poussé sur la recherche sonore qui enrichit le spectre sporadiquement et qu’ils sauront certainement développer pour leur quatrième album.
Dès lors, « Dawn Of The Satanic Age » apparait comme une nouvelle avancée pour des artistes qui ont compris que, se définir et se remettre en question sont indissociables d’une saine évolution.
Point vinyle :
Comme toujours, Clouds Taste Satanic caressent les aficionados du format physique. Un gatefold costaud limité à 250 exemplaires qui s’ouvre sur du Gustave Doré, et une coloration à base de rouge, de vert et de jaune pour un résultat remarquable de brouillard infernal.

Souviens-toi le printemps dernier : Ecstatic Vision débarquaient de Philly, conviés par un certain Walter à une certaine petite sauterie mondialement réputée dans une certaine ville des Pays-Bas.
Une invite au Roadburn, ça vaut toutes les Garden Parties du monde. Ça vous permet de donner une bonne poignée de shows plus ou moins confidentiels en guise de tour de chauffe sur notre vieux continent, même avec un seul vinyle sous le bras.
Mais quel vinyle ! Sonic Praise émergeait du seul cerveau de Doug (guitariste/chanteur/claviériste) sur une décennie d’idées, rejoint petit à petit par ceux qui allaient devenir ses acolytes. Un essai en forme de voyage tortueux et psychédélique à la fois envoutant et inquiétant, qui pour l’anecdote a été enregistré en grande partie “à l’envers”, commençant par les voix et finissant par la batterie.
Autant dire qu’entre hâte, interrogations et une certaine confiance dans le potentiel du groupe vu l’ambiance qui semble y régner, tenter de dépeindre ce premier “vrai” effort de groupe du quatuor à cordes, touches et vent s’annonçait… Ecstatique, évidemment…
Si le Pure Rock Fury de Clutch portait bien son nom et insufflât en son temps une vague de fraîcheur, ce patronyme de Raw Rock Fury n’est pas non plus auto-adjugé à tort. Les premières secondes de l’album suffisent à s’en convaincre, à se demander déjà si la touche dédiée à la basse sur la console de mixage n’était pas bloquée sur 11… Aux antipodes d’un …And Justice For All, ici c’est la basse qui fait la pluie et le beau temps. Prédominante, elle porte le groove hypnotique et tribal du groupe à bout de manche, intelligemment dénuée de la panoplie d’effets dont ses comparses usent et abusent. Pour autant le mixage n’est pas figé pour un sou et chaque instrument prend à son tour le dessus, mettant tantôt en valeur un solo de saxophone hanté ou jazzy, un lick de guitare halluciné ou des déclamations vocales possédées. Cette voix rauque, saturée et gorgée de réverbe nous invite à s’interroger sur la vie et/ou en profiter, tandis que la batterie se place derrière, nous rappelant ce que kraut et space rock avaient en leurs temps découvert : répétition = immersion.
Un disque quasiment indivisible, comme sur Sonic Praise où tout ou presque s’enchaîne, ne laissant comme répit à l’auditeur que larsens ou nappes ambiantes de clavier, discrètes ou proéminentes au besoin.
Et pourtant on en redemande, à peine le temps d’y penser que vingt minutes se sont déjà écoulées, et tout juste le “tube” “Keep it Loose”, sorte de single de part sa durée et sa construction, nous décroche (à peine) du voyage. A moins que tout ça n’ait de sens que pour introduire la trilogie “Twinkling Eye”, qui en sa qualité de face B a le potentiel de vous faire fermer les yeux et vous laisser aller à pensées ou autres phases subconscientes.
Faites le test : pour peu qu’il ou elle prenne un peu le temps de se plonger un minimum dedans, un(e) pote à vous d’obédience musicale complètement différente devrait à un moment se laisser emporter et glisser un “P****n mais c’est bon ça !”.
Et bim, ça finit comme ça a commencé, en pure furie…
Ecstatic Vision a choisi de battre le fer tant qu’il était chaud et on peut le comprendre, les mecs ayant bourlingué un bon bout de temps sans avoir les opportunités qu’ils ont aujourd’hui. Ce premier effort collectif sent (bon) l’urgence, là où on pouvait attendre un peu plus d’explorations et d’errements. Gageons que ça viendra sur le troisième LP, qu’on espère double.
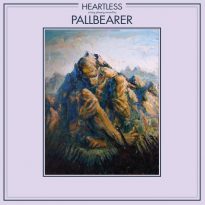
Pallbearer est un de ces groupes qui fait causer. Pour certains, le quartet de l’Arkansas véhicule des émotions transcendantales et fait couler les larmes sur les joues. Pour d’autres, la somnolence et l’ennui sont les deux seuls effets notables. Réceptif ou hermétique, il n’y a pas vraiment d’entre deux. Après deux albums sortis respectivement en 2012 et 2014 chez Profound Lore Records et largement acclamés par tous, le groupe s’est construit une réputation assez solide pour qu’il soit considéré comme un futur très-grand du doom-game. Leur nouvel album, Heartless, sort via Profound Lore mais aussi le géant Nuclear Blast, puisque de grandes ambitions nécessitent certains changements. Avant même d’écouter une seconde de l’album, on sait que Heartless a déjà quelque chose de très réussi : sa communication. L’album nous est teasé depuis des lustres, et on nous le présente comme le prochain messie auditif qui va changer la face du monde. La prophétie disait-elle vraie ? Pas sûr.
Pallbearer a le mérite d’avoir construit son propre style et de ne rien faire comme les autres. On retrouve certes plusieurs caractéristiques du doom, notamment au niveau du son lourd et assommant, mais il est impossible de cantonner Pallbearer à cette case trop réductrice. Le doom est généralement plombant et nous fait plier sous le poids des horreurs du monde. Pallbearer, lui, nous fait plutôt relever la tête pour nous faire regarder vers les étoiles. Si on omet le titre le plus sombre de l’album, le long morceau « A Plea For Understanding », il s’agit ici plus de nostalgie que de dépression, celle qui nous dessine un léger sourire sur le visage à l’évocation de souvenirs heureux. Par quel mystère Pallbearer arrive t-il à apaiser nos esprits ? Grâce aux mélodies spatiales et gigantesques, à la voix claire et rayonnante de Brett Campbell, et aux thèmes abordés, introspectifs et métaphysiques. Cette tendance au doom positiviste et intellectuel est la direction dans laquelle s’engouffre pleinement Heartless.
Les deux premiers titres, « I Saw The End » et « Thorns » ne nous dépaysent pas puisqu’on retrouve le Pallbearer que l’on connait, avec des riffs grandioses et la voix très reconnaissable de Brett qui a encore gagné en envergure. Si un effort de production avait été fait entre le premier et le deuxième album, on a de nouveau franchi un cran sur Heartless avec un son encore plus impeccable et lisse. On est ensuite plus surpris à l’écoute de « Dancing In Madness » et sa longue intro que n’aurait pas renié David Gilmour. « Cruel Road » et « Heartless » mettent quant à eux un pied timide dans le sludge en osant accélérer le tempo et taper de la double croche en palm mute.
Heartless est un album complexe où rien ne se répète plus de 15 secondes, chaque morceau semble être une macédoine de riffs et d’idées et tout s’enchaine parfois aux dépens d’une quelconque cohérence. Rentrer dans l’album demande un effort de concentration qui n’est pas toujours récompensé. D’une manière générale, l’album joue à fond la carte du grandiloquent, certains iront même jusqu’à dire du pompeux. Le groupe a eu la main lourde sur les effets en tout genre, Brett Campbell est plus théâtral que jamais, et cette fameuse mélancolie s’efface parfois au profit du grotesque.
Sans décevoir totalement, puisqu’on y retrouve ce qui a fait les grands jours du groupe, Heartless donne l’impression d’écouter un groupe à qui l’on a trop répété qu’il était bon et qui a fini par trop se regarder le nombril. A vouloir absolument composer un album hors du commun, Pallbearer a pondu des morceaux inutilement complexes et alambiqués, et a oublié de laisser parler son intuition et son cœur. Un album qui porte bien son nom.

Quand on y pense, cet album de The Obsessed doit beaucoup à la drogue. Enfin disons plus qu’à l’accoutumée. Et pas mal à la police norvégienne aussi d’ailleurs. Novembre 2014, Scott « Wino » Weinrich, figure iconique du metal lent et alors en tournée avec Saint Vitus se fait coincer à la frontière avec 11 grammes (11 putain de grammes !!!) dans les poches. Résultat ? Retour immédiat aux USA assorti d’une interdiction de quitter le territoire et Saint Vitus de faire appel à Ben Ward d’Orange Goblin pour boucler sa tournée. Trois ans plus tard la sanction court toujours et Vitus a depuis décidé de reprendre son chanteur original, Scott Reagers. C’est avec ce dernier d’ailleurs que la légende doom prévoit de re-traverser l’atlantique pour nous rendre visite cet automne, au Fall Of Summer notamment. Et Wino dans tout ça ? Et bien le bougre en a profité pour remettre sur patte The Obsessed, tout simplement. Des multiples projets du bonhomme, The Obsessed est probablement le plus mésestimé en Europe. La faute à un hiatus datant de 1994 et l’enregistrement de Church Within, au peu de concert donnés (malgré un live exceptionnel au Roadburn, puis au Maryland Deathfest en 2012) mais surtout et principalement à ce son heavy rock, typiquement US qui ne semble pas faire recette par ici. Les choses vont devoir changer à compter d’aujourd’hui car The Obsessed vient de verser dans le sacré.
Sacré car respectant le passé, l’album s’ouvrant sur une version réenregistrée de « Sodden Jackal » titre du premier Ep de 1983.
Sacré car remplit raz la galette de riffs, comme seul Wino et Iommi semblent capables d’en pondre.
Sacré car après plus de 20 ans d’attente, publier un tel album relève du messianique.
De bout en bout, Sacred est un album passionnant, prouvant sans forcer qu’il est encore possible de publier un album de heavy rock à la fois pertinent et traditionnel en 2017. Sans rien trahir de ses habitudes sonores, Weinrich et ses comparses délivrent une séries de pépites, serties d’une production sublime, comme sur les touches extrêmement discrètes d’orgue sur « Persevereance of Futility », apportant juste le nécessaire à un son respectueux de ce que doit être un album portant le sceau Wino. Tout ici est sublime, du single imparable « Sacred » à l’instrumental « Cold Blood », seul (petite) faute de goût : le refrain catchy de « Stranger Things » immédiatement rattrapé par « Razor Wire », l’un des nombreux points culminants de l’album. Tout du long de l’album, Wino se confie, chasse ses démons, expie ses fautes et bien sûr balance riffs et soli avec sa classe habituelle. Le résultat peut sans sourciller concourir au titre d’album de l’année. Quelle classe les amis, quelle classe.
Point Vinyle :
Relapse Records a vu les choses en grand, proposant une version collector (250 exemplaires, déjà sold out) en blanc splatter rouge avec pin’s et posters puis une version rouge splatter gold (750 ex) ainsi que des versions en bleu royal et rouge sang (600 ex), or (300 ex) et une version rouge classique. A chacun son option.

Un an après leur véritable retour aux affaires avec un « 5 » qui a laissé un morceau de moi dans le cosmos, Farflung s’autorise la sortie d’un EP. Enregistré plus ou moins dans les mêmes conditions, dont une partie toujours au Saturn Moon Studio, on reprend faussement là où nous nous étions arrêtés. Avant même de s’intéresser au contenu musical, c’est ce que semble déjà introduire la pochette, pendant sans brume de la précédente.
Et c’est maladroitement que démarre la première face. En forme de morceau somme, « You Will Kill For Me » est à la fois direct, entêtant et nauséeux dans sa fin, mais il est surtout une face B correcte qui aurait pu servir de bonus au précédent album. Un fait renforcé par les presque 30 secondes de silence qui nous conduisent à la suite, ou au début donc.
Seul autre morceau à la rythmique énergique, « Unwound Celluloid Frown » s’en tire beaucoup mieux en clôturant la face A. Ici se trouve une petite partie de l’identité de cet EP. Voilà un morceau qui ne vous ramène pas en arrière, quand bien même les bases et signatures sont les mêmes que sur des productions antérieures.
L’identité de l’EP sera complète une fois les trois autres morceaux ingérés. Plus biscornus et peu descriptibles, ils sont finalement la vraie raison d’être de cette production, quoi que l’introduction ait essayé de nous faire croire. En poussant à peine, c’est surtout la face B et donc la fin de l’EP qui nous retient. Le voyage « Axis Mundi » adjoint à la mélancolie transcendante de « Silver Ghost With Crystal Spoons » sont simplement les quinze meilleures minutes disponibles.
En essayant de passer pour un « 5 bis » tant dans son visuel que dans ses premières minutes, alors qu’on en perd pourtant complètement la puissance frontale, cet EP est finalement ce qu’il doit être, soit un moyen d’avancer.

Deux ans après le très bon Crooked Doors, Royal Thunder nous revient avec son quatrième album studio Wick. Sans trop faire durer le suspense, on peut déjà dire que ce nouvel opus est une sacrée réussite pour de nombreuses raisons. Regardons tout cela de plus près.
La première raison s’explique à travers la qualité sonore et une production qui reposent sur une homogénéité parfaite des instruments et de la voix. Et d’ailleurs quelle voix que celle de Miny Parsonz : véritable muse vocale qui oscille entre voix éraillée et mélodieuse. On pourrait même croire qu’elle est le fruit de Joan Jett et de Janis Joplin tellement ça vous prend au corps. Si vous ne me croyez pas, écoutez donc « Plans ». Puis même si les grosses distorsions de guitares se sont un peu calmées par rapport aux précédents albums, ne vous en déplaise, la collection de riffs est sincèrement accrocheuse. Rien qu’en découvrant « The Sinking Chair » ou « The Well », on pense tout de suite à du très bon Foo Fighters, mais à la sauce d’Atlanta. Et si vous voulez vous faire une idée de la base rythmique, il suffit de se laisser bercer par le titre éponyme « Wick » : véritable bijou de Rock progressif qui révèle toute la maturité accomplie du groupe.
La deuxième raison repose surtout aussi sur la grande diversité et richesse de chacun des titres. Le premier single et clip-vidéo « April Showers » nous offre un parfait mélange entre Stoner/Rock affirmé tout en proposant des schémas rythmiques blues jusqu’à nous emmener sur un refrain des plus Pops. Quant à « Anchor », on a l’impression de faire un saut du côté de Seattle avec ces riffs très à la Nirvana et à la Pearl Jam. Et entre deux gros morceaux puissants, vous avez des petites pépites expressives, sensuelles à la limite de la balade comme c’est le cas avec « Push ». Ce titre est d’ailleurs à triple facette puisqu’en dépassant les trois minutes, on s’embarque pour une grosse phase lourde, groovy pour enfin laisser place à une fin solennelle. D’ailleurs, le dernier titre qu’est « We never Feel Asleep » confirme bien la maîtrise du son et de la qualité de composition en envoyant le mammouth de riffs, d’ambiances, de puissances tout en terminant sur une douceur musicale, innocente et voyageuse telle un gospel.
Vous l’aurez donc compris, ce quatrième album qu’est Wick est à se procurer au plus vite. Parce qu’il montre bien que Royal Thunder est devenu un groupe unique, original, puissant et poignant à une époque où on a besoin d’un peu réconfort. Rien que pour ça, on peut leur dire merci.

In her Garden est le 13ème opus de Colour Haze et peu de groupes peuvent se targuer d’une telle discographie indissociable, bien sûr, d’une longévité à toute épreuve. Des hauts, des bas, de la qualité lumineuse mais aussi du paluchage en règle, le groupe a forcément goûté et offert toutes sortes d’impressions à son auditoire énamouré.
Cependant, on ne demande plus aux allemands de la nouveauté ou une ré-écriture du saint riff et de ses onze commandements fuzzés. A vrai dire, on attend plus d’eux de réelles histoires, inscrites dans un canevas bien troussé et aux entournures définies. Le savoir-faire narratif de la troupe est bien connu, fonctionne t-il seulement sur ce nouvel album ?
Pas gagné à l’écoute du premier vrai titre « Black Lily », blues lourdingue à la voix forcée, sans réelle avancée et aux guitares peu inspirées. On s’y ennuie ferme, on regarde la durée de l’album et on lève les yeux au ciel. C’est dur, je sais, mais vraiment, même après plusieures écoutes, cette entrée en matière n’est pas la bonne. Elle fausse la perception que l’on pourrait avoir de la musique à venir et il faut vraiment passer outre pour profiter du son qui vient ensuite.
Car oui, le trio démontre par la suite qu’il est toujours ce conteur délicat, au phrasé inspiré et à l’idée multiple. Sous l’arc naturaliste, développé par les titres, “Magnolia”, “Arboles”, “Lotus”,… appuyé par l’artwork de la pochette (qu’ils ne pouvaient de toute façon pas faire plus simple et hideux que le dernier en date), Colour Haze tricote un entrelacs de notes en une mixture dont eux seuls ont le secret. A l’instar d’une planche botanique, le diable se cache dans les détails et In Her Garden n’en manque pas. L’histoire se déroule donc sous nos oreilles attentives, contant anecdotes cuivrées, péripéties transitoires, rebondissements rythmiques et autres césures toutes de groove vêtues. Perdez-vous donc dans « Labyrinthe » et vous comprendrez pourquoi Colour Haze mettra toujours un paquet de puceaux à l’amende. Les Allemands ont su recentrer le débat et se perdent moins en route que par leur récent passé. Et ce, pour notre plus grand plaisir.
In Her Garden est donc un bon cru du domaine Colour Haze. Après une mise en bouche un peu rude, le vin s’aère pour laisser place aux notes fruitées, à une chaleur sucrée qui parcourt le corps avec frissons et envie. Il accompagnera idéalement votre été, calé entre pétanque, sandale et barbecue. A placer idéalement entre un Causa Sui et un Sungrazer pour plus de sensations.

Un album qui prend directement pied de par son nom et sa pochette dans un monde marin fantaisiste et héroïque, pour des Suédois cela fait sens. Et c’est un indice pour l’auditeur quant aux influences du groupe qui pioche autant dans le Desert Rock que dans le Heavy Metal et le Doom. En ressort dès les premières secondes un savant mélange de matraquages de cymbales et de riffs tempétueux, et une profusion de mélodies plus ou moins classiques. C’est aussi et surtout la voix qui détache le groupe de la masse. S’approchant principalement d’un Hetfield, elle se fait aussi celle d’un Liebling sur la conclusion. Enfin, il se dégage bien quelque chose sur les 5 morceaux proposés qui ne devraient, sans surprendre les aguerris, pas les repousser au large.
|
|




 Depuis quelques années, la grande famille du Stoner au sens large s’est très largement développée. Des groupes nouveaux ne cessent d’arriver, les sorties se comptent chaque année par dizaines et il n’est pas exagéré de dire que notre scène musicale préférée se plutôt porte bien.
Depuis quelques années, la grande famille du Stoner au sens large s’est très largement développée. Des groupes nouveaux ne cessent d’arriver, les sorties se comptent chaque année par dizaines et il n’est pas exagéré de dire que notre scène musicale préférée se plutôt porte bien.