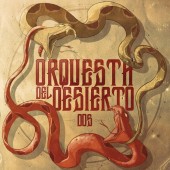Depuis la fermeture du label il y a bon nombre d’années, la plupart des albums sortis chez Man’s Ruin sont devenus cultes. Bon, soyons honnêtes, la plupart sont devenus cultes auprès de ceux ne les ont jamais écoutés car il faut voir les choses comme elles sont, si le label a sorti un bon paquet de disques effectivement (et objectivement!) cultes, ils ont aussi sorti pas mal de bousasses plus ou moins infâmes dont le seul intérêt tient dans leur artwork (et encore). Alors à quelle catégorie appartient ce premier album de Tummler?
Certainement pas à la deuxième! Car on est bien loin de l’album complètement naze qui prendra la poussière sur une étagère de collectionneur compulsif.
Mais pas non plus à la première, soyons réaliste.
Tummler nous offre là une très bon album, bien charpenté, aux compos soignées et solides, au son bien gras sans sentir l’amateurisme. Un album très agréable à écouter et qui pourra même trouver quelques amateurs de stoner pour le défendre bec et ongle. Cela manque certes de ce petit solo qui fait la différence, de ce petit riff qui vous prend aux tripes illico, à se demander d’où ça sort, mais l’ensemble n’a pas à rougir pour autant. Aussi à l’aise dans des formats allant des 5 minutes au quart d’heure bien passé, le groupe nous offre un album qu’on prend plaisir à écouter de temps en temps, un album qu’on ressort avec plaisir et qui, mine de rien, passe l’épreuve du temps.
Un très bon album à découvrir pour ceux qui seraient passé à côté il y a bien longtemps…
|
||||||||||||||||
|
Tout droit arrivé de Washington DC aux Etats-Unis, Borracho nous propose son deuxième album : Atacama. Ne vous y trompez pas, le groupe n’en est pas à un simple deuxième essai studio : huit splits et singles en tous genres ont construit le trio avant de nous offrir le successeur de Oculus. Le temps de porter plusieurs écoutes, un premier constat se fait : la durée des morceaux surprend. En effet, vous allez être face à des titres faisant moins de quatre minutes pour ensuite laisser place à de véritables récitals de dix minutes. L’album ne se dessine pas autour d’un schéma identique et répétitif. Au contraire, vous allez pouvoir vous plonger dans une multitude de délires musicaux oscillant entre le morceau simple et efficace avec « Gold From Sand », le long trajet à plusieurs étapes avec « Overload » et le voyage psychédélique instrumental comme le laissent entendre notamment « Descent » et « Flower ». Ainsi, on est face à un trio qui puise dans de nombreuses influences : Motörhead, Clutch, Fu Manchu avec des petits airs à la Monster Magnet et à la Melvins. Autant dire que Borracho sait s’inspirer des meilleurs pour construire un opus efficace et riche. Il suffit de porter l’oreille à « Lost in Time » pour comprendre qu’il est ici question de faire du Rock à l’état pur sans artifices ni volonté de réinventer la musique. Mais cela n’empêche pas le groupe d’emmener son auditeur sur des sentiers plus solennels et progressifs comme avec « Drifted Away From The Sun ». Puis question son, il n’y a aucune mauvaise surprise. La rythmique basse-batterie est simple mais puissante, les ambiances de la guitare sont riches et variées avec un soupçon de fuzz qui se laisse embrasser par une distorsion plus métal. Puis la prestation vocale de Steve au chant est juste un délice avec sa voix bien grasse qui hume le whisky et la cigarette. Il n’empêche qu’à la découverte du dernier titre acoustique « Last Song », fort en émotion, on retrouve un tout autre groupe qui nous offre un moment intime et posé. Si vous cherchez à ne pas vous prendre la tête et juste à déguster un bon album au volant de votre voiture ou pour mettre de l’ambiance à la maison, prenez donc le temps de vous passer Atacama.
Point vinyle : Vous pouvez retrouver cet opus dans différents formats vinyles :
Hé ben mes cadets, hé ben mes p’tits frères, s’il y a bien un truc sur lequel le quatuor allemand nous a bien banané c’est bien au sujet de la sortie d’un album live. Ces vils gredins nous ont ressassé la même rengaine des années durant alors que nous leurs demandions – pas innocemment je le concède – s’ils prévoyaient un jour de nous graver dans le sillon une de leurs prestations live tant celles-ci nous transportent. Argumentant au sujet des usuels pains commis sur scène (lesquels ne nous ont jamais ni sauté aux yeux, ni gâché le moidnre de leurs concerts), les porte-voix du groupe firent leurs numéros de perfectionnistes éternellement insatisfaits alors que nous jappions d’impatience à l’idée d’avoir un jour un vrai album en public du groupe. Il faut avouer que les instrumentaux de MSK confrontés à l’exercice live prennent un zeste de testicules, un poil de rugosité et un soupçon de désinhibition au passage qui leur sied plutôt bien. Après 10 ans de bons services et d’engagement en faveur de la noble cause, les Teutons ont cédé à l’appel des sirènes et c’est tant mieux ! Je leur pardonne leurs mensonges répétés au vu de la qualité de cette pièce de grande classe : ce « Mela Ananda – Live » est d’une efficacité redoutable au rayon hypnotique du style que nous chérissons sur ce site. Un site que nous avions déployé avant même que le groupe ne se mette en activité ce qui ne nous rajeunit pas vraiment au passage. Au menu de cet album live nous n’avons pas de nouveauté et le second album du groupe, « Satya », est carrément passé sous silence ; tant pis pour lui ! Le setlist est constitué de compositions tirées des quatre autres albums de la formation qui monte avec une bonne pondération de « Moksha » leur dernier album en date (ce qui ne constitue pas vraiment une surprise en soit). C’est « Vayu » (un peu écourtée), « Akasha » et « Prithvi » – en ouverture – qui représentent la pièce la plus récente et qui sont balancées sans réelle surprise avec juste ce soupçon de matière plus brute qui fait le charme des albums live (pas les pirates captés depuis le public sur lesquels on entend brailler le mec qui tient le micro dans un yaourt des plus hideux). Si l’on remonte le temps, on a ensuite droit aux deux chefs-d’œuvre de « Soma » : « Psilocybe » et « Ephedra » sur lesquels on perçoit (voire entend à plusieurs reprises) le public entrer dans la transe que ces gourous du psychédélisme fomentent sur scène. Il s’agit clairement d’énormes instants de ce live. Un petit bon en arrière dans le temps et nous retrouvons « Tri », troisième effort du groupe, dont sont extraits « Tamas », un morceau assez commun dans la discographie de MSK sur lequel on entend le bassiste remercier son public pour dix ans de fidélité à leur cause, et le transcendantal « Brahama » qui constitue, avec la doublette de « Soma », mes instants préférés de cette sortie. On termine par le commencement de l’histoire avec le disque éponyme et « Enigma42 » (qui a changé son nom originel : « 23 Enigma » et sur lequel on entend des salutations à l’adresse du public parisien chauffé à bloc) un grand classique live de la formation envoyé en deuxième position pour faire décoller la foule qui est solidarisé à « Glow11 » pour un parfait – et cohérent – enchaînement. Le dixième, et dernier, titre de cet album forcément trop court c’est le rapide « Hymn72 » nous ramène sur terre au terme de cette écoute par son style moins aérien et plus bourru (avec quelques niveaux gagnés sur le couillomètre par rapport à l’original). Ponctué par des remerciements pour la capitale française, cet extrait du premier effort referme cette première incursion des Allemands dans un monde qui leur réussit plutôt bien : celui de l’album live. La puissance hypnotique du quatuor durant ses prestations est fidèlement retranscrite sur cette production extrêmement soignée qui est un excellent moyen de se retrouver piégé en plein délirium par MSK avec son casque sur les oreilles. Il est à noter que ce « Mela Ananda – Live” propose des images en plus du son. Malheureusement, je n’ai pas eu droit à celles-ci et ne peut pas vous en dire grand-chose en dehors du fait qu’il y a un documentaire vidéo sur les 10 ans de la formation : « Let´s Give It A Try » qui ne devrait pas décevoir plus 6 titres captés à l’Underground de Cologne en 2010 : « Brahama », « 23 Enigma » (qui n’était pas encore passé à 42) enchaîné à « Glow11 » (ça me rappelle quelque chose), « Ahimsa », « Tamas » et un final sur « Hymn72 » (tiens donc !). Je me réjouis de me mater tout ça lors de la sortie de cette chose que je conseille à tout mélomane qui se respecte la moindre. Point Vinyle : « Mela Ananda – Live » sort chez Napalm ; nous avons donc droit à plusieurs déclinaisons de ce produit plutôt grand public : un double noir pour se réveiller avec le dvd, un double golden sans la douche, mais avec le dvd, et un double bleu avec dvd limité à 300 exemplaires. De quoi contenter tous les inconditionnels de cette formation unique.
Lien : Bandcamp Point Vinyle : 200 exemplaires sur vinyle blanc accompagnés d’un poster. Y’en aura pas pour tout le monde!
Feindre une objectivité rationnelle dans nos écris vis-à-vis d’All Them Witches serait un mensonge total tant le combo américain nous transporte depuis son premier album. A ceci, nous nous devons d’admettre un certain passe-droit puisque le quartet n’évolue pas à proprement parler dans le stoner, dans le desert-rock, ni le psychédélisme, encore moins dans la crasse ou la fange. Mais le groupe est dans un tel mélange des genres qu’il ne saurait nous échapper. Et s’il tutoyait la lumière sur son précédent opus « Dying Surfer meets his Maker », force est de reconnaître que sur ce « Sleeping Through the war » l’heure est à la marche engluée, aux promenades forcées, éreintées par un bayou-prison.
Formé en 2008 à Hastings, le trio Sir Admiral Cloudesley Shovell se fait connaître hors d’Albion (si si la perfide) en retournant le Roadburn 2012 ainsi que le DesertFest Londres l’année suivante. Rompu à la science ancestrale du riffing, inspiré par l’énergie des MC5, portant cuir et moustache comme trop peu en ce capillairement triste millénaire, les Shovells ont le rock’n’roll dans le sang. Franchement, je vous mets au défi de me trouver un groupe de pub plus génial live que celui là. Leurs deux premiers albums, publiés chez Rise Above en 2012 et 2014, sont des must have, indispensables pépites de heavy rock high energy. Avec la précision d’horloger suisse (mais la dégaine d’un motard californien), Admiral Sir Cloudesly Shovell sort son troisième opus en six ans d’activisme rock, reprenant les codes qui ont fait sa reconnaissance : pochette mettant en scène leur chouette fétiche dans des situations d’Amérique profonde des 60’s, titres vulgaires et décomplexion à tous les étages. « U Got Wot I Need » ouvre idéalement la galette : refrain qui colle à l’encéphale, basse ronde et guitare envahissante sur batterie débridée, avec un jeu à la Ian Paice, direct et brutal. Le ton est donné. Ne cherchez pas de Mid-tempi ou des titres à rallonge, tout ici est calibré pour le live. Et comment alors résister au pont de « Paid in Full », à la cavalcade finale de « Wrong » ou au riffing dingue de « Potato Boy », avec ses parties d’harmonica, inclus immédiatement dans les set-lists du groupe. Impossible, on est bien d’accord. Bon. Soyons franc, il s’agit surement là du moins bon des trois albums du vaisseau Admiral, mais ça reste tout de même plus graisseux et moustachu que toute la production discographique de 2016. Tenez le vous pour dit.
Point Vinyle : Un disque que tu peux retrouver, selon le groupe, dans les meilleurs shops, ou à Emmaüs. Pour ce qui est des versions collectors, le Clear vinyl + 7’ (150 exemplaires) est bien sûr sold out, reste 500 disques en violet (marché US), 500 en rouge pour l’Europe et 300 en noir. Il n’y a plus rien de disponible sur le site du label, voyez direct avec vos disquaires, ou à Emmaüs donc. Bonne chasse !
Formation pionnière du genre issue de la constellation de groupes gravitant autour de Joshua Tree dans les années 90, le groupe s’est vu contraint de ralentir (pour ne pas dire arrêter) sa production après deux longs formats, des suites du décès de Fred Drake en 2002. Membre fondateur du groupe aux côtés de Dave Catching (EODM, …) avec qui il détenait le Rancho de la Luna, et de Pete Stahl (Goatsnake, …), Fred Drake était et en est toujours indissociable. Nous voici néanmoins face à un troisième album sorti début 2016. Dans la grande tradition du Rancho de la Luna, dans lequel l’album a bien évidemment été enregistré (en quasi-totalité), le nombre d’artistes présents est très important. Matthias Schneeberger, Molly McGuire, Brant Bjork, Gene Trautman, Josh Homme, Mario Lalli sont entre autres de la partie et participent à la requalification de communauté en lieu et place de groupe pour définir earthlings?. Bien sûr, un hommage à Fred Drake prend forme par le biais de deux de ses enregistrements inexploités. Il est crédité à chaque début de face, avec pour la face Mudda l’écriture et l’interprétation de l’intro « There Is Hope », et pour la face Fudda une partie du chant et l’orgue sur « Punk Ass Fuck » écrit par Pete Stahl. Si l’on cherche maintenant à faire comprendre ce qui se trouve sur les deux faces de l’objet, qui contiennent chacune un nombre faussement roboratif de 6 morceaux, il est plus simple d’évoquer l’esprit et le format des Desert Sessions. Soit un ensemble disparate de vrais morceaux, d’expérimentations et d’entre deux. Finalement un ensemble uni plus par l’esprit que par une quelconque matérialisation physique ou sonore. Par extension on tient peut-être là la vraie définition du Desert Rock, mais je vous laisse seuls juges. A ce propos, vous trouverez un élément de réflexion dans les paroles de « Stoner Rock Rules (Who Wrote the) ». C’est d’ailleurs l’un des gros morceaux de la face Fudda avec l’étrange « Zazoom » et le magnifique mélancolique « Gentle Grace ». Mais la pièce maîtresse se trouve sur la Mudda peu après « Waterhead ». « Individual Sky Cruiser Theory » pourrait en effet presque à lui seul justifier l’acquisition de cet album unique. Pete Stahl y est remarquablement juste émotionnellement et l’instrumental est d’une finesse invraisemblable. Initialement disponible uniquement grâce à l’acquisition de l’un des 600 vinyles pressés, il est désormais possible de le télécharger sur le bandcamp bien vide du groupe. Mais ce qui paraît être une très bonne nouvelle est assombri par un fait incompréhensible. Il semble que les pistes 3 et 6 de la face Mudda du vinyle aient disparues. « Forgotten Memories » et « Accordingly », plus transitions que morceaux, participent pourtant au dégagement de l’ambiance de l’album. Je m’émeus donc. Pour conclure, j’ai le sentiment que chacun y trouvera ce qu’il y cherche et que, d’une certaine manière, il y a un quelque chose d’universel dans cet album qui le rend nécessaire au Desert Rock mais aussi et surtout à la musique.
Point vinyle : D’abord, l’artwork de Dirk Bonsma est sublimé par un traitement qui reflète la lumière quand exposé. Ensuite, la galette est glissée dans une pochette en carton épaisse, avec d’un côté les crédits et de l’autre un second artwork pour le moins déconcertant. Enfin, le vinyle est disponible en trois versions. On part sur une base transparente blanche ou bleu, assortie d’une explosion de couleurs cosmiques, différentes en fonction des dîtes versions. Surtout, il existe deux versions de 250 copies et une version de 100 copies disponible uniquement dans un pack regroupant les deux autres versions mais qui, excusez du peu, possède des couleurs phosphorescentes. Bref des pressages qui paraissent uniques pour le son qui va avec. Le moins que l’on puisse dire c’est que je suis un amateur du travail de Mark Greening. Je l’ai suivi d’Electric Wizard à Ramesses, trouvant, et c’est bien normal, plus de qualité objective au travail du petit rejeton damné, qu’au grand sorcier électrique, d’autant plus depuis Black Masses. Je l’ai suivi aussi dans ses pérégrinations aux frontières de la psychose, avec 11 Paranoias. Alors imaginez bien quelle était mon excitation lorsque j’ai appris son désir de jouer sur le nouveau projet de sa compagne Virginia Monti, Dead Witches. La voix de l’Italienne, par ailleurs entendue dans Psychedelic Witchcraft, avait l’avantage d’être enjôleuse et sensuelle, pouvant, associée à un riffing plus doom, proposer quelque chose se rapprochant de l’insurmontable et envoutante Jex Thoth. Malheur, trois fois malheur, avec Dead Witches, il n’en sera rien. La publication de Ouija, leur premier album chez Heavy Psych Sounds Records, vient doucher froidement ma pourtant palpable excitation. Malgré leurs passion commune pour l’occultisme et le doom enfumé, le couple n’arrive pas à faire décoller l’album, proposant une musique sans grand relief (il n’y a pas dans tout ce foisonnement un seul riff à retenir) et malgré le jeu toujours identifiable de Greening, la magie ne prend pas. Le principal soucis de cette galette tiède, par ailleurs à la production franchement moyenne, reste la voix de Virginia Monti. Est-ce parce que les tempi ont accéléré ou parce que la musique s’est alourdie que la chanteuse a cherché à forcer le trait ainsi ? Loin de produire l’effet d’une accalmie au milieu d’une avalanche de doom, le style vocal adopté par l’Italienne est caricatural et forcé, noyé dans un effet cheap, tirant finalement les morceaux vers le bas. Pas un titre pour sauver l’autre, pas un refrain à retenir, pas même du côté du single « Mind Funeral », dont les artifices tombent à plat dès que la voix s’en mêle. Dommage, franchement dommage. Finalement, Ouija est un exemple frappant que l’intention ne suffit pas pour faire du doom, style certes rudimentaire, mais demandant un engagement et un esprit total pour ne pas sombrer dans les turpitudes du disque sans âme. « Esprit est-tu là ? » semble demander Dead Witches. Mais à y regarder de plus prêt on voit bien qu’il y a des doigts de petits malins pour pousser le verre. Moi je retourne au dernier 11 Paranoias tiens.
Point Vinyle : Chez Heavy Psych Sound, on a fait dans la simplicité : 350 violet, le reste en noir. Et pis c’est tout.
Trio Lorrain, Lord Of The Brett Stone fait depuis 2012 pas mal de bulles dans leur coin, à grand renfort de concert fiévreux, doublé d’une maitrise de leur image franchement notable pour un jeune groupe. Entre clips chiadés, sessions acoustiques et concert couplé à une démonstration de pôle danse, le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe en veut. Coté son, après deux démos, leur premier album, Insolent Thruth, fait partie des autoprods hexagonales les plus notables du moment. On pense à Loading Data bien sûr, compatriotes avec qui ils partagent la science du riff robotisé et de la voix de crooner, et donc aux Queens Of The Stone Age, par extension. Cet album distribue du groove sans discontinuer, tandis que certains titres de morceaux rappelle que c’est avant tout de fun qu’il s’agit (« Wake The Spartan », « Suck Me I’m A Lord », « The Witch is a Bitch » etc.). L’avenir de Lord Of The Brett Stone semble, par ailleurs, passer par « No Matter », single du disque pour lequel le groupe propose un joli clip. Plus original, plus maitrisé, cette sombre couleur leur sied plutôt bien. Surveillez les cafés concerts de votre région les amis, car ce trio là ne va pas s’arrêter en si bon chemin ! Pour le groupil que je suis des légendaires Kyuss, chacune des sorties des différents protagonistes du mythe du siècle passé provoque une excitation plus que certaine. Malgré la foule de détracteurs et de langues-de-putes en tous genres qui ont craché à l’avance sur cette sortie – et qui n’ont pas nécessairement toujours tort soyons honnête pour une fois – le démon s’est emparé de moi à l’annonce de la release date de cette chose et c’est dans le plus simple appareil que je me suis frotté contre le crépis de la cage d’escalier. Remis de mes multiples stigmates sur l’épiderme, le moment vint de se pencher avec un poil de sérieux tout-de-même sur « The Coyote Who Spoke In Tongues » en se débarrassant des prismes Kyuss, Slo Burn, Unida et Hermano voire même de l’apparition du quidam dans un premier exercice version feu de camp avec J.M.J. sur une vague compile que les anciens connaissent très bien. Il faut dire que le premier exercice de John Garcia en solitaire m’avait au final bien botté le popotin et que j’avais été emballé par la plus récente tournée acoustique en binôme de la voix de Kyuss. Cette tournée intimiste marque le point de départ de la plaque dont je vous cause aujourd’hui. Celle-ci se déploie de manière similaire en ce qui concerne le choix des titres même si les protagonistes sont passés de deux à quatre s’éloignant de fait de la simplicité remarquable – et remarquée – de la version scénique de cette chose. On reprend donc ici encore plusieurs standards du mythe Kyuss à la sauce mariachi pour constituer la couche de fond avec un résultat final plutôt hétérogène. « Gardenia » qui se déploie de manière très intimiste avec des vocaux susurrés par Monsieur Garcia est plutôt bien réussi en étant réduit de moitié en ce qui concerne sa durée et en allant se terminer dans des marécages plutôt bluegrass. Ce dernier titre réarrangé n’ayant, au final, plus grand chose de commun avec la version figurant sur « Welcome To Sky Valley ». « Space Cadet », tiré de la même plaque me convainc nettement moins en ce qui concerne sa relecture par ailleurs dans la même veine que celle de la tournée acoustique ; l’ennui me gagnant tant le titre tire en longueur. Pour rester dans les terres de légendes, « Green Machine » de l’incroyable « Blues For The Red Sun » figure aussi au sommaire de cette production. Fort lancinant et empreint de sonorités slide, la perle de Kyuss – envoyée vite fait – subit un arrangement orchestral pour son refrain que les producteurs auraient dû refreiner un poil car le style musique de film fait perdre de la substance à ce titre pourtant déployé de manière fort intéressante. La dernière ogive c’est « El Rodeo » le titre génial de « …And the Circus Leaves Town » qui, même en subissant 10’000 outrages en ce qui concerne sa déclinaison, demeurerait une source de satisfaction pour ma pomme (qui n’est pas si objective que ça quand on se situe dans la galaxie des pères fondateurs du mouvement je le concède). Tant mieux pour moi, la recette appliquée à ce chef d’œuvre de la musique lui sied plutôt bien : la tessiture du vocaliste prend tout le champ pour s’exprimer comme sur l’original, le rythme originel est respecté et mes poils se dressent tel un zizi dopé au miracle de la pilule bleue ! Ces quatre réinterprétations côtoient des compositions plus personnelles du Californien grand amateur du Rat Pack. L’auditeur a droit à des digressions autour de thèmes déjà effleurés voire à des vraies nouveautés neuves. Celles-ci, soyons honnête (car parfois il faut bien l’être), ne sont pas homogènes en ce qui concerne leur inspiration. On tombe parfois bien et parfois plus maladroitement dans le sillon. Si « Kylie » – qui sert de support à la première vidéo de grand classe issue de cette plaque – est une belle réussite qui ravive en moi la flamme allumée jadis par des formations comme Orquesta del Desierto avec son attaque trépidante à la guitare en bois il n’en va clairement pas de même pour certaines plages qui me font plus penser à des grains de sables dans la mécanique bien huilée qu’au désert californien où tout est né. Des noms à jeter en pâture à la foule qui tirera à boulets rouges sur cette ogive : « Give Me 250 ML » ou trois minutes inutiles sur un disque pourtant utile. Ce morceau chanté se casse un peu la gueule et l’instrumental « Court Order », pourtant pas mauvais, ne saura pas rabibocher le fan de Kyuss qui sommeille pourtant en vous, car assez éloigné de ce que nous pourrions attendre d’une production portant la signature d’une légende de la scène. Nous sommes à des années lumières du son du désert et les musiciens tapent là dans un registre qui frôle l’exercice de style pour une audition ; s’ils se sont fait plaisir, ils peineront à convaincre l’auditeur auquel cette galette semble tout de même finalement être adressée. Alors on fait quoi mon p’tit père me direz-vous ; on achète ou pas ? Je pense en toute objectivité que les newbies qui fréquentent notre monde depuis une toute petite poignée d’années fonceront quel que soit mon avis sur la chose (la jeunesse incontrôlable a du bon). Je suis persuadé que les intoxiqués depuis les débuts fonceront sur la chose uniquement à cause de la connexion directe de cette production avec Kyuss quitte à ne jamais l’écouter plus d’une fois ; ce disque allant sans doute rejoindre les reliques Man’s Ruin de leurs collections. Le ventre mou, et ses ventres bombés par le malte ainsi que le houblon, ferait bien de se poser très sérieusement la question de l’intérêt de la présence d’une pareille plaque dans leur collection sous un autre angle que celui généralisé par une certaine police du bon goût qui se plaît à jeter régulièrement l’opprobre sur les approches novatrices avec leur sempiternelle rengaine du « c’était mieux avant ». Le monde change… et des pièces du calibre de « The Hollingsworth Session » ça ne se trouve pas par hasard sous les sabots d’un cheval de labour. Ce titre transpose admirablement bien sur disque l’ambiance qui régnait durant la tournée acoustique de John Garcia et c’est pour des raisons de ce type qu’il faut procéder à l’acquisition de « The Coyote Who Spoke In Tongues » et clairement pas pour retrouver la dynamique live de Unida. Un achat conseillé pour les amateurs d’onanisme qui seront transportés dans leur salon comme ils le furent durant les sets live du duo. Point vinyle : La structure germanophone est très forte pour décliner ses productions en diverses couleurs et cette sortie bénéficie donc de plusieurs tirages en plastique. D’abords avec une version standard, puis avec un splatter bleu et blanc limité à 500 exemplaires qui a une gueule plutôt aguichage puis finalement en violet solide pressé 200 fois. Un bon choix pour les nombreux aficionados de la galaxie Kyuss qui pourront ainsi griller quelques billets pour rallonger de quelques centimètres leurs collections.
On avait beau attendre avec impatience le successeur de l’excellent dernier LP de Lo Pan, « Colossus », le quartette de l’Ohio nous désarçonne quand même en nous proposant… un simple EP ! 5 chansons, 22 minutes au compteur, l’objet est certes frustrant dans sa forme, il n’empêche que dans certains cas l’on peut se satisfaire de peu ; reste à voir si ce sera le cas ici. Pourquoi un EP, tout d’abord ? Pas de stratégie très élaborée de la part de Lo Pan, pas d’argument marketing ou de gestion de carrière : ils étaient quasiment obligés de sortir ce disque, sous cette forme. Ne serait-ce que par intégrité. Retour arrière : fin 2014, leur guitariste Brian Fristoe quittait le navire. Pas un détail pour un groupe évoluant dans un genre musical aussi acéré niveau 6-cordes, un mix de grunge / stoner / sludge, le tout dopé en énergie brute. Dans cette configuration à un seul guitariste, la musique de Lo Pan est intrinsèquement, structurellement imbriquée à la performance de son gratteux. Enter Adrian Zambrano, un remplaçant qui apparaît tout à fait judicieux (constat opéré suite aux prestations live du groupe avec ce dernier, qui ont pu confirmer l’intensité déployée par le combo sur scène). Lo Pan prend alors le chemin des studios et couche sur bandes les premiers titres issus de cette nouvelle formation… avant que Zambrano ne quitte lui aussi la formation ! Un remplaçant lui a été trouvé depuis (Chris Thompson), mais la question du devenir de ces bandes ne s’est pas posée longtemps : pour repartir d’une page blanche avec Thompson, il convenait de clôturer complètement cette séquence Zambrano, en publiant le matériel composé et enregistré avec son prédécesseur. D’où ce format court, qui constitue donc en l’état le premier et dernier témoignage vinylique de cette incarnation du groupe. Un témoignage, mais pas seulement. Les techniciens de la guitare et les puristes sauront probablement disséquer les écarts stylistiques entre Zambrano et son prédécesseur. Mais concentrons-nous plutôt sur la qualité globale de la galette proposée ici : le format 6-titres s’avère finalement plutôt adapté à la musique du groupe. Après plusieurs écoutes, l’aspect « dense » du matraquage en règle que constituent habituellement les disques de Lo Pan est ici rendu plus digeste. Difficile en revanche de décréter sur un modeste « échantillon » que la qualité globale du travail de composition est la meilleure à ce jour pour le groupe. Les écoutes successives apportent en tout cas la confirmation que le groupe ne faiblit pas et reste à un très haut niveau. Ça riffe toujours velu, le chant est toujours aussi efficace (remarquable Jeff Martin, à la fois clair et puissant), et les rythmiques bastonnent ; ça reste viril. On distinguera quand même un “Go West” très emblématique du style des gaillards, et un “Pathfinder” plus aventureux, riche et efficace à la fois. Savoir s’ils s’y maintiendront après encore un changement aussi significatif de son line up est une question légitime ; seul son prochain véritable album nous le dira. Mais en l’état, on est plutôt confiants à l’écoute de ce In Tensions solide et efficace.
Point vinyle : Bien conscient de l’attrait relatif que constitue un simple EP en lieu et place d’un album entier, le petit label US Aqualamb en propose une édition limitée à 500 exemplaires du vinyl “powdered blue” 10″, accompagnée d’un livret de pas moins de 100 pages ! (on n’a pas eu le livret entre les mains mais il a l’air superbe)
Tout est surprenant à l’écoute d’un album de Glitter Wizard, et en même temps… rien ne devrait nous surprendre ! En effet, tout est clairement établi dès les postulats de base : le nom du groupe, en premier lieu, un jeu de mot un peu lourdingue qui associe le fantasque et le rutilant du Glitter aux penchants psychoïdes des groupes aux ramifications « wizard-iennes ». Quand on connaît le groupe, on sait aussi qu’il est un peu à la botte quasi exclusive de son frontman, Wendy Stonehenge (dont le subtil sobriquet évoque lui aussi la double filiation « fantasque » et space – notons au passage que les autres musiciens sont eux aussi affublés de faux noms dans la même veine). Enfin, le groupe lui-même qualifie sa musique de « progressive punk », en gros une étiquette aussi proche de sa musique que… n’importe quelle autre étiquette, en fait. Un gros WTF émane donc de ce combo atypique, difficile à cerner et à cataloguer a priori. On est en revanche dubitatif sur la démarche éditoriale de l’excellent label transalpin Heavy Psych, qui offre certes une jolie maison à de plus en plus de combos méritants, mais risque de perdre petit à petit sa cohérence stylistique et sa spécificité « Psych », justement. Mais passons. Les premières écoutes du troisième album des californiens ne désarçonneront donc que les auditeurs pris par surprise. Difficile de caractériser un genre musical précis de l’expérience, même si au final se dégage quand même une farouche tendance vintage 70’s, auréolée de penchants hard rock 80’s (les plans en droite lignée Deep Purple se comptent à la pelle, réminiscences Jon Lord en bonus, l’orgue étant TRÈS présent tout au long de la galette), le tout baignant dans un space rock « d’époque » (comprendre plutôt Hawkwind que Nebula, par exemple). Une sorte de Blue Oyster Cult sous amphétamines, en gros. Et encore… L’ensemble est exécuté avec une fougue qui, contrairement à l’humour développé par le combo, ne doit rien à un quelconque second degré : authenticité et premier degré sont de mise, les gars sont à fond dans leur trip. C’est avec un réel plaisir que l’on enchaîne les écoutes de l’album, qui contente les amateurs de tous les genres susmentionnés, et bien d‘autres au final. Un disque bien barré en tout cas, qui maintient l’attention de l’auditeur tout du long (pas vraiment un disque « d’ambiance » que l’on écoute distraitement en fond sonore). On notera quand même quelques titres plus faibles que d’autres, rendant aussi le disque quelque peu inégal sur la longueur. Je suis en revanche convaincu que derrière cet album « prétexte », c’est toute l’énergie du combo qui ne demande qu’à exploser en live. A voir donc sur scène aussi (surtout ?).
[Chronique de l’album pour sa sortie d’origine publiée en 2004 : https://desert-rock.com/dr/chrocd/orquesta-del-desierto-dos.html]
Le jeune et volontariste label italien Spin On Black semble vouloir dédier son existence à redonner leurs lettres de noblesse à des productions d’origines variées. Fonctionnant au coup de cœur, ils ont jeté leur dévolu sur le second et dernier album du projet protéiforme « Orquesta Del Desierto » ; leur première sortie « non italienne », du coup. Pourquoi pas le premier ? Mystère… Quoi qu’il en soit, on ne détaillera pas l’album en tant que tel, qui regroupait pour la seconde fois Mario Lalli (Fatso Jetson, Yawning man…), Pete Stahl (Goatsnake, Wool, earthlings ?…) et autres, à l’initiative de Dandy Brown (Hermano). La chronique est accessible via le lien ci-dessus, et elle retranscrit parfaitement la teneur de ce disque emblématique du vrai desert rock. On se focalisera plutôt ici sur l’intérêt de cette réédition, 100% vinylique. Trois éléments bien distincts distinguent cette sortie de l’original : – 1) Le support : vinyle, donc ! Il n’y avait eu en son temps qu’une sortie CD de l’album. – 2) Le track listing : l’ordre des titres est légèrement remanié (rien de révolutionnaire) mais surtout, cette sortie devient une sorte de compilation exhaustive de toutes les éditions du CD à l’époque. Le disque contient en effet non seulement les deux chansons publiées sur l’édition U.S. de l’album (« Rope » et « Reaching Out »), mais aussi « El Diablo un Patrono », réservée elle au marché hors-Amérique. Il va de soit que ces trois titres sont qualitativement bien au niveau. – 3) Le son : même si techniquement il s’agit d’un « simple » remastering effectué à partir des bandes initiales, il ne s’est pas agi simplement, comme on le voit le plus souvent, de rajouter un peu de dynamique et de volume ici ou là, vite fait bien fait. Re-travaillés sous la houlette du désormais incontournable Harper Hug, les titres se voient dotés non pas d’une nouvelle jeunesse, mais quasiment d’une nouvelle incarnation sonore ! Le mix des instruments est complètement revu (les lignes de basse, par exemple, sont bien plus élaborées et riches que l’on pouvait l’entendre initialement, et apportent un renfort remarquable à la mélodie globale), les effets appliqués aux différentes pistes ont été complètement revus (moins de réverb notamment, pour un son plus percutant et plus chaud). Plus appréciable encore : des pistes sonores inédites viennent renforcer certains morceaux, comme ce lick de guitare qui vient accompagner le refrain de « Above the Big Wide », ou encore les intros remaniées de « El Diablo un Patrono », « Over Here » ou encore « Sleeping the Dream », où le piano est carrément remplacé par de la guitare ! On reste dans le domaine d’un remastering, certes – on ne peut techniquement pas parler d’un nouvel enregistrement. Toutefois, la valeur ajoutée apportée à l’ensemble est indéniable, et témoigne d’un réel travail apporté à cette re-sortie. A noter, l’artwork est lui aussi tout neuf, remplaçant un peu inutilement l’illustration initiale d’un désert torride bien emblématique de ces sonorités, par un combat de serpents bien exécuté mais sans grand intérêt dans le contexte. En résumé, si vous aviez comme nous adoré cette sortie en son temps et souhaitez la retrouver avec le lustre d’un son complètement retravaillé, sur vinyl, cet achat se justifie sans peine. Loin d’une démarche mercantile, l’objet proposé ici par Spin On Black, à la fois respectueux de l’œuvre originale et porteur d’un réel re-travail d’artisan du son, mérite qu’on y prête attention.
Point vinyle : Une seule édition, évidemment la raison d’être même de cette réédition : disque 12’’, 180 gr, gatefold, limité à 500 exemplaires.
11 Paranoias est un groupe parfait. Oui parfait. Du moins si l’on aime les musiques aussi pessimistes que radicales. Un jour, où leur premier EP passait sur ma platine, ma femme, rentrant du travail, a qualifié leur musique de « mort de toute vie ». Voilà qui à mon sens résume parfaitement le propos. Initialement créé par les ex-Ramesses Mark Greening et Adam Richardson ainsi que par Mike West, guitariste halluciné de Bong, le trio s’est dès le départ positionné comme autosuffisant. En effet leurs disques, superbes œuvres aux designs soignés, sortent sur leur propre structure, Ritual Productions, leur permettant de contrôler leur art des premières (lentes) notes jusqu’à vos (lourdes) étagères. Donc oui 11 Paranoias est un groupe parfait, si tant est que vous êtes sensible à la noirceur de leur black metal ralenti, ou de leur doom extrême, c’est selon. Après un premier EP en 2013 (le passionnant Superunnatural), puis un second (Spectralbeastiaries), le trio accède à un véritable succès d’estime grâce à Stealing Fire From Heaven. Nous sommes alors en 2014 et si les concerts de la formation sont rarissimes (une quinzaine en 4 ans), leur réputation dans les sphères les plus embuées du metal lent n’est désormais plus à faire. En 2016, Après une parenthèse Ramesses, revenu d’entre les morts pour quelques dates dont un concert sublime au Hellfest (et qui sait, un nouvel album ?), Richardson s’est replongé dans 11 Paranoias, sans son instable batteur, Greening, parti vers d’autres cieux au sein de Dead Witches. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps : Reliquary For A Dreamed Of World est un disque essentiel. Inspiré, ténébreux, implacablement sombre et traversé par une mélancolie sublime, ce nouvel album d’11 Paranoias ne vous décevra pas. On pourra regretter l’absence de Greening (Nathan Perrier, son remplaçant entendu chez Capricorns, abat un travail superbe mais le jeu inimitable de l’ex Wizard manque forcement un peu) mais difficilement résister aux perles que sont « Destroying Eyes » et « Phantom Pyramid » qui, par sa puissance émotionnelle évoque les effets qu’avait provoqué « Marrow » de Yob sur nos âmes fragiles. Serti d’un visuel proprement incroyable (superposition de trois œuvres, qui se rêvelent selon le film chromatique, fourni avec le disque, que vous placez devant vos yeux. Ce concept basé sur le RGB color concept est baptisé ici « Multidimensional Paranoid Vison ») Reliquary For A Dreamed Of World est simplement l’une des œuvres les plus chères à mon cœur dans cette année 2016 pourtant fournie en matière de disques de qualité.
Point Vinyle: Pas de chichi chez Ritual Productions, une seul et unique tirage, en noir évidement. Reste que le travail sur la pochette est une excuse bien suffisante pour posséder à tout prix ce magnifique objet.
|
||||||||||||||||
|
Copyright © 2004-2026 - Tous droits réservés |
||||||||||||||||