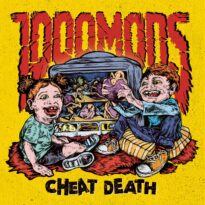|
|

Un peu désorientés par leur quatrième album, Excruciation, sorti il y a quatre ans, c’est avec circonspection que nous nous sommes concentrés sur l’écoute de ce nouvel album, pas aidés par un léger manque de confiance vis-à-vis du label Ripple (qui ces derniers mois nous a habitués à des sorties plus hétéroclites que dans ses grandes années) et un visuel un peu décalé, que l’on imaginerait plutôt orner un album de neo-metal lambda. En outre, le trio américain ressemble de plus en plus ces derniers mois à un projet si ce n’est despotique, en tout cas proche du (gentil) népotisme : Ron Vanacore a changé son bassiste en 2022, et, suite au départ récent de son batteur, vient de le remplacer par… son propre fils, Logan, apparemment un jeune prodige de 14 ans (c’est néanmoins l’ancien batteur Brian Harris qui apparaît sur le disque).
Dans tous les cas, pas de doute, c’est bien autour de Ron que tourne la musique du combo : ses riffs surnagent complètement et structurent les morceaux (et constituent la pierre de soutènement de la production), bien accompagnés par son chant si emblématique. En effet, et ça peut surprendre en première écoute si vous ne connaissez pas le groupe, à l’instar d’un Steve Hennessey (sHeavy) par exemple, la voix de Vanacore, puissante et sournoisement nasillarde, ressemble très souvent à celle d’Ozzy (de l’époque où il pouvait chanter avec ses propres cordes vocales, sans ordinateur…).
En outre, la filiation Sabbathienne ne tient pas qu’à ça : l’inspiration du groupe quintessentiel transpire de la plupart des compos de ce Delirium qui, de l’aveu même du groupe, se veut reposer sur ses plus profondes bases musicales. Et ne parlons même pas de cette efficace reprise du génial « R.I.P. » des doomsters cultes de Witchfinder General…
Plus globalement, ce sens profond du master riff, très Iommi-esque dans l’approche, vient charpenter l’ensemble de ce Delirium, comme Curse the Son ne l’avait probablement pas fait depuis ses deux premiers albums. Côté riffs, on aura du mal à trouver plus efficace que ceux de « Suffering is Ours » ou de « Delirium ».
Pour autant le trio sait montrer qu’il n’est pas qu’un ersatz fadasse de Black Sab’, avec des compos plus originales, à l’image du catchy « Deliberate Cruelty » ou de « Liste of the Dead » (dont plus d’une fois sur le couplet on se dit qu’il n’aurait pas dépareillé dans la discographie d’un… Soundgarden !).
Bref, malgré un plan de carrière confusant, Curse the Son, avec ce Delirium, décrit comme l’album du « R.A.Z. », confirme ses modestes ambitions. De retour à ses bases, le trio compose un album solide, intéressant, qui ne se perd jamais en circonvolutions stériles, et dispense un plaisir d’écoute qu’on ne retrouve que rarement dans les productions récentes.

Vessel, duo australien composé de Jordan Forster à la guitare et Mason Matheson au chant et à la basse vient de sortir son nouvel album The Somnifer, un effort médicamenteux pour le guitariste, véritable thérapie conçue pendant cette damnée période de Covid-19.
En s’appropriant le thème du sommeil, le six-cordiste tente de concilier ses angoisses et traumas avec les composantes de cet état indispensable à la vie. Car on le sait, même s’il est propice à la régénération, le sommeil est loin d’être un chemin de tout repos. Accalmie, REM, état paradoxal, autant d’étapes que Vessel tente de retranscrire dans son nouvel effort.
On traverse donc dix titres à la croisée du doom cathédrale et du stoner graillon, de l’harmonisation 80’s aux effets psychés sur les voix. Il y a du bon (« Draining the Labyrinth ») et du moins vaillant (« Image Reharsal Reaction »). La multiplicité des styles rend difficile l’adhésion totale à l’ensemble, on peut sortir de l’album comme facilement y revenir par la grâce de certains instants, à l’image de « False awakening Continuum ».
Globalement Vessel n’est jamais autant meilleur que quand il est instrumental et minimaliste.
On ne doute pas un instant de la sincérité de Vessel dans ses envies et ses compositions. Le duo est même généreux dans l’effort et le partage. On sent transpirer les années d’angoisses et de doutes aux travers des compositions mais le groupe devrait resserrer son propos et ses idées pour être plus impactant. On garde une oreille alerte quant au devenir du groupe.

Nous avons eu la joie de chroniquer le premier album de Wizard Must Die il y a quelques années (à lire ici). Les voici de retour avec une nouvelle production, cette fois adossée à la boîte de production Klonosphere, le tout dans un joli packaging fait de géométries et de tons pastel, le nouvel album s’appelle L’Or Des Fous et on l’aborde avec le doute de devoir se confronter à une production qui n’aurait pas sa place ici. En effet, Wizard Must Die fait office d’ovni tant le trio lyonnais nous avait laissé entrevoir sa capacité à piocher dans un répertoire vaste, stoner certes, mais aussi empreint d’indie rock et de mille autres choses.
L’expérience peut s’avérer fastidieuse si l’on cherche à tout appréhender d’un coup mais ce qui est sûr c’est que l’écoute elle, devient vite un voyage. Les plus simples aimeraient que cela soit d’un morceau à l’autre. Mais la réalité des Lyonnais est évidemment plus complexe. Au sein d’un même morceau, des riffs puissants côtoient l’atmosphère suspendue d’une réflexion profonde, à la manière de “Close To The Edge”.
Qu’il s’agisse de “The Breach” ou de “The Disappearance of Camille Saint-Saëns”, on ne cesse de se demander où le groupe souhaite nous emmener. Pourtant, on se laisse porter, et même si la tête nous tourne en nous demandant ce qui se passe, on trouve toujours une saillie à laquelle se raccrocher, comme l’emploi du piano sur “The Disappearance of Camille Saint-Saëns” ou ce saxo inattendu sur “Clouds Are Not Spheres”, dont la conclusion fragile évoque une boîte à musique. Voici quelques surprises que vous trouverez dans cet album.
Si l’on se demande souvent en écoutant Wizard Must Die si l’étiquette stoner, ou toute autre étiquette approchante, peut s’appliquer, le doute est rapidement dissipé face à l’acidité d’un riff de guitare comme celui de “Flight 19”, avant qu’il ne soit rejoint par la basse et la batterie, balayant tout sur leur passage. Et comme rien n’est binaire, le doute initial revient vous titiller dès l’outro plus subtile du morceau.
Wizard Must Die joue à souffler le chaud et le froid sans discontinuer. Le trio décompose ses pistes comme autant de sous-morceaux, de pépites prises dans la roche, comme la mélodie et le chant en français de “L’Or des Fous”, un titre fort mal choisi tant pour la piste que pour l’album, car il n’est pas question de pyrite ici. Il y a bien plus de valeur dans cet album à la production soignée. Cette dernière démontre le niveau atteint par Christophe Hogommat et son studio d’enregistrement.
Ce disque n’est pas anodin. Il suffit de regarder l’artwork, une fois de plus signé par La Discorde, pour comprendre qu’il s’agit d’un objet qui ne ressemble à rien d’autre, si ce n’est au précédent qu’il vient compléter à merveille. Vous l’aurez compris, dans cette chronique, il y a peu d’objectivité : il faudrait tuer le magicien, car le sort de L’Or Des Fous est efficace et ne laisse guère place à d’autres critiques que celle d’une galette déconcertante, ardue d’approche mais reliée par un fil précieux qui assemble les pistes entre elles.
Ce retour en très grande forme de Wizard Must Die n’aura cessé de nous faire voyager tout au long des 6 pistes et 47 minutes de L’Or Des Fous. Le temps de décantation de l’œuvre est certes long, mais le trio délivre, une fois de plus, un album borderline et éminemment poétique.

Pour la quatrième fois en quatre ans, le discret mais très qualitatif label américain Desert Records, confortablement ensablé au coeur du Nouveau Mexique, sort un split album ambitieux et intéressant (lancé via crowdfunding, dispo désormais via son bandcamp – cf plus bas). Ce volume 4 est non seulement orienté doom, mais met aussi en avant la scène musicale de l’Utah, à travers Eagle Twin et The Otolith. Chaque groupe se fend de deux chansons, pour un total de vingt minutes chacun environ ; on s’attend évidemment à du lent et lourd.
Eagle Twin est un objet bien singulier dans la sphère « élargie » de la chose doom. Le duo, mené par Gentry Densley, est peu productif (et trop rare sur les planches) mais chacun de ses disques est une franche réussite, poussant dans ses retranchements un genre un peu trop étriqué pour eux. L’annonce de nouveaux titres (plus de six ans après son dernier disque) ne pouvait donc pas nous laisser insensible, et c’est la bave aux lèvres que l’on s’est jeté sur ce split.
Attardons-nous d’abord, donc, sur leurs deux nouveaux titres. Comme prévu, il faut un bon paquet d’écoutes pour en appréhender la teneur, le duo américain n’aimant rien de plus que de déconstruire son doom radical et le mêler à des structures aux limites du progressif, enchaînant les plans, plus écrasants ou étourdissants les uns que les autres. C’est le cas de ce « Horn vs. Halo » introductif, qui commence sur un lit mélodique convoquant discrètement des sonorités ethniques presque primitives (on pense aux chants indiens, d’autant plus avec le recours au chant de gorge diphonique toujours confusant de Densley). Rapidement, le gaillard y pose un riff de colosse, qu’il tord en tous sens pendant 10 minutes, autour de tergiversations guitaristiques diverses, harmonies malaisantes, breaks impitoyables… On n’y compte plus les envolées épiques ou les passages de rouleaux compresseurs sordides, quand le groupe choisit, pour le dernier tiers, de nous prendre par la main vers une issue moins sombre. « Qasida of the Dark Doves » ne propose pas de changement stylistique majeur : on est toujours déchiré entre riffs massifs et accords dissonants, sur un morceau un peu moins déstructuré toutefois (tout est relatif).
On passe ensuite aux deux titres de The Otolith (groupe né des cendres de Subrosa, sans Rebecca Vernon), dont le style pratiqué ne surprend guère : on est en plein dans un doom mélodique sombre et (paradoxalement ?) très lyrique, violon très présent (en lead/mélodie ou en support rythmique) et un chant où presque systématiquement se mêlent en chœur celui de Sarah Pendleton et celui de Kim Cordray, l’un assez convenu, et l’autre sur-aigu et quasi opératique. L’ensemble vise la grandiloquence, c’est très dark et emphatique, et conséquemment ça s’éloigne un peu du doom quintessentiel, primitif et âpre. Il y a peu de riff ou de socle mélodique basique, mais c’est plein de couches mélodiques harmonisées qui viennent se conforter l’une l’autre.
Affichons-le directement : le split mérite clairement le coup, pour la partie de Eagle Twin en premier lieu, et même rien que pour ce colossal premier titre. Sa densité, sa richesse, font qu’il dévoile encore ses trésors après (littéralement) des dizaines d’écoutes. On appelle ça une composition rentable ! En considérant le reste du disque comme du bonus, tout le monde est gagnant.

On avait laissé Wormsand sur leur excellent premier album Shapeless Mass ! Profitant à fond de la période post Covid, le trio mentonnais a enfin pu tourner à fond en France mais aussi en Europe, assurant notamment les premières parties de Mars Red Sky ou Dopethrone et en se produisant dans des festivals comme les Volcano Sessions. 3 ans après, il est temps pour le ver de sable de ressortir des tréfonds d’Arrakis pour nous engloutir avec leur deuxième album You, The King.
Il suffit de quelques secondes sur “Daydream”, titre d’ouverture de l’album, pour prendre une première baffe sonore. Wormsand attaque avec un morceau puissant, efficace, qui casse sa rythmique pour nous emmener dans des mélodies plus mélancoliques et teintées de rock 90’s, et survolé par l’envoutant chant clair de Clément. Le ton est donné, le trio est toujours plein de cette colère sombre, désespérée, qui ne s’efface que pour faire apparaître des sentiments de mélancolie, fatalité et parfois, aux alentours d’une mélodie ou d’un chant plus fragile, d’un peu de lumière.
Cependant, on peut aussi rapidement remarquer que les chemins empruntés par Wormsand diffèrent de ceux du premier album ou même de leur EP éponyme. Déjà côté chant, l’association chant clair / chant guttural (un des atouts phares du groupe) est nettement moins marquée avec une présence beaucoup plus forte du premier. Choix payant puisque la voix de Clément rend chaque refrain entêtant (“Daydream”, “Black Heaven”) et équilibre plus les émotions de l’album. Attention cependant à ne pas oublier les explosions gutturales de Clément et Tom qui peuvent faire chavirer n’importe quel morceau dans les abysses (“Digging Deep”, mais surtout “Drown” et son final fracassant) !
Musicalement ensuite, le groupe laisse plus d’espaces à ses riffs de pachydermes et accentue son côté mélodie quitte même à insérer des solos de guitares sur certains titres. Outre “The Crown”, un doux (mais toujours inquiétant) interlude qui fait écho à l’outro de “You, The King”, ce penchant plus mélodique se ressent particulièrement avec le morceau “The Final Dive” où seules les notes de guitares malsaines en milieu de morceau viennent rappeler la menace qui peut surgir à tout moment.
Mais alors où est la puissance et le fracas dont on parlait sur “Daydream” ?! On nous aurait menti ?! Eh bien non car ce You, The King est un album malin. Si les breaks vicieux sont moins présents, les riffs sont garantis triples épaisseurs et viennent vous hanter jusqu’à être fredonnés dans l’ascenseur. Si le chant guttural est moins présent, il vient vous submerger à chaque apparition (ce cri sur “To Die Alone”). Et s’il vous manque un peu de violence, écoutez un peu Tom qui s’applique à nous enfoncer un peu plus dans le sol à chaque coup de cymbales et dont le jeu subtil permet fait constamment le lien entre la fureur brute et la technicité de l’ensemble !
Vous l’aurez compris, You, The King est un album aussi déroutant que réussi. Sans chercher à se révolutionner, Wormsand apporte ici des évolutions intelligentes à sa base stoner tranchant / sludge obscur un poil psyché. Techniquement le groupe maîtrise son sujet sans se perdre dans des complexités stériles et le cocktail d’émotions est toujours aussi savoureux, surtout avec cette thématique du roi en déclin qui fait écho à tout un univers SF/fantasy dont le groupe est friand. Un seul conseil donc, foncez vers cet album et si vous n’en avez pas encore eu l’occasion, foncez voir Wormsand en concert pour vous imprégner encore plus par leur musique (ou prendre une bûche de ramonage en pleine face) !
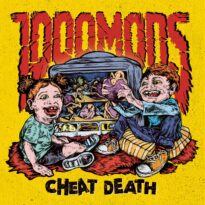
Youth of Dissent, le précédent album des grecs, nous avait clairement déçus. Probablement parce qu’on aime le groupe dans cette case où ils excellent, celle d’un stoner rock trappu et groovy, rapide ou mid-tempo. En essayant de briser ce si confortable carcan, avec quelques pointes de maladresses en plus, 1000 Mods n’a pas recueilli beaucoup de suffrages avec ce disque (même s’il est parvenu à en valoriser une poignée de titres dans ses set lists live). En apprenant qu’ils avaient eu recours pour ce Cheat Death au même co-producteur, Matt Bayles, on avait le droit d’être inquiet (même si l’américain a quelques jolis noms à son tableau de chasse). De plus, en douce, le quatuor est devenu trio : suite au départ de Giannis en début d’année (pour “raisons personnelles”), le groupe n’a pas jugé utile de le remplacer et continue son chemin en mode power trio, apparemment (constat que la production du disque ne nous fait pas ressentir – attendons le live !).
Avouons-le, on était déjà prêts à ne pas aimer ce disque. Les premières écoutes, où les premières impressions pensent capter titres trop mous et astuces trop faciles, viennent conforter cet avis. Hommes de peu de foi que nous sommes… Avec un peu plus d’abnégation, les (at)traits réels de ce disque se font progressivement jour. Car oui, Cheat Death s’avère finalement être un bon, voire un très bon disque. En premier lieu, il propose quelques unes des compos les plus efficaces de la carrière du groupe (qui en connaît pourtant un rayon dans ce domaine !). C’est le cas du morceau-titre de l’album, avec son riff acéré et son très intelligent refrain multi-couches, “The One Who Keeps Me Down” et son riff méga-énervé et méga-accrocheur, “Overthrown” qui commence par un riff mollasson mais d’une belle efficacité, articulé avec un break plus rapide et surtout un final époustouflant (quel solo ! ça va être dur en live avec un seul guitariste…), ou même “Love”, étonnamment, un titre joué en électro-acoustique, aux atours quasi-pop, qui devient vite entêtant et propose une montée en pression très intéressante… En outre, le groupe larde son œuvre de purs moments de grâce, emblématiques de leur maturité et compétence en tant que songwriters (on pense aux différents arrangements de “Götzen Hammer”, au petit lick de guitare qui vient finir le refrain de “Astral Odor” comme une évidence, à la construction de la seconde moitié de “Misery”et en particulier son final, au break post-refrain articulé avec un petit solo sur “Cheat Death”, et évidemment au final de “Grey, Green Blues” et son arrangement de clavier particulièrement judicieux en fond, etc…
Après ce concert de louanges, on s’apprêterait presque à lui décerner le titre d’album de l’année. Sauf que non, Cheat Death souffre de quelques petites scories qu’on ne peut pas taire. En premier lieu on notera plusieurs titres trop longs, pour aboutir à… un album trop long ! Plus d’une heure de musique, on n’a rien contre a priori, mais ici cela nuit à l’efficacité. On aurait pu avoir un disque bien plus efficace en arrêtant “The One Who Keeps Me Down” au bout de 3 min, “Götzen Hammer” à 3:40 avant ce break malaisant, “Astral Odor” après 4 min quand il commence à se répéter, “Speedhead” à 2:30, ou encore en retirant quelques segments redondants de “Love” ou “Grey, Green Blues”… Par ailleurs tout n’est pas magique ici, et aussi mémorable soient-ils, certains morceaux sont moins intéressants : c’est le cas de “Astral Odor”, “Speedhead” (qui fera plaisir aux fans de Motörhead, mais trop cliché pour mettre en valeur 1000Mods), la bluette acoustico-instrumentalo-pop “Bluebird” (intéressante mais trop longue)… Mais vous savez quoi ? Repassez-vous la discographie du quatuor-devenu-trio, et vous vous rappellerez qu’il n’y a rien de neuf sous le soleil : même ses albums les plus emblématiques souffrent parfois des mêmes maux… (dans des proportions différentes).
Cheat Death est donc sans l’ombre d’un doute un bon album, et il redonne des couleurs et des perspectives à une carrière discographique qui nous faisait un peu peur (les prestations live enflammées du groupe nous ont toujours rassuré sur sa bonne dynamique, heureusement). Il permet en outre au groupe d’atteindre deux objectifs : celui de procurer un vrai plaisir d’écoute (sur le long terme aussi, via des compos d’excellente facture) et celui de fournir quelques cartouches toutes neuves pour renouveler un peu son vieillissant arsenal live et rafraîchir un peu ses set lists. C’est donc sans réserve que l’on peut conseiller l’acquisition et l’écoute de ce disque qui, sans toucher au génie pur, propose quand même de grands et beaux moments de stoner rock.

L’exercice merveilleux que voilà, écrire sur la ligne de front entre deux forces passion se livrant une guerre sans merci. Étant totalement étranger à l’univers et la musique de Gnome, me voilà bloqué entre les gardiens d’une musique se voulant grave, obéissante à des lois précises et codées, abhorrant la joie dans le metal, et une horde de trublions décomplexés ne jurant que par l’hédonisme et la liberté de casser les codes. Je grossis le trait bien sûr, mais les débats passionnés autour de ce trio belge chapeauté me donnent cette impression.
A l’origine Sleepless Titan, Gnome le devient parce que ses musiciens estiment que la dérision et l’absurde ont aussi le droit de cité dans un genre bien trop sombre et sérieux. Quelques pas de danse à la con et trois bonnets ridicules plus tard, le savoir visuel carton pâte du trio devient une marque de fabrique et des objets de merch qui s’arrachent. Mais quid de la musique ?
L’objet de curiosité que devient Gnome, attisant passions, joie et colère ne tient-il que par sa singulière image ?
Il serait bien réducteur de les cantonner à cette posture de stand-upper Lidl de la scènes stoner. La vérité c’est que quand on lance Vestiges of Verumex Visidrome c’est le gros riff bien gras de « Old Soul » qui nous saisit, un son bien heavy et syncopé qui parcourra l’ensemble de l’album. Un troisième effort qui foisonne d’idées, passe d’une basse wha-whatée à mort à un saxo rock bien 90’s, ose le grand écart entre chorale mystique et groove funky, le tout charpenté par un héritage sabbathien en diable. C’est travaillé, précis même si la créativité du trio mériterait par moment d’être épurée pour plus de claque dans la gueule.
Le chant est une composante essentielle de l’identité « Gnome ». Il fait que l’absurde devient un rouage nécessaire à cette machine. Growl et crécelle, mélodie à scander, chœur 8°6, voix angéliques, un champ infini de possibilités vocales nous est proposé. C’est parfois trop, par moment audacieux et justement placé, souvent baroque.
Vestiges of Verumex Visidrome est une expérience singulière à mi-chemin entre Red Fang et Devo. Une vraie proposition à l’identité visuelle et sonore forte qui, bien sûr, suscite les débats tant elle cherche à sortir des clous. Divertissant et travaillé à défaut d’être novateur, vous traverserez l’album en dodelinant du chapeau, le sourire aux oreilles. Il faudra accepter aussi que la fosse de vos prochains fest’ soit remplie de téléphones et de cabochons pointus gâchant ainsi méchamment la beauté de l’instant. Turfurlututu. Sale temps pour les petites gens.

“Pourquoi” est sans l’ombre d’un doute le mot qui revient le plus souvent à l’esprit lors des écoutes répétées de ce disque. Mais petit retour arrière avant ça pour rappeler un peu le contexte… enfin, pas la peine de revenir très loin : il y a à peine 9 mois sortait ce qui, sur le papier, s’annonçait sensationnel. Un projet de “all stars” du stoner / doom concentrés sur un objectif qui naviguait quelque part entre premier degré fanboy et fantasme conceptuel un peu WTF : jouer des reprises de Slayer, parangon du speed metal, en mode stoner doom, rythmes ralentis et accordages bien grave… L’album n’aura malheureusement pas tenu toutes ses promesses, et le projet a un peu fait pschiit. Quelle surprise donc de voir déjà le projet se relancer pour sortir un deuxième disque la même année (!!).
Pour des raisons probablement pragmatiques, le groupe se resserre sur trois musiciens : Bob Balch, forcément, à l’initiative du projet, Esben Williams le batteur de Monolord (pratique : il fait aussi le mix et le mastering) et Amy Tung, de Year of the Cobra (pratique : elle fait basse et chant). Exit les autres contributeurs du premier disque : Scott Reeder, Peder Bergstrand et Laura Pleasants.
Selon Balch, le trio se serait engagé dans la reprise intégrale du EP de Slayer Haunting the Chapel (pourquoi ? On aurait eu tant de suggestions alternatives, tant qu’à jouer le jeu…), mais au bout du troisième titre, ils ne seraient pas parvenus à faire sonner convenablement “Captor of Sin”. Difficulté insurmontable qui les fait vite prendre un tournant finalement assez prévisible : au diable les préceptes fondateurs du groupe/projet, ils se sont donc attelés à composer de nouveaux titres. Mais avec quelle idée en tête ? Faire du metal lent ? Faire du doom ? Quel concept ? Personne ne le sait en réalité, mais on se retrouve donc avec cette galette de six titres sur la platine.
Deux reprises, donc, “Chemical Warfare” (assez réussie, pas le titre le plus mélodique de Slayer à l’origine, qu’ils parviennent à bien arranger) et “Haunting the Chapel” (dont l’enchaînement de riffs passe bien dans cette version très ralentie, qui développe une identité propre intéressante). Le reste, ce sont quatre compos, donc, et la question du concept continue de nous hanter : comment on fait pour composer des chansons du projet Slower ? Est-ce que l’on écrit des chansons de speed metal avant de les ralentir ? Est-ce que l’on vise à faire du stoner doom académique ? On ne le saura jamais, mais en tout cas les quatre titre ne sont pas inintéressants. C’est particulièrement le cas de “Hellfire” qui introduit le disque et a été judicieusement choisi comme premier extrait : très bon riff, bel arrangement très ample sur le refrain, bon choix de production (la voix d’Amy avec cet écho subtil)… Plus loin “Gates of Hell” fait preuve d’un grand classicisme dans le genre musical pratiqué (mais efficace) et “Sins of the Dead” propose des choses intéressantes (un refrain qui rappellera ce que l’on aurait pu entendre chez Mars Red Sky par exemple, un long solo où Balch se fait plaisir…). Plus de réserves sur le morceau-titre “Rage and Ruin”, que l’on aurait beaucoup plus de difficulté à rapprocher du concept initial, avec ses nombreuses plages plus atmosphériques, et son riff moins structurant.
Sur les cendres à peine chaude de son premier album-concept innovant, Slower n’aura pas attendu longtemps pour installer un vrai groupe/projet qui déjà se détache de son idée initiale pour proposer autre chose. Ce “autre chose” trouvera-t-il sa place dans l’aréopage de formations évoluant déjà dans ce style musical, chacune avec des degrés d’implication, d’intégrité et de talent variables ? Loin d’être infamant, Rage and Ruin montre des choses intéressantes, et à ce titre mérite qu’on y jette une oreille. Les éléments fondateurs de l’intention sont plus intrigants, et on revient inévitablement à la question… pourquoi ?

Black Elephant revient après un long silence. Leur dernière galette remonte à 2020, et la chronique correspondante est disponible ici. Ce trio transalpin ne déchaîne jamais un engouement fulgurant et récolte d’ordinaire une mention honorable, voire juste passable. Alors, qu’y a-t-il de particulier dans les jams stoner et psyché du sombre pachyderme, pour qu’on revienne encore une fois pour la sortie de leur nouvel opus, The Fall of Gods ?
Bien que produit avec sérieux en studio, peut-être est-ce ce son DIY as fuck qui caractérise Black Elephant et fait figure de totem d’immunité rock’n’roll par excellence. Ou bien ce mélange de styles, oscillant entre indie rageur et pur stoner, qui imprègne The Fall of Gods du début à la fin. La voix y reste toujours en retrait, laissant la part belle aux soli enflammés d’un grand-papi du riff. Chaque piste invite à se délecter de sonorités aériennes et psychédéliques, portées par une batterie puissante, comme celle de “Vedova Nera”. L’enchaînement instrumental qui suit cette piste illustre à lui seul la capacité du groupe à sortir des sentiers battus, tout en assumant un chant en italien que l’on retrouve plus loin sur l’album ; une singularité qui garantit à Black Elephant l’attention de l’auditeur.
Pour revenir à ces chemins peu conventionnels, Black Elephant divague comme à son habitude, passant d’une intention à l’autre, donnant l’impression d’un assemblage de pistes éclectiques plutôt qu’une œuvre homogène. On vous avait prévenus. En écoutant attentivement The Fall of Gods, on prend plaisir à découvrir un break stoner bien senti après une introduction quasi-blues rock sur “Cuori Selvaggi”. Sur la mystique “Jupiter”, on atteint un moment suspendu, hors du temps, qui fait oublier la fin abrupte de “Dissociale”. Ce dernier titre, construit dans une atmosphère post-metal, s’évanouit d’un coup sans prévenir, dommage après une ambiance aussi prometteuse et inattendue.
Au final, on pourrait passer notre chemin en disant que The Fall of Gods est un album où l’on trouve à boire et à manger, mais Black Elephant réussit encore une fois ce tour de force : nous attraper par la manche et nous faire écouter jusqu’au bout un album peu commun, où chaque détail contribue au sel de l’ensemble et pousse l’auditeur à vouloir encore appuyer sur le bouton play.

Lowrider et Elephant Tree, deux groupes de “générations discographiques” différentes, mais qui partagent un statut de quasi-vénération, auprès d’une communauté restreinte, certes, mais avertie. La rencontre de ces deux-là ne pouvait que séduire, et le format d’un split-EP semble bien adapté. Toujours dans le cadre de la campagne PostWax menée depuis quelques années par le label Blues Funeral (et qui avait notamment accueilli le dernier album de Lowrider), cette sorte de double EP contient quatre chansons de Lowrider et trois d’Elephant Tree, dans cet ordre (respectivement environ 24 et 20 minutes de musique) avec pour chacun une chanson qui, symboliquement, accueille des membres du groupe “ami”, généralement sous la forme plutôt symbolique de contribution en backing vocals.
On attaque donc la galette avec les suédois et le très bon “And the Horse you Rode In On”, une saillie stoner énervée emblématique des premiers hits du quatuor / quintete (on ne sait jamais s’il faut compter leur récente recrue aux claviers) : beau riff, excellent travail mélodique… Ce petit bijou catchy a été à juste titre retenu comme le premier single proposé pour découvrir le disque. Et il met tout sur la table en moins de trois minutes ! Un détail qui a son importance pour la suite, surtout lorsque la chanson est enchaînée à “Caldera”, sympathique compo de stoner “à la suédoise” (Truckfighters dans ses bons moments aurait pu pondre ce riff), qui dit tout en trois minutes… mais tire en longueur pendant presque 10 minutes ! Cet étirement très peu utile et répétitif semble plus le fruit d’une auto-suffisance nombriliste que d’une volonté d’apporter de la valeur ajoutée. Même constat pour leur titre suivant “Into the Grey”, mid-tempo lancinant et envoûtant plutôt malin, mais qui s’étiole au bout de 4 minutes à travers une succession de plages atmosphériques et de soli qui sentent plus la jam en salle de répèt’ que la compo finement ciselée. La section Lowrider se termine avec l’intéressant “Through the Rift”, un titre lent mais chaloupé comme nos suédois savent le faire, un morceau chaleureux dans lequel il est presque logique d’inscrire la continuité stylistique avec Elephant Tree (comme dit précédemment, c’est le titre qui accueille les backing vocals des anglais).
Après quelques longs mois de break forcé (un accident début 2023 a immobilisé le guitariste Jack Townley, passé pas loin de la mort) on est forcément enthousiastes à la perspective d’entendre du nouveau matériel de la part d’Elephant Tree – d’autant plus après ce vrai-faux album de raretés et inédits sorti il y a quelques semaines, qui nous aura juste permis de confirmer que le quatuor était toujours actif. L’entrée en matière se fait à travers le déstabilisant “Fucked in the Head”, une plage lente et vaporeuse aux sonorités quasi-expérimentales d’où s’extirpent, sur presque 10 minutes, des filets de chant distants, des gémissements de guitare et un refrain vaguement catchy. Pas forcément l’intro que l’on aurait espérée, même si la montée en tension finale apporte un peu en densité. Le titre suivant “4 for 2” est plus intéressant, avec quelques marqueurs clés de nos anglais (gros riff, beau travail mélodique, évolution harmonique intéressante…). L’ensemble se termine par un “Long Forever” assez prenant (le titre est inspiré de l’expérience récente de Townley et en particulier cette expérience de long coma), porté par une trame mélodique assez efficace. C’est là aussi un bon titre, qui aurait mérité d’être génial.
Sur le papier, ce split avait tous les atouts pour être l’une des sorties de l’année, mais force est de constater qu’il ne répond pas vraiment aux (énormes) attentes qu’il a suscitées. Le constat d’une poignée de bonnes compos est un peu terni : pour Lowrider on ressort avec le sentiment d’un groupe en roue libre, qui aurait pu mieux matérialiser ses (bonnes) idées, et pour Elephant Tree on déplore trop peu de matériel nouveau, même s’il est globalement qualitatif. Bref, pas de quoi remplacer le nouvel album que l’on attend de la part de chacun de ces deux groupes que l’on adore.

Apparemment, Small Stone revient sérieusement aux affaires, si l’on en croît le rythme de ses sorties cette année (d’autant plus quand on compare avec les années précédentes) – on croyait le label plus proche de la fin, clairement, et ce soubresaut d’énergie nous met du baume au cœur. Lancés sur cette dynamique, ils sortent aujourd’hui une galette excitante, le troisième album de The Electric Mud, dont la précédente sortie sur le même label nous avait particulièrement enthousiasmés.
On s’est donc jeté comme des morts de faim sur ce disque prometteur… qui a largement répondu à nos attentes. Le quatuor floridien ne se repose pas uniquement sur ses compétences déjà démontrées, il capitalise sur ses acquis pour emmener sa musique encore plus loin. Il est bien aidé en cela par by Ben Mcleoud aux manettes, le guitariste de All Them Witches les aidant à identifier et appliquer les arrangements riches, audacieux et judicieux qui viennent servir leurs compos.
En outre, The Electric Mud transmet une sensation de groupe solide sur ses bases, couvrant à la perfection l’ensemble des composantes d’un excellent groupe de heavy rock US : un duo de guitares brillant, complémentaire, alignant riffs impeccables, mélodies catchy, breaks percutants… Globalement, instrumentalement il n’y a rien à redire, l’ensemble est en béton armé. Et au milieu c’est Peter Kolter qui surnage : le guitariste chanteur pose des lignes vocales puissantes, chaudes, mélodiques, qui donnent à la musique du quatuor ses atours les plus captivants.
Difficile après une poignée d’écoutes de se départir des compos punchy et catchy du combo, qui ont toute une identité bien singulière (socle rythmique, son, énergie, etc…). On vous souhaite bon courage pour oublier des titres aussi accrocheurs que “The Old Ways”, “Top of the Tree”, “Manmade Weather” (et ses atours presque proggy), etc…
Ashes and Bone est donc une galette de pur plaisir, un disque qui ne révolutionnera pas le visage de la musique, mais qui propose une dizaine de compos de haute volée, que l’on se plaît à chantonner avec le sourire au coin des lèvres. Un disque qui ne flatte pas que les sens les plus primitifs, mais qui pour autant ne se la joue pas prise de tête. Un vrai bon disque de heavy rock.

Premier album en 2013 (Mannequin), deuxième en 2015 (The Great White Dope) et puis… plus rien. Grosse surprise donc à l’annonce d’un troisième effort pour Sun & Sail Club. Alors, après presque dix ans d’absence, rappelons un peu le contexte.
SSC est un de ces supergroupes qui fleurissent par-ci par-là et qui sortent un album, rarement plus, plus ou moins bien réussi. Donc dans la série supergoupes, je vous (re)présente Bob Balch et Scott Reeder de Fu Manchu, Scott Reeder de Kyuss (entre beaucoup d’autres) et Tony Adolescent (un de ses nombreux pseudos) de The Adolescents. Rien que ça !
L’énorme différence entre les deux premiers albums c’est le vocodeur. Utilisé sur la totalité du premier et nullement sur le deuxième. On se pose donc légitimement la question pour ce troisième album surtout si ce choix vous empêche d’apprécier le premier LP. Fin du suspense, ici, chant classique. Comprendre par là, comparable au deuxième album car on est quand même sur un chanteur punk/hardcore, faut pas charrier.
Du premier album on retrouve ici l’idée d’une intro et d’une outro typées jazz/blues totalement différentes du reste du contenu. Entre deux, ça envoie sec et sans concession avec huit titres pour à peine 21 minutes.
Si vous avez un jour eu envie d’entendre du hardcore fait par des piliers de la scène stoner, voilà ce qu’il vous faut. D’autant plus que c’est vraiment très convaincant. La construction est classique autour d’un bon riff d’intro suivi d’une rythmique accrocheuse avec un batteur qui défonce ses fûts pendant que le chanteur met à mal ses cordes vocales. Des breaks, des solos et on ne cherche pas à faire durer. A l’image des meilleurs albums de punk et de hardcore, pas besoin de te trainer le riff sur dix minutes, tu as compris le concept en deux minutes, ça suffit, on passe à la suite. Et ça s’enchaîne sans pause. A l’image de “Vector” qui en 1 minute 5 secondes, regroupe tout ce dont je viens de parler.
Clairement si vous avez apprécié The Great White Dope, ce Shipwrecked est de la même veine, peut être même plus énervé.
Un bon disque de punk/hardcore c’est quoi en fait ? C’est une claque en pleine tête bien brutale mais pour lequel, si on se concentre avec une écoute attentive sur chaque instrument, on se rend compte qu’on est loin de l’amateurisme et que ça maitrise carrément son outil. C’est exactement ce qu’offre SSC. Concentrez vous sur la batterie, la basse ou la guitare et vous vous dites, “ah oui quand même, les mecs sont carrément au top”. L’alchimie est parfaite et Tony au chant est excellent.
Bref, fait par d’autres gars, pas sûr qu’on chronique cet album mais vu le line up, impossible de passer à côté. Et je suis certain que parmi les lecteurs et lectrices de ce site, on a un paquet de fans de hardcore qui attendaient aussi depuis bien longtemps un digne successeur à The Great White Dope. Le voici, sautez dessus !

Trio confidentiel qui s’est fait une place depuis quelques années, principalement dans les salles “stoned and doomed” de Paris, Oda sort enfin cette année son premier album, une autoproduction attendue par ceux qui ont eu l’occasion de les voir en live et de savourer des prestations scéniques de qualité, accompagnées d’un son fédérateur. Leur CV commence à s’étoffer avec des premières parties prestigieuses (Stonus, Domadora, Decasia, Giobia, bref, du beau monde !). On espère que cette production leur ouvrira de nouvelles portes. Oui, vous l’avez deviné, on s’apprête à vous dire du bien de ce premier opus : Bloodstained.
Oda, petit poucet rendant hommage à Black Sabbath, nous invite à un plaisir certain, même si l’on ne s’attend pas forcément à découvrir quelque chose qui chavire d’excitation. Pourtant, au fil des écoutes, on finit par reléguer cette référence au rang d’anecdote.
Les français se démarquent par des compositions, qui intègrent presque systématiquement des passages aux harmonies intrigantes, voire carrément fédératrices, comme le solo d’”Inquisitor” ou les quelques notes de guitare qui transpercent le mur de basse et de batterie dans “Zombi”, la plus centrale des pistes qui en près de 11mn réalise un sans faute. Le chant lancinant et envoûtant de “Rabid Hole” capte également l’attention. Bref, il y a toujours un élément qui retient l’auditeur et l’incite à s’enfoncer un peu plus dans l’épaisse poix sonore d’Oda.
Bloodstained offre des rythmiques lourdes et pesantes, avec une batterie et une basse massives qui suivent les traces de confrères comme Witchfinder, passés par là quelques années plus tôt. Il suffit d’écouter “Succubus” ou “Inquisitor” encore et encore pour s’en convaincre. Et puisqu’on parle de lourdeur, à l’exception d,e l’introductif “Children Of The Night” les morceaux oscillent entre 5 et 11 minutes : autant dire qu’il faut de l’appétit pour dévorer cette galette. Pour autant, on ne se sent pas alourdi, même après avoir digéré le massif “Mourning Star” et les 42 minutes de l’album.
Oda livre ici un premier disque de qualité, et le fait-maison ne le diminue en rien. Bloodstained est à la fois un parangon du doom moderne, jouant bas et lent à l’excès, et un assemblage d’idées créatives qui permettent au groupe de se distinguer sans tomber dans la pâle copie de leurs glorieux prédécesseurs.

A peine plus d’un an après Elektrik Ram, le quatuor sud-africain remet déjà le couvert avec un nouvel album ! Changement d’écurie au passage, avec un départ du label sud-af’ Mongrel Records et la signature chez les allemands de Sound of Liberation Records, une jeune structure dans l’édition de disques, certes, mais bien implantée et expérimentée dans la gestion d’artistes, tournées, festivals, etc… Un pied supplémentaire sur le vieux continent en tout cas pour le groupe, qui ces derniers mois a arpenté l’Europe en long et en large (tournées, festivals, premières parties…).
Musicalement, on n’est pas vraiment déstabilisé avec ce disque… pour peu que l’on soit familier de Ruff Majik ! Il faut quand même à nouveau s’accrocher un peu pour rentrer dans leur univers : si le groupe a toujours été lié à la famille stoner, il reste difficile de l’associer à une tendance précise du genre, ou à des groupes spécifiques qui pourraient être identifiés comme influences directes ou indirectes. Tandis que sur les disques précédents, on pouvait tracer des liens avec QOTSA parfois, c’est ici bien plus rare (bon OK, sauf sur “Cult Eyes”…). Le groupe est émancipé, et fait du Ruff Majik, à savoir un heavy rock débridé, énergique, qui va piocher ici ou là dans le stoner, le garage rock, le metal, le funk, le blues, etc… Le tout emmené par la voix emblématique de Holiday (qui peut poser problème à certains… mais tellement marquante et importante pour l’identité du quatuor !).
Il apparaît que ce disque est le dernier volet d’une trilogie, entamée avec le brillant The Devil’s Cattle en 2020. Au regard de la musique “bariolée” du groupe, la ligne directrice qui pourrait lier ces trois disques ne saute pas franchement aux oreilles… si ce n’est dans sa qualité de composition ? Car c’est à nouveau ce facteur qui distingue Moth Eater du “tout-venant” : même s’il n’y a pas de hit dévastateur évident comme sur ses deux prédécesseurs (“Rave to the Grave”, “Jolly Rodger”, etc…), Moth Eater propose son lot de perles super catchy, probablement plus dense même que sur les deux disques précédents. On a ainsi du mal à se détacher des énervés “Battering Lamb” et “What a Time to be a Knife”, du groovy “Dirt and Deer Blood”, du très malin “Wasted Youth” et son refrain dévastateur à chanter les bras qui balancent en l’air (si si)… Forcément, le disque comporte son lot d’OVNIs, mais on reste dans des genres musicaux très accessibles, et ces morceaux sont réussis (on pense à “We’re Not Out of the Swamp Yet” qui porte bien son nom avec son blues sludgy, au funky “Ingozi”…).
Dans un texte de huit pages (!) transmis aux médias et amis du groupe pour accompagner l’album, Johni Holiday, son indéboulonnable frontman, décrit longuement son approche artistique, sa nostalgie du music business du début du siècle, son sentiment de nostalgie d’être dans un système musical qui ne va pas dans le bon sens, et dans lequel il essaye de faire survivre son groupe, via parfois des approches un peu décalées… Le bonhomme force au respect, et son intégrité, mêlée à sa créativité, en font un personnage particulièrement attachant. En outre, son dernier disque est, en toute objectivité, un bien bel ouvrage. Un disque qui comporte un échantillon remarquable de hits que l’on se plaira à chanter longuement sous la douche, des compos enthousiastes et enthousiasmantes qui font presque toutes mouche. Moth Eater est un disque réussi, un disque difficile à cerner pour le non-initié, mais qui récompense l’auditeur aventureux. Il faut lui donner sa chance.

Il est étonnant de constater que pour un groupe avec si peu d’activité sur les deux dernières décennies (un seul concert en plus de 15 ans – au Hellfest en 2016 – et dernier album il y a 17 ans), l’aura autour du groupe / projet Hermano est restée particulièrement vivace. Difficile d’en comprendre la raison… Présence de John Garcia dans le projet ? Alignement des planètes ? Dans les faits, cela relève plus d’une alchimie absolument tangible dans la constitution de ce line-up bricolé par Dandy Brown : le bassiste a su voir le potentiel qui pouvait émaner de ces musiciens qui ne se connaissaient pas avant de les faire rentrer ensemble en studio pour ce projet, pour produire un album référentiel, sorti de nulle part. L’histoire ne retiendra même pas que ce disque, pris dans l’imbroglio du dernier album mort-né de Unida, fut bloqué dans les limbes pendant plusieurs années pour des questions contractuelles (du fait des engagements de John Garcia d’une part, de la faillite du label Man’s Ruin, etc…).
Aujourd’hui, le groupe est au point mort, ou plutôt au ralenti : ils ont quelques compos sous le coude à l’état de démos plus ou moins abouties, mais ses musiciens sont (littéralement) aux quatre coins des Etats-Unis, ont avec les années dû faire évoluer leurs priorités (et donc leur disponibilité), et leur chanteur (Garcia) privilégie ses projets perso pour son rare temps « libre » (sans faire une croix sur ses autres projets)… Difficile dans ces conditions de développer le groupe. Pour autant, Hermano existe toujours, et ce disque s’en veut la preuve.
Pour l’aspect « signe de vie », il faudra se concentrer sur une seule chanson sur le disque : « Breathe » est un très bel échantillon de la musique de Hermano, il déroule son groove blues-rock sur une trame mélodique et rythmique chaloupée, propose un beau terrain de jeu à une paire de guitaristes toujours justes (du riff efficace, de la lead en portion raisonnable) et le chant de Garcia vient apporter la touche finale à l’identité bien particulière du combo. Un très bon titre. Le second morceau est certes un inédit, mais il date de plus de 25 ans, des sessions d’enregistrement du premier album. « Never Boulevard » se développe sur une trame électro-acoustique (la légende veut que Garcia et Dandy se soient assis avec une guitare acoustique quelques minutes avant la fin de l’enregistrement du disque pour poser quelques lignes vocales quasi-improvisées sur un petit riff de Brown…), probablement complétée depuis de quelques subtils arrangements et instrumentalisations complémentaires en post-production (discrets leads, un peu de percus…). Le titre est sympa, il fonctionne bien, même si pas parfaitement emblématique du « style Hermano ». Autre inédit « ou presque », « Love » n’a pas été enregistré en studio et est issu d’une interprétation live : il fut joué au Hellfest, et à l’époque nous vous en avions proposé la captation vidéo en exclu (lien vers la vidéo). Un titre déjà connu des aficionados, donc, mais qui peut apporter un peu de fraîcheur à ceux qui sont restés dans leur bulle ces dernières années. La chanson est cool, encore un mid-tempo reposant sur un bon travail mélodique, qui mériterait peut-être un peu de re-travail de production pour être peaufinée sur disque.
Le reste du disque est constitué d’extraits live d’intérêt musical ou historique hétéroclite. Deux autres titres sont issus du concert au Hellfest (dont émerge le groovy « Señor Moreno’s Plan »), et un autre du concert au W2 de Den Bosch (Bois-Le-Duc si vous préférez) le 4 décembre 2004. Sauf que ce concert a déjà fait l’objet d’un album live du groupe, et que ce titre n’y figurait pas ! Il s’agit donc d’une vraie rareté, d’autant plus que l’on s’interroge vraiment sur son absence dans l’enregistrement d’origine : déstructuré pour l’occasion, reposant largement sur les « divagations guitaristiques » d’Angstrom, ici très inspiré, cette version de « Brother Bjork » ne manque pas d’originalité, sans perdre la trame et l’esprit originel de la chanson. Excellent choix donc que de le sortir finalement sur disque.
Avec moins d’une demi-heure de musique, et une proportion d’inédits « à géométrie variable » (rajoutons aussi que conformément à la mode de ces dernières années, tous les titres ont déjà été sortis en amont sur les différents réseaux sociaux / plateformes de streaming), l’acquisition de ce disque au regard de la valeur « nouveauté » seule peut être discutée. En revanche, ce disque vaut pour deux autres facteurs : d’une part il est le signe d’un groupe qui, s’il ne sera plus jamais « vivace » comme il a pu l’être au tournant du millénaire, n’est pas mort. Il est constitué de musiciens qui s’entendent bien, il existe des compos partiellement enregistrées… bref les conditions d’un nouvel album et d’une nouvelle tournée sont bien là, en sommeil, et il ne manque qu’une étincelle pour remettre tout ça en ordre de bataille. Le dernier facteur d’intérêt tient à la musique elle-même : s’il manque de « consistance » (fait de bric et de broc), ce disque propose quand même quelques belles portions de musique de Hermano, qui reste un groupe à part. Et si ce ne sont pas les meilleures chansons de sa discographie, ce sont de bonnes compos. A plus d’un titre donc, ce disque s’avère très intéressant.
|
|