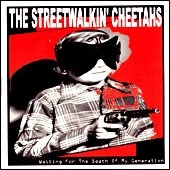|
|
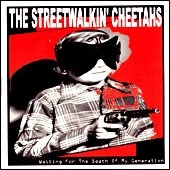 A l’heure à laquelle ce groupe de Los Angeles n’as sorti « que » deux véritables albums, une poignée de singles et participé à un nombre non négligeable de compilations en tout genre, le label espagnol Munster Records sort une compilation des Streetwalkin’ Cheetahs (qui étaient déjà présents sur leur compilation « Fuck The Millenium »). Cet album regroupe des faces B, des prises live, des extraits de compilations, de splits, de tribute albums et quelques inédits ; l’intérêt de la chose réside donc dans le fait que la plupart de ces morceaux sont quasiment introuvables. Les accros d’Iron Maiden (qui se comptent par centaines parmi les lecteurs de Transit) seront d’ailleurs heureux de pouvoir écouter la « fameuse » face B qu’est « Sanctuary » reprise à la sauce Streetwalkin’ Cheetahs. Et c’est quoi la sauce Streetwalkin’Cheetahs ? C’est du bon gros rock’n’roll puissant et sans fioritures, puisant principalement ses influences dans le punk et le hard rock des seventies et des eighties. Les amateurs de ce genre tout en finesse apprécieront.
Je ne sais trop quoi penser de ce disque. Autant j’ai adoré Yawning Man, autant déja Ten East m’en touchait une sans bouger l’autre. Je suis un die-hard fan de Fatso Jetson, il faut donc croire que l’influence Lalli disparaissant, la chose perdait de sa magie… La même chose avec ce disque, sans queue ni tête, et sans grand génie.
Les chansons s’enchaînent sans que l’une ou l’autre ne se détache, sur fond de licks de guitares clairs et lancinants. On ne peut dès lors qu’imaginer un groupe proche de l’anémie, avec, dans une salle bien climatisée, une poignée de zicos qui regardent leurs chaussures en ondulant gentiment. Bref, un groupe de furieux passionnés.
Je charrie un peu, on sent que les gars en ont sous la pédale, et côté gratte, ça tricote gentiment, ça joue bien, mixant odeurs de sable chaud, avec tendances jazz progressif (voir le saxo qui surgit parfois au détour d’un morceau). Mais le “chant” parlé tout du long ajoute une touche décalée totalement absconse.
Au final, j’ai quand même du mal avec ce disque. J’ai du mal à imaginer qu’on puisse l’adorer sans un pétard dans le pif (auquel cas c’est sans doute un disque génial, hypnotique et névrotique à la fois)… Mais à jeûn, l’intérêt est faible. Je crains que Gary Arce ne soit en train d’user ses 4 derniers fans hardcore avec ce genre de sortie, qui a plus sa place sur un CDR démo que sur une sortie de l’excellent label Alone Records.
Kyuss quand tu nous tiens ! Si on procédait à un recensement systématique du nombre de groupes ayant directement été influencé par le quatuor de Palm Springs, on obtiendrait certainement un chiffre remarquable. Un de ces chiffres qui permettrait de mieux comprendre le culte voué à cette formation séminale. On trouve de tout parmi les pratiquants de ce culte. Pour aller vite, disons qu’il y a d’un côté les laborieux et souvent pénibles suiveurs, et de l’autre, ceux qui, sans renier leur héritage, parviennent à y intégrer un truc personnel, aussi infime soit-il. HTSOB fait partie de la deuxième catégorie. Si bien que passé les premiers doutes, on se laisse rapidement captiver. Et on se dit que pour un début (4 titres), c’est plutôt très bon. Le son est excellent, ce qui prouve que le producteur, Alex Newport est sous utilisé dans le genre. Ce petit disque devrait permettre d’y remédier.
Quasiment 8 ans après le classieux “Deep in the hole”, le très peu prolifique père Goss nous délivre enfin sa nouvelle offrande, qui plus est sous une “forme” musicale un peu atypique, avec un album qu’il envisage en 2 parties : “Pine” et “Cross Dover”. Pour l’occasion, il reste accompagné de son éternel frère d’arme, John Leamy, et d’une demi-douzaines de potes (dont les noms ne vous seront pas étrangers : Brendon McNichol, Dave Catching…) qui viennent filer un coup de main, ici ou là sur le disque. Rien de surprenant.
Après avoir écouté ces derniers mois une belle série de brulots sévèrement burnés, l’écoute d’un album studio de MOR relève un peu du sevrage, et la rupture auditive est brutale. La musique et le son (Chris Goss s’auto-produit, of course) sont ronds, suaves, travaillés… Pas vraiment du garage rock crasseux… Ce n’est d’ailleurs toujours pas du stoner, MOR continue à évoluer sur sa planète musicale bien à part, indéfinissable. Certes, le combo reste maître incontesté du “robot rock” cher à QOTSA (les petits riffs répétitifs et saccadés typiques de “VP in it”, “Dreamtime Stomp” ou encore “Always”, on est en plein dedans), et c’est déja un trait qui leur est propre. Mais le groupe excelle au delà d’un seul genre.
La première partie de l’album, “Pine”, est probablement la plus décalée, la plus austère aussi, presque “froide”. Austère comme la prod super discrète du très rock “King Richard TLH”, titre qui aurait pu dépoter sévère, s’il avait été servi par un mur de guitare à sa hauteur ! Mais le choix de prod de Goss, audacieux mais judicieux, introduit l’album en douceur. Des titres entêtants, lancinants, limite bruitistes parfois, lui prennent la roue. Ca fonctionne, la tension monte pas mal jusqu’à l’épique “Johnny’s dream”, un instrumental qui sonne comme une musique de film. On passe donc à la seconde partie, “Cross Dover”, à mon avis la meilleure. La liaison se fait par 2 titres bien accrocheurs, comme une progression rock bien ficelée, amenant à “Rosie’s Presence”, un titre aux relents rock blues modernisés, toujours enrobés de la voix suave de Goss et de sa prod encore une fois plutôt en retrait (sur un titre qui aurait pu être plus pêchu encore). Le titre suivant est plus anecdotique, mais mène à “Testify to love”, probablement le meilleur de l’album : introduit par une guitare “d’outre tombe”, ses couplets sombres et graves le mènent à un refrain d’une efficacité imparable, même si super répétitif. Le dilemme de cet album tient à sa dernière plage, “Alfalfa”, un long instrumental qui, comme le dit Chris Goss dans les crédits, est en réalité une jam de 4 mecs qui se sont retrouvés dans un studio pour la 1ère fois ensemble, ont branché les instruments et ont enregistré leur jam session. On peut admirer la musicalité de ce quatuor improvisé, et baver à l’idée d’être là pendant ce moment magique, mais… ce titre, une longue impro quelque peu déstructurée et finalement assez inégale sur la longueur, détonne un peu en conclusion d’un album aussi finement ciselé, aussi bien construit.
Mais c’est un bien léger bémol, face à un album dont la qualité intrinsèque reste remarquable. Une petite perle pour les fans de desert rock non élitistes, et plus généralement pour les fans de rock et de bon son. Longue vie aux Maîtres.
 Revoilà Spice ! Le charismatique ex-chanteur-bassiste des Spiritual Beggars a quitté le groupe en mauvais termes pour se consacrer entièrement à son Mushroom River Band il y a quelques mois, et voici donc le nouvel album de ce qui est désormais son propre groupe. Leur première galette, ‘Music For The World Beyond’, avait botté plus d’un cul il y a deux ans, on était donc en droit de s’attendre à un petit joyau. L’effet de surprise en moins, on se jette donc sur ce nouvel album avec l’anticipation bien légitime du fan qui espère au plus profond de lui que l’un de ses groupes préférés (les Beggars) a engendré deux groupes au moins aussi bons (les Beggars Mark II et le Mushroom River Band, donc), tout comme le split de Kyuss en son temps avait généré QOTSA et Unida. D’où une légère déception. Légère seulement, parce que la voix de Spice est bien là (sans doute la plus chaude et éraillée du stoner rock contemporain), parce que le son de guitare est énorme et arrache tout sur son passage, parce que la rythmique et en particulier la basse (dont le son ultra saturé rappelle le Motörhead des grands jours) laminent toujours autant les tympans. Ensuite il y a ces compos, parfois énormes, tel cet hallucinant ‘My Vote Is Blank’ porté par un riff anthologique, ou ce ‘Tree Of No Hope’ ultra violent. Mais bon. Certains morceaux sont seulement ‘moyens’. L’album est donc bon, mais inégal. Il recèle toutefois quelques vrais trésors qui méritent inéluctablement d’y jeter une oreille. Mais pas trop près des écouteurs, ça fait mal.
 Putain la baffe ! Aurelio de fenec (que je remercie) avait balancé un courriel pour attirer notre attention sur cet opus stoner qui venait de lui arriver aux oreilles et il a bien fait. Ardents défenseurs du stoner et désireux que nous sommes de partager une de nos passions avec un maximum de gens dans la francophonie, il eût été criminel de passer à côté d’une production pareille. Zoe vient de Calais : ça tombe bien, ça fait encore un bon groupe dans la région linguistique dont nous venons et c’est certainement une des productions qui m’a le plus laissé sur le cul depuis le début de l’année.Mise en boîte entre mars et avril 2005, ce cd soigné se réclame de l’héritage de Motörhead, AC/DC ainsi que des groupes seventies, mais il se rapproche indéniablement de Queens Of The Stone Age, Fu Manchu, Dozer, Hellacopters ou Hermano et ça fait du bien par où ça passe croyez moi. Ce skeud est composé de onze titre et du clip de ‘Think Today’ (et non pas celui de ‘Make It Burning’ comme mentionné sur la pochette) sur lequel un des guitaristes arbore fièrement un t-shirt de Parabellum (c’est vous dire si ces types-là sont rock’n’roll), clip qu’on aimerait bien voir sur les chaînes musicales car il élèverait le niveau au raz du plancher que ces gens nous imposent jour après jour.Musicalement, le quatuor balance la sauce sur des tempi rapides et terriblement groovant un peu à la manière de Sparzanza. Les compos sont toutes assez brèves à l’exception de ‘Strike It On’ qui dépasse les 4 minutes et lorgne plus que les autres vers le style d’AC/DC que le groupe cite comme une de ses notoires influences. Les rythmiques sont carrées, les riffs affûtés, la basse vrombit et la sauce prend dès les premières notes de ‘Make It Burning’, qui est dans un registre très proche de ce que Dozer a réalisé de mieux, s’ensuit 9 titres absolument mortels qui défilent sans jamais lasser l’auditeur avec une facilité déconcertante tout en évitant les redites. Outre le titre mis en image, ‘Shake’, ‘Free Born Man’ ou ‘Coming Down’ sont de véritables petits bijoux élaborés sans fioritures dont on se souvient immédiatement un peu comme les titres de leurs confrères ricains d’Hermano.Enfin je ne saurai que trop vous encourager à vous jeter de toute urgence sur cette production ne serait-ce que pour écouter ‘Bad Vibration’, titre auquel va nettement ma préférence. Vivement la suite de l’aventure de ce groupe grâce à qui nous n’avons plus à rougir en nous comparant aux Scandinaves !
 Je vous avais causé de cette formation hexagonale l’an passé lorsque ces cinq types sortaient ‘Ecce Pachyderme’ en guise de teaser annonçant l’arrivée de la pièce définitive ‘Pachyderme Garage’. Je n’ai pas eu à attendre bien longtemps pour que la version définitive du long format fasse son apparition autre part qu’au rayon démo bénéficiant du coup d’une distribution nationale en France.
Très logiquement, les plages déjà présentes sur le cinq titres (’27’, ‘Dirty Little Pretty Scary Thing’, ‘Ultra Pop’, ‘Dispomania’ et ‘Sunday Morning (Are Gone)) se retrouvent sur ce douze titres de près d’une heure et je ne vais pas revenir spécifiquement sur ces morceaux. Les plages qui m’étaient inconnues évoluent dans le même style avec toujours ce brio en ce qui concerne la production et cette recherche de s’éloigner le plus loin possible des sentiers battus tout en gardant une touche assez proche de QOTSA ainsi que des Desert Sessions. Je note au passage que la formation nous livre sur la plaque définitive des morceaux un peu moins accessible que sur son prédécesseur et ce pour mon plus grand plaisir.
Le quintette se lance dans une pièce envoûtante de près de dix minutes avec l’aérien ‘Still A Mess’ qui transpire les influences désertiques à grands coups de reverb avec toujours cet air de violon qui tourne derrière. Les amateurs des projets auxquels Mario Lalli a participé devraient se pencher sur ce titre qui leur parlera à n’en point douter. Cette réussite musicale touchante et aboutie est un grand moment de cette galette avec le redoutable ‘Skip Link’ qui est un bon mix du rock progressif et de fuzz assez calme jusqu’à son refrain scandé avec fougue qui se termine brutalement en me frustrant carrément. C’est là que le flemmard que je suis se réjouit de n’avoir qu’un skip arrière à faire en lieu et place de lever son cul pour remettre l’aiguille au bon endroit du sillon…
Agrémenté d’une pochette orientalisante dans le style de Ben Radis, ce digipack au contenu fuzzo-chaotique qui fuit les étiquettes comme la peste devrait trouver son public auprès des aficionados de ce qui se fit naguère du côté du Rancho De La Luna.
 Je ne connaissais pas la formation de Trévise avant d’avoir reçu leur production et c’est en fait assez normal étant donné qu’avant cette partie de rodéo, le quintet n’a laissé gravé dans le sillon qu’un titre sur le sixième volume d’une compilation indépendante. Le fait de ne pas avoir propager sa musique jusqu’à mes conduits auditifs n’est en soit pas un handicap et c’est toujours un sacré plaisir que de faire connaissance avec des nouveaux venus. Je me lance donc au contact des huit titres du groupe italien.
Premiers accords, première impression et premier avis : Mosca, Johnny, Pax, Fede et la charmante Liz, à la batterie, balancent un rock d’obédience alternative à mi-chemin du rock noisy et du stoner. Attention, quand je parle de stoner, je ne parle pas d’un énième combo de rock qui marche dans les traces de QOTSA et se réclame du stoner depuis qu’il a entendu le groupe du rouquin. Je parle de gens qui balancent des compos fuzzy aux forts relents seventies dopées à l’adrénaline.
Alors ouais, Bodyntime n’est pas non plus un groupe à cent pourcent stoner, mais Bodyntime n’est pas non plus un groupe touche-à-tout qui a sorti un seul titre genre stoner et fait de la britt-pop sur le reste des morceaux et à ce titre il a sa place sur ce site. Pour nous ne convaincre, les Italiens envoient le gros son sur ce premier effort et deviennent incroyablement séduisant quand ils nous délivrent ‘Law & Order’, un titre magique qui convainc bien dans le style qui nous fait vibrer sur ces pages.
Le problème, car il y en a un, c’est les parties vocales que le mixage final a mis beaucoup trop en avant sur cette plaque. Le résultat est assez désarmant car, ormi sur le titre déjà cité, nous avons parfois l’impression d’assister impuissant à une production de Simone et ses Bodyntime et c’est bien dommage parce que ce qui se passe derrière est plutôt digne d’intérêt.
Même si les transalpins ne sont pas les autour du disque du siècle avec cette production, le potentiel de ce groupe à nous faire vibrer demeure intact et je ne demande qu’à les entendre sur scène avec un mix différent pour m’en convaincre.
 Sous le prénom de Boris se cachent trois japonais complètement barges et une jolie fable contemporaine. Pour nous la raconter, Boris s’est fendu d’un morceau de soixante-cinq minutes qui a donné son nom à l’album, puis d’un second, « Dronevil 2 », qui dure près de huit minutes et basta ! Guitare et basse assènent de grands riffs monolithiques et répétitifs. De la batterie, on entend souvent rien de plus que les vibrations du timbre de la caisse claire. Un coup de grosse caisse égrené de ci, de là. Point. Le chant se borne à des hurlements sourds au lointain. Insidieusement, les guitares se mettent à hurler à leur tour sous l’influence d’une tonne d’effets. Des bruits métalliques s’entrechoquent. On se croirait dans une scierie en plein turbin au fond des Vosges. C’est la scierie de Boris et de ses amis. Veulent-ils ainsi prendre leur revanche sur la nature qui a infligé bien des souffrances à nos vertes forêts le 25 décembre 1999 ? On pourrait le croire. Tiens un coup de gong. En tout cas, il retranscrit une expérience traumatique. C’est sûr. Boris a morflé. Mais de quoi ? Ça y est, le batteur s’y met enfin et rejoint ses copains. Vingt-cinq minutes viennent de s’écouler. Lentement, un morceau se dessine. Et là on se dit qu’on a bien fait d’être patient. C’est outrageusement heavy. Boris débite à mort pendant dix minutes. Les machines-outils fonctionnent en cadence. Puis il est l’heure. Les potes de Boris rentrent à la maison. Boris lui, a du boulot à finir. Sa scie-guitare, monstrueuse, envoie un larsen continu. Elle tourne à plein régime puis s’évanouit. Par la fenêtre, un bourdon-basse intrigué s’introduit dans la scierie et s’approche de Boris. « C’est toi qui fait tout ce raffut ? » lui demande-t-il. Boris à peur. Dans le même temps, le vrombissement du bourdon exerce sur Boris un charme, proche de l’engourdissement, fort agréable. Boris est franchement épaté. N’écoutant que son courage, il se reprend et lance à son tour : « associons-nous ! ». Ainsi fut fait. Le bourdon féconda Boris. Et nous livre le nœud de l’histoire. Boris est enceinte. Et il ne se sent pas bien ces derniers temps. S’il y a une morale à cette fable, c’est qu’avec de bons amplis et quelques idées on arrive à faire reculer les frontières réputées infranchissables. Même lorsqu’elles sont posées par EARTH, puis SUNN O))). Sacré Boris va !
 Amis du drone et des musiques conceptuelles, cet album s’adresse à vous. Vous qui aimez les bidouillages amphigouriques, les morceaux décomposés, les copier/coller, le manque de cohésion, l’absence de structures classiques, la musique d’obédience plutôt rock emballé dans des larsens ou des nappes de synthés monotones etc… vous ne pouvez pas passer à côté de cette sortie. Formé au beau milieu des eighties, Skullflowers se déclare comme étant une formation noise/drone/rock, tout un programme quoi !
Si vous n’avez pas abandonné la lecture de cette review à la fin du premier paragraphe c’est qu’on est entre amateurs de choses tordues et la suite va vous intéresser : ces lascars ont collaboré dans le passé avec des formations tout aussi cintrées dans des styles assez différents comme les mal meneurs d’ordis fous de Whitehouse et les agités destructeurs de Godlfesh (on nage à des années lumières de la culture dite stoner là).
Musicalement parlant les fans de Boris ou SunO))) devraient assez prendre le panard en se passant les huit plages de ‘Orange Canyon Mind’ qui oscillent entre ambient, électro, drone et trip d’informaticien en évoluant dans une ambiance toujours malsaine. On devine les concepteurs britanniques de cet ovni investi d’une mission que j’ai de la peine à conceptualiser. Je n’ai ni adoré cette œuvre ni détestée d’ailleurs j’ai simplement eu de la peine à pénétrer ce monde 100 % instrumental qui bouscule tous les schémas établis pour jouer dans son monde selon ses propres règles.
 Quel personnage extraordinaire que ce Dandy Brown, venu de l’anonymat le plus total, il débarque avec deux projets qui font fantasmer depuis plusieurs mois les fans de stoner rock de la planète entière : avec le superbe Orquesta Del Desierto, il proposait sa version acoustique hallucinée du all-star band stoner dans toute sa splendeur. Le revoilà qui débarque quelques semaines plus tard à peine, avec un projet vieux de plusieurs années (voir interview), un projet qui alimente les rumeurs depuis longtemps déjà. Hermano est composé de musiciens incroyables, peu connus du grand public mais qui ont pourtant fait leurs preuves : Dave Angstrom est le guitariste des excités Supafuzz et apporte des parties de lead somptueuses ; Mike Callahan était le guitariste des rageurs Disengage et aligne des riffs d’une efficacité et d’une puissance redoutables ; la base rythmique est composée de Dandy à la basse, épaulé de son ami Steve Earle à la batterie, qui a fait les heures de gloire des mythiques Afghan Whigs de la grande époque. Le chant quant à lui est assuré par ni plus ni moins que John Garcia (ex-Kyuss et actuel Unida), que d’aucuns considèrent comme l’un des plus grands vocalistes ayant foulé cette planète, tout simplement, et ce n’est pas à l’écoute de ce joyau que l’on pourrait contredire cette affirmation : le chant de Garcia y est puissant, mélodique et ‘aérien’, comme toujours, probablement à son meilleur niveau (ex-æquo avec le nouvel Unida, qui sortira… un jour !). Ce redoutable rassemblement de fines gâchettes forme ici une entité compacte, un groupe à part entière, et rend mille fois justice à des chansons extraordinaires. Les hostilités commencent par ‘The bottle’, heavy et lancinant en diable, et les morceaux s’enchaînent, tous aussi bons les uns que les autres, pour se terminer par un ‘Nick’s Yea’ qui s’articule autour d’un riff hallucinant, mélange improbable du grand Sabbath Noir et d’un Led Zep légendaire. Impossible de citer ici toutes les chansons (je vais encore me faire taper dessus par la tyrannique rédac’ chef !), mais comment ne pas mentionner les trois minutes de pure furie de ‘Manager’s Special’, ou encore ‘Landetta’, ou bien ‘Five to five’. Chacune des chansons de cet album justifie à elle seule l’achat du CD; procurez-vous ce chef d’œuvre à tout prix !
Amplified Heat est formé par trois frangins (“brother trio” au lieu de “power trio”. OK, la vanne est nulle), les frères Ortiz, originaires d’Austin, Texas. Ce jeune groupe, qui a sorti un seul véritable album en 2004, voit son premier EP re-sortir aujourd’hui, agrémenté de quelques morceaux bonus, le tout constituant une bien sympathique galette.
Musicalement, le groupe se positionne sur une sorte de blues rock sous amphétamines, un hard rock teinté 70’s qui pulse outrageusement (soli et riffs à l’appui, rythmiques syncopées et avalanches de cymbales en sus), mais qui, à la première écoute, ne semble pas casser trois pattes à un canard cul de jatte. Toutefois, au bout de quelques passages en boucle, on est séduit, on appuie sur “repeat” avec un goût de “revenez-y”. On est finalement (fatalement) conquis par ces assauts guitaristiques (soli blues-esques ou breaks à deux doigts du jazz) sur cette basse qui tourne sans fin (délice que ce break impromptu dans “Mornings warning”). Amplified Heat se révèle dans un concept musical qui frise le cliché, car évident : rarement groupe n’a autant illustré la passerelle entre le blues, le rock et le hard rock. Le trio modélise ainsi sur un seul album, en une poignée de chansons, plusieurs chaînons manquants dans l’évolution musicale (et donc plusieurs décennies successives). Et par là même, le groupe fait sens, littéralement.
Mais foin de théorie pour justifier notre plaisir : Amplified Heat se révèle être une découverte rafraîchissante, un groupe que l’on se plaît forcément à écouter quand on aime le bon hard rock, et ses origines, le tout sans jamais, un seul instant, virer dans le passéisme. Une figure de style, et dans tous les cas un exercice réussi.
C’est sur un label espagnol qu’est sorti, il y a déjà quelque temps, ce split cd réunissant deux groupes suédois de stoner qui présentent chacun quatre titres de leur répertoire. Les premiers à nous livrer leurs compositions sont Generous Maria qui évoluent dans un style rappelant tour à tour Led Zeppelin, Black Sabbath et Kyuss. Les compositions qu’ils nous présentent ici vont du rock ‘pur jus’ de ‘Like A Dog With A Frisbee’ à l’envoûtant ‘Brother Pain’, morceau à la structure alambiquée débutant à la limite du doom pour finir dans une débauche hypnotique d riffs venus tout droit des seventies. Avec Skua, le registre s’oriente vers un son nettement plus doom qui m’a nettement moins séduit à l’exception de ‘Blue Temple’, morceau de six minutes passées, qui est nettement en dessus des trois autres titres présentés par le groupe.
 Vieux routier de la scène italienne, le chanteur bassiste et claviériste Paul Chain, aidé par Alex Vasini à la guitare et Danilo Savanas à la batterie et aux percussions nous offre une nouvelle improvisation en deux actes. Il prolonge ainsi la pièce précédente qu’il nous avait livré en 2001 sous le nom de « Sign from space ». Le lien entre les deux disques est évident. On est loin d’un quelconque sabir expérimental. Seul le langage phonétique utilisé par Chain, dont le ton est par ailleurs assez proche de Dave Wyndorf, reste mystérieux. Ce disque nous propulse une fois encore au centre d’une expérience psychédélique particulièrement construite, dont on éprouve quelques difficultés à saisir le caractère non élaboré sur lequel il insiste pourtant dans le livret. Ce qui signifie manifestement que ces gusses sont très balaises. Paul Chain et son équipe comptent probablement parmi les prolongateurs les plus efficaces de l’héritage Hawkwindien. Avec l’énorme avantage de le restituer sous une forme plus épurée et nettement plus cohérente, tout en affirmant sa propre originalité en prenant appui sur un groove stellaire. Ce disque est la confirmation supplémentaire d’un immense talent. Gorgé de spatialité. Totalement hypnotique. Sidéral. Paul Chain EST l’Astroman. L’Aerospatiale et la Nasa l’ont dans le baba. Cool !
Séance de spiritisme du vendredi 4 octobre 2002. Il est 21 h 58. Nous sommes deux. Ma platine disque et moi. Délicatement, je pose mon index sur sa bouche goulue, puis invoque un esprit. Rapport de séance.
Rock’n’roll Sixties Weed Fuzz Psych Wha Wha es-tu là ?
Ouaip !
J’ai comme l’impression qu’y a quelqu’un avec toi, je me trompe ?
Nan, j’suis avec mon pote Govinda Jaya Jaya Gopala Radha-ramanahari Nrsingadeva
Cool ! Et vous êtes où exactement ?
En Norvège mon gars !
Oulala ! Dois pas faire très chaud par là-haut !
On se rend plus bien compte, nos instruments chauffent à mort ici
Vous faites de la zique ensemble ?
La zique qui passe sur ta platine en ce moment… [silence]
Ouais ?
C’est la nôtre ducon !
Déconne pas ! Mais c’est génial ce truc ! Ce mélange de curry, de safran et de sueur, groove terriblement ! Bon, je te rappelle dans la semaine. J’ai un disque sur le feu.
22 h 03. Rupture de communication pour cas de force majeure.
|
|