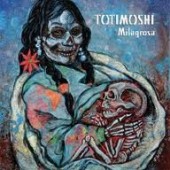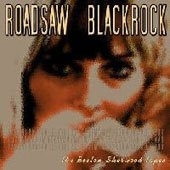|
|
Après avoir longuement occupé la rubrique faits-divers de la presse avec leurs diverses frasques, ces cinq lascars reviennent dans une rubrique dans laquelle ils excellent : celle de la musique. Ce quintette au line up prestigieux : Scott Weiland, ancien changeur de Stone Temple Pilots, Slash, Duff et Matt Sorum respectivement guitariste, bassiste et batteur des mythiques Guns N’Roses ainsi que Dave Kushner, musicien au curriculum vitae impressionnant (ex-Infectious Grooves et collaborations avec Dave Lombardo entre autres) joue un rock énergique un poil heavy ,d’excellente facture, qui n’est pas une copie de leurs participations précédentes. Soigné par une production frisant la perfection, ce disque ne devrait pas arrêter de tourner dans les platines des amateurs de rock au sens large.
 Après un premier split prometteur avec Kyuss, revoilà Queens Of The Stone pour un nouveau split CD. Cette fois-ci, ce sont les Néerlandais de Beaver qui s’y collent. Le split débute par 2 titres proposés par le combo de Josh Homme. Ces derniers sont dans la veine de ceux qui paraîtront sur le premier album éponyme du groupe. Le sympathique ‘The Bronze’, toute guitares en avant, permet à l’homme (je sais, il est facile le jeu de mot) de donner libre cours à tous les excès guitaristiques tandis que l’instrumental ‘These Aren’t The Droids You’re Looking For’ (dialogue tiré de Star Wars) dans un style un peu plus conventionnel nous rappelle étrangement certains volumes des premières Desert Sessions. Bref, que du bon encore une fois.Après ces perles ‘stonagienne’, nos amis de Beaver nous distillent deux titres dont eux seuls ont le secret. Les fans de stoner seront comblés par ‘Morocco’ et son tempo assez planant typique de nos castors. Et que dire de ‘Absence Without Leave’, le plus ambitieux des 2 titres proposés par le combo néerlandais. Cette sublime chanson réunit tous les ingrédients d’un stoner comme on les aime : un son de basse assez hallucinant, des riffs sortis de nulle part et un chant tout en nuance. Bref, Beaver avec ce split, s’impose comme une des références européennes (oserais-je dire comme LA référence) en la matière.Au final, ce split CD, malgré sa durée assez brève (16 minutes à tout casser) est un incontournable pour tous les fans de stoner, et de bonne musique en général.
« J’ai “American Style” de ce groupe mais je me souviens même plus ce que ça donne. »
– Shinkibo, décembre 2006.
« Je viens de m’écouter “Experiment …” et je le trouve un peu chiant. A part le premier morceau très floydien, le reste est très… expérimental et plein de feedback. Le premier ne m’a pas non plus particulièrement marqué mais au moins y’avait des riffs clairement identifiables.»
– Jihem, décembre 2006.
Eh oui, certaines personnes respectables de ce site (qui, j’espère, ne m’en voudront pas de les avoir citées, sinon vous lisez ici ma déjà dernière chronique) éprouvent des lacunes ou montrent un désintérêt scandaleux pour ce que j’estime être l’un des meilleurs groupes signés sur le label à tête de chat. Sans doute parce dans ma fougue juvénile, je reste encore accroc aux amplis chauffés à blanc et à une certaine attitude j’menfoutiste et hargneuse dont le premier but, avant de faire de la musique, est celui de faire du bruit. Heureusement, une autre figure de proue de Desert-Rock est également de mon avis :
« Moi j’aime les (Men of) Porn… »
– Laurent, décembre 2006. (c’est ok boss ? Je peux passer prendre mon chèque ?)
Ce premier album, aux allures plus que douteuses (un leitmotiv pour le colosse Moss) est tout simplement un vivier de riffs heavy, tous plus jouissifs les uns que les autres,. Si vous avez lu mes autres chroniques du groupe, vous savez à quoi vous en tenir, bien que ce premier opus semble plus sage dans ses expérimentations. Nous avons néanmoins droit à notre lot de bruits incongrus et autres manipulations de la saturation mais le tout reste intelligible et son audition ne nécessite pas de s’arrimer à son siège de peur de se faire engloutir dans un magma bouillonnant de boucles sonores .
Ca riffe sec (ou plutôt gras), chaque morceau est un hymne à la guitare, à l’alcool et au laissé aller, la grosse voix éméchée de Moss n’y étant pas étrangère. Certaines intros marquent directement et l’on sent que derrière tout ce son monolithique se masque (pas vraiment en fait) un esprit que l’on retrouve chez les Melvins, celui d’une déconne qui se veut sérieuse, nous empêchant de connaître les véritables intentions des antagonistes : nous rendre sourds ou s’amuser à nous faire perdre pied face à ce déluge électrique.
Depuis 1999, Moss n’a pas changé de trajectoire. Il fait un rock velu, gras, alcoolique (il faut l’entendre roter au début de la seconde version de ‘Ballad of the Bulldyke), joue avec la saturation et même si cette relation semble exclusive, il prend toujours soin de nous laisser une place d’où l’on peut constater que son oeuvre n’est pas si timbrée que ça.
 C’est sans le moindre soupçon de chauvinisme que je me réjouis à chaque fois que la formation suisse-allemande envoie du nouveau son car, à chaque coup, je me prends une bonne baffe et vu que je suis un peu maso, j’en redemande.
Bref, après avoir exploré le stoner sous-toutes ses coutures sur sa précédente production, le groupe bâlois renoue avec ses vieux démons sur ce troisième long format dopé aux amphétamines. A l’image des bolides que le groupe affectionne tant, les douze nouveaux titres du trio sont interprétés à coin et se succèdent de façon fort agréable. Le style pratiqué est toujours à mettre du côté de Monster Magnet, Fu Manchu, Black Nasa et les Hellacopters soit du tout bon !
Bénéficiant d’une production rutilante qui demeure dans la sobriété, cet opus a un rendu proche de ce que le groupe délivre sur scène : un rock énergique sans artifice et extraordinairement bien maîtrisé par ses concepteurs. Les compositions n’excèdent que rarement les quatre minutes et aucun remplissage ne pointe le bout de son tarin sur cette plaque. Bien au contraire : cette nouvelle production recèle de véritables petits chefs-d’œuvres dont ‘Off We Go’, ‘The High One’ et ‘The Future’.
Ces quarante minutes de son s’achèvent en apothéose avec le magnifique ‘Lady From The Sun’ qui est paradoxalement le titre le moins rapide du disque. Cette pépite qui laisse le champ libre à la basse durant une bonne partie des couplets a un refrain qui allie simplicité et efficacité : smpossible de ne pas le fredonner sitôt que le groupe l’attaque pour la seconde fois. C’est carrément la grande classe made in Switzerland !
 Ce groupe a commencé à faire parler de lui après un LP sorti sur Meteorcity, qu’il partageait avec Unida en 1998. Ils n’ont pas changé de direction musicale depuis. On les sent toujours très proches de Kyuss et de Fu Manchu. L’hybride parfait peut être. En tous cas, parmi toute la clique vautours, c’est certainement eux qui s’en sortent le plus brillamment. Tout y est. D’excellents morceaux, un putain de son fuzzy, du rythme et beaucoup d’énergie. Modestes, comme leur titre d’album l’indique, ils se considèrent comme faisant partie de la queue ondoyante de la comète. La comète stoner probablement. Et c’est là où ils se trompent. Kyuss, en s’éteignant, est devenu l’étoile du Berger. Fu Manchu s’est écrasé dans le désert Mojave (pour mieux se relever j’espère). Le cœur de la comète a donc besoin d’un nouveau moteur. Et force est de constater qu’avec un album de cette envergure, Dozer prend une sérieuse option sur le titre de Lider Maximo, de brasier incandescent, dans ce créneau précis. Ce n’est qu’au terme de plusieurs écoutes que l’on perçoit réellement leur personnalité. Ils ne sont certainement pas réductibles au rang de vulgaires plagieurs comme une écoute trop rapide tendrait à le suggérer. Par leur capacité à utiliser intelligemment des influences puisées dans un registre somme toute assez limité, Dozer fait la preuve de qualités certaines, qui, bien négociées risquent de faire quelques dégâts dans notre système solaire. Toutefois, comme l’orbite des comètes est souvent très excentrique, n’attendons pas 76 ans, comme pour la comète de Halley, avant de consacrer celle-ci.
La carrière explosive de Alabama Thunderpussy s’est éteinte trop tôt, et personne n’a repris le flambeau de leur gros stoner heavy bien gras aux relents sudistes affirmés. Leur discret mentor, Erik Larson, nous a gratifié occasionnellement de disques solo tout à fait admirables, montrant que le bonhomme, même s’il savait se fondre dans une dynamique de groupe, en « avait sous la pédale », et se sentait à l’aise avec des compositions de genres tout à fait variés. Mais depuis une demi-décennie, rien. C’est sur ces bases que débarque The Might Could, un groupe qui, comme son nom pourrait le laisser penser, pourrait bien reprendre là où les seigneurs (saigneurs ?) de Richmond, Virginie, se sont arrétés.
Le point le plus remarquable concernant The Might Could est qu’il ne s’agit clairement pas d’un nouvel album solo de Larson : les titres sont homogènes, le son est bien mastoc, le genre musical est cohérent et maîtrisé. Pas de place aux lubies ou aux plaisirs égoïstes : Larson s’est remis en mode « groupe », remisant sa machine à riffs au service de ses trois compères. Finalement, les fans de Alabama Thunderpussy devraient s’y retrouver : Larson au chant use de sa plus belle voix d’écorché vif, servant un stoner sludge lourdingue du plus bel effet. En gros, pensez à ATP qui rencontre Down (cette rythmique bien crade, pas d’ambiguïté, et il y a pourtant plusieurs centaines de miles entre Richmond et la Louisiane !), et glissez-y ce chant mal dégrossi au papier de verre gros grain, ces soli vicieux, et ces rythmiques libidineuses, et vous aurez retrouvé un bout de la recette magique. Aucun hit immédiat, aucun refrain à chanter à tue-tête, mais des morceaux lancinants, des tas de riffs glaireux, le tout pourvoyeur d’infections auditives sévères. Le groupe se frotte même à la power ballad suave (« When the spirits take control »), mais plus proche de la passe à $10 avec option MST que de l’étreinte torride, en gros. D’ailleurs, c’est pour mieux nous en coller un derrière la nuque avec le presque punk « Mad dog blues », voyez le genre de vicieux.
ATP n’est donc pas revenu en selle par le truchement de ce nouveau combo qui fleure bon le stoner sudiste grassouillet, mais c’est pas grave ! Effectivement, même sur un malentendu, découvrir un groupe du calibre de The Might Could, auréolé d’un tel potentiel, s’apparente au minimum à une excellente surprise, certainement pas à une déception. Ni le fruit d’un héritage empoisonné, ni complètement étranger à cette filiation incestueuse, The Might Could est parti pour tracer sa route et, espérons-le, accoucher au passage d’une floppée d’autres galettes de cet acabit.
 Sobrement intitulé Rotor – 2, l’album du combo allemand arbore fièrement un artwork des plus kitsch ne laissant en rien présager de son contenu. Que le premier titre du cd ne vous égare pas non plus sur le reste de l’album qui est en fait majoritairement instrumental (le chant n’est présent que sur deux titres).« On The Run » qui débute l’album nous donne d’emblée le ton et se révèle, déjà, être un excellent titre avec un démarrage direct suivi pas un changement de rythme très bien ficelé. On remarque immédiatement que la guitare au son plus que plaisant va très certainement nous transporter tout au long d’un album qui s’avérera être une agréable surprise. Les guitares, de part le traitement accordé à cet instrument, sont particulièrement mises en avant, un peu comme Yawning Man même si c’est certainement là le seul point commun. « Auf Der Lauer », second titre, en est le parfait exemple avec un jeu de va et vient sonore entre deux guitares qui sonnent à merveille. Là encore, le changement de rythme est bougrement efficace et je dois dire qu’étant amateur de ce genre de pratique je me régale totalement. Le troisième titre, « supernovo » se base sur la même alchimie tout en évitant les redondances, assurément un excellent morceau.Loin de moi l’idée de détailler chaque titre car ma foi, je préfère tout de même vous laisser la surprise de les découvrir par vous-même. Sachez tout de même que les compliments que l’on peut faire sur les trois premiers titres ne seront à aucun moment atténués et ce tout au long des 43 minutes de cette galette. Un album qui évite les longueurs et qui sera sans aucun doute convaincre les plus réticents d’entre vous quand aux bienfaits que peut apporter l’absence de chant si celui si s’avère en fait superflu.
La recrudescence de groupes instrumentaux depuis quelques années est à mon avis une bonne chose car cela nous apporte du sang neuf, une diversité que l’on ne retrouve pas forcément chez les autres. Les membres de Rotor peuvent s’enorgueillir d’avoir placer la barre assez haute et espérons qu’ils rencontrent le succès que mérite un album tel que celui là. Mais c’est en cela que réside le plus dur combat des groupes instrumentaux, genre encore trop souvent boudé par le public, à tord j’en suis convaincu.
House Of Broken Promises (HOBP pour les intimes) a commencé comme un passe-temps, un échappatoire aussi de la part du binôme le moins célèbre des mythiques Unida : alors que les fans se focalisaient sur la paire Kyuss-ienne du combo (Garcia & Reeder), Mike Cancino et Arthur Seay ont vite trouvé en HOBP un vecteur parfait pour continuer respectivement à marteler les fûts et abattre les riffs pendant les périodes « off » de Unida. Grand bien leur en a pris : gagnant progressivement en maturité, le trio californien s’est développé là où Unida est devenu un tas de cendres, et le groupe abat le bois aujourd’hui sur la route avec une renommée croissante.
Les premiers rondins ne tardent pas à tomber et avec un furieux « Blister », HOBP introduit en force un album chargé de plusieurs bombes du même tonneau. Avec des riffs joués « à la Zakk Wylde », et des passages aussi furieux que les regrettés Alabama Thunderpussy, ce titre annonce une rondelle qui ne va pas s’arrêter en si bon chemin. « Obey The Snake » qui prend la suite est sympa, mais lorgne franchement trop sur AC/DC pour être apprécié en totalité. Passons rapidement pour se consacrer à une poignée de titres qui remontent bien haut la barre du stoner metal incandescent, un hommage vibrant aux plus furieux combos du genre, sans concession mercantile (belle prouesse). « Justify », « Broken Life », « Walk on by », « Ladron », les titres les plus furieux défilent , portés par une rythmique au taquet : Eddie Plascencia n’a pas la grâce über-heavy de Scott Reeder, évidemment (quoique, « Buried Away » est soutenu par un son ronflant que l’ancien bassiste de Kyuss n’aurait pas renié), mais il suit les frappes de mules effrénées de Cancino avec une belle efficacité. Et le bougre abat un boulot remarquable derrière un micro, où ses vocaux légèrement rocailleux font mouche, crachant ses glaviots furieux sans retenue. Arthur Seay portait clairement le son de Unida, et cela s’entend ici : véritable MVP de cette galette, l’homme est partout, et assure sur tous les fronts, qu’il s’agisse de ses riffs impeccables, de ses rythmiques acérées, de ses soli parfaits (un paquet ! C’est assez rare pour être noté). Il est présent à tous les étages, si bien qu’on a du mal à penser que le trio ne comporte qu’un seul guitariste.
HOBP a trouvé avec Small Stone un hôte impeccable pour sortir sa première galette. Un premier album qui rend enfin « tangible » ce groupe qui jusqu’ici ne paraissait pas dépasser le stade de second couteau. Belle erreur d’appréciation : HOBP accouche d’un brûlot jouissif, fun et décomplexé. Le genre abordé, un gros metal aux relents stoner assumés, fait mouche et surtout détonne dans un paysage musical parfois trop formaté. Après plusieurs écoutes, le plaisir est toujours là, et on est rassurés, car on en attendait beaucoup, forcément.
Deux ans après ‘Vast Active Living Intelligence System’, Valis revient avec son rock’n’roll psychédélique. Les rythmiques sont plombées, les vocaux aériens et les guitares distordues. Emmené par les frères Conner, ce qui à sa genèse n’était qu’un side project dans le sillage de formation comme Mudhoney ou les Screaming Trees, s’est mué en un véritable groupe développant sa propre identité à quelques encablures du mouvement dont les plus connus des membres présents et passés sont issus. Après avoir ouvert pour des groupes mythiques au sein de la communauté stoner comme Fu Manchu ou Qotsa il serait temps pour ce groupe, qui n’est pas sans rappeler Nebula, de rencontrer enfin le succès qu’il mérite. Jetez une oreille sur ‘Voyager’ et laissez-vous entraîner par l’excellent groove de cette formation.
Wow. J’avais vaguement entendu parler de ce groupe français (oui, FRANCAIS) il y a quelques mois (années ?), et les avais classé connement dans la rubrique “groupe français à surveiller, potentiellement intéressant s’ils arrivent à décoller”. Imbécile. Manifestement j’étais passé à coté de quelque chose de très impressionnant. Je ne connais pas, donc, leur 1er maxi, mais ce nouveau skeud (un maxi aussi, selon eux, mais 6 chansons de cette qualité et longue comme ça, ça vaut bien une douzaine d’albums médiocres !) est une bombe.
Déjà, un quintette qui entame un album (ne chipotons pas, c’est bien un album) par un instrumental de 6 minutes a manifestement des testicules en béton armé. Faut oser. Surtout que c’est du tout bon. Le morceau suivant est assez axé metal (surtout avec ses “shreds” typiques Pantera), mais ses soli rutilants et ses breaks lents et graves le positionnent nettement dans la nébuleuse stoner. Une orbite musico-stationnaire qu’ils ne quitteront plus !
Le chant, trop “extrême”, pourra en rebuter quelques uns (c’est un peu mon cas, je dois l’avouer, c’est pour moi le seul point faible de cet album) : ça gueule beaucoup, ça beugle même, et c’est trop linéaire pour mettre vraiment en relief le travail musical de ces gars fort talentueux… En gros, le groupe se positionne de ce fait comme le pendant français de Alabama Thunderpussy : un groupe proposant une richesse musicale rare, masquée derrière un chant qui peut lui faire parfois de l’ombre…
L’avant-dernier morceau, un autre instrumental, finit d’ailleurs d’entériner cet état de fait : un pur délice musical, épique, bien construit, posé, modeste et audacieux à la fois. La reprise de “The Last Rebel” de Lynyrd Skynyrd qui clôture la rondelle finit d’emporter le pompon : pleine de feeling et de subtilité, le chant rocailleux se met cette fois plus au service de la chanson, et le groupe force à la conviction.
Un vrai morceau de bravoure que cet album, et au delà du fait que le groupe soit français, il se situe à un niveau de qualité qui le positionne franchement dans les meilleures productions internationales du genre. En toute honnêteté.
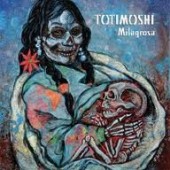
J’avais distraitement entendu quelques titres de ce groupe il y a quelques années, sans y préter, mea culpa, un énorme intérêt. Je l’avais un peu rapidement catalogué clone Melvins-ien aux relents heavy limite sludgiens. Quelle surprise de les retrouver quelques années plus tard avec un album si “mûr” !
Amateurs de sons chauds et lourds, vous resterez un peu sur votre faim ici. Le trio se concentre sur l’essentiel – à savoir ses compos – et allège son son par la même occasion. La prod, propre et claire, est encore une fois le produit de ni plus ni moins que Page Hamilton, légendaire leader de Helmet (qui les a un peu pris sous son aile). Un peu plus fouillé et diversifié que Helmet, justement, le son produit par Hamilton est impeccable, ce qui permet à Totimoshi de se faire plaisir, et de varier les plaisirs sans entrave : passant du gros metal stonerien aux morceaux acoustiques, s’essayant aussi aux power balads et aux titres plus rock, tendance rock indé, avec toujours une grande réussite. Ca groove bien, ça joue bien, c’est original et on ne s’ennuie pas.
En revanche, je regrette quand même de ne pas trouver plus “d’aspérités” sur ce disque : tout est propre, carré, parfaitement joué, les compos sont finement ciselées… mais c’est trop beau pour être honnête, ça manque d’urgence, de fureur, de matière brute. Ceci en toute subjectivité évidemment ! Car au final, tout amateur de gros rock devrait prendre son pied avec cette galette.
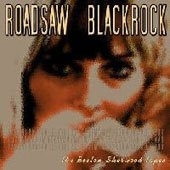 Autant l’avouer d’emblée. ROADSAW et BLACKROCK sont des groupes dont la fréquentation discographique ne m’avait pas convaincu jusqu’à présent. Pourtant, à l’écoute de ce split CD il me faut réviser ce jugement. ROADSAW tout d’abord. Le son qui accompagne le riff de guitare qui ouvre « Busted monk » est absolument grandiose. L’idée que je me fais d’un sonde guitare. Sale, gras et sacrément compact. Le développement qui s’en suit est à l’image du son. Un très bon morceau de rock’n’roll. Puis arrive LA surprise. Une cover de « Where is my mind ? » des PIXIES. Et là, c’est l’apothéose. Riggs, le chanteur atteint des sommets. Il se révèle époustouflant. Franck Black l’à dans le cul. Grave. Le morceau est aménagé de telle manière que les PIXIES apparaissent explicitement pour ce qu’ils ont toujours été. Une soupe à l’eau sans saveur. Les ROADSAW ont magnifié cette fadeur. Réellement touchés par la grâce. Dans leur laboratoire, tels des Jésus, ils sont parvenus à maîtriser la transsubstantiation. Tout simplement superbe. Le morceau fini sur un discret et évanescent clin d’œil à LED ZEP. Quel talent ! BLACKROCK maintenant. Un son toujours aussi faiblard. Un morceau découpé en trois parties, rapide, lourd et jazzy, qui ne parvient pas à m’émouvoir, cède la place à une nouvelle cover. « Indian Rope Man », fantastique morceau datant de 1969 que l’on doit à JULIE DRISCOLL, BRIAN AUGER & TRINITY. Très proche de l’original, le morceau est rondement mené. Excellemment interprété. Espérons que les BLACKROCK sauront s’inspirer de ce groove chaleureux pour la suite de leur carrière.
 Ça commence avec une petite ritournelle tristounette de rien du tout. Dès le deuxième morceau on se dit qu’elle représentait l’antichambre de l’enfer. On est tout de suite stupéfié par la massivité du son qui se trouve être au moins, sinon plus heavy que celui d’Electric Wizard sur « Dopethrone ». Ça vous cause ? Ecrasement total. Seuls quelques rares breaks et échappées acoustiques permettent d’atténuer brièvement la pression que nous infligent ces trois ricains. Révélation. Ce disque est une méthode de préparation subliminale aux conditions de vie orbitales. Tout devient clair. Les ricains ont effectivement prévu de bousiller la planète. Comme ils ne peuvent pas envoyer tous leurs ressortissants en stage dans la centrifugeuse de la Nasa avant de quitter définitivement la Terre dans les fusées qu’ils font construire par les enfants thaïlandais, ils ont demandé à Warhorse de travailler pour eux. En loucedé. Ces agents-doubles proposent ainsi une musique proche de celle de Grief, Sleep et Cathedral pour préparer les doom addicts « à l’insu de leur plein gré » (selon une formule devenue célèbre). Ce qui signifie également que seuls les fans de doom seront sauvés de l’Apocalypse. Heureux ceux qui liront cette chronique. Heureux ceux qui achèteront ce disque. Une preuve supplémentaire ? Vous pensez que le son de basse flangérisé a été réalisé en studio ? Détrompez-vous, il ne s’agit de rien d’autre que des premières navettes spatiales ayant décollé pendant l’enregistrement.
 1968. San Francisco. Après s’être épanoui dans un climat de contestation politique, de sexe à gogo, d’usage effréné de drogues, le mouvement flower power se vautre dans le sordide : Haight Ashbury, bastion hippy, désormais sous l’emprise de la pègre, des rites sataniques, des émeutes, vit ses dernières heures. La chimère d’un monde de liberté totale s’évanouit définitivement. C’est dans ce contexte socio-politique qu’arrive « Vincebus Eruptum». Pure déflagration sonique d’un trio nommé Blue Cheer. Les adorateurs de Bob Dylan en furent pour leurs frais. Larsen, fuzz, cris, agressivité, provocation, énergie. Le négatif parfait des hippys. Black Widow a eu la géniale idée de leur rendre hommage pour payer son tribut aux pères du hard rock. On ne saurait les en blâmer. Au contraire. L’objet est sublime. On y retrouve encore la touche Malleus pour la pochette. 15 groupes pour 16 reprises. Toutes sont magnifiques (hormis celle des pénibles Rise and Shine). La grosse majorité des groupes ne touche pas aux versions originales et les jouent souvent avec ce son sec et âpre, caractéristique des albums de l’époque : Pentagram (qui a l’avantage d’ouvrir et de fermer le disque), Internal Void, Thumlock, Fireball Ministry, Norrsken, Wicked Minds, Space Probe Taurus, Drag Pack, Vortice Cremisi. Et il y a les audacieux qui se laissent aller à des aménagements assez libres de certains morceaux : Hogwash et son « Magnolia Caboose Babyfinger » superbement planant (je vous conseille également l’adaptation libre qu’en font Mudhoney) ; les argentins de Natas et leur desert sound délicieusement chaleureux, presque pop ; Garybaldi, une sorte de Hendrix italien qui s’est reformé pour l’occasion : très, très bien ; Standarte qui signe LA reprise de ce tribute : « Sandwich » qu’ils transforment en un monument de groove rock plus qu’exaltant ; Ufomammut qui a opté pour « Peace of Mind », morceau qu’ils réussissent à rendre longuement psychédélique avant de revenir au heavy style qu’on leur connaît en fin de morceau. Je confesse apprécier par-dessus tout les groupes qui innovent à partir d’un morceau original. En quantité, ce sont donc encore une fois les italiens qui se montrent les plus entreprenants. En somme, ce tribute est un must absolu par sa qualité historique et les possibilités qu’il ouvre à tous les stoner rockers du monde en tant que source d’inspiration infinie. Totalement indispensable, ce disque est une forme d’avenir.
 Le mythe est de retour. Matt Pike génial guitariste de feu Sleep déboule, oui déboule avec son nouveau groupe : High on Fire. Toujours sous la forme d’un trio, Matt, en plus de la guitare, est passé au chant. La production a été dévolue à ce maïeuticien sonore qu’est Billy Anderson auquel on doit les albums de Sleep et certains Melvins. Une fois de plus, il a réussi à capter l’énergie vraiment brute que distillent les trois terroristes qui composent High on Fire. L’atmosphère qui se dégage de ce disque est réellement terrifiante. Sombre et écrasante. Presque barbare. Médiévale c’est sûr. A l’image du Prince Noir qui figure sur la pochette. Fils aîné du Roi d’Angleterre Edouard III alors que le pays connaît de graves troubles religieux, sa vie a été marquée par les débuts de la guerre de Cent Ans et la Peste noire. Ne vous attendez pas à entendre du dulcimer ou de la vielle à roue ici. Les instruments sont 100 % rock’n’roll. C’est l’utilisation qui en est faite qui renvoie au Moyen-Age. « Blood from Zion » est particulièrement caractéristique de cette ambiance guerrière. On y entend les anglais fondre avec fracas sur les français dans le tumulte des fers qui se croisent, embrochent, mutilent. Le grandiose « Baghdad » qui ouvre l’album me semble raconter la fureur dévastatrice de Tamerlan qui ravagea sanguinairement la Mésopotamie après que les Mongols l’aient mise à sac quelques années plus tôt. Si un cinéaste décidait de mettre en scène cette époque agitée pour en tirer un film, High on Fire ferait avec cet album la bande son parfaite. Si ce disque peut par certains aspects foutre la trouille, nul doute qu’il fasse à son tour de terribles dégâts dans la mouvement stoner. Comme la peste, il se répand de manière pandémique et frappe. De disque aux vertus historiques, il devient fait historique. La Peste noire était venue d’Asie centrale. Après s’être tapie au fond des bois pendant près de 700 ans, la voici qui réapparaît, venue d’Oakland en Amérique. Si Albert Camus était toujours vivant, sûr qu’il en ferait l’éloge de cette peste-ci.
|
|