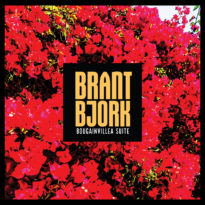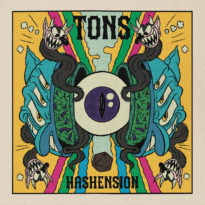|
|

Les Texans de Warlung affutent leurs armes depuis 2016, ce quartette signé depuis désormais deux albums chez Heavy Psych Sounds Records joue la carte du Hard rock doomy et explore diverses facettes du psychédélisme. Ils ont sorti cette année leur quatrième production, Vultures Paradise qui promet si l’on en croit les précédents opus d’être un bon cru.
Difficile jeu d’équilibriste que de s’essayer au doom old school. Risqué de ne pas sombrer dans le cliché du heavy grandiloquent où sonnent les soli luisants de sueur aux touffes de cheveux permanente. Néanmoins Warlung en s’aventurant dans ces contrées évite systématiquement le faux pas comme le prouvent “Hypatia” ou encore “Return of The Warlords”.
La maîtrise est là, les instrumentistes s’ajustent entre eux sans provoquer l’ombre d’un sourire narquois chez l’auditeur. Vultures Paradise c’est 43 minutes d’un objet musical soigné qui convoque l’épique sans lui laisser toute la place et le mélodique sans jamais oublier de le saturer sans excès comme lors du dernier tiers de “Sky Burial” ou de “Grave Marauder”.
A certains moment le doute pourrait étreindre celui qui s’arrête sur les compositions de Warlung, sommes-nous encore réellement dans le domaine du doom, est ce qu’ils ont bien leur place ici ? A ceux-là je répondrais qu’il faut aller fouiller dans “Cavemen Blues” tant la piste sent la poussière des portes du désert ou de chercher dans “Worship The Void” les passages les plus psyché qui s’ajustent autour de ceux les plus agressifs pour se convaincre que les américains sont pleinement légitimes.
Une fois de plus Heavy Psych Sounds Records ne s’y était pas trompé en signant Warlung en 2019, le label porte en son sein un de ces groupes au savoir-faire certain qui sait se risquer sur des chemins semés d’embûches sans jamais se prendre les pieds dans le tapis. Vultures Paradise fera le bonheur des amateurs de proto metal 70’s comme des gourmands de la vague hard rock du début des années 80 sans pour autant bouder le plaisir les aficionados de la culture stoner rock. Une plaque complète qu’il convient d’aborder ne serait-ce que pour culture.

Après un seul LP et une paire de EPs, Gaupa se retrouve signé sur le prestigieux label Nuclear Blast (Earthless, Graveyard, Hangman’s Chair, Blues Pills, COC, Green Lung, Khemmis, Lucifer, Orchid, Pallbearer… oui, rien que ça). On peut le critiquer autant que l’on veut, le label a le nez fin dès lors qu’il s’agit de trouver des groupes à potentiel, en développement (la moitié des groupes de la liste ci-dessus, en gros), et il a donc jugé que ce que notre petit public de niche apprécie depuis plusieurs années chez les suédois était de nature à plaire à un plus large public. Alors, bonne pioche pour Nuclear ?
A l’écoute de ce premier album, déjà on peut dire qu’il n’y a pas mensonge sur la marchandise et que Gaupa fait du Gaupa : à savoir un heavy rock bien construit, pas si “retro” que ça (ceux qui classent directement le groupe dans l’aéropage “retro rock” en droite ligne des 70’s font quand même un raccourci un peu facile), très mélodique, sur lequel vient se greffer le chant incroyable de Emma Näslund. La vocaliste délivre encore une fois une prestation vocale qui transcende la musique du quintette : piochant dans un registre atypique (pour notre style musical de prédilection), quelque chose entre Bjork (beaucoup) et un peu de Stefanie Mannaerts (de Brutus), Näslund est le point d’attraction majeur de chaque plage. Est-ce à dire que les quatre instrumentistes font de la figuration ? Evidemment non, et la production, impeccable, même si elle met évidemment le chant en avant, sert efficacement la valorisation de tous les instruments.
Côté style, on est donc dans quelque chose de sympathique, pas fondamentalement original, mais pas non plus trop balisé. Le juge de paix c’est donc les compos, et là, on est globalement aussi dans du positif. On note en effet du très bon (l’efficace “Exoskeleton” et son très gros riff en ouverture, le mid-tempo “Moloken” et son break puissant qui balance un blast beat venu de nulle part, le lancinant “Ra”…) mais aussi du plus dispensable (même si bien fichu et accrocheur, “Elden” ennuie un peu sur la longueur, “My sister is a very angry man” semble n’aller nulle part…). Il en va de même du final sur “Mammon”, un beau bébé de plus de sept minutes qui souffle le chaud et le froid…
Globalement, on est quand même sur une belle pièce, un disque efficace et riche, qui montre un visage mature de Gaupa. Myriad a le potentiel, par le truchement de la signature sur une “petite major”, de leur permettre de se faire connaître au plus grand nombre, ce qui serait mérité, au vu de leur parcours mais aussi du disque lui-même. Et même si cela ne se réalisait pas, au moins l’ami Jo Riou, heureux homme qui signe encore une fois leur artwork, pourra prendre des bains de billets, vu ce que doit rapporter une pochette d’album chez Nuclear Blast !

Depuis plusieurs mois la hype se développe autour de ce projet de Marc Urselli, annoncé comme construit autour de guests qui nous ont donné l’eau à la bouche : Matt Pike, Steve Von Till, Wino, Lori S., Dave Chandler… N’en jetez plus ! Pas vraiment un activiste de la cause doom/stoner, Marc Urselli est plutôt connu comme un technicien d’enregistrement réputé que comme musicien. Par ailleurs son champs d’action est plus orienté sur les musiques “de niche” (pour des objectifs de marketing son nom est souvent associé à des artistes comme U2, Elton John, Foo Fighters, Luther Vandross, Jeff Beck… mais au delà de quelques chansons enregistrées avec ce type d’artistes, il se consacre plutôt à des albums de musiciens jazz, avant-gardistes, expérimentaux, folk…) et on ne l’avait pas vraiment entendu exprimer son intérêt pour les musiciens de la sphère doom / rock / metal…
SteppenDoom, donc, que l’on traduira volontiers par “Doom des steppes”, est issu d’un concept aussi saugrenu que (pourquoi pas) intéressant, visant à méler les univers musicaux de musiciens de doom metal avec ceux de chanteurs indigènes spécialisés dans le “chant de gorge” traditionnel. Cette technique très particulière est particulièrement répandue dans les territoires nordiques de l’Asie ou de l’Amérique, par les Inuits par exemple, les mongoles, etc… Les esthètes du doom ne sont probablement pas étrangers à cette technique de chant, déjà pratiquée sous sa forme diphonique par Gentry Densley de Eagle Twin, par exemple. Bref, le concept est là, mûr et affirmé, reste à en apprécier la réalisation et l’intérêt musical.
En tant que disque, SteppenDoom défriche donc un territoire musical absolument vierge (chez Eagle Twin, le chant diphonique est occasionnel, au service d’un album de doom metal, donc pas la même intention qu’ici). Musicalement, l’objet est difficile à décrire, a fortiori car chaque titre est très différent l’un de l’autre. On passe de morceaux effectivement plutôt doom (“Garuda Khuresh”) à des titres de pure émanation ethnique (“A-dkar Theg Pa”) en passant par toutes les strates de plans expérimentaux noise/bruitistes et de drone. Les différentes nuances de chant apportent un surplus de relief à chaque titre, allant du traditionnel diphonique jusqu’aux divagations gutturales les plus glauques (plus souvent qu’à son tour on pensera à certains titres de Sunn-o))) interprétés par Attila Csihar).
Même si Urselli, multi-instrumentiste, assure la base musicale commune de tous les titres, c’est bien sur ses guests prestigieux que la rumeur autour du disque s’est développée. Dans les faits, les contributions sont très hétérogènes, mais ont pour point commun de rarement apporter ce que l’on aurait pu de prime abord imaginer (espérer ?). Matt Pike vient apporter quelques lignes de guitare au milieu de ce concours de dissonances mélées d’open chords graveleux en fond de “Etuken Eke & Od Ana”. Pas de quoi émoustiller quand même les groupies les plus fanatiques. Autre contribution très attendue, le riffing de Lori S. d’Acid King sur “Sedna and Eliduc” ne trahit pas trop son origine, avec un son de guitare qui ne rappelle pas vraiment le trio doom de la bay area. Aaron Aedy (Paradise Lost) apporte lui quelques leads et riffs un peu plus construits sur “Garuda Khuresh”, tandis que Johannes Persson (Cult of Luna) de manière assez prévisible contribue à l’ambiance lente et poisseuse de “Agloolik Igaluk” avec notamment son riff joué quasi ad lib pendant plusieurs minutes. La contribution de Steve Von Till (Neurosis) est plus surprenante, sur “Tamag and Ocmah”, un titre très lent et à la rythmique répétée à outrance, qui ne dénoterait pas dans la discographie de Earth. Quant aux contributions de Wino et de Dave Chandler (Saint Vitus), elles sont d’ordre plus “bruitistes” que réellement musicales, et viennent se noyer dans ce “A-dkar Theg Pa” de 33 minutes (!!), une plage sans relief qui vient étirer son ambiance ethno-contemplative en déroulant quasiment la même séquence sonore, seulement perturbée parfois par une lointaine ligne de feedback de guitare, de voix distantes, de percussions saugrenues… A noter que ce dernier titre ainsi que “Sedna and Eliduc” (avec Lori d’Acid King) ne figurent pas sur le vinyl, mais seulement dans l’édition collector (50 eur en CD, 100 eur en vinyl…).
C’est à l’aune de son objectif que l’on doit évaluer le projet SteppenDoom. Le discours promotionnel autour du disque met en avant la dissonance culturelle et les origines antagonistes entre ces musiques traditionnelles et le metal… nous n’irons pas sur ce terrain là, un peu “capillo tracté”. Si l’objectif est de faire découvrir le chant de gorge à travers certains de ses plus emblématiques interprètes dans le monde, l’objectif est atteint : rendre accessible à un public plus large cette technique musicale si particulière (et adaptée à tant d’ambiances et de contextes) est louable et intéressant. Si votre objectif est d’écouter un bon disque de doom, doté de riffs lourds et gras, vous ne trouverez pas vraiment votre bonheur dans ce disque. Si en revanche vous n’êtes pas hermétique à l’expérimentation musicale tendance “bruitiste”, que l’avant-garde musicale poussée dans ses retranchements vous intéresse, au détriment de la simple musicalité parfois, ce disque pourrait vous plaire.

Witchfinder c’est un peu le Electric Wizzard à nous autres français, ils ont fait école dans la lenteur la plus crasse et la lourdeur la plus poisseuse avec toujours une touche de chant pour mettre le tout en lévitation leurs compos. La séduction effectuée par le trio porte ses fruits en 2019 avec Hazy Rites et la hype autour de ce groupe ne cesse de grandir depuis. Pour son nouveau cru, la formation de Clermont-Ferrand s’adjoint les services d’un clavier qui vient ponctuellement garnir les pistes de ce nouvel opus, Forgotten Mansion signé (Gage de qualité made in France) chez Mrs Red Sound.
Au global l’écoute de la plaque s’avère plutôt agréable, on ne navigue certes pas hors des eaux territoriales d’un doom sludge bien poncé par les générations précédentes mais les riffs font mouche et la voix plaintive de Clément donne toujours un souffle de fraîcheur aux composition du guitariste Stan et du batteur Tom, pourtant collantes comme la glaise aux bottes du promeneur égaré aux dernières heures du jour.
Le sentiment que le thème de “Marijuana” demanderait un peu plus de papier de verre sur la voix, pour que cela sonne crasse et sludge comme un Bongzilla ne tient qu’à la première écoute car lors de la reprise de ce thème en fin de titre, les voix en chœur quittent l’éther pour devenir braillarde et enfoncer les pieds de l’auditeur dans la boue et alors les riffs martelés finissent de le clouer dans le sol pour mieux permettre au chant de limer les oreilles avec ce sludge tant attendu. A croire que les gonzes avaient prévu leur coup et savent ménager l’auditeur en lui donnant à point nommé ce qu’il attend. “Lucid Forest”, axe central de la plaque rejoue l’entourloupe des précédentes plaques et ne quitte pas ce qui avait fait l’atout du groupe jusqu’alors, lancinance du chant sur fond de grattes aussi détendue qu’après un spliff de 30cm.
C’est dans cette même piste, “Lucid Forest” que la nouvelle touche clavier vient apporter un rien d’horrifique que l’on ne peut qu’adouber tant il vient renforcer l’esprit du groupe sans s’imposer comme un phénomène de foire qu’il faudrait absolument promouvoir. Kevyn trouve donc sa place naturellement et ajoute au désormais quartette un souffle de mise en scène tout en pondération particulièrement palpable sur “Ghost Happen To Fade” et ne dénaturant pas “The Old Days” alors qu’il aurait été si facile de faire glisser cette dernière piste vers le mielleux ou le lourdingue.
Je n’ai jamais été des premiers fans du groupe, écoutant Witchfinder de loin en loin j’ai toujours trouvé leur doom agréable et entrant dans les catégories de ce que j’aime le plus dans ce style précis. Forgotten Mansion ne fera toujours pas de moi leur groupie, cependant j’admets qu’il y a avec cet album un nouveau palier de franchi et qui les rapproche quand même un peu plus de mon centre d’intérêt profond. D’un point de vue plus générique, il est à parier que les habitués du groupe trouveront à se réjouir de l’œuvre et fonceront pour acquérir l’objet sous quelque forme que ce soit pour enfin le dévorer à répétition car il semble difficilement altérable.

L’histoire de Candlemass s’est chapitrée au rythme des péripéties de leurs chanteurs. Entre périodes fastes et grandes instabilités, la carrière des suédois est telle que l’on trouve aujourd’hui autant d’adorateurs de Messiah Marcolin que de fanatiques de Rob Lowe et tous ou presque s’accordent à dire le plus grand bien de Johan Längquist, chanteur de session ayant donné sa coloration épique au premier album du groupe, Epicus Doomicus Metallicus, en 1986. Son retour pour The Door To Doom (2019) s’étant fait dans les conditions particulières d’un départ précipité de Mats Levén, il n’a de nouveau pas pu laisser une réelle empreinte sur des titres qui étaient déjà tous enregistrés et c’est en cela que Sweet Evil Sun, le 13ème album de Candlemass se révèle unique. Le timbre de Längquist marque immédiatement (existe-t-il encore beaucoup de vocalistes de sa génération à ce niveau ?) mais ce sont les thématiques des chansons qui interpellent. Le champ lexical du doom est ici mis au service des inquiétudes de notre temps : « Sweet Evil Sun » et son texte aux relents amers, dans lequel on peut presque projeter quelques questionnements climatiques, donnent le ton à un album par ailleurs dans la droite lignée de ce que Candlemass a toujours produit. Si quelques invités apportent un peu de profondeur (Jennie-Ann Smith d’Avatarium sur « When Death Sighs », le réalisateur Kenneth Anger sur « Angel Battle »), rien ici ne sort pourtant du cahier des charges que Candlemass a défini il y a bientôt 40 ans : le riff de « When Death Sighs » invoque immédiatement Black Sabbath, « Wizard of the Vortex » s’installe confortablement dans la lignée de ce que fait Candlemass depuis toujours et le rampant « Goddess » amène aussi son lot de lourdeur.
Ce nouvel album de Candlemass aurait pu être un simple album de plus, un bel ouvrage d’un groupe admirable mais en fin de carrière s’il ne renfermait pas en son sein un banger comme peu en ont proposé cette année. Car au final c’est le surprenant « Scandinavian Gods », avec sa batterie portant le morceau, son riff de mammouth et son refrain immédiatement adopté, qui reste en tête et devrait, espérons-le, intégrer les setlists du groupe. Cocasse lorsque l’on sait que ce mid-tempo aux allures d’hymne à chanter le poing levé, est un morceau que le groupe a rajouté à la dernière minute. Comme « Solitude » en 86, comme « Paranoid », comme « Smoke Of The Water », n’est-ce pas là l’histoire du heavy metal finalement ?
Point vinyle :
Alors que les prix des vinyles s’envolent, Napalm Records garde les pieds sur terre et propose pour Candlemass une box (triple vinyle, livre, démo de « Scandinavian Gods », patchs et autres goodies) pour 70 euros, une édition jaune comme un soleil diabolique à 29 euros et une noire, simple, pour 23 euros. Le choix est donc avant tout une question de prix.

Half Gramme of Soma (HGOS) est de ces trop nombreux groupes à avoir produit un stoner énergique et bien tourné au travers desquels nous sommes passés ces dernières années. En effet, le quintette peut s’enorgueillir d’avoir sorti son quatrième album et de gagner en visibilité grâce à une signature chez Sound of Liberation. Passons donc à l’écoute de Slip Through The Cracks, nouvel album des athéniens de HGOS.
Un album qui ne manque pas de convictions. Il est toujours presque trop tentant de rapprocher les groupes de la scène grecque entre eux et bien que voulant totalement évacuer ce poncif il est impossible de ne pas trouver une filiation sur “Voyager” ou “High Heels” avec 1000mods notamment dans le chant qui pousse ses phrases et vagues rauques successives et le délié des grattes. Au fond rien d’étonnant lorsque l’on connaît la proximité des deux groupes et la participation flash de John de 1000Mods au précédent album de HGOS. Pour autant c’est un fait insuffisant pour parler de Slip Through The Cracks qui ne renie pas l’approche classique stoner des précédentes plaques comme le prouve le titre “Wounds”.
En première intention tous les titres ne font pas l’unanimité, “Magnetar” débute sous forme de balade prenant le risque de perdre l’auditeur avec cette introduction un peu molle mais au fil des écoutes on s’attarde plus volontiers sur les ronflements d’une basse classieuse, soutenue par des gémissement guitaristiques qui n’ont franchement rien de désagréable. Si l’expérience est renouvelée sur le pont de “Mind Game”, les titres de Slip Through The Cracks sont assez remarquables d’équilibre dans leur ensemble et aucun des musiciens ne vient tirer la couverture à lui, y compris lorsque l’esprit du groupe divague vers les planantes sonorités orientales de “Sirens” qui une fois de plus devront passer le cap des écoutes successives pour finir par n’être considérées que comme anecdotiques et insuffisantes pour blâmer tout l’album.
Half Gramme of Soma change passablement de cap avec cette nouvelle production. Slip Through The Cracks reprend le stoner brut de ses précédents albums pour le polir avec des outils consensuels et le transformer en un objet inscrit dans son époque et son aire d’influence. Si l’on n’obtient pas un monument d’originalité au final il serait quand même dommage de passer à côté de ce boulot maîtrisé et joliment fait.

Si l’on devait identifier des bassins géographiques plus propices que d’autres à chaque genre musical, la Norvège ne serait probablement pas le premier pays qui viendrait à l’esprit concernant le stoner tendance psyche. C’est pourtant le terrain d’opérations de Dune Sea, jeune trio qui nous propose avec ce Orbital Distortion son déjà troisième album, toujours chez les discrets mais valeureux All Good Clean Records.
Inutile de vous embarquer dans des circonvolutions ampoulées ou un développement de chronique laborieux et finalement un peu stérile, on va plutôt faire direct : ce disque est probablement l’une des galettes de stoner psych les plus enthousiasmantes de ces derniers mois. Rien que ça. Et pourtant, on en voit passer un certain nombre… Dune Sea propose 8 plages fort bien troussées, mélodiquement abouties, d’une musique proposant les caractéristiques principales du psych rock (rythmiques à tendance hypnotique, envolées propices aux jams,…) mélées à un stoner rock d’école (du riff, de la saturation, du groove). L’alchimie est bonne, l’hybridation réussie. Un peu le meilleur des deux mondes. Le trio se distingue surtout par la profusion d’idées qui parsèment sa galette : sans être toutes ébouriffantes d’originalité, elles apportent toutes quelque chose d’intéressant à l’édifice – mais surtout, elles apportent ce petit facteur “X” qui fait que l’auditeur, encore et encore, réécoute ce disque sans jamais se lasser.
Avec en plus une qualité d’écriture remarquable, chaque titre trouve sa place, proposant chacun des moments forts, marquants. On pense au refrain aérien (littéralement) de “Astro Chimp” (porté par un chant en choeur bien vu), le riff (re)bondissant de “Hubro” et sa lumineuse conclusion au violoncelle (!), la rythmique presque kraut euphorisante de “Euphorialis” (si efficace qu’ils la ramassent sur trois minutes seulement pour ne pas la diluer), le couplet à la rythmique hallucinante (mix de disco et de musique circassienne…??!) de “Draugen” immédiatement rattrapé par un gros refrain tout en saturation… n’en jetez plus, on ne sait plus où donner de la tête ! Autre point d’orgue du disque, le prodigieux “Gargantua” vient déployer sa rythmique stoner fuzzée pour aboutir, après quelques errements variés, à un final extatique. Le trio de chansons final est un peu en deça, avec des titres un peu plus dispensables (sans être ratés).
Orbital Distortion est un album réussi et rafraîchissant. Efficace et audacieux à la fois (ces caractéristiques font trop rarement bon ménage) il devrait contenter tous les amateurs d’un psych rock pêchu et diversifié. Par ailleurs, il confirme un constat qui se renforce un peu plus mois après mois : la Norvège n’est peut-être pas le pays le plus productif en termes de nombre de groupes, mais qualitativement, on est très souvent dans le haut du panier…

Bow Down To Your Masters est une série de live tribute par le label U.S. Glory Or Death Records, dirigé par Tyler Dingvell – par ailleurs chanteur de The Great Electric Quest – visant à rendre hommage aux cadors du heavy metal. Excellente idée s’il en est, le premier volume rendait grâce à Thin Lizzy en 2018 et permettait d’entendre Goya, Mos Generator, Duel, Wo Fat ou Egypt s’essayer sur « Jailbreak » ou « It’s Only Money ». Le second, paru en en 2021, pliait le genou devant Deep Purple et déjà les gros noms s’étaient évaporé au profit de groupes bien plus modestes, laissant Steak, High Reeper ou Red Wizard tenir le pavé. Seul Yob et Mos Generator surnagent dans le marasme stoner/doom, certes sympathique, mais loin d’être inoubliable, de ce second volume.
Alors qu’attendre de la troisième génuflexion, consacrée, elle, aux dieux metal absolus que sont Judas Priest ? S’il est évident que 99,9% des groupes de stoner connaissent et révèrent le groupe, déceler du Judas dans leur musique est souvent de l’ordre de l’infinie particule métallique, noyée dans un fort alliage de fuzz et de THC. Je rajoute à ceci qu’en matière de noms marquants, ce troisième volume relève pour le coup de la désertion absolue, façon grande débâcle de 1940. Derrière The Great Electric Quest, formation témoin, sympathique même si méconnue, et Mos Generator, toujours au rendez-vous, c’est la hess, comme on dit chez les jeunes. Quelques noms tout de même, Kyle Shutt de The Sword en one man band, Rob Dukes, ex-Exodus ou Ron Lipnicki, qui fût batteur chez Overkill. Pas exactement de la « A » list vous en conviendrez.
Mais qu’importe le flacon tant qu’on a l’ivresse, comme disent les amateurs de biture ; quel dommage cependant de n’avoir ici qu’une vieille sensation de gueule de bois. 16 titres des Metal Gods repris souvent façon répét’, avec quelques moments moins scandaleux que les autres : Ruby The Hatchett sur la ballade “Dreamer Deceiver” de Sad Wings Of Destiny, même si le guitariste aurait pu faire une prise supplémentaire, ça n’aurait pas été du luxe, “Ram It Down” de Monarch (aucun lien, fils unique), une transposition interessante de « Metal Gods » portée par la voix de Rob Dukes, et pour finir le groove lascif de Salem’s Bend sur « Killing Machine », avec bruit de perceuse en prime, de loin la meilleure relecture de l’album. Mais en dehors de ces quelques sursauts, l’ensemble se révèle, franchement, mais alors franchement anecdotique. Et le terme anecdotique a ici valeur d’atténuation pour le qualificatif craignos.
En même temps, soyons honnête, la démarche, aussi louable soit-elle était vouée à l’échec. Judas Priest a un chanteur de classe internationale (« je ne crois pas qu’un hétérosexuel puisse faire ce que je fais dans Priest” s’amuse Halford, histoire d’assoir un peu plus sa légende), une paire de bretteurs comme personne avant ni depuis et une musique qui – contrairement à celle des Dieux Sabbath – n’appelle pas vraiment à la relecture. La différence entre une matrice et un aboutissement, finalement.
On s’incline devant Judas oui, mais en silence, avec déférence.
Point vinyle
Il existe quasiment autant de pressages que d’Octaves dans la voix d’Halford, soit 5, plus un test press. Vous pouvez tous les avoir dans un Bundle 10 vinyles (deux de chaque parce que pourquoi pas) ou à l’unité sur le bandcamp du label. Tout ça vient des Etats Unis, va vous coûter un bras et ne verra jamais le diamant de votre platine, mais la passion ça ne s’achète pas. Et pour le reste il y a Paypal.

Le trop discret premier album des anglais de The Grand Mal nous avait pour le moins pris par surprise, étonnés que nous fumes de trouver un disque de stoner aussi groovy émanant des mornes plaines anglaises, sur un terrain de jeu qui n’est pas vraiment leur point fort habituellement (ce type de stoner étant généralement plutôt incarné par les combos scandinaves pour l’Europe, ou de la côte Ouest pour les USA). Le groupe composé de membres des énervés Desert Storm et des méconnus psych rockers Möther Cörona nous avait surpris d’une part par cette orientation musicale et d’autre part pour la qualité de ses compos et du disque en général. Peu (pas ?) actif en live au-delà de la perfide Albion, on ne donnait pas cher de la peau de ce projet sympathique, qu’on ne voyait pas durer dans le temps. Erreur d’appréciation de notre part, ils nous reviennent donc encore une fois sans crier gare, avec un second album qui semble s’inscrire dans la continuité (exactement le même artwork aux couleurs inversées, un titre d’album très original probablement proposé par un gros cabinet conseil en marketing…). A confirmer après quelques écoutes.
Ce qui se confirme assez vite, c’est la qualité globale de la galette : l’ironiquement titré « Petit Mal » vient apporter d’entrée de jeu une belle démonstration de l’envie de nos gaillards, avec un petit riff incisif, emmené par une rythmique à toute berzingue, mode uppercut sur à peine plus de deux minutes. Même approche pour « I Live for Today » un peu plus loin, nerveuse caresse option groovy, ramassée sur moins de trois minutes. Plus loin, une poignée de mid-tempo heavy/groovy (« Shallow », “Smash the Grave”…) viennent prêcher la parole du saint fat riff, complétés par d’autres petites perles toutes délicieusement catchy : le mid-tempo solide “Rule My Soul”, l’agressif “Hellbound Blues”, “Seas of Glory”…
Petite réserve : quelques petits intermèdes instrumentaux viennent aussi agrémenter cette galette, certes sans trop perturber le propos général, mais mis bout à bout, ils représentant quand même plus de 7 minutes de musique, ce qui, pour un album de 36 minutes en tout, est un peu too much (et encore, on n’inclura pas dans ce comptage « Blue Moon », gentille bluette électro-acoustique inoffensive qui vient posément conclure le disque).
Bref, The Grand Mal nous propose pour sa seconde production un petit album-plaisir, une œuvre utile d’artisans musiciens épicuriens, promoteurs d’un stoner rock séduisant et attachant. Sans prétention autre que de faire hocher la tête et taper du pied, ils proposent encore une fois avec ce second album une palette de morceaux variés mais fondamentalement cohérents. Ils tracent ainsi une voie musicale qui commence à ressembler à une véritable identité de groupe, s’affirmant entre références musicales assumées et choix musicaux intègres. Un vrai bon petit album, qui n’a aucune autre prétention et atteint donc pleinement son objectif : notre plaisir auditif.
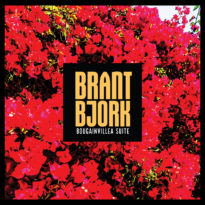
Le projet Stöner perdure mais cela n’empêche pas Brant Bjork de nous livrer un nouvel album solo. J’ai bien dit solo et pas avec son groupe. Comprenez ici que Mr Cool comme pour ses débuts prend les commandes totales et enregistre (sauf exception) tous les instruments.
Trip on the Wine ouvre le bal. Riff basique, répété à l’excès, le titre sans être mauvais n’est pas de plus engageant. C’est bien trop simpliste. Un titre qui aurait sans aucun doute été recalé s’il avait été enregistré pour l’un des deux premiers albums du californien. Ce morceau ne restera pas gravé dans nos mémoires et ce n’est pas le solo discret aux deux tiers du morceau qui viendra relever l’ensemble. Difficile de boire ce verre de vin jusqu’à la fin.
Plus de 70 fois. C’est le nombre de répétitions du riff de 5 notes (variations incluses) qui reviennent dans le titre Good Bones. C’est trop, clairement trop. On a souvent reproché à Brant Bjork de tirer sur la corde lorsqu’il trouve une idée de riff mais là c’est bien trop flagrant. Ce titre, vous l’écoutez une fois et n’avez plus envie d’y revenir. Sans compter le deuxième riff, plus présent sur la fin du morceau qui est aussi hyper présent. Bref, un morceau qui sent bon l’ostéoporose.
Ce constat est le même avec le morceau suivant, So They Say. Heureusement, celui-ci est sauvé par la surprise que peut créer l’apparition d’un clavier à la sonorité très Doorsienne assuré par Ryan Güt. Cela donne quelque chose de très sympa à écouter mais qui une fois l’effet de surprise estompé, ne sort pas forcément du lot. L’idée est bonne, elle apporte quelque chose, mais la base est trop faible pour que le résultat soit mémorable.
Broke the spell. Si seulement, si seulement Brant pouvait se débarrasser de ce sort qui le pousse à user jusqu’au bout les pauvres malheureux riffs qu’il trouve. Pas de décompte cette fois-ci mais ça doit être limite plus que sur Good Bones vu qu’une grande partie du morceau ne contient rien d’autre. Que c’est long. Tu me répéteras mille fois le mantra « Ton riff, si tu veux qu’il soit jouissif, ne le fait pas trop répétitif, ou il deviendra vomitif ».
Nick Oliveri vient jouer de la gratte et pousser de la voix sur Bread for Butter. Un titre qui, oui je deviens moi-même répétitif, tourne autour d’une idée exploitée tant et si bien qu’elle se noie dans une mare de lassitude. Mais bon, en milieu de titre y’a un changement cool. Enfin par cool, je veux dire qui nous éloigne du riff que l’on ne supporte déjà plus. Jacques Pepin a un jour dit « Si vous avez du pain extraordinaire et du beurre extraordinaire, il est difficile de battre le pain et le beurre. » C’est clair qu’ici le pain, le beurre ou les deux ne sont pas de toutes premières qualités.
Bim ! La quinzaine de notes faciles ! c’est le gimmick qui sert d’intro et de motif pour Ya’ Dig. Et en plus c’est pas mal trouvé. De loin la meilleure idée jusqu’à maintenant. Le titre étant relativement court et le schéma pas répété abusivement, on peut même qualifier le titre de plutôt bon. Petit solo à la sonorité qui vient bousculer un peu le morceau, l’ami Brant nous donne un bon titre, bien groovy et moi je le suis et je l’adore à fond ce titre !
Pfiou ! Faut se reposer de toutes ces émotions. Heureusement, Let’s Forget est là avec sa petite mélodie à la cool. Rien de bien méchant, petit relâchement salutaire qui s’oubliera bien vite.
Toutes ses meilleures idées étant exploitées, Brant n’en a plus pour finir l’album. Mais il n’a que 32 minutes de musique en stock, c’est léger. Une reprise ! Mais bien sûr, une petite reprise, presque 9 minutes et on est raccord. Il va donc aller piocher le Who Do You Love Me ? de Bo Diddley enregistrée initialement en 1956. Problème, le titre d’origine dépasse à peine les deux minutes.
On lui ajoute donc une intro et une outro (qui a dit répétitives ?) chacune plus longue que le morceau d’origine. Fallait oser. On ralentit un peu le tempo et hop, le tour est joué. Le tout chanté sans trop de conviction.
Bref, Bougainvillea Suite est un album dispensable. Trop répétitif, en mode écriture automatique et sans originalité. Comment voulez vous qu’on l’aime?

Ce jeune trio new yorkais propose son second album déjà. Largement méconnu jusqu’ici, leur biographie officielle met en avant une expérience scénique significative, qui aurait façonné leur approche musicale, et en particulier une certaine propension au jam. Inutile de tergiverser, ce dernier point se confirme très rapidement, au détour de l’ensemble des chansons pour être clair : on entend poindre quasi-systématiquement les séquences où le groupe pourrait partir en vrille et lancer des séquences jam débridées. Ces digressions restent mesurées sur disque, prenant la forme de quelques passages de jams contenues (souvent à peine un petit solo), mais on les imagine sans peine potentiellement démultipliées sur scène.
Plus généralement, Sun Voyager propose un psych rock nerveux, qui se distingue un peu de la masse de groupes évoluant dans ce genre en deux points principalement : leur son chaud, souvent garage (qui rappellera plus qu’à son tour les excellents Ecstatic Vision) et leur capacité à glisser quelques plans stoner punchy bien construits, qui les détachent du cliché des chansons psych rock répétitives et hypnotiques. En revanche, dès lors que la question psych entre en jeu, le talent du trio est assez évident : les gars ont bien compris et assimilé la recette. Rythmiques lancinantes empruntant largement au kraut rock (voir « Run for You » et son pattern de batterie qui ne dérive quasiment pas sur presque quatre minutes de long), torrents de wah fuzzées ( le refrain de « Some Strange », « The Vision » dès l’intro…), plans de claviers aux sonorités space rock, chant rare et planant… et, comme dit précédemment, ces breaks disséminés ici ou là, qui montrent la place qui pourrait être occupée par des jams dantesques dont on se prend à rêver sur scène (aux deux tiers de « Rip the Sky » en préparation de l’outro, « To Hell with Ride » en remplacement du trop discret solo, le final de « feeling Alright »…).
On pourra chouiner un peu sur la durée de l’album (à peine plus de trente minutes) en se disant que, à défaut de compos supplémentaires, le groupe aurait pu pousser quelques jams pour gonfler un peu sa galette… mais globalement, l’album, ainsi ramassé, est exempt de reproches. Il présente le visage d’un groupe séduisant, plus qu’agréable sur disque, mais encore plus prometteur en live… où on espère avoir la chance de les voir dès que possible !
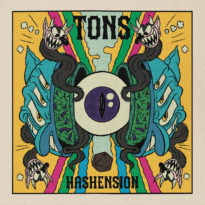
On avait déjà causé des italiens de Tons dans une précédente chronique, ce trio avait sorti en 2018 un album doom-sludge qui avait ravi les amateurs et l’avait catapulté sur le devant de scènes qu’ils ont partagé alors avec Bongzilla, profitant ainsi de l’occasion pour enrichir leurs discographies respectives d’un split, Doom Sessions Vol.4. Mais fini la gaudriole, cette fois il s’agit de revenir en son propre nom avec une galette au libellé pas très surprenant de Hasension qui dit à lui seul ce qui se passe autour de Tons.
Avant même de déballer le paquet, il convient de s’arrêter sur un artwork savamment choisi. Tons sait se résumer, si le titre “Hashension” correspond aux lumières des spots qui éclairent nos quatre mecs depuis quelques temps, autant qu’à leur amour immodéré de la beuh. L’artwork quant à lui est une pochette surprise ironique tirée de l’imaginaire cartoon des années 50 avec une dimension diabolique et fumasse correspondant donc bien au produit que l’on est censé trouver derrière cet emballage. Coup de génie ou pur marketing, au fil des auditions on serait tenté de dire: “aucun de deux mon capitaine”. Tons n’est pas le groupe qui fera se pâmer d’émoi toute la scène doom et sludge tant il est vrai que la voix de Paolo entre le sludge et le black à de quoi dérouter. Cependant les aficionados de Bongzilla se sentiront clairement comme à la maison. Les riffs sont puissants, lourds, ça joue la boucle sans fin et hypnotise sur “Slowly We Pot”, les montées épiques et grandiloquentes de “Hempathy For The Devil” ou de “Ummagummo” (et son solo de conclusion pas piqué des vers) gagnent l’auditeur à la cause du groupe. Cependant ce dernier ne trouvera pas grande raison de s’extasier, c’est bien fait, c’est agréable et ça écrase comme une tonne de plomb sur la coin de la gueule, certes! Mais ce n’est pas l’extase la plus folle. Exit donc le génie pur et bienvenu, le bon boulot défouloir de “A Hash Day Night” et les riffs lancinants de “Hashended”.
Reste la question du marketing, est ce que le groupe travaille à se rendre plus bankable? Ce n’est là qu’une hypothèse probablement un peu hasardeuse, cependant il est clair que Tons apporte un grand soin à cultiver son image de fumeur invétéré, comme bon nombre de groupes avant lui, de Belzebong à Bongzilla sauf que le bong étant déjà pris, il a fallu trouver quelque chose d’autre. L’incrustation d’extrait de films annonçant la couleur au début de “Hasended” ou sur l’horrifique (et très qualitatif) “Hempathy For The Devil”, comme le running gag des titres; déformations herbeuses de titres des Stones, Obituary ou des Floyd placent Hashension dans la continuité du précédent album, Une production sans doute bien plus potache et rigolarde que définitivement marketing.
Tons fait le taf avec ce Hashension qui vient gonfler la petite cohorte des albums doom sludge qui tiennent l’étendard de la fumette crado bien fièrement. La plaque trouvera son lot d’amateurs à coup sûr parmi les headbangers les moins vifs et les carpettes de fond de fumoir. Il est même presque certain que par accident certains non fumeurs pourraient y prendre goût, ou je l’admet j’y ai pris du plaisir.

Depuis 2015 Wizzerd publie régulièrement ses frasques stoner au sein de démo, singles et autres EP. Il faut croire que l’abondance de ces productions régulières, même si passant pour mineures, auront su résonner des States jusqu’en Suède puisque notre quartet signe son album Space‽: Issue No.001 sur le label qu’on ne présente plus, Fuzzorama Records. C’est parti pour près de 45 minutes d’une plaque délicieusement illustrée par un artwork convoquant les classiques du genre : bagnole et fond intersidéral.
Le label a eu le nez creux et déniché une jolie pépite stoner ou s’entremêlent avec subtilité sur “Launch” un Rock classieux qui fait penser à Duel et des passages acid psych’ échevelés qui ne sont pas sans rappeler un Ecstatic Vision sur “Attack Of The Gargantuan Moon Spiders”, hommage volontaire ou non à Led Zep, dont les instruments jouent la redite de quelques-uns des titres phares du groupe sans en dire précisément le nom – mais la rythmique et l’identité sont là navigant d’un titre à l’autre de ce groupe légendaire et les habillant d’habiles choeurs féminins.
Le constat est celui d’une rythmique implacable qui assaille l’auditeur à chaque morceau, exception faite des passages les plus barrés, qu’il s’agisse de “Transmission” ou du tout à fait dispensable titre de conclusion, “End Transmission”, qui rappelle les expérimentations électro du début des années 80. Un hors sujet qui meuble de façon inutile près de 5 mn clairement amputables de la plaque.
Revenons-en donc à la rythmique à mon sens élément essentiel de Space‽: Issue No.001 , une basse fière et ronde comme pas deux qui roule ses notes avec suavité sur “Space Chase” ou “Super Nova” pendant que le reste du groupe déroule une cavalcade à en faire perdre le souffle. La batterie n’est pas en reste, frappes sèches et maîtrisées, abondances de cymbales sans aller jusqu’à rendre malade l’auditeur, elle sert de tremplin au groupe sur “Doom Machine Smoke Break” et fait swinger “Sister Of The Sun”.
Wizzerd rentre pleinement dans le jeu de la scène Stoner, et avec de fermes appuis chez Fuzzorama, espérons qu’ils seront placés dans les conquêtes essentielles du label car ce quartet réalise une plaque sans faux pas et devrait séduire plus d’un auditeur avec son phrasé et sa fougue.

Black Capricron est un trio sarde actif depuis presque quinze ans, un groupe de besogneux discrets, auteur de quatre albums et d’une poignée de EPs avant ce Cult of Blood, la plupart sortis chez Stone Tallion Rex, un label allemand qualitatif mais chichement doté en termes de moyens de promotion notamment. Bref : peu de monde les connaît. C’est peut-être la raison qui les a fait se séparer en 2019 ? Toujours est-il qu’ils ont retrouvé la flamme doom, se sont enfermés à nouveau dans une salle de répèt (forcément) obscure et ont pondu cette nouvelle offrande, qui sort cette fois chez Majestic Mountain.
Du doom donc, du doom lent et lugubre, mais dans une veine “accessible”, plutôt stoner-doom. On pense beaucoup à Acid King, avec cette même gestion des leads de guitare, ce même usage du chant en fond de mix, et ce recours aux rythmiques lentes et roboratives, déroulant un boulevard pour un son de guitare fuzzée en mode poids lourd. On est dans une vraie zone de confort, et en même temps, sur le papier en tout cas, ça ne brille pas par l’originalité. C’est probablement là qu’interviennent les années d’expérience et d’abnégation du groupe, qui rejaillissent à travers des petites perles d’inventivité, des astuces d’écriture qui viennent pimenter le tout, et surtout un riffing 100% pure qualité (“Secret Society of Seven”, “Witch of Endor”). Proposant 7 chansons (pour un peu moins de 45 minutes au total) le trio italien ne fait jamais dans la redite, propose des titres plus atmosphériques (“Godsnake Djamballah”), d’autres plus enlevés (le très malin “Snake of the Wizard”), et ne s’engonce jamais dans un carcan stylistique trop étriqué.
Cult of Blood est donc un impeccable album de doom, proposé par un groupe qui met du talent et de la passion dans son ouvrage. Il ne changera pas la face du monde, et ne chamboulera pas la hiérarchie en place des groupes de doom les plus populaires – en revanche il s’agit d’une galette qualitative, intègre et très jouissive pour tout doomster épicurien, une rondelle généreuse en riffs efficaces et en morceaux mémorables.

Sonic Flower est avant tout le side project (second groupe ?) de Tatsu Mikami, emblématique et indéboulonnable leader de Church of Misery. Le groupe, mis en sommeil pendant le plus clair du XXIème siècle, a été ranimé il y a quelques années par Mikami, qui semble vouloir redonner un semblant de “vie” au groupe (side project ?). Comme il l’a toujours fait avec ses groupes (par obligation et contrainte plus que par envie, on le présume), le bassiste s’entoure de musiciens d’opportunité, parvenant difficilement à les fidéliser sur le long terme (tout en sollicitant souvent de vieux potes, les faisant passer d’un groupe à l’autre le cas échéant…). Les deux premiers albums nous avaient laissé une impression un peu mitigée, entre constat implacable de la qualité musicale proposée, et ce sentiment d’une production qui ne se démarque pas assez, s’exposant à une “durée de vie limitée”. L’enjeu de ce troisième disque est donc avant tout de voir si le groupe se donne les moyens d’aller plus loin et plus fort, dans un paysage musical bien chargé en groupes se revendiquant d’influences 70’s.
Très rapidement on doit admettre que la configuration proposée ici séduit, à plus d’un titre. Déjà, le groupe propose désormais du chant, et par ce biais se détache un tout petit peu de ce sentiment (un peu subjectif) d’un simple jam band de psych rock sans valeur ajoutée, juste bon à enregistrer ses albums lors de répètes entre potes dans leur cave. D’autant plus que ledit chanteur, Kazuhiro Asaeda (qui a traîné ses guêtres il y a une vingtaine d’années dans… Church of Misery !) n’est pas mauvais, loin s’en faut, aportant un chant rauque et chaleureux à l’ensemble. Avec son apport déjà, pas mal de choses s’éclairent. Avec ensuite Fumiya Hattori à la guitare, une image plus claire encore du groupe se dessine : peut-être moins axé sur le feeling (comme pouvait l’être sa prédécesseure Arisa), Hattori est un guitariste doué, actif et performant autant sur le plan lead que rythmique, apportant une vraie densité au disque. Toshiaki Umemura vient compléter le line up à la batterie, finissant le portrait d’un groupe tout neuf (autour de Mikami, donc…).
Nouveau line up, nouveau potentiel de composition (avec l’apport du chant notamment), et donc nouvelle dynamique pour le groupe. Positive ? Assez franchement, oui. Me And My Bell Bottom Blues n’est toujours pas, à l’image de ses prédécesseurs, un disque révolutionnaire – mais honnêtement, peut-on décemment attendre celà de groupes farouchement porteurs de l’étandard rock 70’s ? Le visage proposé par cette nouvelle incarnation de Sonic Flower est résolument plus blues rock, là encore le virage est tangible, audible notamment au travers des jams proposés au coeur des différents titres. Pour illustrer facilement ce constat, il suffit d’écouter “Quicksand Planet”, qui figurait déjà sur l’album précédent en mode rythmique psych et envolées de leads à gogo, et qui est ré-interprété ici, avec chant puissant, riffs acérés et solo bluesy bien maîtrisé. Ca n’empêche pas le titre de garder cette fraîcheur jam à travers une envolée à fond de Wah-wah “sauce Earthless”, mais le tout est carré, sous contrôle. De là à dire que tout est parfaitement ciselé, il y a un pas qu’on ne franchira pas, certains titres se prétant plus que d’autres à de copieux étirements jamesques – un peu trop généreux parfois, à l’image de l’indolent “Poor Girl”, qui traîne sa mélodie entêtante sur plus de huit minutes de soli divers et breaks variés, ou encore du titre éponyme, qui sur presque 10 minutes, s’appuie sur son (très efficace) gimmick mélodique pour envoyer des gerbes de leads un peu dans tous les sens. Dire qu’on n’y prend aucun plaisir serait toutefois un éhonté mensonge. En revanche, ces titres moins “maîtrisés” nous ramènent à la version précédente de ce groupe, qui du coup donne l’impression de ne pas avoir terminé sa complète mue.
Mais l’essentiel du constat reste valable : même si l’on serait bien en peine de savoir si ce line-up s’inscrit dans le temps, et si le groupe envisage de se projeter sur une activité scénique notamment, on commence en revanche à entrapercevoir la perspective d’un vrai groupe désormais, reposant sur des compos solides. Me And My Bell Bottom Blues est un disque intéressant et très plaisant, qui installe Sonic Flower comme un (potentiel) groupe actif, et non plus ce lointain et intangible projet entre potes. Un combo à surveiller donc.
|
|