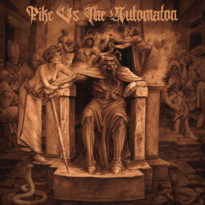|
|

Le texan Travis Weatherred a monté Fostermother en 2019, rejoint rapidement par Stephen Griffin. Touche-à-tout instrumentistes, les deux musiciens ont écrit et enregistré seuls leur deuxième album, The Ocean (même si un troisième musicien vient d’être recruté par le duo, vraisemblablement pour leur permettre de donner quelques concerts – tout au moins l’espérons-nous). Deux ans après leur premier album, originalement appelé Fostermother, ce second disque, cette fois signé chez Ripple, vient enfoncer le clou.
La musique du duo est une sorte de stoner doom très fuzzé et très mélodique, très travaillé aussi (gros travail du son, avec notamment un travail de production convaincant). On pense souvent aux talentueux Mars Red Sky (écoutez les couplets de “Hedonist” en particulier) pour le contraste entre une base instrumentale lourde mais mélodique, et un chant clair et hanté. Loin du plagiat, Fostermother trouve sa voie dans ce segment musical peu exploré, caractérisé par un vrai travail d’écriture qui fait rentrer ses mélodies au forceps dans nos petits crânes après seulement quelques écoutes. L’ensemble est plutôt lent, voire mid-tempo, et explore méticuleusement, sur 45 minutes, cette étroite frontière entre lourdeur et subtilité. De plus, les compositions parviennent à jumeler un travail de structure très élaboré (les chansons sont denses, roboratives même, chargées en riffs, refrains, breaks…) et une durée (relativement) courte, avec un seul titre au dessus de 6 minutes. Tant et si bien que l’ennui n’est jamais là, et les écoutes peuvent se succéder avec toujours une petite surprise au détour d’un riff déja engrammé depuis longtemps, ou un refrain déjà chantonné après seulement trois ou quatre écoutes…
Toute autant audacieuse que séduisante, la musique de Fostermother a pas mal d’atouts pour plaire largement. Il faut se pencher sur leur cas.

Venu de Citadella, ville fortifiée de la province de Padoue au nord-ouest de l’Italie, entre Trente et Venise, Messa a très vite su séduire un public d’esthètes de la musique lourde mais classieuse, avec Belfry, un premier album aussi naïf que beau et surtout Feast For Water qui, à grands renforts de claviers et de touches jazzy, a positionné Messa dans le haut du panier des underdogs de l’underground. Une fois n’est pas coutume pour un album de 2022, Close, troisième effort du groupe, a été composé durant la pandémie et trouve son inspiration dans cette période. Exit la thématique aquatique qui traversait les deux premiers disques, Close philosophe sur les liens humains, l’éloignement, le déracinement, partant du confinement pour élargir l’idée de séparation jusqu’à la migration.
L’album s’ouvre sur du clavier, quelques notes en ouverture de « Suspended », comme un lien organique avec l’album précédent puis nous transporte vers autre chose. Le jazz s’efface peu à peu (il en reste quelques vestiges, comme le solo de « Suspended » ou le saxophone en ouverture d’« Orphalese ») et Messa de s’ouvrir aux gammes arabes, utilisant du oud sur de nombreux morceaux. Point d’orgue de cette nouvelle coloration, « Pilgrim » et son entêtante mélodie débouchant sur un riff de pur doom après trois minutes de montée mélodique. C’est ici la force de cet album, par ailleurs assez long, les morceaux sont extrêmement variés et jouissent d’une grande cohérence malgré les nombreuses expérimentations (l’interlude au oud « Hollow », en résonance du second « Leffotrak » complètement black metal, « 0=2 », très progressive, presque drone stoppée net par un gros break doom etc…). Comme sur l’album précédent c’est le chant de Sara Bianchin qui apporte ce truc en plus, ce facteur X pour le groupe. Avec ses vocaux habités, quelque part entre Anneke Van Giersbergen et Jex Thoth, cette dernière donne de l’âme à l’ensemble, sa voix agissant comme un lien entre les différents mondes, Maghreb et Europe, prog et doom, jazz et metal.
Même s’il aurait gagné à être plus court (il y a surement un morceau en trop même si je n’arrive pas à savoir lequel), Close est dans la droite lignée de Feast For Water, pareil mais différent. Charge à Messa de désormais parcourir le monde pour porter leur musique au plus grand nombre. D’être proche de nous, finalement.
(des dates sont annoncées à Nantes et Paris en avril ainsi qu’au Rock In Bourlon en juin)
Point vinyle:
Deux options chez Svart Records: un vinyle Gold déjà sold out (mais disponible à la Fnac semble t’il) et une version noire classique.

Février 2020, Kirk Windstein attaque la promotion de Dream In Motion, son premier album solo et met une touche finale au deuxième album de Crowbar, dont la sortie est prévue pour la fin de l’été. Un emploi du temps millimétré pour le divin barbu, à peine contrarié par une pandémie mondiale quelques semaines plus tard. Le monde est immobilisé durant 2 ans et Zero and Below gardé au congèlo tout ce temps, pour nous parvenir aux premières fontes de neige de 2022 (enfin métaphoriquement, merci le réchauffement climatique). Aussi improbable que cela semble, Kirk Windstein, parolier se nourrissant des horreurs de ce monde pour accoucher de ses textes, n’a pas trouvé en deux ans de pandémies, crashs économiques et morts en cascade, de raisons suffisantes pour toucher à son bébé. De son propre aveu tout ce temps à réécouter l’album l’a conforté dans l’idée qu’il n’y avait rien à y changer. Audacieux.
Et pourtant force est de constater que Capt’ain Kirk a eu raison. Zero and Below est parfait comme il est. Sombrement lumineux, désespérément enthousiasmant. Sans toucher à sa formule (power chords en pagaille, break de mammouths, voix rocailleuse sur désespoirs patentés) Crowbar renoue avec la majesté mélodique de ses vertes années (98 – 2001) : entre déboulés ultra efficaces (« Chemical GODZ », « The Fear That Binds You ») et mid tempi aux développements plus ambitieux (« Bleeding From Every Hole » et surtout le majestueux morceau titre « Zero and Below »), Crowbar a bel et bien donné le meilleur de lui-même. Shane Wesley, leur nouveau bassiste, apporte déjà beaucoup, rappelant un peu Pat Bruders, faisant oublier le vrai faux retour de Todd Strange dans le groupe. Toujours produit par Duane Simoneaux (comme les trois Crowbar précédents, l’album solo de Windstein et son prochain à venir), Zero And Below est le meilleur album de Crowbar depuis de nombreuses années, venant à mon sens se classer quelque part entre le riffing de Sever The Wicked Hand (2011) et le souffle de Sonic Excess In It’s Purest Form (2001). D’ici à pouvoir regarder Odd Fellows Rest dans les yeux ? Sachons raison garder tout de même.
Point vinyle:
Le LP noir est disponible facilement et un peu partout, un Blue and Ice limité à 300 exemplaires est disponible via le shop de Brooklyn Vegan, un light blue chez Nuclear Blast et pas mal d’autres couleurs (splatter bleu et blanc, Transuscent Galaxy, noir et bleu et un très moche tricolore noir, bleu et gris bien déprimant) sur le site du label (ou via le site du groupe). Attention aux frais de port et de douane cependant.

Quatre ans presque jour pour jour après la sortie du troisième album du groupe originaire de Thessaloniki en Grèce, nous avons le plaisir de découvrir la suite. Comme à l’habitude, point de fioritures dans les noms. Annoncé comme le travail le plus mature du groupe, ce quatrième opus est sobrement intitulé IV, et nous propose une dizaine de morceaux. Et si certains nous emmènent en territoire connu, d’autres ne manqueront guère de surprendre l’auditeur même aguerri.
On commence par le morceau d’introduction « Reflexion », qui nous permet aussitôt de détecter la présence d’un piano, chose nouvelle pour Naxatras qui jusqu’à présent comptait trois membres. À mesure que l’on progressera dans l’album, on comprendra que les notes de synthé et d’orgue ne se limitent désormais plus à d’anecdotiques apparitions, mais qu’un quatrième larron, nommé Pantelis Kargas, vient de rejoindre la bande.
À la différence de ce premier titre assez lent et au groove curieux, « Omega Madness » nous ramène dans le giron du groupe. Un rock psyché, majoritairement instrumental, diffusant une atmosphère planante et non dépourvue d’énergie. Accompagnées par de sporadiques effets de synthé, les nappes de guitares flottent autour de nous, racontent une histoire. Tandis que basse et batterie tournent les pages les unes après les autres devant un lecteur qui agite doucement la tête.
On enchaîne avec « Journey to Narahmon », une terre d’où serait originaire la race du héros de ce récit, assimilable aux anciens elfes, une terre désertique ou temples et traces de civilisations ne subsistent qu’à l’état de ruine. Et c’est là que l’aspect le plus notable de l’album s’illustre. La narration s’y trouve beaucoup plus présente, prenant le pas sur la composante jam organique du groupe. Comme le suggère aussi bien l’artwork, nous nageons ici dans une atmosphère de fantasy omniprésente. Même si l’écoute de IV peut s’effectuer sans y prêter attention, il n’en reste pas moins construit autour de cette histoire. La musique s’en révèle donc plus contemplative qu’introspective.
Le quatrième morceau, « The Answer » incarne le plus le tournant indéniable que prend la musique de Naxatras dans cet album. Section rythmique feutrée à souhait, guitare funky et synthé enjôleur, pas une once de distorsion, une voix aussi douce qu’une caresse. Exactement comme « Radiant Stars », plus grand-chose à voir avec du stoner donc. À partir de là, on se dit que tout est possible pour la suite. Néanmoins, l’album reste cohérent et les morceaux s’enchainent en oscillant entre de l’ancien et du nouveau, sans que l’on sache vraiment sur quel pied danser.
Et pourtant, on danse… Car le groove est indéniable, l’écriture impeccable et la nuque n’a au final d’autre choix que de s’agiter. La magie spectrale de Naxatras nous envoute toujours. Mais on ne peut nier qu’un travail différent a été accompli sur IV. Un travail que le groupe considère comme ce qui se rapproche le plus de son essence, et qui sera donc ce qu’il faudra attendre à l’avenir.

Avec ce troisième album (le second chez RidingEasy), le trio suédois enfonce le clou déjà planté avec sa précédente galette, Under a Blood Moon, en 2019. Dwell in the Fog est meilleur en tous points que son pourtant déjà très bon prédécesseur. Les premières écoutes plantent un décor que l’on connaissait déjà, dans les largeurs : un doom sludge lourd et poisseux envahit les haut parleurs pendant les 40 minutes de l’album. L’ensemble est si dense et oppressant qu’on a du mal à s’en détacher, et les écoutes s’enchaînent finalement pour petit à petit qu’on se laisse absorber par l’animal. La basse colossale du nouveau venu Nicklas Hellqvist dresse un socle mélodique massif appréciable, que vient compléter le jeu de batterie surpuissant (et pas avare en groove) de Axel Wittbeck. Une musique de fondement metal, un gros jeu de basse, un batteur remarquable… Clairement, plus encore que ses prédécesseurs, Dwell in the Fog rappelle le Mastodon des débuts (Remission surtout) dans ce qu’il avait de puissant, majestueux, sans concession et… intelligent. Sacrée comparaison vous en conviendrez. Pourtant, plus qu’à son tour, on retrouve cette finesse d’écriture dans les compos de Firebreather : les arrangements sont très malins, et les compos sont souvent rehaussées d’un ou plusieurs véritables moments de grâce. On notera par exemple le très majestueux pont central de “Kiss of Your Blade”, l’intro dévastatrice et écrasante de “Spirit’s Flown” emmenant à un refrain sublime, les leads enivrants du final de “The Creed”, le couplet groovy (un jeu de batterie impeccable) de “Weather the Storm”, le break de “Sorrow” matraqué par Wittbeck… Forcément on pense aussi à High On Fire quand nos suédois poussent les sonorités dans un bain purement metal – ce qui est finalement le cas sur l’ensemble de la galette, reconnaissons-le.
Autre point marquant de la musique du trio, le chant de Mattias Nööjd est un peu le fil rouge de ce disque, l’élément monolithique fédérateur : stable et robuste, le chant tout en gutturalité rocailleuse du barbu manque un peu de modulations sur la longueur, mais se place toujours intelligemment, avec efficacité. Son jeu de guitare vient évidemment structurer l’ensemble, qui via des riffs puissants et efficaces, qui par des leads jamais démonstratifs et toujours mélodiques et originaux, et surtout au global en support d’une rythmique bulldozer (en ça la formule du power trio fonctionne à plein ici, avec une efficacité décuplée quand Nööjd vient s’allier à ses collègues déjà redoutables en rythmique).
Tout à la fois agressif et subtil, puissant et mélodique, Firebreather a beau évoluer sur un chemin parallèle du doom le plus classique, il enrichit finalement le genre par ce qu’il y injecte en terme d’hybridation avec tout un pan d’influences metal notamment. Ces gars-là confirment tout le bien qu’on pense d’eux.

Spaceslug c’est avant tout de la régularité on vous le dit à chaque fois. Le trio polonais est venu poser sa dernière stèle long format intitulée Memorial, deux ans après Reign of Orion et un an après son EP, Leftlovers. Nous voici donc cette fois devant huit pistes d’un groupe dont les auditions ne nous ont jamais déçu et qui nous avais laissé en 2019 dans l’attente de voir ce que leur évolution allait donner.
Traçant sa propre voie, sans se réinventer lorsqu’elle entonne “Follow This Land”, il serait faux de dire que la limace de l’espace nous sert toujours le même filet de bave et c’est bien ce à quoi on s’attendait.
Une fois de plus selon l’humeur la perception de la plaque est variable. Cette fois-ci l’album ressemble à une lénifiante redite ou à un compagnon de voyage paisible et introspectif. Avec un titre protéiforme comme “Spring of the Abyss” je me dis qu’à vouloir trop en faire on rate parfois sa cible et “Memorial” me confirme que ce n’est pas ici que je trouverai mon compte.
Les passages plus orientés post métal apportent la touche qui rehausse la plaque et “In The Hiatus Fall” et “Of Tree and Fire” en sont les parfaits exemples avant qu’à nouveau le sentiment qui m’avait étreint précédemment ne réapparaisse à un moment où à un autre des titres.
La seule constante est clairement la maîtrise du trio qui offre à entendre sur mémorial une profonde fluidité des compositions et s’appuie comme avec ses disques précédents sur une production soignée. Techniquement une réussite.
Memorial est de ces albums ou d’une écoute à l’autre on peine à se trouver. Tantôt ressenti d’une manière tantôt de l’autre c’est en quelque sorte une énigme qui m’est passé entre les oreilles. Spaceslug malgré une narration erratique, livre avec cet œuvre un assemblage méticuleux et soigné, constante qui permettra à l’auditeur d’y retrouver ses petits.

Drôle d’histoire que celle de ce disque ! Le trio émane de Perth, en Australie, une région qui, si elle a vu discrètement émerger quelques groupes de stoner, n’a pas franchement taillé sa renommée sur sa vivace scène doom. Atolah y vivote quelques années, chope toutes les premières parties du coin, et sort Relics, un remarqué EP (remarqué par nous-mêmes il y a plus de 13 ans, voir notre chronique ici), mais globalement l’affaire patachonne. Du coup, Pierre François, son frontman, émigre et s’installe aux Pays-Bas. En plus de prendre part à quelques projets musicaux, il dégotte une nouvelle paire de mercenaires pour enregistrer en 2012 trois nouveaux morceaux, sous la forme d’un second EP. Et pfffiut… Disparus ! Ce n’est qu’en 2020 qu’on entend à nouveau parler d’Atolah, rené de ses cendres du côté de… Mebourne cette fois, de l’autre côté du continent, où Pierre François a encore embauché deux nouveaux doomsters pour reprendre là où il s’était arrêté.
Jamais sortis sur support physique, les trois nouveaux morceaux enregistrés en 2012 trouvent une incarnation discographique près de dix ans plus tard, grâce à Sleeping Church Records. Attention toutefois, ce disque a beau ressembler à un album, c’est en réalité un double EP, proposant, en outre du nouvel EP, une réédition de leur première production, le sus-mentionné Relics. Sur une heure de musique, la moitié (5 chansons sur 8) sont donc déjà dispo depuis longtemps. Pour autant inutile de crier au vol : ne soyons pas dupes, pas grand monde ne les avait entendues, ces chansons ! La question est donc de savoir si d’une part elles valent le coup, et d’autre part si elles s’incorporent bien à l’ensemble. La réponse est oui et oui. Au final, cette galette en intégralité déroule toute seule, même si la séparation entre les deux EP est quand même audible. Atolah propose sur ces huit plages un stoner doom de très bonne facture, bien construit et bien gras. Sur le dernier EP, il propose une version un peu plus âpre de son doom, déjà bien dense à la base. Il s ‘y éloigne un peu des plans plus stoner (l’ensemble est aussi incidemment moins fuzzé) pour pour développer des ambiances plus lancinantes et sombres, plus complexes aussi (à l’image de ce “Focke Wulf” de plus de 15 minutes qui rappellera plus qu’à son tour les géniaux Bongripper). Par ailleurs, le groupe sort du 100% instrumental pour proposer quelques lignes vocales, bien que rares.
Difficile de dire (a fortiori au regard de sa carrière passée) si Atolah va désormais occuper une vraie place dans la scène doom stoner mondiale. Sa faible production (8 chansons en 15 ans, en gros) ne plaide pas en sa faveur. Espérons donc que ce disque soit plutôt un moyen de célébrer sa première partie de carrière pour préparer le terrain pour la suite – auquel cas, nous nous tenons prêts à les accueillir comme il se doit.
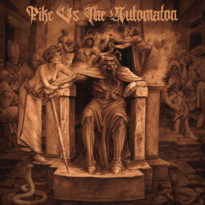
Nous avions laissé Matt Pike en 2018, un orteil en moins mais avec un Grammy en plus, content d’obtenir enfin une reconnaissance du milieu pour tout le bruit qu’il a pu faire, avec Sleep et High on Fire en quelques 30 ans de carrière. Une belle lancée que rien ne semblait pouvoir ralentir, si ce n’est une pandémie mondiale, finalement. Et s’il y a une chose que Matt Pike ne supporte pas, c’est bien de rester chez lui à devoir écouter ses théories fumeuses (l’homme est nettement moins bien structuré que l’artiste convenons-en) et quelle meilleure thérapie que de prendre sa guitare et quelques potes sous le bras pour jammer un peu ? Et quel meilleur moyen de nous en faire profiter que d’en faire un album une fois le gros du COVID derrière nous (si si il faut l’espérer)? Voici donc Pike vs The Automaton, dans un esprit proche de Tucker & Dale Fightent le mal : quelques bouseux se dressant face aux grands problèmes de ce monde, une bouteille de whisky dans la main et un joint au coin des lèvres.
Matt Pike fait ici équipe avec Jon Reid, batteur de Lord Dying et son technicien guitare, Chad « Chief » Hartgrave à la basse. Un disque réalisé en famille, avec l’incontournable Billy Anderson derrière la console, Mme Alyssa Pike (et bassiste de Lord Dying) pour quelques voix et parties de basse, Brent Hines (Mastodon), Jeff Matz (HoF) et quelques autres happy few apportent également leur petite contribution. Tant qu’à être piégé dans sa caverne (« Trapped in a Midcave »), autant faire un maximum de boucan et à ce jeu-là Matt Pike n’est pas le dernier. Vous trouverez chez Pike vs. The Automaton toutes les obsessions du guitariste, des déboulés à la High On Fire (« Abusive », « Throat Cobra ») au doom cosmique de Sleep (« Trapped in a Midcave » ou « Living The Wars of Woe », deux des tout meilleurs titres de l’album), mais la liberté que confère un tel projet permet au guitariste de s’essayer à d’autre styles, comme la vibe D-beat/punk d’« Acid test Zone » ou le blues gras de « Land », morceau sur lequel Hinds délivre un solo qui n’est pas sans rappeler Billy Gibbons. C’est bien là que se trouve l’intérêt (et les limites) de Pike vs. The Automaton, dans cet assemblage foutraque de titres sacrifiant à la cohérence un certain usage récréatif de la musique. Jouer ce que l’on veut, avec les potes de passage et enrubanner le tout pour une sortie mondiale, en attendant que les restrictions sanitaires permettent à High On Fire d’enregistrer et tourner à nouveau. Alors pour les drogués qui, comme moi, considèrent Matt Pike comme un guitaristes incontournable, passer à côté d’autant de ses riffs est une hérésie, mais les consommateurs occasionnels peuvent sans problème attendre sagement que le bonhomme retrouve ses canaux habituels pour nous en mettre plein les oreilles. Mon petit doigt (mon gros orteil ?) me dit d’ailleurs que c’est pour bientôt.
Il est à noter que Matt Pike fait partie de ces gens ayant des idées particulières sur la pandémie et si je n’ai rien décelé de problématique dans l’album, le dossier de presse fourni comporte un passage complotiste assez pathétique. Il appartient aux journalistes qui l’intervieweront de faire attention à ce qu’ils retransmettront, vu qu’à priori sa maison de disque (MNRK, soit ce qu’il reste d’Eone depuis sa vente à Hasbro) n’a pas jugé bon de faire attention.
Point vinyle:
De multiples vinyles colorés sont disponibles, gris, rouge, doré, splatter et autres réjouissances, à des prix plutôt corrects étant donné le délire actuel du vinyle. Il est par exemple possible d’avoir une version noire pour 19 euros, y compris venant de France (Season of Mist) et le coloré autour de 25 euros. Profitez-en, les prix grimpent de façon absurdes ces derniers temps.

Triste constat après des dizaines d’écoutes : A Loner, c’est un peu l’album d’une rupture consommée. L’histoire d’un couple qui depuis quelques années voit la passion irrémédiablement se distendre, les partenaires progressivement évoluer vers des envies et des goûts différents, et qui prennent acte d’un écart de vision trop grand pour continuer ensemble. On en est là avec Hangman’s Chair. Même si Banlieue Triste, son prédécesseur, avait séduit la fibre musicale intime de certains de nos chroniqueurs, il est temps de prendre acte du fait que Hangman’s Chair n’a plus rien à voir avec notre ligne éditoriale. Finis les riffs lents presque doom de This is not supposed to be positive avec ses atmosphères sludge poisseuses à souhait, finis les plans sombres et lourds (même si déjà de plus en plus rares) de Banlieue Triste : A Loner nous propose une version résolument plus légère de Hangman’s Chair. La guitare se positionne désormais clairement dans un spectre sonore plus clair, la production à la sauce Type O Negative (quel son de basse !) écrase désormais l’ensemble. La lourdeur se retrouve néanmoins ici ou là (bien aidée par la frappe de sourd de Mehdi), sur quelques plans de “Cold & Distant” ou “An Ode to Breakdown” notamment, mais dès qu’on passe le virage de la troisième plage on revient dans un territoire désormais plus proche de la dark wave que du doom. Est-ce un mal ? Nous ne pouvons pas en être juge, cette tendance musicale trouvant désormais difficilement sa place dans nos pages.
Aucune amertume, aucune critique du groupe, qui trace sa voie comme il l’entend et avec talent. Souhaitons-leur de continuer à grandir et évoluer, en espérant que ce passage chez Nuclear Blast leur donne le coup de boost utile pour enclencher une nouvelle dynamique dans leur carrière. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

Le trio suédois pose là son troisième album studio et moi la troisième chronique du groupe chez Desert Rock. De l’ambition, les gars doivent en avoir car après Kozmic Artifactz puis Ripple Music, c’est chez Heavy Psych Sounds qu’on les retrouve à présent pour la sortie de leur Blinded by the Wicked. Ça sent le merchandising à gogo et la volonté de toucher de plus en plus d’auditeurs.
Hazemaze devient ici un serpent de mer, à chaque sortie d’un long format, on s’interroge sur l’intérêt réel de les chroniquer puis au bout de quelques écoutes on se laisse séduire par leur approche classico classique du genre stoner doom. Cette chronique ne dérogera pas aux constats de mes prédécesseurs en 2018 (à lire ici ) et en 2019 (à lire là).
Gros son, voix traînante, efficace mais pas implacable. La production est toujours aussi adaptée aux sonorités de Hazemaze et met en valeur la besogne à défaut de faire entrer celle-ci au panthéon de originalité.
Les références s’y croisent et s’y multiplient. Le Sabbath éternel est bien présent et les nappes de clavier m’ont parfois fait penser au géant vert O négatif notamment lorsqu’elles entament les entêtantes phrases de “Ceremonial Aspersion” ou que la voix tente une poussée sur “Devil’s Spawn”. Le clavier puisqu’on en parle est d’ailleurs une nouveauté ici et son emploi est justement dosé.
On pourrait se dire que d’un album à l’autre le trio joue la redite, mais ne nous y trompons pas il y a une trajectoire chez Hazemaze. Blinded by the Wicked se démarque de ses prédécesseurs et met en retrait la carte doom old school et apporte à son stoner des mélodies plus complètes. Rien n’est renié dans ce parcours mais ce dernier opus sonne autrement et embrasse son époque pleinement. Pour s’en convaincre je ne saurais que trop vous recommander de pousser le potard sur le très réussi “Luciferian Rite” et le très sexy “Malevolent Inveigler” qui clôturent parfaitement l’album dans un duo gagnant.
Avec Blinded by the Wicked, Hazemaze ne soulève toujours pas de vague d’engouement hystérique. Pour autant le trio assied sa position de groupe à l’écoute agréable et déclencheur d’un certain plaisir. Un groupe qu’il est bon de retrouver épisodiquement selon la savante rythmique de leurs sorties d’albums.

J’aime la musique. Et l’une des choses qui me fascine dans cet art c’est cette faculté qu’ont certains humains à mettre côte à côte des sonorités, les emmêler, les triturer pour vous donner ce qu’on appelle musique. C’est captivant. Et dans ce registre, il y a eu de tous temps des personnes, des groupes, plus doués que d’autres. Des compositeurs d’un niveau supérieur, qui maitrisent leur art, qui ont ce petit truc qui vous touche encore plus. Earthless en fait pour moi indéniablement partie. Et ce n’est surement pas avec ce nouvel opus que je vais les retirer du piédestal où je les ai placés lors de leur découverte. Chronique d’un disque qui ne pouvait qu’être bon.
Après une incursion du côté des formats courts, comprendre par-là entre 5 et 10 minutes, le groupe retourne à ses premiers amours avec le format 20 minutes. Après avoir poussé la chansonnette, on retourne aussi sur de l’instru 100% pur jus. Retour aux sources donc pour ce groupe qu’on avait découvert sur ce format.
On retrouve aussi une construction par mouvements, comme une symphonie. Chaque titre se découpant clairement en plusieurs phases, plus ou moins différentes mais clairement identifiables.
“Night Parade of One Hundred Demons, Pt. 1.”
On commence doucement, pas vraiment de rythme clair, on touche les cordes, on effleure les cymbales. On se place et on installe une ambiance. Un peu comme en live lorsqu’on cherche encore son écho parfait, son accordage favori, comme si on s’adaptait à la sonorité de la salle avant de vraiment commencer. On teste les effets, on se regarde entre musiciens et on se sourit. Voilà plus de 4 minutes et un premier motif de guitare se montre clairement. On est prêts, on peut commencer. On teste quand même un petit solo discret pour voir si les ultimes réglages sont bons. Petit blanc… et hop, on y va. C’est parti pour 12 minutes de pur fuzz, de pur solo, de pur Earthless. La basse et la batterie ont leur rythme respectif, Isaiah Mitchell peut donner libre court à sa créativité. Toujours avec cette impression d’être à mi-chemin entre l’impro et la composition. “Listen Without Distraction”, vous connaissez surement cette expression. Elle ne s’applique jamais aussi bien qu’à ce groupe. Laissez vous transporter, laisser vous prendre par ce son unique. Plus de 12 minutes après le début, troisième mouvement qui s’enclenche. Gros son, gros riff, et solos qui vous fouillent le cerveau à la recherche du dernier espace à occuper. C’est splendide, c’est imparable.
Qui dit Part 1, dit Part 2.
La construction est assez similaire à la première partie. On redémarre avec un rythme lent. Allez, je vais dire un peu de mal quand même, ce premier mouvement est peut-être un peu trop long. Ou alors c’est l’impatience qui parle car on sait d’avance que tout cela va déboucher sur un truc de dingue, on le sent. Et on ne se trompe pas. C’est donc après plus de 11 minutes de cette intro planante que le groupe repart avec fougue explorer les tréfonds de nos émotions en enclenchant le deuxième mouvement. Et l’attente en valait la peine. C’est hallucinant dans tout les sens du terme. Comment peut on sortir des sons pareils, comment peut on trouver ces enchainements, ces changements de sonorités, comment est-ce possible ? Je terminais ma chronique du live From The West avec ces mots « Heureux sont ceux qui ont vu Isaiah Mitchell sortir de sa guitare de tels sons avec un tel feeling ». Je ne trouve pas meilleure punchline pour attirer le réfractaire, pour vous persuader de la nécessité absolue d’écouter ce disque.
Après nous avoir parlé de la violence de la mer Rouge (“Violence Of The Red Sea” – From The Ages, 2013), voilà que c’est la mort du soleil rouge que le groupe souhaite dans le troisième titre (“Death to the Red Sun”). Sorti en single sur les plateformes de streaming quelques semaines avant l’album, ce titre a déjà eu l’occasion de passer un paquet de fois dans ma playlist et que vous dire si ce n’est que les 20 minutes de ce titre sont exceptionnelles. Pas de temps mort, intro réduite au minimum. On est dans le vif du sujet rapidement et on ne reprend sa respiration qu’à la fin. C’est encore une fois un hymne à la sainte guitare électrique avec un Isaiah Mitchell inspiré.
Retour aux fondamentaux donc pour Earthless qui sort ici un album absolument magnifique. La technique et le feeling d’Isaiah Mitchell aidés par une rythmique basse/batterie irréprochable et ce sont trois nouvelles pépites qui s’offrent à nous. Chapeau bas, une nouvelle fois messieurs.

Une pochette digne de Gotlib, un nom de groupe sous forme d’hommage aux piscines olympiques et aux westerns spaghettis, il n’en fallait pas plus pour que je me saisisse de la Fuzz Soup de Mud Spencer.
Ayant fait mes propres recherches, c’est une déconvenue, il faut croire que Mud Spencer est le nom d’un chien de berger et force est de constater que la pochette est plus foutraque que le contenu. Allons, ne nous décourageons pas et approchons-nous de l’animal avec prudence.
Pas à pas on découvre qu’il s’agit en fait d’un…one man band. Et si on s’attarde encore un peu, on constate que celui-ci est un français (Autre mot pour fainéant?) du nom de Sergio Garcia (Ah le vil Renard, je soupçonne le jeu de mots!) qui vit et compose du fond de son lit sur l’île de Java. Un être paresseux et lent qui a été capturé par Argonauta Records lors de l’enregistrement de Fuzz Soup avant d’être rendu à la vie sauvage de sa piaule sans vraiment savoir à quelle espèce on a affaire.
Au fil des écoutes, nous voilà donc en présence d’une espèce curieuse qui produit des sons issus des vapeurs lysergiques des années 60-70 et autant vous le dire tout de suite, Mud Spencer ce n’est pas vraiment un multi instrumentiste. L’homme est plutôt un bidouilleur talentueux qui assume sa passion du genre , celle qui nous réunit ici. Le gars pousse le vice parfois au-delà en s’essayant à des bidules plutôt électro sur “The Cheating Mole” qui restera cependant la seule “sortie de piste” de l’album en regard de ce qui justifie cette chronique.
Lent et profond sur “Tumulus”, dansant et hypnotique sur “Quest of Fire”, oriental et psychédélique sur “Back to Origin”, Mud Spencer contient un univers où le maître mot est toujours la passion d’un genre entier. Chaque piste embrasse un aspect de la galaxie stoner doom, elles naviguent entre fuzz et psyché sans jamais épingler clairement les références mais toujours en usant habilement des codes du genre.
Il y a fort à parier que beaucoup de stoner heads se retrouveront dans cet objet sous forme de divagation utile. Fuzz Soup est une soucoupe volante, un condensé de style réalisé avec soin, plutôt pas mal pour un bricolage qui n’a d’autre vocation que de rester une plaque fièrement réalisée et offerte au plus grand nombre. C’est aussi peu sérieux que Bud Spencer mais ça en a la carrure, la soupe est servie, à table!

Confusion Master est un quatuor de jeunes doomsters suédois (basé en Allemagne ?), ayant œuvré séparément dans des formations underground d’engeance punk, hardcore, metal… Le doom en style fédérateur de leur créativité, voilà une belle histoire… Une histoire entamée il y a quelques années soit dit en passant, ce Haunted étant leur seconde production, après un premier album sorti trois ans plus tôt (passé sous notre radar).
N’y allons pas par quatre chemins : Confusion Master nous a cueilli en exactement 1 minute et 3 secondes, juste le temps de l’intro de “Viking X”, écrasante et oppressante, terrifiant rouleau compresseur au son de gratte aussi gras qu’étouffant, intro judicieusement accompagnée d’un growl d’outre-tombe avant d’engager le redoutable master riff du morceau. Oumpf… Le titre déroule ensuite sur plus de dix minutes plusieurs séquences, sans jamais toutefois atteindre la densité de cette intro incroyable.
Ce growl d’ailleurs et la lourdeur monolithique de cette intro s’avèrent finalement très partiellement représentatifs de la musique du groupe : le stoner doom de Confusion Master est plus riche finalement, prolixe en guitares leads en tous genres, et, même si sa musique est majoritairement instrumentale, se dotant occasionnellement de vocaux (non growlés, comme quoi…) et même de samples (manifestement extraits de bande sons de films). Mais c’est par sa profusion de riffs que le groupe trouve son principal argument de vente : ils jaillissent de toutes parts, mémorables, sombres, efficaces (“The Cannibal County Maniac”, “Jaw on a Hook”…) et viennent in fine distinguer Confusion Master de la masse de groupes de doom souvent insipides ou rébarbatifs.
On notera néanmoins que si l’album “normal” (prévu pour le vinyl) se cantonne à 4 titres, le groupe offre un cinquième titre (“Haunted”) sur la version CD, et même… un sixième titre (!!), “Under the Sign of the Reptile Master”, face B d’un 12″ confidentiel, le tout rendu dispo sur son bandcamp. Autant “Haunted” n’est pas le plus intéressant, autant “Under the Sign…” aurait pu trouver sa place sur l’original (si ce n’était cette contrainte de durée maximum d’un vinyl). Plus de quinze minutes de musique en plus du vinyl, donc.
On sort quand même de ce disque dans un état de légère confusion lorsque l’on essaye de synthétiser son écoute. Il est très riche, sans jamais se départir d’une ligne musicale finalement cohérente et respectée dans le temps. Le disque propose de vrais moments de grâce, des riffs épiques, des arrangements absolument lumineux… mais également quelques passages moins intéressants, reconnaissons-le (la moitié de “Jaw on a Hook”, quelques longueurs ici ou là), menant au constat d’un disque hétérogène. Mais au moment de faire le bilan des “+” et des “-“, on se rappelle des quelques claques dégustées avec envie au long de cette galette, et on décide de l’écouter encore…

Les italiens sont déchaînés ces derniers mois ! Bien aidés notamment par une palanquée de labels autochtones (même si la présente galette sort sur un obscur label US), les formations transalpines de stoner de toutes engeances émergent un peu dans tous les sens, et squattent une bonne part des sorties chaque mois. Pour la plupart toutefois, ces groupes ne restent pas longtemps dans les mémoires. Deep Valley Blues fera-t-il partie de la minorité remarquable de cette cohorte ?
Les premières écoutes nous permettent de baliser le terrain de jeu du groupe du jeune quatuor calabrais, à savoir un stoner nerveux et groovy, ne manquant pas de charme à première vue. La séduction opère si bien que l’on se prend à enchaîner les écoutes avec un certain plaisir un peu coupable, un peu régressif aussi. On se laisse vite happer par le groove implacable de “Bronco Buster” ou de “Mally’O Mucy”, et les riffs de “Smokey Mountain Woods”, “Epitaph” ou “Pills of Darkness”. La recette du plaisir auditif est finalement assez simple quand on y réfléchit… Le chant glaireux de Giando Sestito vient efficacement compléter une musique tout de même largement instrumentale, rappelant parfois – toutes proportions gardées – quelques joutes vocales de Neil Fallon sur les passages un peu “scandés”.
Le bien nommé III (information pour ceux qui glandent au fond de la classe : il s’agit du troisième album du groupe…) se révèle au final être un disque rafraîchissant et très bien exécuté, bien confortable dans un genre pourtant largement balisé depuis maintenant plus de deux décennies – preuve si nécessaire qu’il reste des choses à faire et à dire dans le genre, sans pour autant tourner en rond. Il n’y a aucune raison de reprocher un quelconque manque d’originalité à Deep Valley Blues (qui laisse intuiter son intention musicale jusque dans son sobriquet) : les gars se font plaisir, et régalent à l’occasion tous les amateurs d’un stoner efficace et bien fait.

On n’est pas forcément saisi a priori d’un enthousiasme délirant à la perspective d’écouter un album de stoner italien sorti un peu de nulle part. C’est donc dans les lointaines ressources insoupçonnées d’un professionnalisme chevillé au corps qu’on s’attèle à l’écoute de ce disque. Pourtant l’adoubement du label Argonauta aurait pu nous mettre la puce à l’oreille, tant la sélection du label transalpin est la plupart du temps qualitative.
Le duo sarde propose un stoner rock somme toute assez classique, ce qui est, somme toute aussi, finalement devenu assez rare, au milieu de toutes les variations et hybridations proposées ces derniers temps. On aborde donc ces six morceaux (pour plus de 50 minutes de musique quand même – rien qui descend sous 7min30, la fameuse générosité sarde en œuvre) avec l’esprit ouvert et les esgourdes fraîchement nettoyées. On est très vite cueilli par ce son de guitare chaud et fuzzé qui sera la base de l’onctueux matelas dans lequel on se vautrera pour les nombreuses écoutes qui s’ensuivront.
Les deux iliens font donc la démonstration en six actes de leur capacité à écrire des compos mélodiquement efficaces et surtout une poignée de riffs bien mastocs : on a du mal à se sortir de la tête le refrain de “Yellow”, le riff subtilement dissonant de “Brain War” ou celui plus imposant de “Sunrise and Sunset”. Mais c’est aussi dans ses audacieuses plages mid-tempo, en son clair parfois, que Bentrees se révèle d’autant plus accrocheur, à l’image de ce “Dust’n’Gold” où ces arpèges de guitare rappelleront même le grand My Sleeping Karma.
Pas grand chose d’autre à dire par rapport à ce disque qui ne tienne en ces quelques principes : si vous appréciez le stoner old school, emmené par un duo de jeunes italiens sachant manier puissance et bonnes idées, dans un généreux bain de riffs fuzzés, il est probable que vous trouverez votre bonheur avec ce disque. Même s’il ne révolutionne rien, il propose son lot de bonnes ondes.
|
|