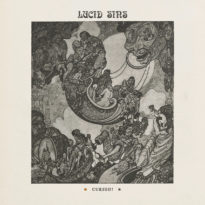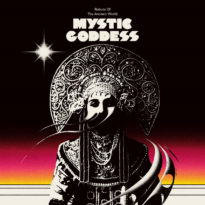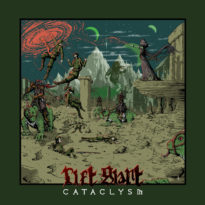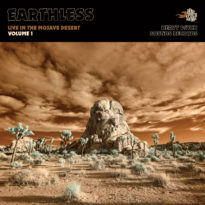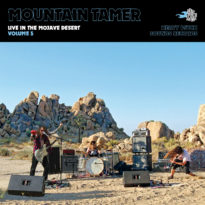|
|

Little Jimi est un jeune trio bordelais exempt de basse et signé pour The Cantos, sa seconde production, sur le label Mrs Red Sound. Rien que ça, un label qui produit notamment Witchfinder et Mars Red Sky devrait suffire à vous faire pardonner l’absence de basse et vous pousser à lire la suite de cette chronique.
En premier lieu arrêtons nous sur la pochette de l’album illustrée par les excellents Arrache Toi Un Œil et qui résume à elle seule l’album. Soit six chants épiques d’une aventure fantastique qui justifient le titre de l’album en convoquant les récits homériques et la tradition grecque de l’hymne itinérant.
En outre, Little Jimi c’est un peu le frangin tranquille de Little Kevin, là où l’on imagine que le personnage de BD se tapait des traces de sucre glace en écoutant du Motorhead à fond, le groupe qui nous occupe lui est un enfant serein, vivant dans sa bulle de longs voyages introspectifs et pleins de couleurs pastel en écoutant King Cirmson .
Pour qualifier The Cantos on évitera tout de suite la référence à Pink Floyd, argument trop évident en regard de la réalisation de Little Jimi et du space rock/prog en général. Ce qu’on retiendra plus volontiers c’est que le trio réalise un assemblage qui lui est propre et qui fonctionne à merveille.
Pour peu que l’on accepte de se laisser porter par la mollesse cotonneuse de l’esprit de l’album, on trouvera là un lieu de réjouissance à chaque écoute. La mesure est toujours pondérée mais la lourdeur s’invite régulièrement au cours des compositions qui ne se départissent pas pour autant de leur nature première. Comme dans “First Cantos” ou “Palace Afternoon”, de puissants instants complètent à merveille l’ouverture calme et systématique des pistes.
L’album The Cantos pris dans sa globalité est fait de morceaux qui s’imbriquent étroitement pour offrir à l’auditeur 42 minutes de cohésion dans un univers musical riche et immersif que l’on pourrait résumer dans le titre “Matchetehew”. (A titre personnel je retiendrai surtout le morceau le plus stoner et le plus percutant qu’est “Indian Rain”, une aventure à lui tout seul même s’il n’est pas des plus représentatifs.)
Le travail de Little Jimi sur The Cantos est assez surprenant, il navigue sur les eaux d’un consensus musical dans lequel on ne trouve de défaut que dans les qualités. Une galette sans aspérités, polie à souhait, fédératrice du plus grand nombre à n’en pas douter. Voyons à présent comment le temps passe sur ce beau travail de Little Jimi et surtout comment cet album sera défendu lors de sessions live qui nécessairement le dénuderont de sa structure globale et du très bon travail de mastering pour livrer les morceaux plus crûment qu’en studio.

Après deux disques passés relativement inaperçus, sortis chez Transubstans Records, Moon Coven se fait mettre le grappin dessus par le label US Ripple Music, plateforme intéressante pour permettre à ce jeune quatuor suédois de sortir du quasi-anonymat, avec cette troisième production, Slumber Wood. Et il ne faut pas longtemps pour réaliser qu’ils le méritent : très vite, leur musique captive l’auditeur, happé par ce son qui emprunte autant au doom moderne ultra mélodique qu’au psych le plus enivrant. C’est dans cette hybridation impeccable que Moon Coven trace sa voie, à grands coups de riffs lourds et entêtants, délicieusement fuzzés (les premières secondes du riff quasi-graveleux de “Further” suffiront à convaincre les plus obtus).
Ce faisant, le groupe se joue avec majesté des écueils des genres musicaux suscités, en évitant par exemple d’abuser des compos à rallonge qui ne racontent plus rien au bout de 3 minutes. Avec 8 titres pour 42 minutes, le format du disque est impeccable, et un seul morceau dépasse la jauge des 7 minutes. Les chansons défilant, les repères se dissolvent petit à petit : on capte pas mal de ce qu’on aime chez Mars Red Sky, c’est vrai (ce son lourd et ces mélodies entêtantes, ce travail de compo…), on pense aussi à Uncle Acid dans l’approche musicale visant à établir une proposition musicale cohérente et consistante, très incarnée, assumée… Au final, on se surprend à détecter des influences que le groupe n’a pas forcément (ces leads de guitare à la My Sleeping Karma sur le splendide “Bahgu Nag”, ce chant chargé de reverb à la Acid King, etc…), qui font finalement surtout écho à ce qui se fait de mieux dans le genre, tout simplement. Il y a pire façon d’appréhender un album, vous en conviendrez.
Si pour vous le doom ces derniers mois (années ?) tourne un peu en rond, Moon Coven est le groupe qu’il vous faut : loin du précepte comme quoi l’évolution d’un genre musical l’amène forcément dans ces extrêmes, les suédois développent une voie musicale plus audacieuse, pour un pari qui est déjà réussi. Derrière ce son – qui déjà justifie de se pencher plus que sérieusement sur ce groupe – Moon Coven tisse une série de compositions malines et efficaces, sans point faible, qui vont finir de vous hanter pendant des semaines et des semaines. Un disque qui ne paye pas de mine de premier abord, mais qui se révèle aussi infectieux qu’intelligent.

Il y a moins de trois ans, on avait pris une belle claque à l’écoute du délicieux premier ouvrage des suédois d’Alastor, Slave to the Grave. Album audacieux et mature de la part d’une jeune groupe qui transpire le potentiel, ce disque était probablement un simple avant-goût de ce que pouvait proposer le groupe à l’avenir. C’est donc armés de cette intuition qu’on se jette à corps perdu dans ce Onwards and Downards, toujours chez les obstinés et inspirés RidingEasy Records.
Comme son prédécesseur, le disque laisse avant tout lors de ses premiers tours de piste entrevoir son large spectre musical, les différents sentiers explorés par le quatuor, le tout baignant dans un son de guitare qui alimente le pouvoir de séduction d’Alastor – on ne peut pas résister à la gratte fuzzée de “Dead Things in Jar” ou poisseuse de “Onwards and Downards”. Ainsi ferré, l’auditeur se trouve engagé dans une séance ininterrompue de lecture en mode repeat du disque, rappelé chaque fois par une nouvelle compo favorite. Véritable compétence clé de nos jeunes scandinaves, cette inspiration (talent ?) donne toute son ampleur au disque, composé de chansons d’une incroyable efficacité. On pense forcément à ce “The Killer in my Skull” en intro (ce riff qui descend dans les tréfonds après sa première attaque), le heavy rock catchy de “Nighmare Trip” ou encore “Lost and Never Found”… Au milieu de ce dense agglomérat de compos de heavy doom rock réussies, “Death Cult” vient amener son groove frais et son tempo plus énervé sur un disque qui décidément ne manque pas de relief : indécemment accrocheur, il est difficile ensuite de chasser cette petite perle de sa cervelle. Autre coup de maître, le colossal “Onwards and Downwards”, 10 minutes de pur bonheur, traîne le riff de son couplet doom old school sans vergogne sur deux tiers du morceau, avant une percée de leads inspirée, qui nous ramène inexorablement à ce doom profond en conclusion.
Avec encore moins de déchets que sa production précédente, Alastor nous propose directement l’un des meilleurs albums des derniers mois, l’un des plus riches et l’un des plus intéressants. Proposant, à l’instar d’un Uncle Acid (dont il n’est pas toujours très éloigné), un doom rock à la fois fidèle à ses origines et fondamentalement intégré dans son époque, Alastor fait mouche. Malins et inspirés, les suédois signent encore un très beau coup. Et nous de regarder ce petit groupe devenir grand, discrètement.

Bientôt dix piges d’existence pour Atomic Vulture, et Moving Through Silence est seulement leur second LP. Quelques titres ici ou là et un EP (chroniqué ici) nous avaient tout à la fois fait saliver et garder patience. C’est par l’intermédiaire du très inspiré label compatriotique Polder Records que le trio sort son nouveau disque, sur lequel on a tôt fait de se jeter. Inutile de nous voiler la face aussi : avec la disparition de Karma To Burn (le décès de Will Mecum date d’il y a quelques semaines à peine) la perspective d’un riff rock inspiré nous apporte peut-être inconsciemment un regain d’intérêt pour le genre musical pratiqué.
Bon, déjà, pas de vraie surprise, on rentre dans ce disque comme dans un bon bain chaud, bien confortable : on retrouve le groupe à peu près où on l’avait laissé, à savoir sur un stoner instrumental qui fait plaisir à entendre. Le groupe mêle riff rock inspiré et plages plus variées pour un ensemble qui, même s’il ne se frotte pas vraiment aux limites de l’hétéroclisme le plus abouti, apporte un vrai souffle de fraîcheur et évite la monotonie.Évidemment, certains titres convoquent directement K2B (“Coaxium” et son riff de référence, “Intergalactic Takeoff”, “Spinning the Titans”…) mais le groupe va aussi taper ailleurs, et on se prend à entendre du My Sleeping Karma (“Cosmic Dance” avec sa ligne mélodique sur fond de basse ronflante), du Monkey3 (la seconde moitié de “Spinning the Titans”, la superbe envolée de “Space Rat”, “Astral Dream”…). Vous en conviendrez, il y a pires références !
Et c’est ainsi que le voyage proposé par ce vautour atomique nous embarque un peu sur tous ces sentiers, des chemins qui fleurent bon le riff fuzzé, toujours, et où l’ennui ne se fait jamais sentir. Le groupe n’est pas que la somme de ses influences, son talent d’écriture ne fait pas de doute, et a un vrai talent pour faire groover ses compos (ce plan à 8min sur “Astral Dream”, diantre…). Un groupe qui promet peu mais délivre beaucoup.
Enfin, ce second LP se sera quand même fait désirer… L’attente en valait-elle la peine ? Pour sûr. S’il n’apporte pas forcément une originalité énorme au paysage musical, ce disque apporte une sérieuse dose de jouissance auditive sans prise de tête – ce qui est probablement ce dont notre époque a le plus besoin.
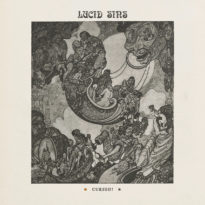
Totem Cat a souvent eu du nez lorsqu’il s’agissait de dénicher des groupes prometteurs, humant l’air du bout du monde, ramenant vers Brest, dans ses filets, les plus grasses mélodies. Si Egypt, Wo Fat, R.I.P. et surtout Dopethrone ont depuis eu un succès toujours grandissant (avec ou sans leur label d’origine), Lucid Sins eux n’ont pas connu la même trajectoire. Il faut dire que l’Écosse n’est pas la plaque tournante du rock, et Glasgow a beau être ouverte à tous les vents de culture, ce n’est pas souvent que la brise emmène ses ressortissants jusqu’à nos salles de concerts. ET POURTANT.
Et pourtant après un premier album, Occultation, se plaçant avec politesse sur les rails d’un rock occulte, 70’s, dans la lignée de ce que Witchcraft a (ré)inventé, Lucid Sins continue son chemin avec Cursed ! sans rien changer mais en étant en tout point meilleur que lors de son premier essai.
Si Witchcraft reste une évidente référence (de nombreuses similitudes vocales renforcent ce sentiment), l’héritage du riff à la Pentagram n’est en revanche ici pas prédominant. Andréas Jönsson développe des ambiances beaucoup plus progressives. Les guitares tissent des motifs occultes, pesants, dans les préoccupations du genre, mais le clavier de Ruaraidh Sanachan vient en contrepoint, formant des mélodies pop, adoucissant l’ensemble. On pense à Hawkwind un peu, à King Crimson beaucoup. Il y a ici une synthèse magnifique de toute une époque de rock libre, hypnotique et digressif mais totalement maitrisé. « Joker’s Dance » et « By Your Hand » s’assurent de nous servir des riffs solides et s’imposent comme meilleurs représentant de l’artisanat Lucid Sins mais il serait injuste de réduire l’album à l’efficacité de ces titres. « Cursed » et ses longues descentes de clavier, accompagné par de multiples césures rythmiques (et une signature vocale beaucoup plus personnelle) ou « Sun and the Moon », roulements de toms et guitares claires sont à mon sens les trésors cachés de ce disque, le genre de titres qui vous font revenir encore et encore, se révélant un peu plus à chaque écoute. Et si votre truc est plutôt les grosses Sabbatheries sans retenue, ne paniquez pas, « Snake Eyes » est là pour vous.
Je ne me fais aucune illusion sur le peu de retour de ce tout petit machin mais il prendra au moins place dans un top de l’année : le mien. Tant pis pour vous si vous passez à côté, vous ne pourrez pas me reprocher de ne pas vous avoir prévenu.
Point Vinyle
200 en orange, 100 en clear splatter. Encore un truc qui va couter 50 balles dans 2 ans.

Kyuss bien entendu, Mondo Generator évidemment, mais aussi Kyuss Lives !/Vista Chino. Bref, Brant Bjork et Nick Oliveri n’ont jamais cessé de se croiser durant leur carrière. L’un accompagnant l’autre et vice-versa pour de multiples projets et tournées dont le point commun si l’on devait le trouver se résumerait en un mot : stoner.
Les deux compères accompagnés de Ryan Güt à la batterie (qui joue avec Brant depuis quelques années) se réunissent une fois de plus pour un nouveau projet au nom qui est donc plus qu’évident : Stöner.
Enfonçons le clou en vous donnant le titre de l’album : Stoners Rule.
La découverte n’est pas totale puisque cette sortie suit celle du Live in the Mojave Desert / Volume 4 avec au final le même contenu. Si d’ailleurs vous avez investi (à juste raison) dans ce Live, la version studio n’apporte pas de plus-value particulière et elle n’est pas forcément indispensable, soyons honnête. Dans le cas contraire, si vous n’avez pas été conquis par le live au point de l’acheter, difficile de vous convaincre que la version studio est un incontournable.
Mais revenons dans la configuration classique d’une chronique d’album, faisons comme si je devais vous convaincre de la nécessité impérieuse d’investir quelques euros dans l’achat de cet album.
Pour commencer, les compos sont assez bien foutues. On reste sur du basique en la matière avec la touche Brant Bjork hyper présente mais c’est dans ce que Mr Cool a pu sortir de mieux depuis longtemps. Ne minimisons pas le rôle de Nick qui a su apporter sa patte plus ou moins reconnaissable (“Evel Never Dies”) pour donner un petit côté plus authentique. On est donc avec une série de titres qui installent tranquillement des riffs guitare et basse assez sympas et qui vous feront à coup sûr dodeliner de la tête (c’est le headbang des presque 50 piges). Cinq des sept titres tournent au-delà des cinq minutes (avec le dernier dépassant le quart d’heure). Le trio prend donc son temps pour placer son jeu, nous laisser entrer dans le rythme et profiter. “Nothin’” et “Evel Never Dies” sont plus directs et assez bien pondus, le deuxième en particulier qui lorgne du côté punk. Finalement, c’est assez varié et ça s’enchaine très bien.
La production de son côté est dans la moyenne de ce qui se fait maintenant, c’est-à-dire sans fausse note. J’ai une préférence pour la prod de l’album live (surtout sa version vidéo) qui met un peu plus la basse devant avec un son plus brut mais le tout est quand même bien ficelé dans cette version studio.
Stöner nous offre donc avec Stoners Rule un disque de… Stoner bien sûr dans son approche la plus simple, la plus pure. On ne recherche pas la fulgurance mais juste l’envie de se faire plaisir. Pas de solo démoniaque, pas de changement de rythme hallucinant, pas d’envolée lyrique, non, juste de la musique à la cool, qui sonne bien et qui fait plaisir.
Ne cherchez pas ici un album révolutionnaire qui écrit un nouveau chapitre de l’histoire du genre. C’est juste trois potes qui n’ont plus rien à prouver et qui s’amusent avec un album qui définitivement est assez réussi.

Productif, c’est sans doute ce qui qualifie le mieux King Buffalo qui nous avait gratifié d’un EP, Dead Star, début 2020 et d’un Live at Freak Valley à la fin de la même année. Le trio américain survolté par tant d’actualité est rentré en studio durant la pandémie au lieu de se laisser aller au marasme du confirment. Ils y ont produit suffisamment de matériel pour un triptyque dont The Burden of Restlessness sera le premier volet. Une affaire à suivre et qui ne devrait pas trop traîner puisque les trois tableaux seront disponible dans le courant de cette année.
La grâce de King Buffalo tient beaucoup à la voix de Sean McVay dont la tonalité et la justesse est une perle rare dans un univers musical où trop souvent on se laisse aller à l’approximation. Même si cet aspect est une constante du trio, il n’est jamais vraiment où on pourrait l’attendre et va crescendo durant toute la galette pour finir en apothéose sur “Loam”.
Il y a bien sûr des points déstabilisant sur The Burden of Restlessness comme sur “Silverfish” et “The Knocks” qui ont en commun les sonorités surprenantes d’une guitare à la limite de l’exaspération. Le genre de riff malicieux qui vient tapoter du bout de la note sur l’encéphale jusqu’à ce qu’on en puisse plus. Ajouté à cela que quasiment toutes les pistes jouent sur la répétition de phrases simples au dehors presque post-rock, on aurait tôt fait de qualifier l’album de lourd. Néanmoins c’est une sensation de force qui se dégage de ce (seulement) troisième LP, à l’opposé de beaucoup de productions de ces derniers temps. Il ressort de cet opus une sensation de lumière et de délicatesse à la fois.
Le propos s’illustre à merveilles avec “Locust” qui démarre sur quelques notes qui pourraient glisser vers le fade ou le larmoyant mais lorsque ces dernières se délient, que la voix prend de l’altitude, quand la basse se libère du carcan d’une ligne presque électro et que la batterie anime l’ensemble la magie opère et la lumière se fait. Un monde de psychédélisme moderne et radieux s’offre à l’auditeur et il semble que cela ne soit qu’un début et une fois de plus c’est le titre “Loam” qui vient placer haut la barre de ce qui reste à suivre.
Qualitativement ce premier panneau de triptyque annonce la couleur, une musique en place, un sens aigu de la composition et un mix tout simplement parfait pour mettre à l’honneur chacun des instruments. Une mise en bouche qui loin de rassasier, ouvre l’appétit et présage du meilleur pour la suite.
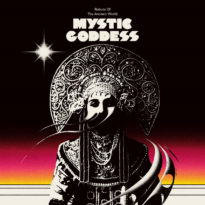
Small Stone records n’est plus que l’ombre de la figure de proue flamboyante qu’il était pour toute la scène au cours de la première décennie de ce siècle. Il faudra un jour se pencher sur ce chavirement brutal, qui nous a laissé un peu orphelins… Pour autant le label n’est pas mort, et Scott nous le rappelle à l’occasion de quelques plus discrètes sorties par an, souvent remarquables. Vous connaissez l’adage sur la qualité et la quantité… Le bonhomme n’a donc pas perdu son nez de découvreur, et il a pêché cette fois une jeune formation de Portland, un quintette auteur d’un premier album en autoprod il y a deux ans, et qui sort aujourd’hui sur le label son second LP, plus d’un an après l’avoir enregistré (!) sous la houlette du respectable Jack Endino (grand producteur d’albums parfois médiocres). Bonne pioche…
Mystic Goddess donne lors des premiers tours de piste l’impression d’un album décousu, qui se cherche. Rien n’est au final moins faux. ROTAW (pardonnez cet élan de familiarité) est en fait un groupe complexe en un sens, ce qui peut désarçonner. Si aucune ligne directrice franche n’émerge des premières écoutes de ce disque, c’est parce que le quintette ratisse large dans le spectre du stoner US, tendance heavy rock US – un style qui, soit dit en passant, occupe une large part du catalogue du label. Un peu casse-cou, le groupe se frotte autant au stoner doom (“Mystic Goddess”) au heavy nerveux (“Out of the Gallows”, “Agua Caliente”), et batifole joyeusement avec un stoner groovy plus classique (“MK Ultra Violence”) ou même de l’ésotérisme acoustique (“Ordo Ab Khao”). Fait remarquable : ROTAW fait partie des très rares groupes qui excellent dans l’exercice casse-gueule du mid-tempo : écoutez le très mélodique “Wasteland” ou ce “Unholy Trinity” aux accents Danzig-iens pour vous en convaincre (et de la part de votre serviteur, ce n’est pas un compliment anodin).
On retrouve par ailleurs chez ROTAW un autre facteur clé propre à beaucoup des groupes de Small Stone : un vrai chanteur ! (qui ne tient aucun autre instrument qu’un pied de micro, soit dit en passant, assez rare aussi pour être signalé…) Les vocaux de Caleb Weidenbach emmènent vraiment les compos sur un terrain plus ambitieux, apportant via son timbre parfois surprenant, une identité plus marquée au groupe. Les autres musiciens, sans émerger autant, sont très bien servis par un enregistrement et une prod, effectivement, aux petits oignons. Même si Endino, capté en plein vol par le Covid, n’a pu superviser que le début de l’enregistrement, la mise en son est de grande qualité.
Ça fait plaisir de retrouver un Small Stone toujours actif et pertinent en découvreur de sang frais, surtout avec des disques de cette qualité. Un disque qui ne cartonnera probablement pas sur les plateformes de streaming, et plus globalement dans cette sombre période, où les avis sont faits au bout d’une écoute de 30 secondes de chaque chanson en mode accéléré, mais qui saura satisfaire l’amateur éclairé de bon stoner rock US (nord des USA pour les puristes) underground.

Monster Magnet ne semble pas près de clôturer cette presque-décennie quelque peu “flottante” dans sa discographie : un seul album studio “normal”, 2 ré-interprétations de leurs albums et aujourd’hui, donc, un album de reprises. D’où provient donc l’intention qui a présidé à la naissance de ce véritable covers album (leur premier) ? Un peu paradoxalement, d’une vraie réaction à l’ennui, apparemment… Dans la torpeur covidienne de ces derniers mois, le sursaut semble avoir jailli d’une prise de conscience collective : le groupe (comprendre : Dave Wyndorf) s’encroutait, il était temps de trouver une bonne occasion de rebrancher les amplis. Avec zéro compo sous le bras (et aucune perspective d’inspiration dans ce sens : le Covid, ça vous gagne…), l’idée a rapidement germé d’engager la petite équipe dans le studio de Pantella quelques jours à l’arrache, pour y interpréter quelques vieux titres, de ceux qui hantent Wyndorf depuis ses premiers émois pubères. Une vraie dystopie donc : tandis que dans le “vrai monde” les forces créatrices de Wyndorf sont neutralisées par un virus mondial sclérosant, que l’ambiance générale est morne et créativement castratrice, le groupe trouve une porte de sortie à travers un environnement musical qui n’est pas directement le sien, via un ensemble de compos d’un autre temps, un temps plus simple, stimulant, naïf presque. L’occasion à la fois d’un retour aux racines et d’un coup de pied aux fesses pour aller de l’avant.
Comme tout album de reprises, la qualité de l’objet s’évalue à l’aune du choix des chansons, d’une part, mais aussi de la qualité et de la nature de l’interprétation qui en est proposée. Sur le premier critère, il est nécessaire d’écouter copieusement l’album pour se faire une idée, car si certains titres sont bien connus (les reprises de Hawkwind, de Pentagram, de Josefus…) d’autres sont bien plus confidentiels. Bénéfice pour Monster Magnet : on apprend à connaître les chansons via l’interprétation du quintette du New Jersey, avant d’entendre les originaux ; un coup d’avance pour nos lascars. Et du coup, le charme opère : on a l’impression bien souvent d’évoluer avant tout dans l’univers de Monster Magnet, ce qui a construit leur base musicale (essentiellement celle de leur pilier incontesté – Wyndorf). “Solid Gold Hell”, “Mr Destroyer”, “Situation”, “Learning to Die”… auraient pu figurer sur une production de l’aimant magnétique, la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre. Les autres titres évoluent fort logiquement dans des sphères musicales plus ou moins variées, allant du psych/kraut rock au punk / garage, en passant par le heavy doom de Pentagram (via une interprétation de “Be Forewarned” moins lugubre certes, mais assez respectueuse au final). Au delà du paysage général dressé par cette délicate sélection, pris séparément, l’intérêt des morceaux est hétéroclite malheureusement… mais rétrospectivement, c’est aussi le cas de la plupart des albums du Magnet : il y a toujours un ou deux titres un peu approximatifs, moins intéressants… C’est le cas ici avec quelques morceaux sans intérêt énorme (“Solid Gold Hell” des Scientists, “Death” des Pretty Things…). En contrepartie, une poignée de titres tirent vraiment le disque vers le haut : on pense au “Born to Go” de Hawkwind bien sûr, “Mr Destroyer” de Poobah, le réjouissant “It’s Trash” (The Cave Men) et ce surprenant (car très récent, lui) “Motorcycle (Straight to Hell)” des Table Scraps, tout en binarité punky psyché (!).
Autre prisme d’écoute d’un album de reprises, l’interprétation est le pilier de ce disque : on n’abordera même pas le talent instrumental, sans objet ici. En revanche, dès les premières écoutes on est absorbé, emporté par la “patte” Monster Magnet, omniprésente, signe encore une fois du poids de l’identité du groupe, qui absorbe tout ici. Tout ce qu’ils touchent se retrouve assimilé, retranscrit au travers de la musicalité propre au quintette. Si bien qu’au bout de quelques tours de disques, on se retrouve à évaluer ce disque au même titre qu’un de leurs propres albums : les identités des groupes repris s’effacent peu à peu. Vraiment, c’est le phénomène majeur adossé à ce disque : l’assimilation sonore, musicale, est bluffante.
A Better Dystopia, œuvre d’un groupe au sommet de sa maturité, est une réussite : Monster Magnet évite toutes les chausse-trappes qui se présentent habituellement à un groupe qui se frotte à une reprise, avec une adresse qui force le respect. Mieux, ils transcendent l’exercice en assimilant parfaitement les compos choisies, proposant un ensemble cohérent et dans la droite lignée musicale de leurs récentes productions. Du coup, loin d’être un accroc ou une simple parenthèse dans leur discographie, A Better Dystopia risque bien, d’ici quelques temps, d’en être considéré comme un de leurs disques “normaux”. Un disque imparfait, clopinant ici ou là, mais disposant d’un sacré paquet de points forts. Une très bonne surprise en tout cas, fraîche et bienvenue dans le contexte actuel, qui nous invite toutes et tous à envisager ce même voyage dystopique et à s’y perdre quelques heures…
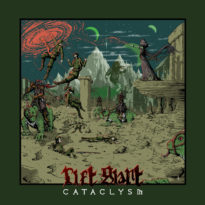
Deux Danois, une paire de gros riffs qui tachent et une voix sludge bien glaireuse, voilà ce que contient Rift Giant. Pour son second LP le duo a choisi le doux nom de Cataclysm. Pour l’anecdote, l’album a été enregistré dans un bunker de la seconde guerre mondiale. Finesse et légèreté au programme donc.
Rift Giant distribue les poutres à coup de blasts de batterie et de gros riffs velus. On notera donc un certain sens de l’à-propos en ayant choisi le patronyme Cataclysm pour l’album. Les deux premiers titres envoient ce qu’il faut de violence pour mettre l’auditeur dans le bain. Mais qu’on ne s’y trompe pas, les gonzes savent jouer avec le tempo et ralentissent sur “Queen Witch” ou “Cataclysm” dans une plaque qui sous des dehors bourrins sait aussi mettre en exergue une certaine “finesse”. (Ne t’attends pas non plus à la légèreté du bruissement de l’aile du papillon hein, y’a du poil autour et ça sent fort quoi qu’il arrive.)
Côté style on navigue un peu en dessous de ce qu’a pu proposer parfois High on Fire et une orientation à la façon de The Necromancers. Sur de telles voies, autant dire que si on n’a pas un must on est pas loin d’avoir entre les esgourdes une plaque des mieux foutue. Il y a malgré tout dans ce Cataclysm sans doute trop d’efforts dans la voix pour tenter l’auditeur de revenir très régulièrement vers cet album et cela minore le malheureusement une galette où le reste est plutôt bien en place.
Au registre des bons points distribués, cependant, on ne pourra que saluer un goût immodéré de l’épique qui ne glisse jamais de trop vers le carton-pâte, un variation rythmique constante qui agrège stoner, doom, death, black (“To Three” est une belle illustration de ce par quoi passent les deux gars en très peu de notes) et une succession des touches de violence défouloir qui peuvent virer au pogo sur “Block Out The Sun”, un titre crasseux et sludge comme on les aime.
Rift Giant donne à entendre un Cataclysm qu’on aurait bien aimé pouvoir recevoir dans une fosse. Cet album veut de la sueur et des hurlements, il est taillé pour la bagarre physique plus que pour la platine. C’est quand déjà le prochain concert?

Un premier volume de Bow To Your Masters avait rendu hommage à Thin Lizzy, cette fois la compilation cover s’attaque à Deep Purple. Enfin un hommage stoner à ce groupe auquel on devrait accorder des temples! Enfin une prière à la gloire du Violet Profond! Ouai enfin c’est bien beau sur le papier mais Deep Purple hante tant de groupes de la scène stoner doom que la tâche semble immense. Une question me tarabuste, est-il possible de reprendre Deep Purple? En mettre moins c’est trahir l’ensemble, en mettre plus serait indigeste. Pour les Puristes il faut savoir que l’album ne compte pas un morceau en dehors des formations Mark II et III ce que beaucoup considèrent comme l’âge d’or de Deep Purple.
La plaque se divise en trois catégories, les dispensables, les hommages et les essais transformés parmi lesquels on repère forcément les plus grosses têtes d’affiche. Du côté du dispensable il y a un lot de quelques groupes qui produisent des reprises de bonne facture mais qui à vouloir remanier l’œuvre ratent le coche. Big Scenic Nowhere fait partie de la fournée, livrant une reprise mollassonne de “Demon’s Eye” qui se voudrait plus doom que hard rock, où la sauce ne prend que difficilement. Mos Generator de son côté frôle le Kitsch sur “Love Child” qui en soit n’est déjà pas la plus grande réussite de Deep Purple et ne tient principalement que grâce à son originalité funk. Mos Generator semble complètement passer à côté du morceau. Ces deux têtes d’affiche font un job honorable mais sans beaucoup de sel. En fond de cours, Gygax entonne un “Speed King” bien exécuté qui, sans être une copie conforme, effleure notre plaisir sans que l’on ne parvienne à exulter.
La première surprise vient d’un des groupes qui réalisent des reprises hommage qui ne bougent pas beaucoup les lignes mais apportent tout de même un feeling appréciable. Ainsi derrière la reprise de “Black Night” par Topsy Kretts dont le nom cache l’union de membres de Crobot, et Mothership entre autre. Le super groupe surprise fait la part belle aux jeux de guitare et se laisse submerger par un enthousiasme communicatif. Coté voix il fallait bien un Brandon Yeagley de Crobot pour assurer aussi bien que Ian Gillan sur ce titre. Dans le panier des super groupes à base de Mothership il faudra aussi retenir la prestation Temple of Love qui reprend “Gettin’ Tighter”et l’enrichi de l’esprit du funk.
High Reeper tire également son épingle du jeu et vient garnir de sa lourdeur “Burn”, le ralenti tout en réanimant les lignes de basses apporter une touche aérienne au chœurs avec une section féminine qui supplée aux tessitures d’origine tout en répondant à une gratte résolument hard rock lorsqu’elle attaque les prémices d’un solo. A côté de ces réussites honorables, Steak livre une reprise assez originale de “Smoke On The Water” sur base de blasts enflammés. Mais Il faut dire qu’un morceau fondu dans l’histoire du Rock ne se laisse pas dompter aussi facilement. L’ensemble tient quelques promesses mais à vouloir aller trop loin dans la réinterprétation les anglais se brûlent le bout des ailes, sur ce titre ré intitulé “SMOKE”.
Arrivent enfin les réussites, des reprises qui transforment l’essai. A ce titre, “Child In Time” est LE morceau original de cette compilation, sans excès Asphodel Wine réinterprète la sublime d’un titre incontournable tel un chœur de pythies macabres auxquels on aurait offert de don de jouer du violon. Plus qu’une reprise, c’est un pari dont vous serez juge (ou non) de la réussite. Moins original, Worshipper ressuscite “Picture Of Home”, faisant le choix d’un morceau linéaire qui balance juste assez que pour l’assaisonner de sauce pimentée facilement, une basse homérique qui écrase tout sur son passage et la mélodie des voix prennent l’auditeur entre charybde et Sylla. Un hommage digne de ce nom qui balise le terrain pour Yob vient clôturer judicieusement la plaque. Judicieusement d’une part car la reprise de “Perfect Strangers” est d’une lourdeur sidérale et confirme la volonté de Glory or Death Records de produire une galette fondamentalement stoner doom et d’autre part parce que le morceau est le seul représentant de la reformation du Groupe avec son line-Up Mark II après 1984 et en soit une fin du groupe.
Que dire de ce Bow To Your Masters – Deep Purple si ce n’est qu’il est Indispensable car il rend hommage à un des groupes fondateurs du metal au sens large et à un groupe qui a transmis son héritage au stoner. Un album indispensable certes mais aussi parfaitement inutile, car rien ne remplace l’original qui à lui seul a atteint les sommets d’un genre dont il est un des parents. Un indispensable inutile qu’il faut se dépêcher acquérir car la plaque vaut quand même le détour et ses inégalités ne font que renforcer une idée, celle que Deep Purple est un groupe unique et inimitable, un groupe historique qui telles des fondations supporte depuis plus de cinquante ans le poids de ses milliers de successeurs.

Le trio hypnotique de suédois de Domkraft vient déposer son offrande annuelle sur l’autel du doom. Il faut dire qu’ils n’ont pas chômés l’an passé, entre EP et leur participation au Live at Day of Doom, nous n’avons raté aucune de leurs sorties. Cette fois encore nous espérons nous repaitre de leurs compositions sur le tout nouveau Seeds.
Seeds est dans la continuité du précédent LP, Flood, à croire que Slow Fidelity qui partait vers quelque chose de plus mélodique dans les voix, n’aura été qu’un intercalaire. On est donc en terrain connu pour cet album, la qualité du groupe s’exprime toujours aussi pleinement. Un doom sombre, apocalyptique pétris de riffs aussi pachydermiques qu’aériens, la prouesse vaut le détour.
Si la voix se perd un peu sur “Perpetuator”, elle n’est jamais autant jouissive que lorsqu’elle explose sur “Tremors” ou s’envole sur “Into Orbit”. Les riffs pleuvent comme des pierres venues du ciel, incandescentes et ne semblant vouloir jamais s’arrêter de tomber. Pourtant les plages atmosphériques sont bien présentes entre deux nuées ardentes. Les pistes savent prendre aux tripes. Elles deviennent alors lancinantes et maladives, on y laisse divaguer son spleen au gré des notes et saillies de Domkraft. Les plus parfaits exemples de ce savoir-faire sont sans conteste “Dawn of Man” et “Audiodome” même si ce dernier titre contient un je ne sais quoi de positif qui laisse un peu d’espoir en germe chez l’auditeur, belle manière de conclure Seeds.
Ce nouvel album est pile dans la zone de confort de Domkraft. Un savoir-faire éprouvé; un artisanat qui tend à s’industrialiser mais qui fait toujours mouche. Ça tombe bien on ne leur en demande pas plus (C’est déjà beaucoup!). Amateurs des albums précédents je ne peux que vous recommander de faire l’acquisition de cette nouvelle plaque qui vous permettra de prolonger l’expérience et complétera à merveille votre discothèque. Et puis de vous à moi, s’offrir Seeds rien que pour l’artwork psychédélique au delà du raisonnable à regarder avec des lunettes 3D cela n’aurait rien de choquant.
Même si ces dernières semaines furent rythmées par les sorties “pluri-médias” autour de cette série “Live in the Mojave Desert”, un rappel succinct du dispositif apparaît utile : Ryan Jones, amateur de stoner et organisateur des festivals Stoned and Dusted dans le désert californien, s’est vu fort marri (et un peu frustré) de voir le COVID venir l’empêcher de tenir son événement annuel. Pas défaitiste, et après un galop d’essai opéré grâce au film/DVD live “Live at Giant Rock” de Yawning Man (chronique ici), le bonhomme engage avec son asso un projet ambitieux, mais parfaitement adapté à cette période de confinement quasi-généralisé : il va faire jouer 5 groupes de son choix dans le même contexte (un spot idyllique dans le désert de Mojave), sans public, mais avec caméras et ingés son. Il proposera ensuite ces live en film (streaming événementiel), disques, et probablement DVD bientôt. Sans les flux vidéo (trois vidéos ont été chroniquées dans nos pages, les liens sont ci-dessous), les versions audio perdent évidemment une dimension importante (le contexte incroyable du lieu, les effets visuels…). Par ailleurs, il reste difficile de parler de ” disque live” comme l’entend l’usage, car il n’y a pas de public ! Néanmoins, la captation est effectuée d’un bloc, en direct, sans overdubs, ce qui justifie sans ambigüité le qualificatif. Les disques sortent les uns après les autres sur ce mois d’avril, on vous en propose donc une dissection “en bloc”, disque par disque, ci-dessous.
EARTHLESS
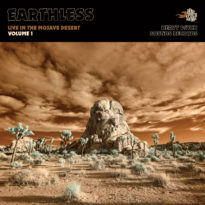
(chronique du livestream ici)
Pas de meilleure entrée en matière possible que de faire jouer Earthless : au delà de la légitimité apportée de fait par les géants du jam rock US, la musique du groupe se prête parfaitement au contexte d’isolation en plein désert. Le trio US n’a pas usé trop d’encre à rédiger la set list du concert : trois chansons seulement… pour plus d’1h15 de concert quand même ! Le duo “Violence of the Red Sea” / “Sonic Prayer” a beau ne pas vraiment surprendre, l’interprétation est simplement somptueuse. La prise de son est stupéfiante, ce qui, jumelée à une maîtrise de plus en plus remarquable chez Earthless, rend probablement ce disque le meilleur de leurs sorties live (le groupe en a déjà une poignée).
On ne va pas vous décrire Earthless par le menu, mais la place accordée à la base rythmique dans le spectre sonore est juste impeccable, laissant à l’insolent Isaiah Mitchell tout loisir de proposer des soli/impro de plusieurs dizaines de minute en complète roue libre, avec un talent qui laisse pantois (le gars n’en met pas une à côté).
Le groupe finit son album par un morceau plus rare, “Lost in the Cold Sun”, étirant les 20 minutes originelles de ce titre en rien moins qu’une plage de 40 minutes ! Le titre, plus lent que les autres sur sa première moitié, est l’occasion d’explorer quelques facettes un peu plus orientales de la musique du combo, mais la même recette est appliquée. Le constat global ne change donc pas : ce live est en tout point remarquable, et rend bien honneur aux qualités musicales du trio californien.
Note : 8,5/10
NEBULA

(chronique du livestream ici)
Nebula n’a pas de vrais live dans sa discographie, lui, contrairement à Earthless, mais il a déjà un “live sans public” (Peel Sessions). Mais bon, 13 années sont passées dessus, quelques ajustements de line up, un gros break, et quelques albums… donc autant le dire : le terrain est propice. D’autant plus que l’on connaît le talent de Nebula en live : le groupe sait s’appuyer sur sa solide discographie pour décliner des séries de titres et les adapter à l’humeur du jour, avec une forte dose d’impro, toutes proportions gardées (toujours l’ombre d’Earthless, même si le genre musical n’est pas très proche). Le set du jour dure 50 minutes, un créneau ramassé dans lequel le trio arrive à rentrer 10 titres, dans une interprétation tout simplement parfaite pour le format : on n’est jamais dans l’interprétation stricte des morceaux d’origine, mais on ne dérive jamais non plus dans les jams risquées de 15 minutes.
Côté set list, le trio californien (qui est venu en voisin) a largement choisi de mettre à l’honneur son récent LP, Holy Shit – pas forcément une mauvaise idée, on connaît la qualité du disque. Mais il n’oublie pas d’injecter quelques classiques (“To the Center”, “Giant”…) voire même quelques raretés (“Perfect Rapture”) pour apporter tout le piquant que l’on retrouve toujours sur leurs prestations scéniques. Le reste de la recette est connu : Tom Davies dresse une chape rythmique solide et des bases mélodiques impeccables pour permettre à Eddie Glass de se lancer dans des soli plus ou moins structurés, mêlant blues et space rock (cette Wah-wah…), souvent sur la brèche mais finalement toujours propres.
Encore une fois bien aidés par une mise en son au cordeau, ce live, moins impressionnant que celui de leurs prédécesseurs dans l’exercice, apporte en revanche une image très fidèle des prestations live du groupe : imprévisibles, vivantes (quelques discrets pains ici ou là), efficaces et souvent jouissives.
Note : 8/10
SPIRIT MOTHER

Le groupe le moins connu de la série est probablement Spirit Mother : le jeune quatuor n’a même pas un album entier sous le bras, mais ils parviennent quand même à assurer un set de 35 min (pour 10 compos quand même), belle perf. Musicalement, le groupe a bien des arguments à faire valoir, même si le genre musical pratiqué laissera sur sa faim les amateurs de gras et de fuzz : le groupe évolue dans une sorte de rock vaguement psyché ici ou là, piochant dans pas mal de genres musicaux. Ils se distinguent surtout par l’apport d’un instrument à corde assez atypique, avec une violoniste qui apporte une dimension vraiment à part à la musique du quatuor, c’est indéniable. Ça sonne un peu comme un gimmick au début, mais finalement l’ambiance qui en ressort est très particulière, ça fonctionne bien.
Soyons honnêtes : j’étais prêt à mépriser ce disque, la première écoute me faisant penser à un de ces groupes de rock indé vaguement goth avec un violon-gadget utilisé pour cacher la misère. Mais il n’aura fallu qu’une poignée d’écoutes pour me faire attraper par plusieurs des compos très efficaces de ce jeune quatuor finalement assez prometteur (même si leur rattachement à notre “scène” musicale reste questionnable). A suivre.
Note : 7/10
STÖNER

(chronique du livestream ici)
Probablement la galette la plus attendue (ou en tout cas la plus hypée) de la série, ce live constitue la première sortie sur disque de Stöner, groupe formé par le duo Brant Bjork / Nick Oliveri (avec le batteur de Brant pour finaliser le line-up). Passons outre le sobriquet, trouvé après quelques onéreuses sessions de brainstorming avec un cabinet de consultants en marketing, et concentrons-nous sur la musique : on s’attendait à une sorte d’hybride improbable entre la musique de nos deux musiciens emblématiques, ben on n’a rien de tout cela – Stöner sonne en réalité comme un disque de Brant Bjork avec la basse mixée un peu plus fort que d’habitude ! Ça en est presque gênant, les apports de Oliveri sont absolument transparents et sans relief : hormis sa basse trop saturée, on n’entend que les compos de Bjork. D’ailleurs, gageons que le disque aurait sonné pareil (mieux ?) avec le même mix de basse appliqué à Dave Dinsmore, par exemple, le bassiste habituel de Brant. Seul morceau d’engeance Oliveri-enne, l’insignifiant “Evel Never Dies”, seul titre chanté (beuglé) par le grand chauve, saura satisfaire les amateurs de riffs indigents et de mélodies insipides – une compo qui trouverait sans problème sa place dans l’un des multiples disques interchangeables de sa discographie.
Mais au global, ça marche bien, ou en tout cas plusieurs titres fonctionnent très bien. On citera par exemple le bien groovy “The Older Kids”et surtout le superbe “Stand Down”. Sans parler du gros “Tribe / Fly Girl” (13 min) qui ravira les amateurs des plans jams et impros du grand guitariste frisé. Il y a aussi quelques titres en deçà, à l’image de ce geignard “Own Yer Blues”.
Mais au global, le disque passe bien, et même s’il est inégal, une poignée de titres justifie de faire figurer ce live à une place honorable dans la discographie de Brant Bjork.
Note : 7.5/10
MOUNTAIN TAMER
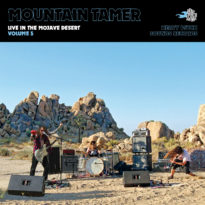
Le dernier disque de la série met en avant un autre groupe moins connu, même si le trio californien a quelques années au compteur. En tous les cas, en terme de style musical, Mountain Tamer est peut-être le groupe pour lequel l’intégration dans le contexte paraît la plus naturelle : leur musique psyché et les ambiances vaporeuses développées par le groupe rendent le tout bien trippant. Niveau concert, on peut néanmoins être surpris : le groupe nous délivre sur moins de 40 minutes de concert 6 des 7 titres de son dernier album (excellent, il est vrai, on vous en avait d’ailleurs parlé ici), dans le désordre certes, et avec quelques petites adaptations ou digressions, mais globalement assez fidèlement à l’enregistrement original. Du coup, la pertinence du live n’est pas forcément évidente… Le set se termine par deux extraits de leur avant-dernier disque, un peu plus “matures” en terme d’interprétation live, mais pas fulgurantes non plus.
Le sentiment est donc plus mitigé avec ce cinquième disque : le groupe est bon, les morceaux sont bons, mais la valeur ajoutée de leur passage en live “audio only” n’est pas forcément décisive. Le disque ne peut même pas faire office de “best of” de leur carrière, étant essentiellement une resucée de leur dernier (et récent) album. Dommage, le groupe semble mériter mieux, en particulier dans un contexte de “vrai” live probablement… à tester (dans quelques mois…).
Note : 6.5/10
Si l’on devait faire un bilan de cette opération pour la partie “audio”, il serait largement positif : chaque disque est différent, et le line up global est quand même remarquable (de la valeur sûre, du vrai groupe “découverte”, des inédits…). Ramené au contexte (pour rappel il s’agit d’une pure opération “100% COVID”), force est de constater que le package proposé est non seulement parfaitement adapté, mais foncièrement original, ne ressemblant finalement à rien d’autre. Alors quand en plus la qualité (musicale et auditive, le son étant nickel de bout en bout) est au rendez-vous, il devient difficile de trouver de gros défauts au projet. Ne gâchons pas notre plaisir, donc, et replongeons nous dans ces live “décalés”…

« Plan 9 from outer space », « L’attaque des tomates tueuses », « Dead sushi », « Sharknado »… Si ces titres de films ne vous parlent pas, c’est que vous n’êtes pas des adeptes de séries B, voire de séries Z. Ces longs-métrages, faits avec des bouts de ficelle et joués par des acteurs qui ont probablement séché les cours de théâtre, sont adorés et adulés des amateurs de cinéma underground qui s’éclatent lors de soirées entre potes (je vous conseille d’ailleurs le concept, c’est très fun). Les gars d’High On Wheels, trio parisien déjà responsable de l’album « Astronauts follow me down » en 2018 (dont la chronique du collègue Sidney est disponible dans ces colonnes), ont donc décidé de rendre un hommage à leur manière à ce genre cinématographique par le biais de leur nouvelle superproduction intitulée Fuzzmovies.
Nous sommes en février 2020. Les 3 gaillards s’enferment dans un petit studio au fin fond de la Normandie et en un week-end, l’album est enregistré (une légende urbaine tenace raconte même que les voix auraient été couchées sur bande après qu’une bouteille de Don Papa ait été entièrement sifflée…). Bref, tout est en place, tout est sur bande, ne manque plus que le nerf de la guerre : le pognon. Nos amis lancent donc un financement participatif sur une plateforme dédiée (pratique de plus en plus en vogue, votre serviteur en sait quelque chose…) afin de récolter assez d’argent pour concrétiser leur projet en physique. C’est un succès, les précommandes sont enregistrées, la fabrication de l’album est lancée et Fuzzmovies débarque donc ce vendredi sous un artwork qui rend hommage à tout un pan de la culture ciné underground.
Du coup, Fuzzmovies, ça ressemble à quoi ? A vrai dire, à pas grand-chose de connu mais dans le bon sens du terme… Accueilli par la douce voix de Tura Satana, sublime prêtresse SM toute en cuir et en nibards, l’auditeur est cueilli à froid avec Blind your mind, une ogive nucléaire dégoupillée en guise d’apéro. 8 minutes et trente secondes de plaisir heavy rock à son apogée. Pour un premier titre, High On Wheels fait très fort ! La suite est du même tonneau : on navigue dans les eaux heavy-desert-stoner avec des compositions juteuses à souhait et dégoulinantes de fuzz, le tout saupoudré d’interventions samplées dans des films comme « Rocketship X-M » (sorti en France sous le titre « 24h chez les martiens »), « Blood feast » (considéré comme le premier film gore de l’histoire), le cultissime « Hitman the cobra » qui donne son nom à une machine à headbanger qui risque d’en dénuquer quelques-uns en concert (parce que oui, ça va bien reprendre un jour, merde !) ou encore « Satan’s sadists » (excellent film de bikers) et « Cannonball » (avec David Carradine et Sylvester Stallone). Bref, un casting cinq étoiles pour un album cinq étoiles lui aussi.
Avec Fuzzmovies, High On Wheels a voulu rendre un hommage appuyé et émouvant à ce qui reste comme un genre cinématographique marginal, en dehors du système mais qui possède son lot de fans transis d’amour qui délaissent volontiers « Star Wars » pour « Toxic Avenger ». Et le parallèle est assez évident avec le courant stoner qui s’agite et survit en dehors des majors sans l’aide ni le soutien du grand public mais qui est suivi par un nombre croissant d’amateurs éclairés et de bon goût qui vident leur livret A pour acquérir la dernière édition limitée 4 couleurs gatefold de leur album préféré. Série Z / stoner, même combat : celui des marginaux, des laissés pour compte, des sans dents de la culture, des passionnés de leur art. Merci donc à High On Wheels pour avoir réussi à réunir le meilleur de deux mondes.

Joyeux jour du 420 ! Bah tiens on n’allait pas rater ça hein ! Aujourd’hui, le 20 Avril (4/20) jour mythique de l’année pour les amateurs de pilons. Ce jour signe aussi le retour très attendu de Bongzilla avec sa toute nouvelle récolte, Weedsconsin. Faut dire que des douilles ont coulé dans les bangs depuis la dernière plaque,16 piges que le trio ne nous avait pas généreusement fourré les portugaises avec ses riffs à faire tourner jusqu’à l’évanouissement.
Tant qu’à faire les choses bien le trio sludge se paye une sortie via Heavy Psych Sounds et se tortore au passage une vidéo promo à l’aide de Môssieur Matt Pike, un arrosage hydroponique des réseaux sociaux et une culture hors sol pour split dans un quatrième volume des Doom Sessions avec Tons. Merci M’sieurs Dames, pardon de rien !
Penchons-nous sur cette nouvelle fleur de Weedsconsin, l’amateur d’huile et de trous de boulettes maousses risque de ne pas y trouver son compte. En effet, plutôt qu’un shilom bien chargé de beuh chimique, le nouveau Bongzilla se la joue splif de locale. On reste sous les auspices d’un sludge roulé à la main et le tout va croiser ce que le genre à de plus space. Difficile de trouver un autre mot quand on se retrouve avec l’acidité expérimentale d’un “Earth Bong/Smoked/Mags Bags” entre les oreilles.
Tout n’a pas changé totalement, n’allez pas croire, la voix de Muleboy quand on se donne un peu de temps pour apprécier la montée “Free Weed” qui tousse le relent glaireux plus que le cri sauvage, c’est un peu poussif mais suffisamment sale alors que d’une main distraite il égrène les notes de basse. On y retrouve encore des recettes qui ont fait l’attrait de la formation d’origine. La même que celle d’aujourd’hui.
La structure des morceaux est sans surprise, ça tourne jusqu’à fumer le carton. Mais il faut noter que ça plane bien plus qu’avec les récoltes précédentes. “Space Rock” fait dodeliner de la tête, on est avachi dans un canapé plutôt que dans un concours de bangs à se déchirer. Même si le trio s’emporte en cours de piste, le batteur, Magma, ne lève pas la baguette bien haut et Spanky suit de sa guitare les redondances de son acolyte à quatre cordes. L’enfumage casse les pattes de notre trio, il ne se relève qu’avec peine de son sofa pour finir par ramper pesamment sur le tapis de “Gummies” et clore la plaque.
Weedsconsin va ravir les amateurs de verdure, surtout ceux qui ont mûri le noble art de la fumette jusqu’ à savoir l’employer comme soupape de décompression. Pour ceux que la fougue tiendrait encore aux poumons, cela risque d’être plus compliqué, ce nouvel album n’est pas la montée de substances défouloir qu’ils auraient pu attendre. Weedsconsin est un album entre deux fumées, un plaisant interlude musical.
|
|