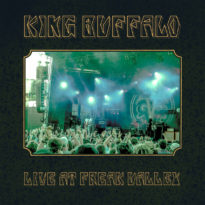|
|

Voici enfin le premier LP de Wormsand, trio du sud-est, frénétiques activistes de la scène depuis longtemps (label, organisation de concerts…). Après trois ans d’existence (depuis la (re)naissance sur les cendres encore chaudes de Clystone, pour 2/3 du trio) et un petit EP pour se chauffer, il était temps de transformer l’essai par un véritable album, ce qui nous amène ce Shapeless Mass.
On rentre dans ce disque avec en mémoire les prestations live du groupe (oui, c’était il y a longtemps), féroces et nerveuses, où des plans de stoner psyche limite space rock venaient très vite être bousculés par des assauts de gros sludge, ou des bourrasques de gros doom. On présume donc qu’on ne rentrera pas dans cette galette comme dans un disque de rock bas du front. Euphémisme en réalité : les premières écoutes sont froides et âpres. La musique du trio est exigeante, on le savait, mais on se fait quand même cueillir comme des bleus : dès que la machine à riffs commence à tourner à plein régime, elle se prend les pieds dans des breaks venus de nulle part… Et sitôt le headbang prêt à déclencher, les gars viennent nous coller dessus des rythmiques saugrenues, genre mesures asymétriques… Pas évident en première approche. Or la frontière est étroite entre la musique prétentieuse, souvent à grands renforts de compos complexes et techniques, et la musique audacieuse, où le travail d’écriture vient servir un propos et une musicalité originales. Avec Wormsand, on est plutôt dans la seconde catégorie, vous l’aurez compris.
Quelques compos plus “immédiates” captent assez rapidement l’attention (“Unlit Sun”, “Deprivers” qui rappellera même ici ou là quelques plans de Mars Red Sky – c’est un compliment) avant de nous amener dans le piège des autres titres, plus complexes (“Collapsing”, “Shapeless Mass”…), l’ensemble donnant à l’album cette densité qui fait qu’on s’en lasse difficilement. Avec 45 minutes au compteur, Wormsand évite le piège des disques du genre qui s’étendent et dissolvent le propos. Le groupe n’a pas de dogme de compo et peut proposer une bonne claque en 2min20 (“Escaping”, qu’on aurait presque apprécié de voir continuer un peu !) et un peu plus loin un bon gros titre de presque 10 min (le colossal “Shapeless Mass”). On n’est pas sur des jams improvisées la veille, tout ça a été bien travaillé.
La richesse de sons en œuvre sur la galette est notable : les vocaux complémentaires de Julien (sombre et guttural) et de Clément (plus clair) viennent enrichir les chansons, les effets de guitare et de basse sont utilisés à bon escient pour apporter qui de la densité, qui de la légèreté… Quoi qu’il en soit, cette richesse ne vient jamais nuire à l’homogénéité du disque et à son identité, tangible de bout en bout.
Même si le disque n’est pas parfait, ses choix (d’écriture, de son) sont revendiqués par le trio comme marque profonde de leur identité musicale. On ressort en effet de ce disque avec l’impression d’avoir affaire à un groupe à l’identité forte et unique, dont les références et influences sont suffisamment digérées pour ne jamais venir perturber le propos. L’album est dense et complexe, à déconseiller aux amateurs indécrottables de stoner classique ; mais c’est avant tout un disque audacieux, de la part d’un groupe qui ne manque ni d’idées ni d’ambitions.

Les groupes italiens ne manquent pas de labels pour accueillir leurs productions : Argonauta, Heavy Psych, Go Down, Electric Valley… C’est chez ces derniers que ce trio bergamasque a choisi de proposer son premier album, judicieusement intitulé 1 (après 3 mois de brainstorming avec l’équipe marketing…).
Le groupe propose six titres d’une musique complètement instrumentale. Forcément, les noms des cadors du genre nous viennent à l’esprit, à raison : car même si pour une fois l’ombre de Karma To Burn n’est pas trop présente, on entend ici ou là des plans dans l’esprit de My Sleeping Karma, Monkey 3, The Machine… en plus gras toutefois, mais sans plagiat en tous les cas, loin s’en faut. Si un point commun devait être trouvé en revanche avec ces autres fleurons du heavy rock instrumental, c’est sur le travail mélodique : Cancervo a bien muri sa machine à riffs, et structure l’essentiel de ses titres sur 2 ou 3 riffs et lignes mélodiques fortes (voir le morceau titre, “Aralalta” ou encore “Darco”), qu’ils savent faire tourner, avec bon sens toutefois (pas trop de fioritures, les titres tournent autour de 6-7 minutes). A noter un plan bien WTF avec une reprise du “Swlabr” de Cream… qui ne ressemble pas du tout à l’originale ! Forcément le rythme est divisé par 3 au moins, mais par ailleurs, bon courage pour retrouver la ligne mélodique quelque part…
Globalement, les tempi sont lents et lourds, et ce son de guitare souvent bien gras les amènerait presque en terres doom si de nombreuses sections plus aériennes en son clair ne venait tirer le tout vers des sentiers moins bien balisés. Petit point faible à noter : la production n’est pas au niveau de l’ensemble, quelques écoutes attentives (au casque notamment) laissent une impression de manque de puissance dans la mise en son du disque. Ces gars-là auraient bien besoin d’un producteur.
Mais pour le reste, ce premier effort des italiens est annonciateur de choses très intéressantes pour l’avenir, et le disque devrait permettre notamment aux amateurs des groupes sus-cités de passer un bon moment.

Après plusieurs années passées sur le label El Paraiso de leurs compatriotes Causa Sui, Tee Pee Records a eu le bon goût de signer ce groupe danois, qui officie dans le vivace milieu underground du psych rock expérimental, depuis leurs débuts il y a plus de 10 ans. C’est déjà leur sixième album, figurez-vous, et si vous aimez Mythic Sunship, vous ne devriez être ni surpris… ni déçu !
Mais si vous ne connaissez pas, mieux vaut vous prévenir… ce disque est un joyeux bordel, du début à la fin. Mythic Sunship est un groupe de psych rock largement porté sur l’impro, 100% instrumental, qui vient piocher dans des plans jazz notamment son sens de l’équilibrisme rythmique en particulier. Un équilibre souvent bien précaire, avec un sens de la musicalité qui ne conviendra pas à tout le monde… Difficile de mieux l’incarner que par ce tellement bien nommé titre introductif “Maelstrom”, fourre-tout instrumental où s’esbaudissent soli de guitares orgasmiques, rythmique psych rock / kraut, effusions de cuivres… Clairement il y a du Ecstatic Vision sur ce morceau, qui utilisent aussi la trompette pour joyeusement faire dissoner leurs compos les plus foutraques… “Maelstrom”, donc, qui déroule des tourbillons de psych rock enivrants, avant d’enquiller quelques breaks approximatifs et plans sans queue ni tête plus proches de jams mal maîtrisées jusqu’à la fin du morceau. Alors oui, dit comme ça, ça fait pas forcément super envie. Sauf que derrière, on retrouve des morceaux avec un peu plus de “repères”, à l’image de ce “Olympia” qui déroule une sorte de jam psych rock autour d’un lick de guitare bien catchy, décliné à l’envie sur plus de onze minutes avec une belle efficacité cette fois. “Landfall” introduit une touche orientale à la palette du quintette, touche orientale bien présente aussi dans “Redwood Grove”. Ça se termine sur le cinquième morceau, un orgiaque “Going Up”, entre jam rock électrique solide et plans déstructurés étirés en longueur, en se frottant parfois à des plans de gigue celtique, en usant de cuivres en fond pour appuyer les passages les plus chaotiques… Oui, tout ça !
Mythic Sunship ne s’est donc toujours pas décidé à faire les choses comme tout le monde, et même parmi les groupes de psych rock les plus barrés, se démarque par une certaine vision de la musique, plus proche du chaos organisé, toujours sur la brèche. Wildfire s’inscrit dans la continuité des productions précédentes des danois : c’est dans son imperfection que se glisse l’excitation du propos musical, cette fébrile incertitude qui génère une bonne part de l’intérêt de toute musique largement basée sur l’improvisation.

Avec un sens inné du merchandising, Heavy Trip a débarqué sur la scène stoner avec tous les accessoires nécessaires pour se constituer une fanbase digne de ce nom en un clin d’œil (Entendez par là qu’outre les vinyles rapidement sold out et le textile le groupe avait annoncé la couleur avec des feuilles à rouler à son effigie). Cette fanbase ne devrait faire qu’enfler…pour peu que les concerts reprennent. En attendant cela, il nous reste l’album éponyme des débuts de ce trio de Vancouver sorti il y a de longs mois déjà.
Les saveurs de Heavy Trip raviront les aficionados de jam sessions. Le travail est plutôt bien fait, on sent que les gonzes ont taillé le bout de gras entre instruments plus d’une fois en live. La guitare ne se prive jamais de partir dans un solo volubile et la section rythmique tient son rang, roulant les temps comme un tapis de marche douillet.
La réjouissance provoquée par cette plaque intervient surtout quand au bout d’un riff funky comme sur “Mind Leaf”, la basse envoie paître une mécanique devenant trop monotone ou quand sur “Hand of Shroom” (Notons au passage que les mecs ne manquent pas l’occasion d’un bon jeu de mot!) au détour d’un chapelet de notes de gratte, les trois comparses viennent entamer un dialogue joyeusement bondissant.
L’astuce est reproduite sur “Tresspinner” qui fait défiler une troupe de riffs pachydermiques jusqu’au moment où la gratte donne le top départ de la cavalcade. Mais une cavalcade éléphantesque, sans endurance, elle s’arrête abruptement pour que Heavy Trip puisse reprendre sa marche rythmée et pesante jusqu’au prochaine affolement quelques minutes plus loin mais cette fois ci avec de bons gros boosters au cul et toujours une guitare qui crache ses notes comme s’il en pleuvait sur fond batterie tentaculaire.
Vous l’aurez compris, cet album ne vous fera pas voyager ailleurs qu’au pas de la porte de la maison stoner mais après tout, quelle importance, il n’est pas impossible que les meilleurs voyages soient intérieurs et que le confort de la sécurité soit également un atout notable. Pour autant ne vous attendez pas à autre chose en Heavy Trip qu’un album sympathique, sans autre ambition que d’offrir à l’auditeur une jam de bons artisans appliqués.

1782 fut l’année de la dernière exécution pour sorcellerie. Pourtant, en 2021, quelque part en Italie, 3 garçons bien sous tous rapports mériteraient bien, selon la bien-pensante et prude église catholique, le même sort qu’Anna Goldin… Effectivement, difficile de voir autre chose qu’une ôde au diable, qu’un plaidoyer au vice ou qu’un appel à la débauche à l’écoute de From the graveyard, second opus du trio transalpin 1782.
L’intro, intitulée « Evocationis », nous téléporte au fin fond d’une forêt lugubre et inhospitalière ou la peur et la terreur font loi. Ces quelques secondes vous englobent et vous happent. Aucune échappatoire possible sinon de prier les cieux pour ne pas croiser le diable en personne, « The choosen one ». Le théâtre noir se met petit à petit en place et laisse l’auditeur exsangue. Oui, déjà, dès le premier véritable titre de cet album, vous plongez au fin fond des catacombes, comme aspiré par une force maléfique terrifiante. Le sol est visqueux, l’air est irrespirable et les ombres virevoltent au-dessus de vos têtes. Et encore, ce n’est que le début des hostilités… Voici que débarque « Bloodline », sa tellurique intro de basse, son riff qui rappelle fatalement un certain Black Sabbath et surtout, cette lourdeur dans le son, cette batterie qui martèle sans concession… Impressionnant, vraiment impressionnant. L’un des trucs les plus lourds de ces dernières années, faisant passer les gars de Monolord pour des chanteurs d’opérette !
On continue notre descente avec « Black void » et là, la lumière s’efface et il ne reste que les ténèbres, froides, lugubres, annonciatrices de l’arrivée imminente du maître des lieux. Le son est tout bonnement monstrueux et la production est simplement parfaite. Et c’est avec, finalement, avec un plaisir non dissimulé, le sourire béat et la bave aux lèvres, qu’on continue notre lente mais inéluctable chute avec « Inferno » qui apporte malgré tout un peu de répit à l’auditeur avec un riff moins acéré et une rythmique moins pachydermique (même si la voix de Marco Nieddu est toujours aussi tétanisante).
Et alors qu’on s’approche des entrailles de la Terre, la magnifique « Priestess of death » vient vous caresser la joue et vous chatouiller l’échine… La demoiselle est nue, étendue sur un sol jonché des restes des précédents visiteurs et elle vous invite à la gaudriole par la grâce d’un riff monumental qui engendrera un tremblement de terre de magnitude 9 à la surface (au passage, on est plus très loin de vouer un culte proche de « Empress rising » à « Priestess of death »…). Il ne vous reste alors que quelques minutes à vivre, bientôt emporté par la faucheuse qui vous guette du coin de l’œil et qui attend le moindre faux-pas de votre part pour agir. Faites donc vos prières face aux « Seven priests » avant de fermer les yeux, accablé par tant de violence et de noirceur, dévasté par l’implacable doom des transalpins. Ne reste plus qu’à déguster « In requiem » avant de suivre cette fameuse petite lumière au bout du tunnel qui guide chaque être humain vers l’au-delà.
From the graveyard est maléfique, déconcertant, terriblement sublime, délicieusement morbide, affreusement magnifique. C’est la substantifique moelle du doom, l’essence de la musique du diable, le chemin le plus court vers l’excommunion. 1782 frappe un grand coup, un très grand coup. Le trio transalpin magnifie le doom, l’amène un peu plus vers les profondeurs, lui assène un grand coup de hache derrière la tête. C’est brutal, viscéral, ça vous prend aux tripes mais putain, quel pied ! L’album doom de l’année, sans aucun doute.

Passer un moment avec Greenleaf est souvent synonyme de bon temps et de régalade. En vrai déjà, parce que les gars transpirent la bonhommie et la sympathie, et sur album ensuite, parce ils sont souvent vecteurs de bons riffs et d’intenses moments de bravoure. C’est avec un rictus de joie non feint aux commissures des lèvres qu’on se lance dans l’écoute de ces Echoes from a Mass, 8ème effort des Suédois actifs depuis 1999.
Dès le premier titre, pas de doute, nous sommes en terrain connu (boutade télévisuelle pour qui saura l’apprécier). Le son de guitare reconnaissable entre mille, le grain de voix si particulier de Arvid Jonsonn, le chant doublé par une ligne de gratte, le p’tit riff du début puis le pied au plancher en termes de production ensuite. Il est toujours confortable de reprendre ses marques avant de se laisser emporter par de nouvelles expériences et de nouveaux paysages visités. Oui.
Oui mais là non en l’occurrence.
Rien dans ces échos ne nous fera lever une oreille d’excitation. Greenleaf applique une recette, certes efficace, mais terriblement convenue après tant d’années. On traverse donc l’album en opinant du chef, en se disant qu’en live les titres se grefferont parfaitement à leurs croustillantes set-list mais que, finalement, il ne sera pas un jalon important dans la discographie du groupe, ni pierre ou caillou angulaire. Pas déplaisant mais fatigué, l’opus passe sans qu’un des dix titres ne nous chatouille les envies. Pas même la tentative épurée de « What have we become » ne parviendra à nous extirper l’envie d’y retourner. Difficile dans ce cas de sortir ne serait-ce qu’un titre de la nasse. Le constat est un peu dur j’en conviens, mais on a l’impression que l’ensemble se satisfait de lui-même.
Echoes from the Mass n’est pas un mauvais album, entendons-nous bien. Mais il semble paresseux, comme en pilotage automatique. Quand on sait à quel point les musiciens de Greenleaf peuvent être ingénieux dans leurs idées et leurs envies, on ressort d’autant plus frustré de l’écoute. Gageons que les musiciens retrouveront un peu de sel, de poivre et d’épices afin de relever le prochain plat. On ne demande pas un chef-d’œuvre à chaque sortie loin s’en faut, juste quelques moments de folies, d’instants moins contrôlés sûrement.

On se retrouve aujourd’hui pour la grand-messe obscure ayant lieu presque tous les deux ans désormais ; pour l’érection de ce quatrième pilier soutenant le monument colossal qu’est en train d’offrir au monde Sunnata. Après Climbing the colossus, le surpuissant Zorya, le fabuleux Outlands, c’est cette année à Burning In Heaven, Melting On Earth de nous propulser dans l’univers sombre et mystique du groupe varsovien.
Sans surprise, on retrouve dans cet opus le doom subtil et complexe, imprégné d’énergie brutale et électrique, véhiculant à nos oreilles et jusque dans nos tripes l’essence presque chamanique de la musique du groupe. Oscillant entre chant clair envoutant et cris saturés proche du grunge et parfois bien sludge, la voix de Szymon se marie à une basse toujours aussi crade et à des guitares, tantôt pachydermiques tantôt éthérées, pour narrer les épopées tragiques d’un autre monde. Prenons pour en témoigner l’exemple de « Black Serpent ».
Ce titre intègre comme sur « A Million Lives » une construction rythmique superbe. Construction qui, couplée à la présence de cœurs féminins montant crescendo jusqu’à des hauteurs dangereuses sur ce dernier morceau, donne lieu à un frissonnant climax. Impossible à son écoute de rester immobile. « Völva » arbore pour sa part des atouts plus introspectifs, évoquant à merveille de vastes étendues désertiques s’étendant à perte de vue sous un couple de soleils lointains. Et bien que tout aussi riche et composée avec une mesure exquise, elle ne secouera peut-être pas autant la nuque. Encore que…
L’album s’achève sur le bien nommé « Way Out ». Sixième piste de presque neuf minutes avec un travail de voix servant à nouveau l’immersion dans cet univers hostile et perdu. On y remarque par ailleurs dans les débuts un léger écho à « Planet Caravan » de l’illustre Paranoïd, avec ce son de voix rappelant sans difficulté le mélange de backward reverb, phaser, delay et que sais-je encore, utilisé par le frontman de Black Sabbath pour nous éloigner de mère réalité.
En somme, le nouvel arrivant se montre à la hauteur des prédécesseurs, sans verser dans la puissance burnesque de Zorya ni dans l’hallucinée fresque introspective d’Outlands. Burning In Heaven se forge au contraire sa propre identité, donnant encore un nouveau visage au quatuor polonais. À l’instar d’un Brahma d’une dimension alternative, Sunnata revêt ce masque supplémentaire sans crainte, conscient de son pouvoir sur les mortels et du chemin qu’il trace pour guider leurs âmes vers de versatiles horizons.

Le sludge est affaire de chaos. Le genre entier repose sur le rejet d’une société égoïste et excluante, sur un refus de la norme. C’est le black metal pour ceux qui sortent de chez eux et voient le monde tel qu’il est. Pour qui nihilisme n’est pas un prête-nom pour racisme. Le rejet de la société et non de l’individu. Et sans le chaos, le sludge risque les mêmes affres que le punk. C’est la porte ouverte aux mélodies (premier pas vers la pop), c’est la possibilité de s’assagir, de prendre conscience de son embourgeoisement. Des angoisses qui traversent plus l’auditeur que les membres d’EyeHateGod qui, désormais cinquantenaires, ont plus d’une fois regardé la tempête droit dans les yeux et se sont toujours sorti des griffes du mandarin.
Avec A History Of Nomadic Behavior, EyeHateGod semble avoir pour la première fois trahi le contrat moral qui le lie à son auditeur en proposant une production… propre. « Je n’ai quasiment aucun souvenir des enregistrements précédents, vu dans quel état j’étais en studio » se défend un Mike Williams ayant retrouvé la/le foi(e). Mais sommes nous prêt à accorder à EHG le droit à la sérénité ? Parce que le sludge sans larsen ni distorsion sonne comme du blues. Le vague à l’âme. Les maux bleus. Mais EyeHateGod, collectif aux trente années au service du chaos pour six rares albums, n’a pas droit à la rédemption. Celle pourtant accordée à Dax Riggs sorti de son bain d’acide pour réenchanter la Louisiane de son blues corrosif. Mais pas EHG. Jamais. Comment pardonner le riff de « The Trial Of Johnny Cancer » ? C’est le chaos qu’on assassine, c’est un miroir que l’on nous met sous le nez, révélant cernes et cheveux blanc. Le visage d’un cadre intermédiaire dans le tertiaire. Eyehategod ne sont certes pas les premiers à avoir lâché. C’est notre colère par procuration dont le groupe nous prive. Parce que nous avons un genou à terre et allons chaque jour à l’école ou au travail. Mike Williams ne dit d’ailleurs rien d’autre sur « Every Thing, Every Day ». Il est vrai que le son de guitare a souvent de quoi faire sourciller. Plus que la production « assagie » il est là le véritable scandale de cet album : les riffs ne sont pas à la hauteur. Jimmy Bower, que l’on sait avoir traversé quelques difficultés d’ordre psychique ces derniers mois, livre ici une partition bien trop faible face à la qualité habituellement proposée. « Fake What’s Yours » démarre plutôt bien, vraiment, avant de patauger les pieds dans la boue ; « Current Situation » nous extirpe d’un passage bruitiste, EHG jusqu’au bout du larsen, par un riff qu’aurait refusé le plus opportuniste des groupes de stoner grec. Non vraiment quelqu’un semble avoir coupé le power de Bower. Pas une accélération punk hardcore, pas un break fracassant la rythmique avec anarchie, pas un titre (à part peut être « High Risk Trigger ») qui pourrait prétendre à s’insérer sur l’album précédent (sans nom – 2014). Pourtant ce nouvel album a de nombreuses qualités à défendre. Notamment en ce qui concerne les prestations vocales de Williams, jetant ses idées dans le désordre de son esprit, créant, par la juxtaposition des thématiques, le canevas de sa sourde colère. Toujours précis, parfois génial, Williams rappelle qu’il est le chaos, en toute circonstance sans que cela ne suffise malheureusement pour pallier à la désertion de Bower (« The Outer Banks », cas d’école de cette dichotomie d’implication, avec pourtant l’un des seuls passages accélérés du disque). Quelle terrible frustration.
Encore ébranlé par le souvenir des nombreux concerts d’anthologie donnés par le groupe (de ce côté Paris a été plutôt gâté, entre la conquête express de Glazart un soir de grand retard et la défaite de la musique), il ne reste plus qu’à espérer que cette panne de courant ne soit que passagère, et que le prochain album du groupe nous mette de nouveau… Chaos.
Point vinyle :
Century média fait dans le noir bien sûr et trois petites éditions limitées : 200 copies en gris, 200 en Bottle Green et 300 en magenta. Les LPs couleur, le seul plaisir restant au cadre intermédiaire dans le tertiaire. J’en ai pris un de chaque.

Chris Babalis est un type chanceux… Bon, déjà, il est grec (l’expression « beau comme un dieu grec » ne date pas d’hier) mais aussi et surtout, il a un paternel qui, tout au long de son enfance, lui aura inculqué les bonnes manières musicales en lui faisant découvrir notamment Black Sabbath, là où d’autres pères sont fans de Jauni Hallyday et affublent leur descendance de T-shirts ornés d’aigle achetés sur les marchés (j’ai les noms mais la décence m’interdit de les divulguer). Du coup, quand vient l’âge de l’émancipation, le petit Chris décide justement de ne pas s’évader trop loin et de se lancer dans le doom avec, et c’est à saluer, son père à ses côtés. La paire Babalis se retrouve donc aux commandes de l’entité Acid Mammoth et, après un premier LP (récemment réédité) paru en 2017 et le furieux et sensationnel Under acid hoof de l’an dernier, voici nos amis grecs de retour ce mois-ci avec leur troisième opus, prénommé Caravan.
Suite logique à Under acid hoof (Dionysis Dimitrakos est toujours derrière la console, Branca studio s’est encore une fois surpassé pour la pochette) qui était de tous les tops de fin d’année, Caravan lui emboite-t-il le pas ? Ne tournons pas autour du pot, la réponse est oui, un immense oui. Caravan est un pur concentré de doom, la substantifique moelle du plaisir guitaristique et il se paie même le luxe d’être plus puissant, plus énorme, plus massif, plus tout. 5 titres, moins de 40 minutes d’une musique pachydermique au possible, parsemée de riffs qui pénètrent immédiatement votre inconscient et des compositions qui, si elles ne semblent pas follement originales au premier abord, sont juste parfaites. Bref, on est plus « mammoth » que « acid » ! Et les Babalis se permettent même de claquer quelques solis bien sentis, chose assez rare dans le genre pour être signalée. Bien évidemment, si vous êtes hermétique à ce genre de musique, ne tentez même pas l’expérience, vous allez sans doute trouver le temps long. Mais pour les autres, préparez-vous à prendre un pied monumental !
Caravan, c’est cinq symphonies doom de poche, cinq petites ôdes au Malin, cinq titres qui vont marquer le genre. Avec Caravan, Acid Mammoth se pose en digne successeur des vénérés Black Sabbath. Heavy psych sounds a eu (comme souvent) le nez creux en les signant il y a quelques mois car les grecs sont appelés à devenir la nouvelle sensation doom des années à venir. Un genou à terre, nous prêtons allégeance. Essentiel, mythique et déjà culte.

Avec un CV plutôt court de trois oeuvres, Spelljammer s’était construit une petite notoriété chez les auditeurs de doom les plus assidus et surtout les plus patients. En effet, il aura fallu au trio de Stockholm cinq années pour sortir le présent Abyssal Trip. Autant dire que la descente vers les abysses à été longue et qu’on attend en conséquence quelques découvertes maturées à souhait.
Avec l’introductif “Bellwether” aux puissants accords plaqués comme des chapes de plomb, le chant plaintif retravaillé en écho de “Among The Holy”, la basse doomesque en redites massives sur “Abyssal Trip”, la parenté avec un Monolord est palpable (Riding Easy oblige ?). Ajouté à cela que le mastering de l’album a été réalisé au studio Berserk de Esben Willems, batteur des sus cités Monolord et on obtient suffisamment de consanguinité pour que cela soit notable. Il y a aussi l’influence palpable de Sleep, sur “Lake” en particulier, qui nous renvoie donc une fois de plus à d’extraterrestres paysages bien connus des amateurs du genre. Spelljammer nous réinvite dans ces vallées brumeuses où l’accord de basse est tenu jusqu’au coup d’assommoir de la batterie
Fort heureusement le trio suédois sait s’extraire de l’ombre de ses pairs et aller chercher tantôt un psychédélisme acide, tantôt une saine agressivité vocale défoulatoire. Le plus notable réside dans la beauté de certaines mélodies éthérées pareilles à celle de “Peregrine” ou du pont de “Lake”. Ces particularismes s’insèrent dans les évidences des références du genre faisant qu’au global Abyssal Trip est une plaque doom pur jus.
Pile dans le credo de Spelljammer cet album ne se contente pas de travailler l’auditeur dans de pesants poncifs . L’album est émaillé de fraîches astuces qui lui confèrent une atmosphère singulière et évite à l’auditeur de sombrer dans la neurasthénie.
Avec des bases assumées constitutives d’une identité originale, Spelljammer gagne un peu plus encore ses lettres de noblesse avec cet Abyssal Trip. Oh certes, on ne tient peut être pas avec cet album LA plaque doom de l’année mais le travail est sain et honorable ce qui représente déjà plus que ce que beaucoup peuvent livrer dans le domaine.
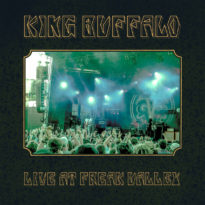
Le monde culturel est en mode veille depuis vous savez quoi et pour espérer vivre un concert live de nos jours, plusieurs solutions s’offrent à nous : se caler devant son écran et mater, seul et désespéré, les prestations scéniques (certes d’excellente qualité pour la plupart) de vos groupes préférés au milieu d’un désert isolé ou dans un studio d’enregistrement ou alors espérer un hypothétique concert ou festival cet été, bien calé dans un fauteuil pliant à trois mètres les uns des autres en plein soleil (vivement la canicule, on va se marrer!). Bon, vous avouerez que pour l’une ou l’autre, les solutions proposées ne sont pas franchement plaisantes mais que voulez-vous, nous devons nous adapter à la situation et attendre bien sagement le retour à la vie normale, si jamais elle revient complètement…
Mais il y a une alternative : s’envoyer un bon LP live en fermant les yeux et en laissant son imagination faire défiler ces images qui semblent si lointaines de concerts entre potes, collés les uns aux autres, partageant une binouze en taillant le bout de gras sur ses nouvelles découvertes musicales. Enregistré au Freak valley festival en 2019, ce live de King Buffalo reste un excellent souvenir pour votre serviteur. D’une part, parce qu’un live de King Buffalo reste toujours une sacrée expérience sensorielle (visuelle et musicale) et d’autre part car ce festival allemand reste pour moi l’une des meilleures petites bulles d’évasion de l’année avec un public chaleureux et amical, une ambiance festive incomparable et une programmation toujours au petits oignons. Inutile de préciser qu’ils viennent d’annuler l’édition 2021 mais j’espère retrouver le FVF l’an prochain.
Bon, venons-en à cet album… Introduit par Volker, le maitre de cérémonie du festival (qui nous gratifie de son désormais célèbre « liebe freunde »), le concert débute avec “Sun shivers”, tiré de l’album Longing to be the mountain. L’occasion de se rendre compte de la qualité de la prise de son, qui permet de replonger un peu plus dans l’ambiance. La voix de Sean MacVay est limpide et la section rythmique (Dan Reynolds à la basse et Scott Donaldson derrière les fûts) est parfaitement mise en avant. “Sun shivers” est enchaîné avec le premier morceau de bravoure de ce concert, l’extraordinaire “Longing to be the mountain”, véritable pièce d’orfèvrerie qui rappelle les grandes heures du rock progressif des années 70. Ces dix minutes grandioses prennent toute leur dimension en live et le trio est en osmose totale.
Souvent comparé à Pink Floyd (pour ses compositions planantes et fabuleusement trippantes), King Buffalo ne peut être réduit qu’à un simple enfant légitime de la bande à Gilmour. Le trio a parfaitement digéré ses multiples influences et a créé un univers propre, subtil mix de parties de guitare puissantes et mélodiques (associées à la voix de Sean MacVay) et d’une section rythmique aux petits oignons. La preuve avec “Repeater” (tiré d’un EP trois titres paru début 2018), une cavalcade psych-prog de plus de 13 minutes, véritable morceau de bravoure qui fera totalement décoller le public. Vient ensuite le masterpiece du trio New-Yorkais, leur “Shine on you crazy diamond” à eux (le riff est d’ailleurs aussi mythique), j’ai nommé “Orion”. Sans doute le meilleur moyen de faire aimer King Buffalo au plus grand nombre, “Orion” est ici transcendé, magnifié, sublimé par une version live de toute beauté. Suit un splendide “Kerosene” (tiré lui aussi de l’album Orion) avant de conclure sur “Eye of the storm” qui termine en beauté cette petite heure passée en compagnie de King Buffalo.
Si vous avez un jour l’occasion de croiser King Buffalo, autant vous dire que vous allez passer un excellent moment (et encore plus si ils jouent quelques titres de leur dernier opus Dead star, paru début 2020). Le trio New-Yorkais a pris du galon et de la bouteille au fil des ans et il reste parmi les valeurs sûres de la scène stoner actuelle.

L’écurie transalpine, qui compte bientôt dans ses rangs la totalité des formations qui ont fait vibrer notre scène il y a plus d’une dizaine d’années (soit à une époque où nous avions nettement plus de place dans les concerts, mais on ne va pas s’en plaindre non plus), s’attaque cette année à la commercialisation de la seconde partie de la discographie d’une des meilleures formations stoner de l’Histoire avec du grand hash. La triplette de rééditions de l’année c’est Beyond Colossal, le dernier opus du quatuor de Borlänge, Through The Eyes Of Heathens, le meilleur album des années 2000, et ce Vultures, sorti en numérique seulement après que ces Suédois nous aient abandonnés.
Cette sortie n’annonce malheureusement pas le comeback de Dozer mais va humidifier du caleçon de groupiles puisque ces quidams pourront toucher, de leurs mains potelées, les diverses formes physiques que prendra cette compilation qu’ils connaissent déjà dans sa quasi-totalité pour certains et totalement pour d’autres. Originellement sortie en 2013, ces 6 titres de l’âge d’or du groupe sont complétés de la reprise de Sunride : « Vinegar Fly » (que les fans connaissent déjà puisque disponible jadis sur Myspace : ça fout un coup de vieux rien que mentionner cette plateforme). En gros, pour mettre les pendules à l’heure (il est Dozer) : cette sortie affriolante pour certains ne contient pas une once de nouveauté ou d’inédit… que dalle ! Pourtant elle s’avère incontournable pour quiconque désire détenir ces joyaux autrement que sous forme de fichier numérique ; achetez, mes sœurs et mes frères, c’est de la came de premier choix !
Sensée, la démarche l’est certainement pour les bipèdes qui partagent mon amour pour cette formation magique, mais l’expérience s’avère surtout frustrante car tous les acteurs sont désormais de retour aux affaires, avec des fortunes diverses, notamment au sein de Ambassadors Of The Sun, Greenleaf ou Besvärjelsen et pas avec cette putain de formation qu’était Dozer ! Et je me taperai volontiers du nouveau son de la part de ce combo qui contribua naguère à la montée en puissance du courant rock qui nous fédère sur Desert-Rock.com.
Revenons à nos vautours : ces pistes ont été enregistrées au Rockhouse Studios de la ville d’origine du quatuor entre 2004 et 2005 soit quand le chef-d’œuvre Through The Eyes Of Heathens marinait dans leurs esprits. Les compositions sont à la hauteur de la réputation de cet incontournable de la scène stoner européenne : elles sont énormes et n’auraient pas dépareillé dans leur discographie congrue même sous forme d’un EP entre Call It Conspiracy et son successeur. Le style se trouve pile poil entre ces deux albums soit quand la transition s’est opérée entre la concision rentre-dedans des débuts et le développement d’obsession heavy en fin de carrière. « Vultures » et « Last Prediction » incarnant la première partie de la carrière de Dozer avec une certaine rapidité d’exécution, des parties vocales scandées et des riffs assez aériens (attention : ce n’est pas du glam non plus), « Head Ghosts » et « The Impostor » s’aventurent dans un registre plus lourd et aussi plus burné avec des voix chantées ainsi que des riffs qui tournent de bout en bout des titres jusqu’à ensorceler l’auditeur. Cette expression plus mature est sans conteste un des points forts de cette formation qui continue à faire briller nos mirettes à l’évocation de son nom, quand bien même elle ne nous a rien proposé de neuf depuis 12 piges.
L’adjonction de « Vinegar Fly » augmente encore l’attractivité de cette sortie puisqu’absente de la version digitale de 2013. A l’origine, cette reprise des Finlandais devait se retrouver sur un split 100% scandinave qui ne vit malheureusement jamais le jour. La relecture de ce titre à la sauce suédoise lui confère une lourdeur bienvenue et il passe de l’autre côté de la force sans perdre sa saveur originelle. Belle opportunité aussi pour se plonger voire se replonger dans le répertoire d’un groupe disparu de nos radars depuis la période à laquelle cette plage, martelée et scandée avec justesse, a été enregistrée.
Verdict : on achète. On achète bien sûr car cette production contient zéro remplissage, zéro faute de goût, et que des pépites comme « The Blood Is Cold » qui s’approche carrément de la quintessence de l’art ! On verse une obole au label italien bien inspiré, on allume un cierge et on implore Dozer de nous revenir vite. Putain comme ce groupe me manque !
Point vinyle :
C’est le banquier des fans de Dozer qui vont être contents et leurs mômes qui vont bouffer des patates durant quelques mois… Vultures sort en CD, digipack c’est obligé, et est tiré en standard noir, en doré à 400 exemplaires, en cornetto blanc et violet (en gros comme un cornet de crème glacée qu’on bouffe l’été et qu’après on se demande pourquoi on ne ressemble pas aux acteurs des séries sur Netflix quand on vire nos fringues), à 200 exemplaires et finalement 10 test press ultra limités complètent la proposition commerciale (vu qu’on ne me l’a pas demandé, je vous informe que les 2 autres rééditions 2021 de Dozer sont proposées elles aussi en quatre déclinaisons vinyles : ça va faire mal à certains budgets).

Dubitatif… cet adjectif ne signifie pas « mon chibre à des poils » mais il qualifie quelque chose qui laisse perplexe ou sceptique face à un évènement, une situation ou quelque chose qui laisse place à un doute légitime. Un exemple : « la première écoute du nouvel album d’Appalooza m’a laissé un peu dubitatif »… Car oui, les brestois n’ont pas fait dans la facilité avec cette nouvelle galette, leur deuxième après l’excellent album éponyme paru au début de l’année 2018 qui sentait bon le sable chaud, la tequila bien fraîche et la generator party dans le désert californien. Un album infusé à la violence grunge d’Alice in Chains et saupoudré d’influences toutes Joshommiennes qui suivait une tournée américaine mouvementée en 2015.
Nous sommes en février 2021 et je tiens dans mes mains la nouvelle offrande du trio. Première bonne surprise : le logo Ripple music apposé au dos du LP, gage de qualité quand on connaît le catalogue de ce label. Et puis, le premier « choc » visuel : cet artwork, qui rappelle fatalement les œuvres de John Baizley, la tête pensante de Baroness. On est loin des grandes étendues désertiques qui nous faisaient de l’œil avec le premier album… Bon, depuis cette foutue année 2020, on n’est plus à une surprise près et plus rien ne nous étonne (cf le dernier Kadavar) et je me dis que le ramage ne se rapporte peut-être pas forcément à ce plumage qui, malgré sa qualité intrinsèque (force est de reconnaître qu’il est juste splendide), ne colle pas forcément avec le genre pratiqué par le groupe. Je sors la galette de son emballage, je la pose sur la platine et je lance The holy of Holies…
« Storm » nous accueille avec un riff de guitare charnu mais somme toute classique, puis la voix rocailleuse de Sylvain emporte l’auditeur vers un sommet de heavy stoner qui sent bon la chemise à carreaux achetée du côté de Seattle. L’ambiance est posée, et elle sera sombre et électrique… Plus menaçant et bien moins dispersé que sur le premier album, le son est gigantesque, propre, concis. « Snake charmer » évoque le groove musclé d’un Clutch ou de leurs compatriotes de 7 Weeks. On sent que les gars ont pris de la bouteille et les compositions sont finement ciselées. Ça riffe, ça groove, ça éructe comme un beau diable… et puis ça s’arrête net avec un interlude qui calme le jeu avant le musculeux « Reincarnation » et sa section rythmique martiale et syncopée. « Nazareth » et son doux parfum d’Orient précède le furibard « Conquest » et ses presque 8 minutes, véritable manifeste de heavy stoner contemporain mâtiné, encore et toujours, de cette petite touche grunge, hommage aux grands noms du genre, de Soundgarden à Alice in Chains.
« Azazael » muscle encore un peu plus le propos des brestois. Parfait pour headbanger avec ses potes (mais si, souvenez-vous, les sorties, la foule, les concerts, tout ça…). Le moment de parler du style du groupe, qui est passé d’un desert rock caillouteux à un grunge alternatif qui sent désormais le goudron et le bitume. Noir comme le charbon, le son d’Appalooza s’est assombri, les chansons sont désormais bien moins ensoleillées qu’auparavant et on sent presque les gouttes de pluie gifler son visage. Un virage qui en décevra plus d’un, qui en déconcertera certainement certains mais l’évolution et la carrière d’une formation qui possède des velléités de succès à l’international est peut-être à ce prix… La preuve avec ce « Distress » menaçant au possible, malgré un refrain sautillant. On approche tranquillement de la fin du voyage avec le très heavy « Thousand years after » et on termine avec le morceau de bravoure de cet album, « Canis majoris ». Là, changement radical d’ambiance avec un titre de plus de 8 minutes à la construction assez progressive (intro acoustique, voix aérienne, ambiance quasi-médiévale) et franchement osée mais le risque s’avère payant car le sommet de cet album, c’est bien « Canis majoris ».
Je disais donc, dubitatif… A la première écoute, je suis resté dubitatif sur The holy of holies… Trop « américanisé » dans sa production, trop « énorme » dans ses compositions, je trouvais qu’Appalooza avait en quelque sorte vendu son âme et s’était éloigné de ses convictions premières. Et comme il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, je l’ai réécouté plusieurs fois et finalement, je me suis ravisé : The holy of holies est un grand album, tout simplement. Pas un grand album de stoner (car ce n’est plus vraiment du stoner…) mais de heavy rock alternatif, ce qui change beaucoup de choses… A vous de voir si vous êtes prêt à faire le grand saut avec eux…

Retour aujourd’hui après 4 ans de silence du quatuor portugais Miss Lava. Un groupe qui pourrait tout aussi bien venir du fin fond de la Californie tant sa musique sent la poussière, le cactus et le sans-plomb 98. C’est à Small Stone Record que revient d’officier cette messe brûlante, intitulée Doom Machine.
Un nouvel album au titre prometteur donc, mais qui n’a en revanche de Doom que le nom. Si par le passé on pouvait prétendre à quelques aspirations du genre, notamment sur Sonic Debris ou Dominant Rush, le dernier opus en reste parfaitement dépourvu. Ce qui n’en fait pas un mauvais bougre pour autant. Loin de là.
Avec ses quinze pistes taillées pour la course, certaines comme « Karma » durant moins d’une minute, Doom Machine nous propose un concentré de désert rock, du bon, du vrai des familles, alimenté d’une fuzz infaillible et porté par la rythmique galopante Ferreira/Garcia ; duo assurant la déferlante avec une pertinence presque touchante.
Dans ce tourbillon de fuzz, on connait quelques instants de répit, comme avec « Terra » ou sur le début de « Brotherhood of eternal Love », moments propices à l’installation d’un climat psyché qui nous ferait volontiers décoller si le fouet ne se remettait pas si vite à claquer. Sur « The Great Divide », le pivot de tout l’album et titre le plus abouti, on atteint enfin cet équilibre béni entre fureur électrique et psyché narratif. Une position nous permettant de pleinement apprécier la musique du groupe dans ce qu’il sait proposer de plus soigné.
La piste suivante, « The Fall », ne trahira pas ce constat. Toutefois, on retourne rapidement aux fondamentaux, le nez dans la tempête sableuse qui s’abat encore et toujours. Paradoxalement, cet album apparaît avec moins de personnalité que les précédents. Le groove du passé qui cassait la nuque et vrillait les genoux se retrouve ici trop dilué voir carrément absent. La cohérence peut-être un poil trop propre de Doom Machine le rend un tantinet lisse et prévisible. Choisissons ici d’y voir une revendication des gars de Lisbonne, car on ne pourra désormais plus leur reprocher de « se chercher » ou « d’oser des fantaisies ». La voie du fuzz a été choisie !
En dépit de cette critique, Doom Machine demeure un excellent album admirablement bien écrit et investi d’une vraie substance. Pour tous les fans de Truckfighters, Deadly Vipers et autres énervés de la pédale, il revêtira même l’étoffe d’un incontournable que je ne peux que vous inviter à écouter.

Aujourd’hui leçon d’archéologie avec le professeur Heavy Psych Sounds. Le label a exhumé pour vous des fragments de la civilisation Sonic Flower. Les fouilles ont permis d’en dater l’origine à 2001, HPS a ressorti cette année leur premier opus et nos lecteurs les plus assidus n’auront pas manqué de lire ce qu’en pense le Professeur Laurent. Par effet d’aubaine sans doute, sortent à quelques jours d’intervalle des enregistrements inédits de 2005 que des soucis des membres de la formation avaient obligé à reléguer aux oubliettes malgré un titre revanchard, Rides Again.
Jouissif sera le terme conducteur de la seconde production des japonais. Rides Again était resté dans les placards, oublié après une séparation du groupe et ces morceaux fonctionnaient comme une machine à remonter dans le temps. Aborder Rides Again c’est comme avoir affaire à un enregistrement qui aurait eu lieu dans un baril d’huile, produisant un son aussi crasseux que saturé sur lequel on n’aurait pas pris la peine de passer un coup de dégraissant. Pas net donc, mais jouissif tout de même.
A embrasser l’intégralité de l’album, j’en viens à me demander si le projet n’aurait pas été de s’appuyer sur “Moby Dick” de Led Zep (en atteste le joyeux bordel de “Captain Frost”) et d’en tirer la quintessence pour réaliser sept titres donnant dans la même inspiration. Comme toute œuvre archéologique, il faut souffler sur la poussière des ans pour dénicher le travail de l’orfèvre qui œuvra jadis. Les parties de gratte s’en donnent à cœur joie sur des boucles rythmiques bondissantes et la jam qui en résulte semble ne jamais vouloir s’arrêter d’exposer sa virtuosité.
Sous des dehors d’antiquité Sonic Flower avait créé une musique organique, un son vivant, une ivresse totale. Une musique qui n’oublie pas de s’appuyer sur les fondamentaux d’où elle est sortie avec deux covers, “Stay Away” de The Meters (Le titre est d’ailleurs sublimé, il faut bien l’avouer) et “Earthquake” de Graham Central Station qui permet de comprendre d’où vient toute l’énergie de l’album, il y a du funk dans tout ça et du bon!
Oui mais… car il y a un mais. Malgré toute la joie dont l’album dégouline, malgré le professionnalisme du quartet à délivrer un disque pur jam de 28 mn sans un bout de Church of Misery dedans, Sonic Flower tourne en rond. L’album certes nous entraîne dans sa sarabande antédiluvienne, il fascine par son cachet désuet dès la première écoute. A tel point que lorsque j’ai voulu rebooter mon lecteur MP3, rien à faire, j’ai perdu tout contrôle sur la liste de lecture et l’intensité du son, le système a continué de jouer Rides Again. L’album est possédé, détenteur d’une secrète magie du fond des âges. Mais y revenir de soi n’est pas si évident. L’album est bon oui, il est entraînant certes, mais voilà il ne marque pas l’esprit par sa superbe, il n’imprime pas sa signature de façon durable. Une belle pièce, finement ouvragée mais à laquelle il manque un souffle de génie.
Rides Again est un de ces albums assez surnaturels, il provoque une intense satisfaction très immédiate mais ne tient pas vraiment dans le temps sans qu’on arrive à lui en vouloir. On se laissera tenter par l’acquisition de l’objet et sans doute y reviendra-t-on à l’occasion comme une pièce de collection chaleureuse. Fait notable, il semblerait que l’expédition HPS n’ait pas fait qu’exhumer deux anciens temples stoner en exposant deux galettes de Sonic Flower en ce début d’année dans vos collections, elle a réveillé quelque chose qui avait été oublié. Préparez-vous donc à entendre résonner encore les notes de Sonic Flower avec un album de plus prévu sous peu.
|
|