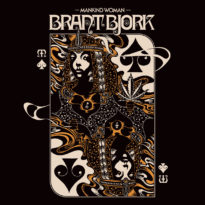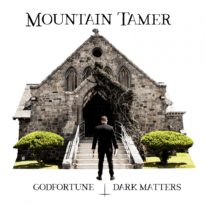|
|

En tout juste plus de dix ans d’existence Conan a su s’imposer comme l’une des formations les plus prolifiques de la scène doom/sludge mondiale grâce à des albums de grande qualité et d’incessantes tournées. Défendant au fil de ses productions un univers artistique unique qui mêle imagerie guerrière, morceaux aux tempi lents, chant hurlé et son extrêmement massif, le groupe originaire de Liverpool, ajoute aujourd’hui à sa discographie un quatrième album studio, Existential Void Guardian, qui paraît chez Napalm Records.
Le point fort de la musique des Anglais n’a jamais résidé dans sa complexité mais dans la cohérence et le jusqu’au boutisme absolus de chacun de ses aspects. C’est dans cette optique que s’ouvrent les hostilités avec “Prosper On The Path” qui a tout de l’archétype du morceau de Conan: le son est tellurique, les riffs sont monolithiques et, renforcés par l’arrivée du chant de Davies, instaurent immédiatement l’ambiance guerrière caractéristique de la musique des Liverpuldiens.
Habitués des épopées flirtant avec la dizaine de minutes, les Anglais ne nous proposent, sur Existential Void Guardian aucune piste n’excédant les 7 minutes (mention spéciale au grindesque tourbillon de blast “Paincantation” et ses 55 secondes!). De même, si le groupe a construit sa notoriété sur la base de morceaux down-tempo, on note sur cet album, à l’image de ce qu’il est possible d’observer sur Revengeance (“Throne of Fire”, “Revengeance”), la présence de plusieurs pistes aux tempi plus rapides (“Eye To Eye To Eye”, “Paincantation”, “Volt Thrower”). Cela a pour effet, par le biais du positionnement clairsemé desdits morceaux, de faire alterner les rythmiques entre les morceaux de l’album ce qui rend l’écoute globale plus riche et variée.
Moins attendus sur ce terrain là, Jon Davies et sa bande nous servent sur cet album plusieurs pistes aux refrains plus accrocheurs que de coutume avec le puissant “Eye To Eye To Eye”, le coup de poing “Void Guardian” et le très épais “Amidst The Infinite”, pierre angulaire de l’album, mené par un chant à deux voix des plus saillants et qui se termine sur un riff doomissime qui laisse présager la lourdeur des derniers titres de la galette.
Enfin, “Vexxagon” et “Eternal Silent Legend” officient dans un registre proche de celui auquel le groupe nous avait habitué sur l’ensemble de sa discographie (et notamment sur ses premiers albums). Les tempi y sont très lents et les morceaux semblent avoir été placés en fin d’album pour asséner un coup de grâce à l’auditeur. Cependant, ces compositions durent moins de 7 minutes, signe que les Anglais choisissent de privilégier, comme sur l’ensemble du disque, l’efficacité et prennent moins leur temps pour développer leurs titres avec un certain empressement.
Vous l’avez compris, sur Existential Void Guardian, Conan développe sa formule en faisant cohabiter les évolutions artistiques entrevues sur Revengeance et les nombreux points forts de ses albums précédents. Le groupe maîtrise sa formule mieux que jamais et a le bon sens de faire varier ses créations davantage qu’à l’accoutumée pour parvenir à reléguer au second plan l’aspect redondant de sa musique. Sans dénaturer aucunement leur projet artistique, Jon Davis et sa bande ajoutent ainsi du relief à leur propos, enrichissant par la même occasion les (ré)écoutes, captant mieux que jamais l’attention de l’auditeur et nous proposent ce qui pourrait être leur tout meilleur album tout en s’affirmant définitivement comme l’un des poids lourds de la scène.
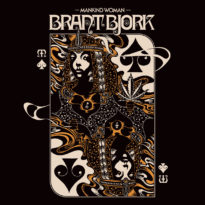
Brant Bjork fait partie de ceux qu’on ne présente plus, des tauliers, des mecs qui sont là depuis le début et qui sont bel et bien encore là. Donc je ne vais pas vous faire la mini-bio classique en introduction de ma chronique, ne serait-ce que parce que citer la liste des groupes auxquels a participé notre ami du jour demanderait bien trop de temps. Bref, le nouveau Brant Bjork est là, il est tout chaud et il ne demande qu’à être dégusté.
Même si Brant est un incontournable du stoner, il a tout de même ses détracteurs. Certains lui reprochent son manque d’audace et de prises de risques, le fait que cela tourne toujours un peu autour des mêmes plans, du même esprit et que chaque album ressemble au précédent. Si je m’inscris en faux pour cette dernière remarque, je dois reconnaître que les premiers arguments sont recevables bien qu’exagérés.
Une fois de plus avec cet album, si vous êtes à la recherche d’un truc nouveau ou d’un concept album bourré d’expérimentations, alors passez votre chemin. Cependant si vous avez une petite envie d’un album à l’ancienne, soigné, peaufiné, sans défaut et qui ronronne en vous charmant les oreilles, Mankind Woman est un modèle du genre. Dans la déjà très chargée discographie de Brant Bjork en solo (on parle quand même là de son onzième album studio ! auxquels s’ajouent Tres Dias et le Live), celui-ci est assurément à mettre dans le haut du panier.
Le premier argument pour vous convaincre c’est que Brant a travaillé le son de sa guitare pour obtenir un résultat plus proche de ce qu’il présente habituellement en concert. Argument difficilement appréciable si vous n’avez jamais vu l’artiste en concert alors disons simplement que ce son sonne plus authentique, moins filtré, un ton légèrement plus bas, un peu moins aérien. Les riffs et autres solo sont bien travaillés et la guitare est souvent doublée, chose très appréciable. On retrouve bien sûr quelques facilités sur les plans de guitare mais aussi un bon paquet de fort jolies choses qui flattent les tympans. On sent que la composition des morceaux a été travaillée, que la copie a été lue et relue avant d’être rendue. Un album très généreux niveau guitare.
Le second argument qui peut et doit être mis en avant c’est cette production et ce mixage de toute beauté. Guitare, basse, batterie et chant, tout s’entend distinctement. On est à mille lieues de la bouillie qu’on peut parfois trouver où on n’arrive pas à savoir qui joue quoi et ce qu’on entend réellement. Un réel plaisir de pouvoir par exemple se concentrer sur la ligne de basse et de pouvoir la distinguer parfaitement, d’autant que là aussi c’est du beau boulot.
Mais le plus bluffant est de parvenir à séparer chaque partie tout en gardant ce sentiment d’unité, de cohésion de l’ensemble. Félicitations à ceux qui ont bossé sur ce disque car c’est tout simplement un exemple de ce qu’il faut faire.
Finalement et même si j’aurai pu ajouter quelques arguments, nous avons là un album de 11 titres bien écrits, très riches et généreux qui en plus sont mixés à la perfection.
Brant Bjork poursuit sa route comme il l’a toujours fait, en ne se préoccupant pas des modes, avec cette sincérité indéfectible et une envie de bien faire mais surtout de faire ce qu’il aime sans se laisser tourmenter par les critiques.
Point vinyle :
Heavy Psych Sounds a fait (un peu trop?) fort du côté des galettes puisque vous pouvez trouver : 100 vinyles “colour in colour” marron et orange, 250 vinyles trois couleurs mélangées orange/rouge/marron, 250 vinyles trois couleurs séparées orange/violet/jaune, 750 vinyles “splatter” sur base transparente avec couleurs jaune, orange, violet, marron et rouge, 50 test press sur vinyle noir et finalement des vinyles noirs.

Loin de souffrir de leurs nombreuses tournées, ou des réguliers changements de line-up, la créativité du trio Ukrainien semble intarissable. À moins qu’elle ne puise justement dans ces mouvements perpétuels pour produire encore. Toujours est-il que trois ans après le succès de The Harvest, Stoned Jesus profite de la rentrée musicale pour sortir chez Napalm Record son quatrième album : Pilgrims. Et, une fois n’est pas coutume, le groupe nous prend à revers.
On le sait désormais, la force du trio réside dans sa capacité à se réinventer en permanence ; à capter l’influence de ses pairs pour en extraire une essence qu’il transforme en d’audacieuses compositions se démarquant tant par leur richesse que par leur originalité. Ce qui le rend particulièrement difficile à catégoriser. Et c’est tant mieux ! De cette façon, si Seven Thunders Roar se démarquait par sa beauté, la profondeur de sa narration, suggérant le conte d’un vieux chaman narré sous un ciel étoilé et rempli d’animaux mystiques, Pilgrims dénote par la tension qu’il véhicule et cette sensation permanente de mélancolie.
Après le percutant « Excited » d’introduction, qui propose des riffs vigoureux, un rythme dynamique et une énergie indéniable, on plonge vite dans la sombre mer de « Thessalia ». Et dès l’intro, on sent toute la lancinance du morceau. Une tension instaurée de bout en bout. D’un côté, la ligne de basse simple et redondante installe un climat d’urgence, renforcé par une batterie discrète mais pressante. D’un autre côté, les riffs d’Igor qui débutent en palm mute se hissent ensuite crescendo vers les hauteurs explosives. Tandis qu’en dernier lieu, vient sa voix qui s’étire, qui se perche comme une épée de Damoclès au-dessus du protagoniste et le menace.
On ressent le même malaise durant « Distant Light », qui bénéficie d’une construction similaire, avec un refrain peut-être plus mou encore. Et pour « Feel », la tension lancinante nous englue tant dans l’apathie qu’elle transforme presque la musique en un appel à l’aide. Et à l’approche du refrain final, c’est une prière de miséricorde…
« Hand Resist Him », d’abord assez évocateur de Mars Red Sky (réminiscence, s’il en est, de la tournée du trio de Kiev en compagnie de nos amis bordelais), rattrape le coup par son envolée finale vers les cieux intangibles du psychédélisme déluré. Altitude salvatrice également atteinte à la sortie de « Water me ». Même si durant les sept premières minutes du morceau, il s’agit d’une pièce lente, incantatoire et épurée à souhait. Le retour au doom du premier album. Mais un doom trop propre. Un doom sans graisse ajoutée. Un doom bio.
Au cours de l’écoute de ces sept pistes, on évolue donc bien loin de l’énergie habituelle du groupe. Le groove à faire chavirer de « Wound » ou d’«I’m an Indian » brille ici par son absence. Mais on y découvre à la place une substance nouvelle. Un style aussi subtil qu’auparavant mais avec une approche bien différente de ce qui fait leur musique. Et lorsque l’on constate le nom du titre clôturant l’album (« Apathy »), on se dit qu’il ne s’agit guère d’un hasard. Stoned Jesus se renouvelle, sort de sa zone de confort et expérimente encore, afin que le moment venu, le trio transcende une nouvelle fois ses créations sur scène et leurs offre ainsi la valeur qu’elles méritent.

Il existe deux façons d’appréhender les derniers albums de Clutch, et en particulier Earth Rocker et Psychic Warfare. Ce binôme remarquable a permis au groupe de jumeler la production d‘albums de qualité, intègres et efficaces, tout en amenant Clutch à un niveau de notoriété jamais atteint. Rien de critiquable, le quatuor mérite au contraire le plus grand respect pour ce résultat. Toutefois, les esprits chagrins (dont une part de notre équipe) déplorait la prise de risques minimale opérée entre ces deux albums : pour certains, pour battre le fer tant qu’il était incandescent, Clutch a produit avec Psychic Warfare une sorte de « Earth Rocker – part 2 ». A l’heure de décider de la suite à donner à Psychic Warfare, le groupe avait plusieurs options à sa disposition : laisser le train poursuivre sa course en avant frénétique, ou bien lever le nez du volant et ralentir, voire le faire dérailler ? Toujours intègre mais aussi raisonnable et responsable, le groupe a plutôt choisi d’opérer un virage ; pas brutal, mais significatif…
Pour ce faire, ils ont commencé par changer de locomotive… euh, de producteur. Exit le fidèle et efficace Machine, enter Vance Powell, machine de guerre au large spectre musical (en termes de production), récipiendaire d’une quantité significative d’awards, mais avec une connotation country-blues rock assez marquée (avec toutefois sur son CV pas mal d’escapades qualitatives en terres saturées). Le pari s’avère assez rapidement payant, tant en termes de mise en son (impeccable, jamais outrancière et jamais cheap) que de choix relevant presque de la co-composition (instrumentations, articulations…).
L’auditeur confronté à l’album se retrouve devant une masse de chansons où, justement, cette valeur ajoutée trouve tout son sens : sans jamais friser l’indigestion (un vrai risque, avec 15 vraies chansons à assimiler, quand même !) le talent cumulé des compositeurs et du producteur rendent l’ensemble efficace, riche, varié, aéré… Aucun temps faible, sans jamais de sentiment de remplissage.
Le talent et l’intention des compositeurs est néanmoins le principal artisan de ce résultat. D’abord, convenons que l’on trouve sur ce disque une quantité de morceaux qui prennent la droite suite des albums précédents… et c’est très bien ainsi ! Personne ne pouvait décemment espérer du groupe qu’il renonce à ce standard d’efficacité et de qualité, et des titres comme « How to Shake Hands » ou « Weird Times » (quel jeu de batterie…) honorent plutôt le CV du groupe et sont dans la lignée de Earth Rocker ou Psychic Warfare. En revanche, et c’est toute l’intelligence du quatuor, ils ont un peu regardé dans le rétroviseur et se sont remémoré ce qui avait fait la richesse de leur carrière, leurs points forts, pour s’appuyer cette fois sur un socle musical plus large. Et du coup, on est baladés un peu dans tous les sens, avec notamment quelques saveurs du passé… « Book of Bad Decisions » (avec son « southern groove » typique , bottleneck et claviers en bonus) ou le punchy mais groovy « Ghoul Wrangler » auraient pu garnir Strange Cousins From The West… « Sonic Counselor » et ses rythmiques emblématiques ou « H.B. is in Control » pourraient venir de Pure Rock Fury… Les super catchy « A Good Fire » ou « Paper & Strife » de Blast Tyrant… Et la liste est sans fin ! Mais au-delà du trip « on se repose sur nos acquis », le groupe pousse ses délires dans ses retranchements (maîtrisés…) sur d’autres titres : la section cuivre brillante du quasi soul « In Walks Barbarella », les déluges de piano d’un « Vision Quest » (qui ne souffriraient pas en hommage à un Jerry Lee Lewis ou Little Richard), le sympathique vaguement country « Hot Bottom Feeder » servi avec double ration de slide guitar, jusqu’à ce “Lorelei” à l’ambiance grave et pesante, énième preuve du large spectre d’atmosphères que le groupe est en capacité de développer…
Clutch voit large (et voit grand) mais ne perd jamais son identité tout du long, essentiellement par le fait de ses musiciens, qui, encore, démontrent un talent remarquable. Dan Maines, solide, n’est que rarement mis en avant, et le chant de Fallon reste à la fois distinctif et emblématique. Mais c’est le jeu de batterie de Gaster (si l’on y prête l’oreille, d’une densité et d’une richesse remarquables) et le travail de guitare de Tim Sult qui amènent ce disque à un niveau de qualité encore supérieur – ce dernier en particulier, gardant son identité en tous temps : ce son mixant un fuzz délicieux et crunchy à une technique de jeu plus riche qu’il n’y paraît sont sa marque de fabrique (voir l’introductif « Gimme The Keys » qu’il porte de bout en bout).
Synthétiser un album aussi riche et copieux tient de la gageure. Pour autant le constat est assez simple au final : Clutch évolue, grandit, mais ne change pas radicalement, et ceux qui espéraient un retour à une période qu’ils trouveront plus glorieuse ou plaisante (et là encore, chacun a sa propre idée de laquelle…) peuvent toujours rêver. Clutch développe ses points forts et ne revient pas en arrière avec ce mal nommé Book of Bad Decisions. En revanche, ils ne renient pas leur passé et n’hésitent pas à le raviver pour affirmer leur identité comme ce « tout » que représente leur carrière. Les perspectives pour leur avenir n’en sont que plus enthousiasmantes. Alors, est-ce le meilleur album de Clutch ? La question mérite d’être posée…

La publication du premier album de Svvamp en 2016 avait fait son effet, soufflant nombre de chroniqueurs (dont moi) avec son bol de blues rock rafraichissant, se plaçant en bonne position dans nombre de (doom) charts de fin d’année. Les vinyles se sont vendus comme des petits pain (de boulangerie artisanale à pressage limité) et le nom du groupe, avec ses deux « v » avait tout pour s’inscrire humblement au bas des affiches des festivals spécialisés, première marche vers le (relatif) succès. Lorsque soudain… Lorsque soudain… Lorsque soudain rien du tout. Svvamp a fait 3 dates en 2 ans, toutes en Suède, ne communique sur aucun réseau social, ou très peu (ils ont même posté un LP dont aucune trace n’est visible nulle part, reprenant les titres de leur premier album, dans le désordre et sorti en autoprod, sous le nom de Swamp. Improbable) et balance à son label son second album avec toujours la même désinvolture.
Un album nommé Svvamp 2 donc, évidemment, répondant à des logiques 70’s (Led Zep et tant d’autre), ce qui colle parfaitement à leur musique. Leur musique qui est toujours aussi bonne, toujours aussi rafraichissante. Maitrisé, traversé de ce feeling bluesy qui avait fait tout l’intérêt du premier effort, Svvamp 2 ne souffre de rien d’autre que de sa comparaison au premier disque. Ces singles (« Queen », « Hillside ») sont un peu moins marquants que les précédents, la magie moins belle qu’aux premiers jours. Ceci dit, quel groupe ! Comment résister à « Sunshine Street », comment ne pas fondre à l’écoute d’« How Sweet It Would Be » ? Comment ne pas réveiller en nous nos envies de voir Cream ou CCR live ? Envies que Svvamp aurait pu – aurait dû – essayer d’apaiser au lieu de rester un trio de potes énervants ne jouant jamais en dehors de leur cave, obsédé par les enregistrements analogiques et n’ayant jamais saisi l’opportunité du buzz pour sortir de leurs froides contrées.
Gageons que Riding Easy Records ne va pas souper longtemps de cet immobilisme qui, en 2018, fait que le talent et la musique seuls ne peuvent suffire.
Point vinyle :
Côté vinyle : 500 Transparent Purple, 50 transparent Orange, 100 clear, 300 black. Servez vous, ça n’a pas l’air de bien se vendre alors que le disque est meilleur que 80% de ce qui va sortir cette année.
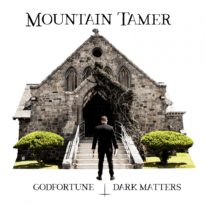
On ne pourra pas dire de leur discographie: “Mountain Tamer il faut un ULM pour en faire le tour”. Officiant depuis 2011, le trio de la côte ouest des États Unis ne signe cet été que sa seconde production. Pour autant, j’ai pu constater que les gars s’étaient laissé pousser les noix. J’ai d’abord cru à une filiation avec Black Rainbows, sans doute à cause du chant et des compos de guitare Psychédéliques, cependant j’ai vite retrouvé leur esprit garage mais cette fois métissé de rock 70’s velu. Il n’aura pas fallu beaucoup d’écoutes pour me convaincre que Godfortune Dark Matters est un album sur lequel il faut compter.
Godfortune Dark Matters ouvre fort sur “Faith Peddler” qui roule sur des riffs aussi entêtants que ceux d’un The Stooges. L’album est une œuvre hallucinée qui fait tourner un Stoner grassouillet, la majeure partie des pistes oscillant entre 3 et 6 minutes pour plus d’efficacité. La répartition des rôles s’y fait plutôt bien, les trois musiciens tiennent tous le chant, la batterie de Casey Garcia sait être discrète tout en supportant la basse mélodique de Dave Teget derrière un Andru Hall et sa guitare sous acide.
A propos d’acide, les gars ont dû en prendre un paquet car lorsque j’écoute “People Problems” les riffs se distordent et la gratte s’additionne d’un clavier dissonant comme une montée de trip trop violente. Il y a là une belle pépite et entre autres originalités j’ai trouvé la césure sous forme de prière indienne de “Funeral of a Dog”(Hurlements canins en prime) et le thème de “Mydnyte” qui sonne comme un vieux Deep Purple. Godfortune Dark Matters puise allègrement chez les anciens sans pour autant sombrer dans les poncifs lourdingues et mille fois entendus.
Parfois les substances font faire des choses inconsidérées, c’est probablement la raison pour laquelle le trio a coupé à la va-comme-je-te-pousse “Living in Vain” pour réaliser deux pistes au cœur de l’album qui pourtant prisent en un bloc ont une puissance indéniable. C’est finalement le seul vrai reproche à porter au débit de l’album: Une coda mal placée sur la première partie d’un éclaté de morceau et ce sans réelle justification.
Avec cet album, c’est un Stoner Psych bien actuel qui s’offre aux oreilles du curieux tout au long des onze pistes faciles d’abord et bien foutues. C’est le genre de galette tout terrain que tu peux soit laisser venir te chercher au fond de ton canapé soit laisser t’accompagner à fond sur un ruban d’asphalte à toute vitesse en direction du couchant. Mountain Tamer signe une belle évolution dans son écriture et une garantie, je l’espère, de qualité pour ses prochains disques.
A noter une double signature chez Magnetic Eye pour le support numérique et chez Nasoni pour l’édition du vinyle.

Mantar, ce groupe qui a la possibilité de te rougir la peau du cul juste avec ses deux musiciens vient se rappeler à ton bon souvenir à la façon d’un Maître Sadomasochiste qui te gronderait, “N’oublie pas, tu es ma chose!”. Et toi esclave soumis devant tant de puissance musicale de répondre, “Oh oui, violez moi les tympans avec votre Sludge surdimensionné”. Donc, pour les néophytes, installez vous confortablement dans un Sling et pour les amateurs de coups de cravache derrière les oreilles vous savez où est votre place, voici The Modern Art of Setting Ablaze, le troisième LP studio de Mantar
Premier constat, le pessimisme des plages est plus marqué, avec une profondeur que n’avait pas encore exploré Mantar. Le duo s’affirme comme non seulement maître de la violence mais aussi du spleen, passant de la cire chaude aux coulées d’acide. S’introduisant avec une piste toute en vaseline, “The Knowing”, débute l’album et surprend par sa prévenance instrumentale, heureusement cela ne dure pas plus de deux minutes et Mantar revient pour mieux nous forer les esgourdes avec sa puissance unique.
La volonté de faire des morceaux plus corrosifs, plus courts, est nette (ce qui faisait déjà largement la marque de fabrique de nos brutes). Les titres explosent les uns après les autres et ne dépassent les 5 minutes que sur le titre final, “The Funeral”. J’espère cher lecteur que ta platine est ignifugée, car les gars on fait monter une fois de plus la température avec leur musique au phosphore.
On sent comme une envie de narration plus forte sur cet album. “Seek + Forget” sera mon illustration, alternance de hurlements mis en avant sur des riffs plus atténués avec reprises puissantes et rageuses de frappes lourdes côté fûts, donnant des envies destructrices. Il se dégage une tendance générale à allumer des bougies pour une atmosphère feutrée dans ce The Modern Art of Setting Ablaze. Mais pyromane un jour, pyromane toujours, le déferlement de violence submerge tout systématiquement. Mantar en tribun avisé va convaincre le plus large public. “Taurus” a la structure type du morceau à tiroir qui peut conquérir les masses et l’outro de chant en duo devrait les galvaniser.
Pour retrouver de l’énergie punk défouloir il faut tout de même attendre la sixième piste “Dynasty of Nails” pour que le tempo s’accélère, et encore par touches successives. Mantar vient te chercher les tripes et laisse libre cours à sa noirceur, le gimmick au clavier de “Obey the Obscene” t’introduit une gêne honteuse puis la reprise des hostilités te fait te comporter en bête enragée. Mantar confirme aux habitués que l’établissement est toujours bien tenu, “Eternal Return” ou “Teeth of The Sea” délivrent ce que l’on attend, un Rock velu et Sludge . L’évolution du groupe flirte couramment aux limites du Black mais elle évite soigneusement tout classicisme.
En 47 minutes 40 secondes Mantar allume un album plus Métal que jamais et se distingue en se hissant à des sommets artistiques où l’apparente facilité d’écoute se traduit vite par un besoin d’audition prolongée et toujours aussi bandante. C’est une galette sans compromis, forgée dans la brutalité la plus primitive. Alors maintenant, range cette chronique sur ton PC, dans ton répertoire à vices, et va en portant fièrement ton baudrier de cuir commander l’objet du vice: The Modern Art of Setting Ablaze, tu peux me croire, tu y trouveras plus que chez D-A-F de Sade.

Ceux qui avaient eu l’occasion d’écouter le précédent album de Forming The Void pourraient être surpris par l’orientation que prend le quartet de Louisianne en signant sa quatrième plaque cette fois chez Kozmik Artifactz. Rift est un album qui se tourne résolument vers le Doom tout en conservant les bases atmosphériques du précédent opus.
Les 46 minutes de l’album contiennent une perle de lourdeur aboutissement des albums précédents. Rift est de fait une belle synthèse de ce qui faisait déjà le charme du groupe tout en y apportant plus de maturité et de réflexion. Forming The Void propose au travers de ses composition une marche forcée au cœur d’une faille inexplorée de l’écorce terrestre et on y traverse différents paysages tantôt sombre, tantôt lumineux.
D’entrée de jeu l’esprit de l’album est sale et lourd comme la traversée d’un bayou où les riffs s’attardent parfois pour livrer une luminosité irréelle. La voix scandée de James Marshall a fait le plein de puissance avec ses abords prog et gonflés de reverb, le tout dans un esprit à la Windhand qui s’accorde tout à fait avec le Doom Mid-Tempo martelé tout au long des titres.
A la carte des riffs pachydermiques et entêtants, on trouve notamment les titres “On We Sail” et “Arrival”. ce dernier alternant un beau mélange de phases Doom et de phases rapides purement Stoner. Pour les amateurs de mets auditifs plus délicats, on portera son choix sur “Arcane Mystic” dont les passages orientaux s’accordent parfaitement avec l’esprit de l’album et débouchent sur un “Transcient” lancinant et toujours marqué par le même attrait culturel du guitariste Shadi Omar Al Khansa. Le tout dévie quasi invariablement sur des montées épiques où les guitares et la basse de Luke Baker envoient toute leur puissance sur fond de frappes obèses de l’agile Thomas Colley.
chaque morceau constitue un une image du voyage au cœur du Rift et Forming The Void ne se repose de son périple que lorsqu’il joue l’éthéré et toujours oriental “Ark Debris” où le chant est plus calme et le souffle des instruments plus lent. Enfin on pourrait croire à une clôture d’album plus cool avec l’intro du morceau mais les potards sont repoussés au maximum pour “Shrine”. Plus puissante émotionnellement et plus lourde, cette conclusion sonne comme une invocation tribale. La piste a plus de tripes que les autres avec une louable césure centrale où souffle de nouveau le vent aride des contrées de désert et d’oasis durant une petite minutes avant le retour de la tempête. Le voyage se termine sur un promontoire battu par les vents et laisse soudainement l’auditeur seul dans le silence.
C’est un album notable que “Rift”, tout en équilibre où tous les morceaux peuvent être pris indépendamment comme d’un seul tenant pour mieux percevoir toute l’ampleur du travail accompli. Il n’y a pas plus de virtuosité que de raison dans ce panorama où les musiciens jouent à parts quasi égales. cependant c’est un travail intelligent et qui glanera une position confortable dans les discothèques des amateurs du genre et ce malgré quelques reproches pouvant être faits sur des clôtures de morceaux parfois trop abruptes.

Le stoner (heavy) rock aime les reprises. Son univers s’est d’ailleurs créé là dessus. Pour la faire courte, son mouvement est celui de musiciens 90’s, sautant une décennie pour se réapproprier les vibrations 70’s, à grands coups de wha-wha. Et Tony Reed, guitariste chanteur derrière Mos Generator, l’une des formations les plus sous estimées de la scène (espérons que leur récent passage au Hellfest change cet état de fait), est un homme passionné par la musique. Fort d’une des collections de vinyles les plus conséquentes du circuit, obsédé par les 70’s (il a de nombreuses pièces tatouées sur lui, dont la Louise de Sabbath et Eddie d’Iron Maiden), Reed a, en 2015, publié un certain nombre de reprises sur internet. Multi-instrumentiste, ce dernier a tout enregistré seul, joué de chaque instrument et a essayé, par cet exercice, de montrer à ses suiveurs l’étendu de ses influences. Listenable Records, label français avec qui Mos Generator est en contrat a décidé, cette année, de presser ces titres pour le plus grand bonheur des amateurs de musiques et de son histoire.
Bien sûr un tel album peut difficilement être noté. La démarche était de publier ce contenu en ligne et si un tel pressage rendra heureux quelques collectionneurs (dont je fais potentiellement parti), son intérêt semble tout de même assez limité. Le contenu lui, dit par contre pas mal de choses qui méritent d’être décryptées.
Les 16 titres choisis viennent tous des 70’s (exception faite de « Court Of The Crimson King » de… 1969, si vous voulez chipoter et ne pas entendre qu’en musique amplifiée les 70’s ont commencé une année en avance). Le spectre musical balayé renvoie aux courants « proto »/« hard rock » qui ont court en ce moment (La série Brown Acid, les réédition Akarma etc.) et si quelques titres célèbres et/ou évidents sont présents : (« Court Of The Crimson King », dont Reed a l’artwork tatoué sur l’avant bras, trois Pentagram dont l’incontournable « Forever My Queen », que j’ai tatoué sur le bras tiens ou Atomic Rooster que… Bah que quelqu’un a bien dû se tatouer un jour mais là j’ai pas d’exemple), le reste est plus aventureux. Reed choisit soit des groupes établis mais sur des titres moins évidents (Slade, Cheap Trick, Iron Butterfly, Rush, Wishbone Ash) ou alors met en lumière quelques pépites qu’internet fait remonter à la surface (Necromandus ou Bloodrock pour les plus évidents, Boomrang, Poobah, Fanny Adams ou Highway Robbery pour les plus confidentiels). L’interprétation quand à elle est malheureusement (un peu trop) fidèle. Pas ou peu de relectures ici : le piano fou de « Battle » est absent, remplacé une guitare lead implacable, « Ain’t No Lovin’ Left » prend des allures Clutchiennes (appuyant les réminiscences de l’originale), Reed rend un peu de groupe au « Dier Not A Lover » de Bloodrock (quel étrange batterie mitraillette sur le titre originel). Mais l’audace vient plutôt du choix de « Garden Road », un (pas tout à fait) inédit du premier album de Rush, trouvable sur u bootleg nommé The Fifth Order Of Angels (et dont le riff pourrait avoir inspiré le « Lonely Boy » des Black Keys) ou du dépoussiérage bienvenu du « Still Born Beauty » de Necromandus (cette guitare acoustique en avant dans le mix !). Le reste, souvent fidèle au modèle original n’a que peu d’intérêt.
Drôle d’album que celui là, travail de mémoire offert aux oreilles de tous le net bénéficiant 3 ans plus tard d’un pressage, laissant envisager par son « Vol 1 » une suite. M’est avis que sa place sur bandcamp est ce qui reste le plus indiqué.
Point vinyle :
Le vinyle est pressé exclusivement en vinyles, black, avec seulement les 10 premiers titres et les 6 suivants en bonus sur un CD. Ce qui est disons… Couillon.
Sinon pour les autres tout est à l’écoute ici : https://tonyreed.bandcamp.com/album/the-lost-chronicles-of-heavy-rock-vol-1

Vous l’avez cette sensation quand on découvre une belle alliance de saveurs ? Quand les papilles chuchotent de mille picotements délicieux au contact d’un sucré-salé inattendu ? Vous en salivez même ?
Voilà, c’est l’effet Hubris. Le jeune combo toulousain officie depuis 2 ans maintenant et vient de sortir cette année un deuxième EP étonnant de fraîcheur, de maturité et d’intelligence.
Par la grâce d’une vidéo live postée sur youtube, teintée de psychédélisme projeté et de plans rapprochés nous faisant entrer dans le corps de l’entité musicale, les toulousains offrent une expérience sensorielle agréable et immersive. Faisons valser les étiquettes autour d’eux afin de comprendre quelle cuisine pratique le quatuor. Elle est chaude et épicée à la manière d’un King Lizzard and the Lizard Wizard, piquée de pointes acidulées à la Ecstatic Vision, mijotée façon L’effondras et aventureuse comme a pu l’être la tambouille du Floyd expérimental.
L’ensemble de ces références est habilement mixé et ne souffre d’aucune grossière erreur. Un Ep peut-être, mais de quasiment une heure qui nécessite une attention véritable pour qui voudrait creuser leur musique. Les cuistots connaissent la formule pour pondre du riff accrocheur mais n’hésitent pas à faire entrer le client dans de longues plages de transes où la respiration se calque au lent rythme de leurs envies. C’est savoureux, étonnant.
Hubris va devoir transformer l’essai rapidement. En se frottant à l’exercice live déjà, pour savoir si l’expérience survit à l’épreuve de la scène, en enregistrant un album ensuite car l’édifice a besoin de plus de charpente, de structures. L’équilibre entre le corps et l’âme nécessite encore de la réflexion et du dosage, on aimerait en effet un peu plus d’instinctif que de cérébral. Mais ne boudons pas notre plaisir, cette cuisine là a clairement un goût de « reviens-y » et pourrait avec l’intelligence qui les caractérise gagner sa première étoile d’ici peu de temps.

Church Of The Cosmic Skull se demandait dans son premier album si Satan était réel. Il revient deux ans plus tard pour traiter de science fiction, ce qui est somme toute logique, la religion étant la plus grande escroquerie scénaristique de tous les temps.
On était tombé sous le charme ironique du combo anglais sur son précédent effort, saluant sa faculté à mixer les codes sans se saborder. Exercice délicat et casse-gueule que le groupe ne parvient pas forcément à réitérer.
Non pas que l’album soit mauvais mais il passe le plus clair de son temps du côté lumineux de sa verve créatrice, à naviguer entre chœurs inspirés et aériens, guitare gorgée de soleil et orgue bienveillant. Tout ceci respire la lumière et la grâce, Church of the Cosmic Skull prêchant finalement pour la pop en laissant de côté ses obédiences métal et 70s. On est sur un effort court et sucré, concis et majeur dans sa tonalité. De bonnes chansons mais pas un album stoner. Le groupe ne s’en revendique pas forcément et sa présence sur les blogs et festivals du genre laissera de plus en plus perplexe.
Church of the Cosmic Skull s’éloigne donc par son choix esthétique de notre ligne éditoriale et l’on ne se permettrait pas une mise au pilori par trop facile. On regarde donc son ex, toujours sexy en diable, partir au loin, avec des envies différentes des nôtres. On reste un peu penaud sur le bord de la plage, un peu triste aussi de cette trop courte idylle. Mais rien ne nous empêchera d’y repenser comme une belle et rafraîchissante expérience. Un amour de vacances en somme.

Après Spaghetti Cowboy et Biufolchi Inside sortis respectivement en 2012 et 2014, le quatuor de Savona en Italie signe cette année chez Small Stone Records pour sa troisième production. Une pièce au carrefour du blues, du psychédélisme et du heavy rock bien stoner intitulée Cosmic Blues.
Tout d’abord, les sept titres de l’album affichent une diversité certaine. Déjà dans la taille des morceaux – de 1 min 43 pour les pièces de groove métallique et froidement électrique comme « Chase Me » à plus de 7 minutes pour d’autres comme « Helter Skelter » ou « Baby Eroina » . Ensuite dans l’écriture de ces derniers. On navigue de grosses rythmiques groovy à souhait et toutes grésillantes à de franches séquences de jams déchaînés avec solo de guitare aux accents space rock. « Baby Eroina » en incarne le probant exemple, et dans cet ordre précis.
Là-dessus, la voix d’Alex Barbanera (qui joue aussi la guitare), vient agrémenter le tableau. Un chant puissant et ultra saturé à la limite du cri qui, bien que relativement peu présent, apporte une énergie supplémentaire ; une sensation d’effort qui intensifie encore la musique.
Une intensité illustrée dans « Cosmic Blues For Solitary Moose » par le reste des instruments. Une rythmique lourde et entêtante d’Il Colonnello et de Dany Kastigo mise en relief par une guitare aérienne qu’il sera impossible d’écouter sans secouer la tête.
De manière générale, cet album sait agiter, et son apparence décousue n’est qu’une façade. Que vous soyez un fervent afficionado de morceaux puissants habités de soli à la pelle ou bien de sons plus bluesy agrémentés d’une voix tout ce qui existe de plus fiévreux, on ne saurait vous recommander davantage ce subtil mélange qu’est Cosmic Blues.

Power trio féminin originaire de Los Angeles, High Priestess sort son tout premier album éponyme chez Ripple Music.
Le groupe vous ouvre les portes d’un Heavy Psychédélique des plus fidèles. Le premier titre « Firefly » est d’ailleurs très représentatif de la couleur musicale : lourdeur rythmique, grosses guitares, ambiances aériennes et planantes et voix mystiques sont au rendez-vous. Autant vous dire qu’on nage en pleine messe noire Doom comme le prouve l’excellente chanson « Banshee » et la terrible « Mother Forgive Me ».
Mais aussitôt habituées à entendre des influences à la Acid King ou à la Earthless, les Californiennes arrivent à surprendre avec des riffs qu’on n’attendait pas vraiment. « Despise » est introduit par exemple avec une charmante guitare acoustique : ambiance feu de camp et spiritisme garantis ! Puis parfois, on a même le droit à quelque chose de plus groovy avec des titres comme « Take The Blame » où la batterie et la basse sont reines. Enfin, le groupe clôt avec un titre tout à fait somptueux : « Earth Dive ». Ce titre révèle toute l’émotion, la finesse, et la justesse vocale raffinée de Katie Gilchrest.
On peut donc dire que ce premier album est une réussite : un fervent mélange de mysticisme et de lourdeur instrumentale. Il y a encore un peu de chemin à parcourir avant d’acquérir un peu plus de maturité, mais High Priestess est sur la bonne voie.

Il ne se passe jamais longtemps avant que la scène polonaise ne vienne nous gratifier d’une belle galette. Spaceslug fait partie de ces petites douceurs très attendues avec son troisième LP en moins de trois ans et une notoriété montante qui ne semble pas vouloir s’arrêter là. Les trois albums de Spaceslug représentent leur parcours au travers de l’espace et ce voyage cosmique n’est pas linéaire, chaque album est une pièce à part, un monde différent, “Eye The Tide” n’y fait pas exception, on s’aperçoit vite que les pistes ont une structure très hétérogène et qu’il faudra plusieurs écoutes pour appréhender totalement leur musique. Fait curieux,cet album, arrive à distordre le temps et l’espace et m’a donné l’impression de ne jamais écouter le même opus d’une fois sur l’autre.
Le trio de chant omniprésent sur la première partie de l’album m’a offert une belle profondeur de spectre,”Obsolith” et “Spaced by One” ouvrent l’opus sur des sons psychés proches parfois d’un Elder avec ce mélange tout à la fois planant et massif, j’y ai trouvé sans surprise des accents Doom et quoi de plus normal pour ce trio qui s’affirme comme un groupe de “Doom Cosmique”. Cette idée est particulièrement valable sur “Eternal Monuments” avec sa basse poussée à fond et son mid-tempo lancinant. Si j’ai navigué en terrain connu avec ces morceaux dans la veine des précédents albums, cette dernière piste se déstructure petit à petit et emmène l’auditeur vers “Words Like Stone”
Césure dans la conception de l’objet avec une composition psych partiellement électro-acoustique qui glisse doucement sur un versant entre Sludge et Post Metal. Il m’apparait évident que ‘Word Like Stone” est la perle de l’album La puissance du trio m’est arrivée en pleine face lorsque le chant devient corrosif (A la limite du Screamo) et que les nappes de sons s’alourdissent. Cet esprit continue de vivre sur “Vialys part I & II”. assemblage de deux morceaux où j’ai trouvé des atmosphères presque contradictoires, j’ai été plongé dans une écoute planante et lumineuse pour qu’au bout de quatre minutes je sois secoué par un esprit bien plus lourd et introspectif à grand renfort de basse et de Wawa. C’est une profonde sensation de déséquilibre qui après plusieurs écoutes renforce un sentiment de délicieuse dichotomie. La jonction est parfaitement assurée pour cette pièce de près de neuf minutes et demies, le cap est affirmé et Spaceslug ne s’échoue jamais avec son vaisseau intersidéral qu’il pilote d’une main de maître.
L’album se clôture sur un “I, The Tide” tout aussi proche du Post Metal que le titre précédent, la basse y sonne lourdement en accompagnement d’une guitare caverneuse au milieu des écho du chant pour un univers déstructuré et plaintif. Les 11 minutes ne sont pas constantes, une fois de plus le morceau peut-être divisé en plusieurs parties avec une conclusion des plus Doom grâce des riffs puissants, basiques et répétés à l’envie.
“Eye The Tide” est un album d’une grande maturité, il est pensé de façon globale sans proposer à chaque titre les mêmes schémas. Il a cette force de pouvoir être écouté d’un tenant comme de permettre une écoute des pistes à la volée. Au final cet album vient confirmer le potentiel de Spaceslug tout en proposant un réel casse-tête aux amateurs de cases. “Eye The Tide” propulse le groupe avec brio au sein de galaxies lointaines dont ils restent les seuls découvreurs.

Il ne faut pas se fier aux apparences. A en juger par le nom du groupe et la pochette de son album, An Asphyxiating Embrace doit être sombre et glauque à souhait, et, à vue de nez, on s’imagine un gros doom bien crasseux et rugueux. Que nenni les amis ! Formé en 2012 à Oslo, le groupe Rongeur aura mis du temps pour nous sortir ce premier album qui est bien loin de tout ce que l’on a cité précédemment. Certes, ça reste du sludge, on a donc un minimum syndical de saleté et de virulence à respecter, mais un sludge entrainant et revigorant.
An Asphyxiating Embrace fait dans la concision puisqu’il n’est composé que de 8 morceaux, d’environ 4 minutes chacun. Sur ce court format, les norvégiens ont choisi d’aller droit au but et de ne pas perdre beaucoup de temps en s’éparpillant à droite à gauche. Les morceaux sont percutants et l’énergie est constante, on ne trouve aucun temps mort ni ralentissement sur cet album.
Le premier titre, “Weltschmerz” (la douleur du monde, en allemand), nous fait fortement penser à certains riffs de Mastodon, très mélodiques, où l’on a l’impression que le guitariste révise ses gammes. Même constat sur les arpèges d’intro de “Wellpisser”. Sur d’autres comme “Mr Hands”, l’influence principale d’un bon stoner des familles bien groovy est plus évidente. La voix du chanteur, basse, rugueuse et gueularde, porte parfaitement ces morceaux définitivement très enflammés. Le titre rouleau-compresseur “Special Needs” de 1 minute 50 vient même donner un côté punk à l’album.
An Asphyxiating Embrace est un bon premier album, où il est impossible de s’ennuyer. On regrettera peut être un manque de variété sur l’ensemble de l’écoute, on aurait aimé certains passages pour sortir la tête du camion et respirer un peu d’air frais. Tant pis, on foncera tête baissée dans les effluves d’essence. C’est sympa aussi.
|
|