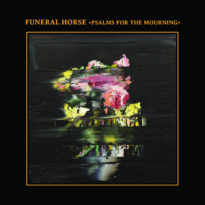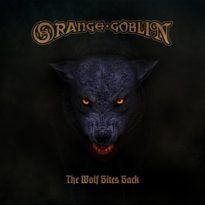|
|
 La gente féminine a le vent en poupe de nos jours sur la scène stoner au sens large (sauf au sein de notre rédaction qui pue la testostérone à pleins naseau…) et nous n’allons pas bouder notre plaisir en assistant à ce mouvement là où jadis Misdemeanor faisait figure d’intrus au milieu des velus comme des poils dans une assiette. On ne va pas exagérer non plus : Lucifer n’est pas un combo 100% féminin quand bien même Lucifer sans Johanna Sadonis – sa frontwoman – ne serait pas Lucifer tant sa présence irradie sur les compositions ainsi que lors de l’exercice scénique. La gente féminine a le vent en poupe de nos jours sur la scène stoner au sens large (sauf au sein de notre rédaction qui pue la testostérone à pleins naseau…) et nous n’allons pas bouder notre plaisir en assistant à ce mouvement là où jadis Misdemeanor faisait figure d’intrus au milieu des velus comme des poils dans une assiette. On ne va pas exagérer non plus : Lucifer n’est pas un combo 100% féminin quand bien même Lucifer sans Johanna Sadonis – sa frontwoman – ne serait pas Lucifer tant sa présence irradie sur les compositions ainsi que lors de l’exercice scénique.
Je ne connaissais que très vaguement la chose lorsque je m’y frottais lors du dernier Desertfest de Berlin et avais été déçu dans un premier temps tant The Oath (formation précédente de la nana dont je vous causais au paragraphe précédent qui demeure assez proche du registre que Lucifer propose) m’avait botté jadis. Mes oreilles vinrent tout de même se poser sur le premier opus de ce groupe dont il ne reste plus grand chose sur cette nouvelle plaque hormis Madame Sadonis !
La blonde chanteuse a négocié l’après Gaz Jennings (qui s’en est retourné à d’autres occupations) en bossant avec un type au curriculum vitae plutôt bien fourni : Nicke Andersson (Entombed, The Hellacopters et Imperial State Electric si ça vous cause un tantinet). C’est cette structure bicéphale qui s’est embarquée dans le processus de composition de ce second album sobrement intitulé « II » (oseront ils le « III » ensuite comme Led Zeppelin ou Rambo ?). Ces deux têtes pensantes désireuses de mettre en boîte le fruit de leur labeur en duo se sont précipitées à The Honk Palace à Stockholm (le studio d’un gars qui a jouée dans Entombed, The Hellacopters et Imperial State Electric si jamais).
Le gars qui a joué dans Entombed, The Hellacopters et Imperial State Electric et qui a un studio à Stockholm s’est chargé de la basse, de la batterie et d’une partie des guitares sur cet enregistrement étant donné que le duo voulait battre le fer tant qu’il était chaud (et plus si affinité). C’est donc avec l’appui de Robin Tidebrink, pour l’autre partie des guitares, que « II » a été dans la boîte. Le format trio adopté pour les prises de ce disque est sacrément complété pour ce qui est des représentations publiques ce qui donne une belle épaisseur dans la sono (pas toujours simple pour une petite équipe ; n’est pas Tony Iommi qui veut).
Sur le papelard la formule a une belle gueule et sur disque elle confirme les écrits avec ce deuxième volet qui se place clairement dans le sillage des légendaires Black Sabbath sans toutefois cloner la bande d’Ozzy (j’ai déjà cité Tony plus haut). Des titres comme « Eyes In The Sky » sont imparables avec un tempo très ralenti, des riffs avec une énorme paire de couilles et un chant avec une paire de nichon. Si l’intensité retombe parfois (« Before The Sun » sorte de va-et-vient entre la bluette et les riffs de Birmingham), c’est pour mieux nous rattraper par le col quelques titres plus loin. Par exemple avec le titre de clôture « Faux Pharaoh » qui renoue avec le doom abordable (rayon Pentagram ou Cathedral pour vous situer la chose) décliné avec Maestria par le trio (qui selon les gossip est un couple + 1 guitariste).
J’aurai apprécié avoir plus de morceaux du genre de « California Son », le premier titre et mon préféré, qui est exemplaire dans sa concision et sa vélocité (sans toutefois singer The Hellacopters) car il est bigrement efficace et j’aime à penser que Llucifer pourrait s’employer à persévérer dans ce style à l’avenir car cette aventure musicale semble être construite pour durer (et le mec qui jouait dans Entombed, The Hellacopters et Imperial State Electric et qui a un studio et qui est avec la chanteuse ainsi que la chanteuse elle-même en ont sacrément sous le pied).

Trois ans après un « Five Degrees of Insanity » froid, oppressant et sombre, les lyonnais de Cult of Occult nous reviennent avec ce « Anti Life » qui, par son titre déjà, annonce un nouveau disque manifestement tout aussi propice que son prédécesseur à la gaudriole ou aux pique-nique en famille au bord d’une aire de jeux pour enfants.
Les composantes clés du combo français restent donc assez stables : les thématiques et ambiances développées sont glauques, sinistres, âpres, et la haine transpire à chaque coup de cymbales.
Côté musical, là aussi, pas de rupture, mais un pas de plus franchi dans le sordide, ou plutôt un saut à pied joint dans un puits profond, évidemment rempli d’un goudron bien chaud. Ca sludge grave et dur, et ça doome lourd et lent. Des plans de gratte empruntés au black, d’autres au doom le plus vicié ou au sludge le plus gras, un chant hurlé à vif, en continu, et des ambiances pesantes et glauques, enrobées pour ne pas laisser de place au silence par des séquences de feedback d’amplis que l’on imagine en limite de rupture. Vous rajoutez une couche de « post-« devant toutes ces étiquettes pour faire bonne figure et on commence à toucher du doigt le bestiau.
Bon, on glosera quand même avec un peu de cynisme mal placé sur les velléités arty-bidule du combo : artwork dark aux limites de l’abstraction, titres de chansons elliptiques et opaques (2 lettres chacun), un track listing supposément constitué d’une seule chanson a priori sectionnée en 4 pour des vilaines considérations techniques et marketing (en fait les 4 segments se tiennent très bien en autonomie…).
Mais on ne retirera pas à C.O.O. le résultat obtenu, à savoir un disque de doom noirâtre, aux relents funeral doom, en vision intégriste. C’est en tant que tel une raison suffisante pour se pencher sur l’objet, tant le genre peut être perverti, dilué, fruit de concessions diverses et variées aboutissant parfois à des résultats intéressants, mais plus souvent à des pérégrinations un peu stériles. Cult of Occult trace sa route à sa manière, en esthète fondamentaliste, radicalise son propos et ne lâche plus le volant une fois prise la direction du ravin… Comment ils pourront dépasser cela ? Le disque est déjà intéressant en tant que tel, mais suivre le développement de cette approche à l’avenir risque d’être passionnant.

Red Sun Atacama est un groupe de menteurs. Déjà comme leur nom ne l’indique pas, il ne viennent pas tout droit du Chili mais de Paris. Ensuite l’album s’ouvre sur une introduction qui pourrait nous faire croire à un album de musique traditionnelle de Cuzco (Source “Dictionnaire de la musique”, ed. Larousse) et il n’en est rien puisqu’il s’agit d’un groupe de pur Stoner! Alors je pourrais crier au scandale, mais finalement tout ceci arrange bien mes affaires et me permet de vous en parler.
Boucles aguicheuses et envoûtantes Red Sun Atacama joue à mille à l’heure comme dévalant une pente abrupte. cet album, “Licancabur” sonne d’un bout à l’autre Stoner et le groupe y balance sa musique avec une énergie toute punk. L’excellent mix studio offre aux oreilles un son gras, puissant et l’on ne déplore pas la mise en avant outrancière de la basse.
S’il s’agit d’un Power Trio guitare, basse batterie,chant, Red Sun Atacama intègre également un clavier dans ce premier album. (Encore un mensonge, trois gars, Cinq instruments !) C’est une idée plus que louable qui permet d’avoir un peu plus à se mettre sous la dent que lors d’un concert. Si j’ai eu l’occasion d’apprécier leur musique en live, cela tient en premier lieu à la puissance dégagée lors d’un set et à la façon dont elle se communique au public. L’exercice de l’album studio pouvait laisser craindre une perte et il n’en est rien. Le son est tout aussi jouissif et l’ajout d’un instrument supplémentaire apporte un peu de finesse dans cet environnement de gifles sonores à l’énergie juvénile. dommage que cela ne garnisse par l’entièreté des pistes.
Si l’on doit parler d’influences elle seraient kyusséennes et avant de crier au manque d’originalité restons raisonnables: “Stoner classique oui, mais énergie juvénile je vous dit!” Si Licancabur est un volcan (Source Wikipédia), cet l’album est une éruption. Cela pourrait se résumer comme ça: En volcanologie musicale tout ce qui se passe est prévisible mais on y prend toujours le même plaisir Fuzzé ( Source “Haroun Tazieff sur le mont Fuzz” ed. Cages à miel)
Pour conclure, l’album laisse un peu sur sa faim, 35 minutes 19 c’est court, trop court, et que l’on aille pas me dire que je ne vous avais pas prévenu: Red Sun Atacama est un groupe de menteurs! Un LP de six titres pour une durée proche de l’EP, on espère donc une production très prochaine et complémentaire avec un album qui fera le plein complet cette fois-ci! faites vite les gars, la platine commence déjà à ronger le disque que je me repasse en boucle en sautant partout.

Qu’elles furent difficiles à vivre ces quatre années depuis Miserable, la précédente offrande de Bongripper… On a eu beau faire tourner l’objet encore et encore, on était en manque. Et on ne peut pas vraiment compter sur les faméliques tournées du quatuor U.S. pour nous sustenter. Dire que c’est la bave aux lèvres et la langue pâteuse qu’on se jette sur ce nouvel album est un large euphémisme. On est morts de faim.
On s’y attendait, le morcif va être difficile à digérer : construit comme une pièce de barbaque de 45 minutes, la plaque est coupée en deux titres pour des questions plus techniques qu’artistiques (les fans de vinyl vont même devoir, sacrilège, changer de face en plein milieu du disque…). On ne dissertera donc pas dans cette chronique sur la teneur distincte de chacune des deux plages, ironiquement nommées “Slow” et “Death” ; la bestiole s’avale en un bloc, du début à la fin.
Et qu’est-ce qu’il y a à manger dans ce Terminal, donc ? Du pur Bongripper, sans ambigüité. Du doom qui amène un des sons les plus heavy du genre à des compos fournies et audacieuses. Du doom intelligent, riche, stimulant, mais qui caresse contre le sens du poil. Mais pas forcément comme le ferait Sunn o))), qui sur-intellectualise le doom et le retranscrit sous une forme quasi physique (son, vibrations…) ; les deux extrêmes, la tête et les jambes. Bongripper, moins pédant en quelque sorte, propose une musique plus accessible (ne versant jamais franchement dans le drone par exemple) tout en restant exigeante, et avec de nombreux niveaux de lecture, permettant à la fois le plaisir simple de se prendre une grosse claque doom sans prise de tête, ou bien l’opportunité de réfléchir aux fluctuations des morceaux, aux sons, aux émotions abordées… Vous y rajoutez une pincée d’ironie et de second degré, et l’identité trouble du quatuor américain se dessine un peu… Musicalement, ils ont créé ce son mêlant un jeu brutal et pachydermique à la fois, avec une production limpide (c’est Dennis Pleckham himself qui s’y colle ici, avec réussite). Le travail sur les guitares en particulier, est leur marque de fabrique : toutes en complémentarité, les explorations soniques des duellistes Nick et Dennis s’entremêlent, se soutiennent l’une/l’autre, tissent des structures et des ambiances sonores variées, pour mieux déverser des nappes de napalm avec l’aide d’une basse complice et elle-même redoutable d’efficacité. Bien entendu, toujours pas l’ombre d’un soupçon de chant.
Terminal est constitué d’une succession de séquences musicales imbriquées, structurées, complexes, qui rappellent à quel point l’œuvre du combo de Chicago peut d’une certaine manière être appréhendée comme une musique progressive. Le segment le plus marquant est probablement le premier, qui est le plus classique aussi : la construction de ce riff-colosse, et son évolution/transformation au cours des plus de huit minutes qui suivent, le rendent infectieux dès les premières écoutes. Ce riff entêtant, quoi que complexe, vous tournera en tête bien après que le disque soit fini… Une fois le propos entendu, le groupe nous sort un break dont il a le succès pour installer sa seconde séquence, encore une fois typique : commençant dans une ambiance plutôt mélancolique, le lick de guitare en son clair s’installe pour se transformer sur les minutes suivantes en un nouveau riff oppressant et violent. Break, on reprend à peine notre respiration quand on se reprend derrière la nuque le segment le plus brutal du disque, avec un nouveau riff quintessentiel (3 ou 4 notes maxi), massue, qui devient même dévastateur quand la basse de Petzke décide de doubler la gratte, tout simplement. Le triple assaut rageur.
Cette séquence écrasante s’efface par le truchement d’un nouveau break atmosphérique, bouffée d’air frais, pour ouvrir à nouveau une partie vaguement “catchy”, comme celle en intro, avec encore une paire de riffs jumelés fédérateurs et mémorables. Petit à petit on est amenés vers le dernier quart du disque, encore une fois construit avec un talent qui tangente le génie : mise en tension par une rythmique “martiale” par la batterie de O’Connor, puis arrivée d’un riff rudimentaire, qui se tend progressivement pour se transformer en une sorte de ritournelle sur-heavy malsaine, un long morceau de doom pesant, s’appuyant sur une instrumentation quasiment dissonante et dérangeante. Le naïf pouvait espérer un final stratosphérique, une envolée épique assez logique et bienfaitrice, une source d’espoir bienvenue pour clôturer cette galette sombre et poisseuse ; mais le quatuor ne l’entend pas ainsi et préfère pousser au malaise en conclusion. Croche pied, la tête dans une flaque de boue, ces connards vous collent leurs rangers derrière la nuque pour finir de vous étouffer dans la fange, en perdant pied petit à petit au rythme lancinant et répétitif de ces lignes de guitare “sirènes” ensorcelantes et lancinantes…
Pour enrober cette œuvre totale, Bongripper propose cette fois encore un artwork saisissant et intrigant (ils font des infidélités à Mike Miller, leur graphiste habituel, pour un certain Sam Alcarez).
Bongripper nous a habitué à rien moins que l’excellence, sur tous ses albums. Certaines de ses sorties plus “expérimentales” (EP, split…) ont pu faire froncer quelques sourcils, certes, mais leurs albums ont toujours été des pièces d’orfèvrerie doom du plus beau calibre, doublées de trésors d’inventivité. Terminal est de ce niveau. L’un de leurs 6 meilleurs albums, sinon LE meilleur. Mais on attend déjà la suite… Ça va être dur…

Domadora, ou « la femme dresseuse de lions » si l’on en croit les traductions d’anciens textes sacrés espagnols. Une entité sauvage incarnée par trois musiciens parisiens depuis 2012 et qui œuvre au carrefour du heavy psyché et du jam des seventies. En 2018, ils viennent poser la troisième pierre à leur édifice avec un album intitulé Lacuna. Quatre pistes arborant comme étendard un artwork du photographe et cinéaste français Antoine d’Agata ; artiste subversif dont les thèmes abordés, tels que l’errance, les corps, le sexe et les expériences alternatives, sauront illustrer à merveille le propos torturé du trio français.
Depuis 2013 et leur premier album Tibetan Monk on pourrait déplorer à juste titre une diminution du nombre de titres sur les galettes ; sept, puis six et enfin quatre. Toutefois, la taille parfois dantesque de ces derniers ainsi que leur richesse pallient sans mal ce désagrément. Prenons comme exemple la première piste : « Lacuna Jam », un gros jam électrique sans détour s’étirant sur plus de neuf minutes. Après une rapide intro sous la forme de samples superposés d’une voix française, la guitare entre en scène. Le premier riff s’éveille et très vite la section rythmique débarque. Une batterie incisive et précise qui, accompagnée d’une basse rondelette à la douceur entêtante, structure et narre autant sinon davantage que la mélodie de Belwil. Une fois à température, ce guitariste déploie son répertoire en enchaînant séquences spatiales et soli endiablés. Une sauce qui interpellera les amateurs d’Earthless, mais pas que.
Comme nous le prouve « Gengis Khan », l’énergie de cet album ne se limite pas à cracher sa fièvre et à distribuer des riffs. Ici, le propos se révèle plus subtil. À tel point que les deux premières minutes du morceau nous évoqueraient presque My Sleeping Karma. Même si rapidement Karim s’emballe derrière ses futs, invitant Belwil à lâcher un puissant riff qui pour le coup nous bousculera à la manière de Karma To Burn. Y’a toujours une histoire de karma, mais la ressemblance s’arrête là. Pendant les 14 minutes de ce voyage en terres lointaines, on ne cessera de balancer entre les deux influences. Un pèlerinage à la fois doux comme un rêve et aussi violent qu’une bataille à dos de cheval. Une dichotomie retrouvée dans « Vaccum Density » et sa thématique torturée. Rien que dans le titre déjà, ça pue l’ambivalence. Et ça, la guitare l’illustre à merveille, tant par l’ajout ou non de ses effets que par le choix de son jeu.
On revient davantage vers le jam avec « Tierra las hommage », dernier morceau et monstre de 16 minutes aux accents d’assaut final, mais surtout épique. Belwil se rapproche par moment plus de l’imprimante sonore que du soliste tandis que ses deux copains ne le lâchent pas d’une semelle dans sa course frénétique. Une superbe pièce dotée d’une formidable énergie, sans doute taillée pour le live et qui vous laissera trempé de sueur.
En conclusion, une musique désarticulée bien loin des standards de construction et faite d’un bois aux multiples essences. On se sent tiraillé, comme en face d’un miroir de l’âme humaine, à contempler nos propres paradoxes. Y’a pas de doute la dresseuse de lions sait user de son fouet à bon escient. Et on en redemande sans une hésitation.

Rose fragile éclose au milieu d’un tas de boue, Chrch verse dans un doom sludgy qui n’oublie pas pour autant de rendre grâce à la mélodie. Depuis 2015 et son premier – et très bon – album Unanswered Hymns, le quintet s’est fait le spécialiste des longues plages sonores mêlant le sombre des abysses à la majesté d’un ciel étoilé, quelque part entre Pallbearer, Bell Witch et Inter Arma. Venu de Sacramento, le groupe a bénéficié de l’effervescence de la scène locale, pris sous l’aile des nombreuses gloires du coin, signant, en toute logique, avec Neurot Recordings pour la publication de Light Will Consume Us All, leur seconde invitation à visiter les recoins embrumés de leurs sombres âmes.
Entre deux albums, Chrch a uni ses forces à celles de Fister, pour une tournée commune et un split, dont le morceau « Temples » est l’une des plus significatives réussites du groupe. Et c’est dans la droite lignée de ce titres et d’Unanswered Hymns (3 longues pistes prenant le temps de développer, à grand renforts d’intros mélodiques puis d’explosions doom, un propos dont la radicalité sonore le dispute à l’occulte des paroles d’Eva Rose), que se positionne ce nouvel album, impressionnant par sa production, ample et puissante, se permettant même d’approcher l’orfèvrerie sur le son de batterie, presque distordu par instant (la caisse claire de Chrch est l’une des plus belles de la scène). Il plane sur « Infinite », qui ouvre l’album, l’ombre d’Acid King, dans la répétition du riff et la mélodie de la voix claire, même si le propos dérive sur un versant plus extrémisant.
Chrch développe ce que son très bon (et finalement meilleur) premier album avait mis en place. Sûr de ses qualités, la formation joue sur de lents tempos et le quart d’heure que dure « Portals » s’impose comme la meilleure expression de ce disque dont on n’a finalement qu’à déplorer la pochette, manquant flagrammant de majesté. Un bon petit album grassouillet pour l’été.
Point vinyle :
Le premier press est en black et en clear, les quantités n’ont, à ma connaissance, pas filtré.

Le moins que l’on puisse dire avec Graveyard, c’est que le groupe entretient une intimité toute particulière avec la faucheuse. Déjà, il nait des cendres de Norrsken il y a dix ans de cela en compagnie de son ténébreux frère Witchcraft. De cette nécromancie découlent quatre albums qui connaissent le succès. Hélas, le sombre enchantement perd de son pouvoir et en septembre 2016, Graveyard annonce sa séparation pour « différends au sein du groupe ». Toutefois, ne voulant toujours pas d’eux dans son royaume, la mort les renvoie sous le soleil et en Mai 2018, nos chers Suédois sortent leur cinquième album, sobrement intitulé Peace.
Pour l’occasion, le groupe s’offre un nouveau batteur nommé Oskar Bergenheim. Et pas la moitié d’un énervé. Dès les premiers instants de « It Ain’t Over Yet », on perçoit toute la vivacité du bonhomme. Ce premier titre dépourvu d’intro nous propulse illico dans un classique rock au groove certain et à l’énergie indéniable. Une énergie retrouvée dans « Walk On », invoquée par un jeu subtile d’accents sur la caisse claire et de toms harcelés. Ce même morceau dévoile en fin de parcours une séquence Deep Purplesque à souhait. Oskar joue à volume minimum, accompagné par la basse galopante et nerveuse de Truls Mörck. Une séquence fiévreuse qui débouche finalement à nouveau sur le refrain.
Néanmoins, si de nombreux titres déménagent, d’autres comme « See the Day » se rapprochent davantage du propos onirique en offrant de douces mélodies et un chant aussi clair que le rire d’un nouveau-né. Tout comme avec « Del Manic », on revient à la période Blues du groupe façon crooner.
Qu’il s’agisse de la voix de Joakin Nilsson ou de celle de Truls mörk, la narration se révèle très accessible. On côtoie en permanence la sensation que quelque chose est en train de se passer ; que derrière les riffs et les mélodies, une histoire se raconte. Une histoire que chacun se figurera à sa façon. On pense notamment à l’ensoleillé « Bird of Paradise », ou dans un autre style à « Please Don’t ». Ce morceau à la lourdeur assumée qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler les constructions burnées de Clutch.
On retient donc une alliance subtile de plusieurs genres. Un son retro aux constructions classiques, paré d’un super groove et assimilé à un psyché parfois méditatif mais toujours sincère. Cet album c’est aussi des teintes très bluesy qui, bien moins présentes que par le passé, viennent colorer l’ensemble et finalement, le dynamisent. Une réussite donc pour le groupe sorti de la tombe et qui, sans forcément triompher dans l’innovation, aura tout gagné de son séjour dans l’au-delà.
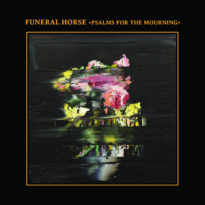
« Trio originaire du sud des Etats-Unis ». Rarement chronique commençant par ces mots n’est annonciatrice de quelque chose de décevant. Ce disque ne dérogera pas à ce principe, qui n’est pas loin d’être érigé au titre de loi. Les premiers albums de Funeral Horse nous avaient mis sur la voie et on savait à qui on avait affaire : depuis leurs débuts durant la deuxième décennie de ce millénaire, les natifs d’Austin avaient déjà produit trois galettes bariolées, trois disques hors du temps et hors des styles, empruntant largement aux codes et aux sons stoner, doom, etc…
Psalms for the Mourning débarque donc presque trois ans après son prédécesseur, avec manifestement les mêmes intentions : lâcher les chevaux… sauf que du côté du Texas, côté chevaux, apparemment on a plutôt des mustangs énervés et indisciplinés, qui partent dans tous les sens et n’en font qu’à leur tête dès qu’on lâche la bride ! Impossible de coller une étiquette à ce disque tout aussi diversifié que ses prédécesseurs, dans ses compos, dans sa production, l’instrumentation…
Sans connaître le groupe, le néophyte curieux pouvait s’attendre à un album déprimant de doom obscur (on parle quand même de l’album « psaumes pour le deuil » par le groupe « cheval funéraire »…). Alors bon, du doom il y en a un peu : « Emperor of all Maladies » convoque les meilleurs riffs de Electric Wizard… mais y injecte des plans jazzy, va gratter à la porte des Melvins à travers des plans quasi noise, pour revenir sur une base doom chaleureuse, le tout en 8 minutes, en majorité instrumentales, qui ne proposent aucun répit à l’auditeur. Autre curiosité : si le doom pouvait être joué à des tempo rapides, il aurait la forme de « Burial under the Sun », étonnant… Mais ce n’est pas la majorité du disque.
Le reste respire plutôt l’envie d’explorer, et tout ce qui peut se faire en nuances de rock saturé (et pas que) passe dans leur moulinette : « No greater sorrow » (par ailleurs premier single de l’album) commence par une intro blues rock en son clair, se transforme en mid-tempo torride à la Tito & Tarantula, où dissonances, assauts de guitare et maracas se donnent la main pour devenir un OVNI fiévreux. Tordu, mais pas autant que « Divinity for the Wicked » (le titre de leur précédent album ? WTF ?!) qui déroule une première section hard rock mid-tempo assez classique, avant de péter un fusible pour se transformer en party song que ne renierait pas Andrew WK (avec option Bontempi cheesy) sur son milieu, sans qu’on ne comprenne vraiment ce qui est en train de se passer, pour mieux revenir sur une conclusion heavy. Même stupéfaction avec l’entraînant « Better Half of Nothing » qui se transcende en conclusion après un break heavy et groovy bardé d’une section cuivres rugissante… On touche aussi à des instrus acoustiques (« 1965 »), du vieux blues gorgé de slide (« Evel Knievel Blues »), des brulots metal thrasheux rageurs (« Sacrifice of a Thousand Ships » qui ne débande pas sur la longueur), etc… Cathedral meets Slayer meets Mr. Bungle meets Los Lobos meets… ‘m’avez compris.
Du coup, inévitable, la digestion est difficile ; les premières bouchées sont même hésitantes pour tout dire. On écoute le disque une fois, deux fois, et rien n’accroche vraiment, aucun repère. Dès qu’une de nos cases mentales commence à clignoter, le titre suivant balance un coup de pied dans les bijoux de famille, remet les compteurs à zéro et il nous faut retrouver une nouvelle « case »… On est conditionnés, c’est un fait. Mais une fois que les shakras sont ouverts, que les titres commencent à s’engrammer, chaque écoute est un vrai plaisir. Les compos ne font jamais sens, ce qui reste déstabilisant : l’album n’a pas une véritable identité en tant qu’objet. En revanche, la qualité des morceaux qu’il contient devient rapidement une évidence.
Si cet état d’esprit ne vous fait pas peur, que vous êtes ouverts à tous types d’expériences musicales pour peu qu’elles soient menées avec talent, conviction et intégrité, le nouveau Funeral Horse est fait pour vous.

Dans la famille des musiques qui tachent autant qu’une baignade dans une mare de goudron, on demande aujourd’hui le Canada. Et plus précisément un trio montréalais porté sur le sludge grassouillet nommé Dopethrone. Pour leur cinquième album, ils nous gratifient d’un artwortk illustrant à merveille leur propos ; un engin d’une lourdeur titanesque lancé à vive allure sur des rails brûlants, et qui, au travers de ce merveilleux pays nord-américain, va avaler les kilomètres avec la prévenance du bucheron pour un tronc d’érable.
On commence sans douceur avec « Planet meth », où tant les riffs dégueulasses de Vince que ses rires démoniaques nous mettent en selle. Pas de ticket première classe ici. Tout le monde est logé à la même enseigne. Soit collé au fond de son siège à déguster des accords plus saturés les uns que les autres, accompagnés d’un chant éraillé et aussi engageant qu’un hachoir de boucher.
Après l’arrêt « Wrong Sabbath » dont le groove plus lancinant invite à se déboiter la nuque, on descend à « Killdozer ». Là, c’est le départ du second moteur. On double la dose de charbon et on se prépare à traverser la jungle à grand coup de pare-buffle. Si cette musique ne vous donne pas envie de tout pulvériser, rien ne le fera. Il s’agit d’une ode à la frénésie qui a d’ailleurs pour clip une délicieuse compilation de braves types complétement démontés qui tantôt prônent la nudité, tantôt défient la police ou détruisent des trucs, quand ce n’est pas les trois en même temps. Les lyrics explicites défilant à l’écran vous aideront sans doute à comprendre les raisons de ces singuliers comportements.
Une fois n’est pas coutume, le train de la rage empreinte quelques pistes plus loin un itinéraire familier. Bien que les riffs de « Kingbilly Kush » restent difficile à identifier, les paroles révèlent vite le pot-aux-roses. Et c’est cette fois-ci ZZ Top qui se voit gratifié d’une interprétation de son mythique « Tush » par les trois Canadiens avides de reprises.
Avec Transcanadian Anger, les gars de Dopethrone atteignent une fois de plus leur objectif. Créer leur propre son et en estampiller la marque sur huit pistes. Enfin je dis propre… Disons qu’il s’agit d’un produit à l’interface entre le doom crado suintant les substances psychoactives et le sludge des cavernes aux accents punk. Un truc plutôt sale en somme, et terriblement lourd. Mais une recette bien loin de décevoir qui va continuer de rameuter des fidèles pendant encore un bon moment.
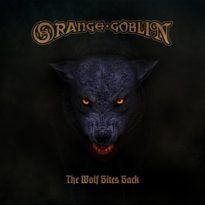
Est-il vraiment nécessaire de présenter Orange Goblin ? Du haut de ses 23 ans d’existence, le groupe, poids-lourd et vétéran de la scène Stoner européenne, nous propose cette année son neuvième album qui s’intitule The Wolf Bites Back. À l’approche de la fin d’une première moitié d’année 2018 riche en sorties de grande qualité nous allons voir si Ben Ward et sa bande ont su rester fidèles à leurs habitudes et nous offrir une fois de plus une plaque de haut niveau.
Comme bien souvent chez Orange Goblin, pas de tergiversations en début d’album. Les londoniens entrent directement dans le vif du sujet avec le coup de poing “Sons of Salem” et enchaînent avec le morceau-titre “The Wolf Bites Back” que Joe Hoare introduit par un riff de guitare acoustique avant d’être rejoint par ses comparses pour une deuxième mandale en autant de pistes.
Les anglais sont d’attaque et le prouvent avec le très rock’n’roll “Renegade” poursuivant sur la même lignée avant de ralentir nettement le propos sur le doomy “Swords of Fire”, morceau particulièrement gras qui rayonne par sa qualité et grâce à la pertinence de son positionnement dans l’ordre de la tracklist.
L’album se poursuit avec “Ghosts of The Primitives” qui débute par une intro qui ne manque pas de nous rappeler l’ambiance des premiers albums du groupe (impression renforcée par le solo de guitare à la pédale wah-wah) et se termine sur un final où le chant de Ben Ward dirige le propos.
Mises entre parenthèses depuis plusieurs années (et albums), les influences psychédéliques des londoniens refont surface sur plusieurs titres de The Wolf Bites Back. Cet élément saute aux yeux sur l’excellent interlude instrumental “In Bocca Al Luppo” mais plane sur l’ensemble de l’album (intro de “Ghost of The Primitives”, break de “Burn the Ships”).
Pour autant, les anglais ne nous laissent pas de répit et poursuivent leur distribution de roustes avec “Suicide Division”. Morceau qui rentre dans le lard façon Punk-Hardcore. Ils enchainent avec le très bon “The Stranger” tout en crescendo avec son riff dans un premier temps bluesy et qui se termine sur un riff massif accompagné d’un orgue et guidé, comme sur l’ensemble des morceaux de l’album, par la performance de son leader avant de poursuivre avec le rageur “Burn The Ships”.
La plaque se clôt sur l’épique “Zeitgeist” et son refrain ravageur chanté par un Ben Ward qui illumine réellement l’album de sa classe et sur lequel on notera l’apparition de Phil Campbell, guitariste de Motörhead, le temps d’un solo en forme de clin d’œil. Le groupe a, en effet, toujours clamé haut et fort l’influence de la bande de Lemmy sur ses compositions.
Porté par la performance exceptionnelle de son leader, Orange Goblin nous propose avec The Wolf Bites Back un album d’une grande efficacité, à mi-chemin entre retour aux sources et emploi d’éléments que l’on peut retrouver sur leurs productions plus récentes. Les anglais maîtrisent parfaitement leur propos et signent une galette pertinente, assurément une de leurs toutes meilleures.

Aux frontières du désert, il est de ces groupes qui tracent un chemin tangent et finissent par nous heurter, c’est le cas de Ingrina, sextet de Tulle qui délivre son premier LP, Etter Lys. Entre un Russian Circles adouci et Long Distance Calling torturé, Ingrina joue loin du poncif des successeurs d’Isis et crée une œuvre d’excellente facture.
La musique est introspective sans être profondément Shoegaze. Les passages à la fois aériens et aquatiques dégagent une force émotionnelle renforcée par des montées en puissance instrumentales qui ne permettent à aucun moment de décrocher. Cette cohérence tient beaucoup à la composition du groupe avec ses deux batteries et trois guitaristes qui facilitent la construction d’une structure intense et riche avec de surcroît une basse aussi imposante qu’un éléphant qui charge.
Cette richesse est particulièrement prégnante dès le premier morceau “Black Hole” puis sur “Fluent” et “Coil” où un chant tantôt clair bien que poussé, tantôt Screamo, se perd à demi au sein de successions de thèmes entrelacés.
Les compositions submergent littéralement l’auditeur pour éveiller des sentiments liquides aussi bien que chtoniens. On croise le chant des sirènes et le craquement de l’orage dans l’air, on chute au sol dans la boue avec plaisir, avec le sentiment d’être pleinement vivant. La musique d’Ingrina est organique et aussi complexe qu’un corps. L’âme d’un monstre ancien se réveille, “Resillience” en est le morceau illustrateur, les membres de la créature bougent lentement puis la gueule s’ouvre et pousse son cri du fond des âges. les mouvement s’amplifient sur “Leeways” et du fond du lac, la créature surgit. “Surrender” lui rend hommage dans une introduction de cathédrale, une piste de près de 15 minutes. S’y enchaînent inflexions épiques et rappels de l’esprit des titres précédents. L’angoisse monte comme si la bête “Etter Lys” se dressait tout entière devant nous. Il est de ces créatures qui intriguent lorsqu’on les devine et qui poussent au recul lorsqu’on les embrasse toute entière. Ingrina crée un dragon du fond des âge, immense et polymorphe, sa complexité séduit et effraie tout à la fois.
La production léchée d’Etter Lys en fait un disque d’une richesse rare où la densité des six morceaux tient sur une cinquantaine de minutes ni trop courtes ni trop longues. Ingrina place haut la barre avec ce premier LP et s’arroge une place de choix au sein du Post-Metal Français avec cette capacité à séduire au delà des étiquettes et des genres.

Heureux qui, comme Candlemass, fait un bel EP. Depuis 2015, et l’annonce d’une sorte de pré-retraite de la part du groupe suédois, Edling prépare son plan épargne vieillesse. Exit Robert Lowe, avec qui la greffe n’a malheureusement pas pris, le bassiste a recruté Mats Levén, qu’il a connu au sein d’Abstrakt Algebra. Un premier EP (Death By Lovers/2016) est né de cette énième collaboration et quelques headlines de festivals et autres participations lucratives à certaines émissions aident à garnir le compte en banque du groupe, qui semble très près de tirer sa révérence. Il est aujourd’hui de notoriété publique qu’Edling se bat depuis de nombreuses années contre la dépression, que son état physique s’en ressent (il est souvent remplacé en live par Per Wiberg, Spiritual Beggars/Opeth). Passons sur le partenariat avec un site de paris en ligne (oui ça craint) et la promo basée quasi uniquement sur la présence en featuring de Papa Emeritus de Ghost (oui ça craint) pour se concentrer sur ces 20 minutes d’extraction heavy doom extra vierge qu’est l’EP, première pression à froid.
Parce que la musique elle, ne fait pas de prisonnier. Quatre titres, quatre tubes. Rien de neuf, surtout pas, mais quatre raisons de se régaler de cette nouvelle offrande, complétant un peu plus la longue discographie d’un groupe qui ne va pas tarder à disparaître. « House Of Doom » déjà, s’il était sorti en 1986, aurait été le titre le plus emblématique du genre : difficile de faire plus cliché et difficile de faire plus efficace. Le refrain, le break, tout ici suinte le doom carnavalesque et épique qui fait le sel de Candlemass. « Fortuneteller » est un titre qui semble faire immédiatement référence à Deep Purple période Stormbringer. Levén dans la chemise de Coverdale, on se prend à fredonner le « Tell me Gipsy can you see me, in your cristal ball ». Derrière ces deux perles, « Flowers Of Deception » renvoie au « Sinister And Sweet » de l’EP précédent et « Dolls On A Wall » à « The Goose », instrumentaux doomy fermant idéalement les parenthèses auxquels ils appartiennent.
Bien sûr, on peut soupçonner Levén d’avoir participé grandement à la composition de ces deux derniers EP, prenant le relais d’un Edling à bout de souffle. Oui bien sûr il n’y a ici aucune trace de fraicheur et de renouveau mais quatre bonnes raisons d’avoir un sourire béat vous barrant le visage lorsque vous passez la galette sur/dans le lecteur. Soyez honnêtes, c’est pas non plus tous les jours que vous avez droit à 20 minutes de plaisir hein.
Point vinyle :
Classique Napalm : version noire classique, une or (300 ex) et pis c’est tout. Simple. Basique.

Alors que certains commercialisent du café, du Guronsan ou d’éventuelles substances peu plébiscitées par la masse afin d’éveiller les zombies que nous sommes, d’autres enregistrent sur un disque huit titres d’une sauce aux effets très similaires et dont l’abus ne causera du tort qu’à votre voisine chiante. Le power trio made in Texas qu’est Crypt Trip appartient à cette famille. Et après presque deux ans de silence, ils reviennent début 2018 avec une galette taillée pour le live qui s’intitule Rootstock.
Niveau style, on ne s’encombre encore une fois pas du lourd fardeau qu’est l’innovation. On branche les grattes sur de vieux amplis vintages et on balance l’invincible bluesy hard rock des 70’. Un pur son retro orienté jam et parfois agrémenté d’une petite touche d’orgue et de percus brésiliennes comme on les aime. « Rio Vista » en attestera mieux qu’un quelconque discours.
En dépit de quelques morceaux plus calmes, comme le psychédélique « Aquarena Daydream » avec son chant onirique et ses effets wa-wa qui évoquent un trip sous acide, le potard frénésie reste bloqué à dix. Même le doux interlude en acoustique d’à peine deux minutes qu’est « Mabon songs » ne trahit en rien la dynamique endiablée de l’album. Cameron et Sam, respectivement batteur et bassiste, en sont les principaux architectes, grâce notamment à leur complémentarité de jeu. Ils constituent un socle robuste et galopant sur lequel Ryan Lee vient lâcher ses lyrics mais surtout ses nombreux solos.
Côté influence, je ne vous ferai pas l’affront d’évoquer les similitudes avec Black Sabbath à l’écoute de titres tels que « Boogie No6 » ou Led Zeppelin sur des morceaux comme « Tears of Gaïa ». Rootstock en est constellé. Là où les Texans font vraiment la différence, c’est dans l’écriture globale du bazar. Les pistes s’enchaînent avec tant d’aisance qu’on peine à en suivre le décompte. Et ce, en sachant que trois d’entre elles existaient déjà en 2016 sur l’EP intitulé Mabon Songs. Trois titres, rafraîchis donc, qui se clôturent ici sur « Soul Games ». La musique du rappel. Celle qui groove un tantinet plus que ses sœurs avec son mariage guitare sèche / électrique et ses breaks de batterie absolument délicieux. Les deux dernières minutes de cette fièvre proposent une sortie jazzy assez surprenante sous fond de percus. Un vrai petit dessert qui nous fait nous interroger sur le pourquoi de notre présence ici, sans pour autant rien regretter du trajet.
En somme, un album conçu pour agiter les foules en live et qui séduira naturellement les fans d’Earthless et de Radio Moscow. Un album qui donne la pêche et fait partie de cette famille qui s’écoute d’une traite, encore et encore.

Yob est un des plus grands groupes de metal de l’histoire à mes yeux, l’un des tout meilleurs. De ceux que je range dans la catégorie « metal total » qui de par leur son et leur qualité dépassent l’idée même d’étiquette. Doom ? Yob. Tout simplement. Dans sa discographie, il m’est jusqu’alors impossible de trouver un seul titre qualifiable ne serait-ce que de moyen. Alors bien sûr The Elaboration of Carbon se cherchait encore un peu stylistiquement, bien sûr Atma est un album vers lequel on revient moins que les autres, mais pour moi pas une seule minute de ce monolithe éthéré qu’est la discographie du groupe ne peut être qualifié de dispensable.
Une carrière qui aurait pu prendre fin en novembre 2016, lorsque Mike Scheidt, voix, guitare et âme de Yob se voit diagnostiquer une infection permanente des intestins (diverticulite du sigmoïde) qui aurait basiquement pu le laisser sur le carreau. Après de longues semaines d’hospitalisation, Scheidt a pu reprendre le cours de sa vie et de sa musique, évidemment influencée par ce par quoi il est passé. Se relever d’un tel moment de douleur et d’incertitude a forcément influé sur la composition (il retient de cette expérience, outre l’évidente peur de mourir, qu’il a passé 6 semaines à être trop faible pour faire de la guitare) et comme souvent lorsqu’un disque post traumatique est publié (Metallica, Baroness pour ne citer que des évidents), Our Raw Heart charrie son lot de difficultés.
Les premières écoutes de la 8ème livraison de Yob ont été terriblement déceptives. Quoique traversé par tout ce qui fait l’identité du groupe, il manque cruellement de subtilité. « Ablaze » par exemple attaque pied au plancher, avec la rage d’un survivant (là où le sage aurait pris le temps de développer) mais est submergé par la mélancolie par un ton plaintif dont le relief tarde à se dessiner. Et l’affaire ne s’arrange pas avec « The Screen », le morceau censément le plus prenant de l’album, jouant sur une corde que « Burning The Altar » (The Great Cessation/2009) avait déjà si brillamment shreddée. De l’aveu même de Scheidt, le riff est inspiré de Morbid Angel période Gateways To Annihilation – sauf que le premier néophyte venu peut s’en apercevoir. Si l’idée de ce riff lourd et rampant est absolument géniale, si la frustration de ne jamais voir le morceau décoller est une astuce merveilleuse gardant la tension de l’auditeur durant près de 10 minutes, l’ornement vocal laisse une fois de plus à désirer.
Mike Scheidt lèche toujours ses blessures – et nul homme ne peut le lui reprocher – mais tout cela manque de growls abyssaux et de variations vocales (de celles qui ont amené le net à inventer la folle rumeur que Scheidt chante parfois sous hélium…) que l’on a si souvent révérés. Le reste de l’album passe et laisse ce même goût étrange de catharsis (le mot, pas l’album) musicale parfois puissante, souvent touchante (« Beauty in Falling Leave »), malheureusement rarement grandiose. Et pourtant le grandiose avait, jusqu’à présent été la norme chez Yob.
Our Raw Heart est de ces albums qui pansent les plaies de son créateur en nous laissant par là même à la porte de ses sensations. Il serait tout de même sacrément égoïste de lui en tenir trop rigueur.
Prenons ce qu’il y a à prendre et attendons patiemment la suite.
Bonne guérison Mike. Bonne guérison.

Avec pourtant plus de vingt ans de carrière dans les semelles, on ne peut pas dire que Witch Mountain ait jamais vraiment explosé de ce côté de l’Atlantique. Plutôt underground dans son approche (complètement DIY sur tous les aspects « business ») et plus ancré aux U.S.A. (le groupe est très actif et présent dans sa région de Portland, au Nord-Ouest), le quatuor a quand même tenté quelques percées sur le vieux continent (on se rappelle d’une date au Hellfest et quelques concerts attenants il y a quelques années), mais trop rares pour figurer dans la liste des acteurs majeurs, vue d’ici. Il faut dire que Rob Wrong, guitariste co-fondateur du combo, a été pas mal occupé en tant que recrue de The Skull, le groupe dissident de Trouble avec Eric Wagner. Par ailleurs, après avoir passé quelques années à stabiliser le siège éjectable au poste de bassiste, en 2014 c’est leur emblématique chanteuse Uta Plotkin qui a quitté le navire pour se concentrer sur d’autres projets. Ils mettent alors la main sur la prometteuse Kayla Dixon, qui a usé les micros de quelques combos metal ces dernières années.
C’est ce récent casting qu’ils décident de mettre le plus en avant, probablement aussi pour rassurer les fans un peu inquiets d’avoir perdu Uta. Que ces derniers soient rassurés : même si les deux chanteuses ne sont pas vraiment comparables, Dixon est clairement la principale « attraction » du disque. Résolument mise en avant dans le mix de tout l’album, elle assure avec brio l’ensemble de ses parties, grâce à une palette technique qui force au respect (chant clair puissant, growl agressif, chœurs aériens, passages quasiment a cappella quasi soul…).
Musicalement, le quatuor ne réinvente pas la lune, loin s’en faut : le groupe est dans la parfaite continuité de l’excellent Mobile of Angels, évoluant toujours dans un doom classique qui emprunte plus aux grands pères du genre qu’à ses plus récentes et extrêmes évolutions, à savoir plutôt mid-tempo, très mélodique, chargé en soli. On pense aux premiers Cathedral, aux vieux Pentagram, à la grosse première décennie de Black Sabbath (oui oui, on déborde un peu des premiers albums cultes et on va même titiller la période Dio), et aux débuts de Trouble aussi. Bref, du très classique, exécuté à la perfection, mais qui pourrait rebuter les esthètes en recherche de fraîcheur musicale : ici on est dans une zone de confort musicale.
Les écoutes de l’album défilent donc avec un plaisir non feint, les titres s’enchaînent… et progressivement la petite faiblesse du disque se fait jour : cinq chansons seulement (dont une acoustique guitare-piano de 2min30, « Hellfire », quasi anecdotique) pour une grosse demi-heure de musique à peine. On aurait aimé en avoir plus, on n’est pas rassasié. Ça ne diminue en rien la qualité des compos existantes en revanche : on déguste le riffing old school de « Midnight » (support aux premières interventions percutantes de Dixon), on aime immanquablement le très classique « Mechanical World » (son refrain grandiloquent, ses breaks doom typiques…), et on adore l’épique « Nighthawk » qui vient clôturer la galette de son généreux quart d’heure riche en riffs mordants, en rythmiques variées et aux ambiances travaillées, passant de plans légers à des passages glauquissimes sans effort. Une belle pièce. Quant à « Burn you Down », le plus heavy metal des quatre (riffs incisifs, chant dans toutes les nuances de power metal), on le connaissait déjà car mis à disposition par le groupe il y a quelques mois.
En résumé, Witch Mountain continue à tracer son sillon musical, loin des modes, et ce faisant construit sa carrière comme une longue autoroute en légère montée, plutôt qu’en enchaînement sinueux de cotes et de pentes violentes. Même l’incorporation de Kayla Dixon se fait sans heurts, naturellement, dans un poste exposé (et largement mis en avant par le groupe sur cet album). Au même titre qu’Angela Gossow avait boosté la carrière d’Arch Enemy, il n’est pas exclu qu’une frontwoman de la densité de Dixon soit bénéfique à Witch Mountain. Il leur reste à battre le fer tant qu’il est chaud, et idéalement traverser l’atlantique pour prêcher leur bonne parole dans nos contrées, armé de ce nouveau bon album dans leur discographie.
|
|
 La gente féminine a le vent en poupe de nos jours sur la scène stoner au sens large (sauf au sein de notre rédaction qui pue la testostérone à pleins naseau…) et nous n’allons pas bouder notre plaisir en assistant à ce mouvement là où jadis Misdemeanor faisait figure d’intrus au milieu des velus comme des poils dans une assiette. On ne va pas exagérer non plus : Lucifer n’est pas un combo 100% féminin quand bien même Lucifer sans Johanna Sadonis – sa frontwoman – ne serait pas Lucifer tant sa présence irradie sur les compositions ainsi que lors de l’exercice scénique.
La gente féminine a le vent en poupe de nos jours sur la scène stoner au sens large (sauf au sein de notre rédaction qui pue la testostérone à pleins naseau…) et nous n’allons pas bouder notre plaisir en assistant à ce mouvement là où jadis Misdemeanor faisait figure d’intrus au milieu des velus comme des poils dans une assiette. On ne va pas exagérer non plus : Lucifer n’est pas un combo 100% féminin quand bien même Lucifer sans Johanna Sadonis – sa frontwoman – ne serait pas Lucifer tant sa présence irradie sur les compositions ainsi que lors de l’exercice scénique.