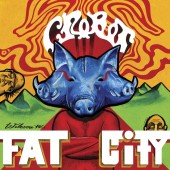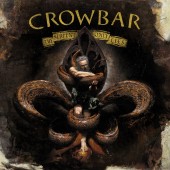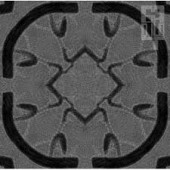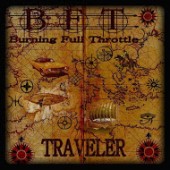|
|
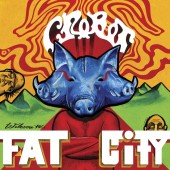
Après un album et quelques EP pas mauvais mais néanmoins discrets (labels approximatifs, tournées essentiellement en anglophonie, avec quelques timides embardées européennes en premières parties de groupes dans d’autres veines musicales…), avec un succès plutôt barycentré du côté de l’Oncle Sam, on n’entendait pas vraiment beaucoup parler de Crobot depuis la naissance du groupe. La double conjonction de deux phénomènes a vu leur notoriété prendre un essor certain sur nos terres : leur prestation remarquée (et remarquable) au dernier Hellfest, ainsi qu’une signature chez Nuclear Blast pour leur dernier album. Welcome to Fat City, donc, disque à l’artwork pour le moins dispensable, déboule sur nos platines et dans nos oreilles dans un contexte plutôt favorable… même si l’on est toujours circonspects à l’approche d’un « nouveau groupe » dans l’écurie Nuclear Blast, en tout cas dans son registre « vintage hard rock » qui voit dans ses rangs évoluer les groupes les plus déplorables comme les plus intéressants, et toute une palanquée entre ces deux extrêmes (petit jeu, à vous de classifier à votre convenance les groupes Nuclear Blast suivants dans chacune de ces catégories : Kadavar, Blues Pills, Orchid. Vous avez 10 secondes).
Bref, on s’attèle à la tâche sans trop de difficulté, et rapidement, la première évidence se dessine très vite : le côté accrocheur des compos est indéniable, une bonne moitié des chansons étant déjà bien ancrées en mémoire après quelques écoutes seulement ; la seconde moitié ne mettra pas longtemps derrière à atteindre le même objectif. Un vrai talent d’écriture, donc, que l’on voulait mettre en avant, point fort absolu de ce combo. Au-delà, le genre musical déployé se détache aussi un peu de l’armada de groupes typés hard rock 70’s (dont les sus-mentionnés) : Crobot apporte non seulement au genre une prod toute « americana » qui pète bien, mais surtout une approche hard rock qui pioche fort dans les 80’s, je m’en-foutisme désinvolte en bonus. Leur approche outrancière complètement décomplexée contribue franchement à l’adhésion de l’auditeur : on se prend vraiment à sourire au fil des titres, toujours fun, se frottant dangereusement à la limite du « too much » sans jamais la franchir. Musicalement, aucune barrière donc, on baigne en plein revival hard rock 70s (vieux Whitesnake ou Aerosmith) mais aussi 80s (Twisted Sister, Skid Row – on croirait d’ailleurs souvent entendre Sebastian Bach au chant), un mix très cohérent à l’écoute, lié par une grosse dose de groove (à l’image de quelques plans de gratte presque « funky »). De cet ensemble plutôt plaisant à l’oreille, se détachent quelques titres (« Play it cool », le single « Not for Sale » au refrain imparable, ou encore le refrain « à étages » de « Blood on the snow ») sans pour autant compter de véritables maillons faibles sur les onze titres proposés. Sous un format resserré de quatuor (comprendre : une seule guitare pour abattre tout le taf), la prod (avec Machine aux manettes, le producteur de Clutch entre autres) se focalise sur l’essentiel, et, légitimement, Brandon Yaegley, vocaliste / performer en chef, surnage dans un mix impeccable par ailleurs.
En conclusion, difficile de faire la fine bouche à l’écoute de ce disque qui – ce n’est pas si courant – tient toutes ses promesses. Écriture efficace, exécution solide, prestance remarquable… Welcome to Fat City est l’album parfait pour alimenter les futures set lists live du quatuor, et à ce titre l’attente de les revoir live devient pressante. Un album très agréable, pas prise de tête, pas prétentieux… mais certainement pas révolutionnaire ; ce n’était de toute façon pas son ambition.

Six ans que l’Asteroid n’avait pas traversé franchement le ciel de la galaxie stoner. Rien depuis six ans donc, mis à part une rapide apparition au détour d’un split 7″ en 2012.
La présence du groupe à l’affiche du Desertfest en début d’année laissait cependant bien présager un retour du trio suédois. Il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour voir débarquer ce III, digne successeur du II qui a tourné (et qui tourne encore) longuement sur nos platines.
Le groupe démarre en douceur, dans l’obscurité lyrique de « Pale Moon » et de ses guitares plaintives. Vient ensuite le classique et doux « Last Days » qui nous rappelle le bon vieux temps et nous rassure un brin sur la forme du trio suédois : Asteroid a toujours le sens du riff, du groove, et sa musique est toujours marquée du sceau de la bivalence vocale Johannes Nilson/Robin Hirse.
Vintage visuellement, le groupe l’est également musicalement. L’ intro de « Til’ Dawn » fait monter la pression d’un cran supplémentaire : porté par un riff à la fois tranchant et rond puis par une voix rocailleuse, le morceau nous emmène allègrement vers « Wolf & Snake », véritable pivot de l’album (au sens propre comme au figuré). Construit autour d’un riff simplissime, le morceau profite de vocaux éraillés et d’une fu(zz)rieuse ligne de basse pour créer un mélange détonnant, véritable quintessence du savoir-faire suédois.
III bascule alors vers un final beaucoup plus aventureux. Hormis l’interlude aérien et mélodique « Silver & Gold », ce sont en effet deux brûlots stoner qui viennent clore ce nouvel opus. « Them Calling » tout d’abord, invitation-incantation à rejoindre le groupe aux portes de l’enfer témoigne d’un Asteroid au sommet de son art. Une intro simple et efficace qui ouvre naturellement sur un étalage de fuzz, et un refrain chanté de façon binomiale donnent au morceau une profondeur abyssale pour l’ériger en véritable hymne de ralliement.
C’est alors « Mr. Strange », septième et dernier titre de cet album, qui se charge de faire redescendre légèrement le rythme des palpitants et de disperser les troupes. Très axé seventies au départ, le titre profite d’un riff plus “moderne” et ciselé à la perfection pour basculer vers un stoner “contemporain” sur son final.
Le groupe suédois n’a donc absolument rien perdu de sa fougue, et possède toujours autant de classe. Seul (léger) bémol, ce nouveau passage de l’Asteroid dans la galaxie stoner ne dure que 36 petites minutes. Raison de plus donc pour ne pas rater ce III qui devrait figurer en bonne place dans de nombreux tops de fin d’année.
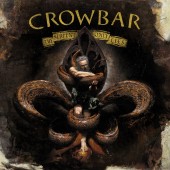
Depuis qu’il s’est libéré de Down, Kirk Windstein consacre toute son énergie à ce qui a toujours été le projet de sa vie. Crowbar, son esprit sludgy, ses vocaux hardcore, ses mélodies catchy et sa fleur de lys, celle de la Louisiane évidemment. Crowbar c’est un style, incarné et souvent imité (et parfois égalé, soyons honnête), c’est une recette, formule magique resservie jusqu’au fond du chaudron tout du long de 10 albums certes inégaux mais très rarement décevant. Et qu’on se le dise, en 27 ans de carrière c’est un fait suffisamment rare pour être signalé. Faisant suite au solide Symmetry In Black, publié il y a deux ans, The Serpent Only Lies n’apporte donc rien de nouveau à l’édifice Crowbar si ce n’est, et ce n’est pas rien, 10 nouvelles raisons de reprendre de la soupe, et la chaudron dans les dents, par la même occasion.
Windstein lui même l’a confessé, pour cet album il a essayé de retrouver les ambiances de la fin des années 90, de faire revenir la patte hardcore, citant Carnivore ou Type O Negative dans ses influences retrouvées, voulant se rapprocher de la sainte trilogie Broken Glass / Odd Fellows Rest / Equilibrium. Évidemment, personne ici ne se plaindra de telles décisions ! Le résultat est par ailleurs plutôt probant, The Serpent Only Lies faisant la part belle au riffing, délaissant quelque peu les harmonies heavy des derniers albums pour se concentrer sur quelques mid-tempos qui sauront parler aux plus nostalgiques. Derrière les rouleaux compresseurs que sont « Falling While Rising » ou « I Am The Storm », un morceau lourd et poisseux, tel que « Surviving The Abyss » rappelle en effet passionnément les ambiances toxiques de « Planets Collide ». Très bonne pioche.
Il en va finalement de Crowbar comme de Motörhead : accroché à une recette aux effets assurés, ces groupes publient avec régularité des albums qui se ressemblent sans pour autant jamais lasser. J’ai de mon côté fini par lâcher le groupe de Lemmy, convaincu qu’il avait tout dit sur ses 7-8 premiers albums. Depuis sa disparition, je comble mon retard en pleurant d’avoir, tant d’années, manqué de confiance en l’un des (le ?) Dieux du rock’n’roll. Je ne ferai pas cette erreur avec Kirk Windstein et Crowbar. Alors vous non plus de déconnez pas !
Info live, Crowbar enregistre dans ses rangs le retour de Todd Strange, bassiste historique du quatuor (et du premier album de Down) qui avait complètement lâché la musique au début des années 2000. Vivement leur prochain passage européen !
Point vinyle :
The Serpent Only Lies est sorti chez E-one au states et SPV partout ailleurs. ll n’y a pas d’infos officielles qui aient filtré sur les différents styles de vinyles pour le moment mais pour l’Europe, en sus des traditionnels vinyles noir, des LPs couleur gold et limités à 200 exemplaires sont déjà disponibles sur certaines plateformes de pré-commande (Nuclear Blast, Napalm, Season of Mist).

Formé en 2015 à Budapest, Hongrie, des cendres de Devla Mufflon, Lemurian Folk Song se place dans la droite lignée du stoner instrumental et psychédélique tel que pratiqué par de nombreuses formations, Colour Haze en tête. Bence Ambrus, leader du groupe aura beaucoup voyagé (jusqu’à faire des concerts dans des caves Islandaises ou en Andalousie) et rapporté, en plus de points miles, de nombreuses expériences, à même de nourrir sa musique. Nommo, premier Ep du groupe, fait en quatres promesses que l’on espère se concrétiser. Il faudra tout de même bosser un peu la communication et s’affranchir des évidentes influences. A suivre !
Lemurian Folk Song – Nommo, disponible sur le bandcamp du groupe : https://lemurianfolksongs.bandcamp.com/releases

Je ne vous apprends rien si je vous dis que depuis quelques années maintenant déferle sur le paysage musical une vague revival 60’s/70’s. Bon nombre de groupes sont repartis aussi vite qu’ils sont venus et d’autres durent et s’accrochent. Dans une démarche plus ou moins authentique et/ou opportuniste, on a vu les catalogues des labels s’enrichir de références estampillées revival, collant cette étiquette un peu à tort et à travers, espérant surfer sur la mode et obtenir sa part du gâteau.
Où situer Slow Season dans cette pléthore de candidats à l’élection du groupe le plus authentiquement authentique et « vintagement » vintage de ce mouvement ?
Tout comme les groupes des 60’s/70’s, Slow Season c’est un album par an. Tout comme eux c’est un enregistrement sur une durée très restreinte (une bonne quinzaine) et sur du matos on ne peut plus dans l’esprit. Donc du côté de la démarche rien à redire, les quatre loustics de Slow Season ne font pas semblant et appliquent à la lettre les bonnes vieilles recettes qui ont fait leurs preuves pour tant de groupes encore adulés aujourd’hui.
Mais là où le groupe tire son épingle du jeu et peut sans aucun doute être placer en haut du panier, c’est qu’en plus les bougres ne se privent pas pour nous sortir des compos qui n’ont absolument pas à rougir face à leurs illustres ainés. Moi ça me rappelle du Four Sticks de Led Zeppelin, du Pound of Flesh de Buffalo tout en allant pourquoi pas chercher du côté de Creedence pour quelques sonorités. Certains y retrouveront une influence Sabbathienne évidente et d’autres y trouveront même une certaine originalité preuve d’une parfaite maitrise du style.
Alors bien sur je ne suis pas non plus en train de crier au miracle mais force est de constater que ce troisième opus de Slow Season s’écoute avec grand plaisir et que les 37 minutes de Westing vous feront passer un agréable moment, voir plus.
Surement une excellent porte d’entrée pour les sceptiques de ce retour un demi-siècle en arrière et une très bonne galette à se procurer pour les adeptes déjà convaincus.
Le point vinyle :
Des versions sur galettes noires, transparentes et bleues ont été pressées ainsi qu’un combo vinyle noir/CD.

Gary Arce est décidément très présent cette année dans nos oreilles. Entre ZUN et Yawning Man, le voilà qui ravive un autre de ses projets, Ten East. Vu le carnet d’adresse de ce pionnier, il est toujours intéressant d’observer de près la composition du groupe qui l’accompagne pour cette nouvelle session créative, la troisième sous le nom Ten East. On retrouve l’habitué Bill Stinson, déjà derrière les fûts chez Yawning Man. Mais voilà de nouvelles têtes, avec Erik Harbers à la basse et Pieter Holkenborg à la guitare, tous les deux en provenance du groupe Hollandais Automatic Sam. Ces joyeux drilles se sont rencontrés au Mañana Mañana Fest en 2014 où ils se sont directement mis à improviser sur scène. Visiblement, le feeling est passé tant et si bien qu’arrive ce Skyline Pressure.
Dès les premières secondes, on comprend que Arce est bien le maître à bord, aidé en cela par Harper Hug, qui était récemment derrière l’enregistrement du ZUN, et qui emmène la production clairement dans la même très bonne direction. Pour avoir jeté une oreille sur Automatic Sam, groupe plus direct que la recherche sonore intéresse visiblement, le lien est ici malgré tout peu évident. Si la basse et la seconde guitare ne sont pas en retrait, bien au contraire même dans ce mix impeccable, l’impression qu’ils se soient faits phagocytés par Arce est très forte.
On connaît la propension de Arce à rester dans sa propriété musicale bien délimitée par une haie de cactus. Les collaborations amenant pour l’auditeur un petit vent de fraicheur pour le moins, un nouveau prisme d’analyse pour le mieux. Sans parler de métamorphose, le chant en retenu de John Garcia par exemple, avait beaucoup apporté au projet ZUN, pourtant relativement classique instrumentalement.
Alors que dire de la légitimité de cette nouvelle collaboration ? Et bien d’abord que la jeunesse de l’amitié musicale qui unit le Ten East nouveau ne transparait jamais dans les soixante minutes de l’album. Il serait facile de croire que Arce est entouré d’amis de longue date, que les années à jouer ensemble transpirent continuellement. Ensuite, que le canevas proposé par les nouveaux venus est rudement bien fait. La basse sait se mettre doucement en avant avec une certaine créativité. La seconde guitare n’est elle aussi pas totalement en reste, même si elle aurait gagnée à avoir un son faisant un peu moins écho à Arce. Mais dans ce projet purement instrumental, difficile toutefois d’entendre dans les détails une réelle collaboration.
Pourtant, le morceau « Sonars And Myths » fait relativiser une partie de ce constat. Si attendus étaient les morceaux atmosphériques, celui-ci semble passer un cap en étant carrément dans le registre du contemplatif. Une vraie B.O de film possédant moins d’éléments typiques en provenance de Arce. A vos imaginaires pour combler le vide visuel. Faut-il y voir une résurgence de la matrice collaborative ? Parlons enfin du guitariste Nico Morcillo du groupe français expérimental Hifiklub, qui a participé aux trois morceaux que sont « Planet Blues », « Tangled Forest » et « Stalactite Dip ». Pour le coup, des effets de la collaboration sont là, par touches, en proposant parfois de véritables arrangements qui ressortent de façon tranchés. Clairement ce qu’il était possible d’attendre sur chaque morceau.
Le constat ne doit pourtant pas être amer. Arce reste Arce et il y a toujours quelque chose à aller chercher dans ses productions. S’il est dommage que la collaboration ne soit pas plus marquée tout au long de l’album, les quelques morceaux qui en sont imprégnés méritent en particulier une écoute attentive.

Cette rentrée automnale 2016 démarre sur les chapeaux de roues puisque 1000 Mods est enfin de retour avec Repeated Explosure To… Et, on peut dire que le titre résume très bien ce que ce troisième opus a dans le ventre.
Et oui, souvenez-vous, le quatuor grec nous avait laissé une très bonne impression avec le mémorable Vultures sorti en 2014. Pour cette troisième expérience studio, le groupe ne s’est pas reposé sur ses lauriers puisqu’il nous a concocté un véritable bijou sonore : une perle grecque qui sort vraiment du lot. Pourquoi ? Tout simplement parce que le quatuor frappe fort en réussissant à nous surprendre à la fois avec des chansons respirant la fraicheur et aussi en nous offrant un son presque unique. Oui un son unique dans la mesure où le groupe n’a pas voulu rebondir sur la vague du « Big » son Stoner que tout le monde semble savoir maîtriser de nos jours. Il a su créer un son propre à lui-même. On peut ainsi imaginer un métissage temporel entre le « british sound » style années 1970 et l’ambiance Rock des années 2010. Mais regardons de plus près ce petit monstre sonore.
Nous découvrons huit titres qui ont leur propre personnalité, que ce soit à la fois dans la prestance rythmique, sonore ou bien l’ambiance. Mais globalement, on y retrouve une énergie stimulante avec des riffs tantôt lourds, tantôt planants, un couple rythmique qui contrôle la situation avec brio et une prestance vocale sous le signe de la puissance et de la volonté hurlante. Prenons notamment le titre introductif « Above 1979 » qui incarne la mise en bouche parfaite. On comprend tout de suite où le groupe veut nous amener puisqu’on décèle ce paradoxe ambiant qui vacille entre bonnes grosses lenteurs planantes et rapidités délirantes. Puis c’est l’enchainement des titres comme « The Son », seul morceau qui se rapproche bien des précédents albums, « On a Stone » qui est le grand récital Stoner de l’opus, ou encore « Loose » : gros coup de cœur pour un morceau vivant et qui a une histoire à raconter.
Puis on découvre que 1000 Mods a gagné en maturité avec notamment « Electric Carve ». Le titre est bien rentre-dedans au départ puis d’un coup net, on se retrouve plongé dans la veille Irlande avec une rythmique excellente et changeante à souhait. « A.W » confirme bien cette énergie débordante où l’on croirait entendre un bon vieux Noir Désir, mais l’inspiration du groupe est à chercher du côté de groupes comme Sonic Youth, The Clash ou bien encore Fugazi. De manière plus large, cette déchéance de lourdeur et de lenteur toujours omniprésente sur les ponts ou même quand on s’y attend le moins ne peut que nous combler. Il suffit de tendre l’oreille sur « Groundhog day », où ce titre nous fait découvrir une facette plus acid-jazz avec toujours plus de Doom et de grosses Fuzz. Sans oublier le final explosif « Into the Spell » qui fait monter le groupe d’un étage. Car ici, on ressent véritablement l’approfondissement artistique. Cette chanson respire la maturité et nous promet un avenir prometteur pour le groupe.
C’est donc un très beau et grand retour pour 1000 Mods qui nous offre un vrai petit chef d’œuvre. Repeated Explosure To… est sans aucun doute l’album de la maturité. On ne peut que féliciter ce groupe qui mérite amplement sa place parmi les grands de la scène Stoner.

Red Spektor aime les symboles. Un simple regard sur la pochette de cet album éponyme saura vous en convaincre. Et de la même manière qu’ils franc-maçonnisent leur visuel, les anglais bâtissent leur stoner avec des techniques éprouvées, illuminatis d’un style efficace, direct mais par trop conventionnel.
Tel un serpent navigant entre compas, œil tout puissant et triangle, Red Spektor glisse ses écailles de cuir craquelé entre blues-rock, gouttes de psychédélisme et riffs poussiéreux. On pourrait ranger le trio entre Brutus et Kadavar pour peu que l’on cherche une comparaison. Efficace.
Le groupe ne cherche pas à ré-inventer le style et s’il s’approprie les codes et conventions du genre assez facilement, les compos défilent sans que l’une ou l’autre sortent du lot. Le disque s’essouffle et perd en intensité. Il faut attendre un titre comme « Black Moon Rising » pour retrouver à nouveau un intérêt certain pour le combo. Ce mid-tempo permet au groupe de se recentrer sur son propos et les intentions font à nouveau mouche. L’histoire de la voix, la justesse des solos, la réverb équilibrée, le riff rythmique martelé, c’est un grand oui qui nous pousse à garder une oreille sur ce groupe. D’autant que celui-ci termine sa galette par « Lost Soul », un titre acoustique tout aussi juste et emprunt d’un véritable respect pour ces Led-Zaînés, une fin tout en espoir.
Red Spektor est un groupe assez jeune finalement (2013, pour leur début). Ce premier long effort est au final, une promesse. Idéal pour boire des bières ou craquer des blondes en discutaillant, il contient tout de même assez de bonnes idées pour entrevoir un futur moins balisé et scolaire. Encourageant mais peut mieux faire.

Trio originaire de Montpellier, Black Witches fait dans le stoner façon cactus. Les g(riff)es acérées de ce Crows In The Skies raviront ainsi nombre de stoners.
Dès l’entame de « Buffalo », premier des 5 titres de cet EP, les contrées désertiques et poussiéreuses envahissent l’espace sonore. Oscillant entre la rugosité d’un Unida et le côté plus mélodieux d’un QOTSA, les montpelliérains débitent des bûches vitesse grand V.
Qu’ils soit instrumental (« All Robots Want To Make Love ») ou non (« Crows In The Skies »), chaque titre de Crows In The Skies fait mouche dès la première écoute. Mention spéciale à « Death By Love » qui, servi par un riff monstrueux de simplicité et d’efficacité, véritable incitation au headbanging, possède les atouts pour devenir un classique du genre.
Black Witches est définitivement un groupe à suivre avec attention.

Cagliari est connue comme une ville chaude et lumineuse du sud de la Sardaigne. Elle est également le terreau fertile qui a nourri la noirceur de la musique de The Blacktones, quatuor sludge/stoner qui sort son premier album autoproduit.
Dès le troisième titre, l’abrasif « Thousand Friends », le gang italien lâche magistralement riffs et décibels pour une furie sonore maîtrisée de bout en bout. Pourtant, réduire le groupe à un combo 100% pur-sludge s’avère être une grave erreur. Certes, la lourdeur d’un Crowbar est là, mais The Blacktones incorpore ci et là des passages mélodiques et des influences grunge (qui lorgnent vers Alice in Chains) pour créer un mix loin d’être complètement déroutant (« I’m Not Here… »).
Au final, les dix titres de cet éponyme The Blacktones passent haut la main l’épreuve d’acceptation auditive et feront, à coup sûr, connaître la Sardaigne autrement qu’au travers de la Duna Jam.
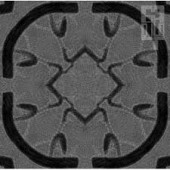
La Suisse est définitivement une terre fertile pour le stoner. Echolot, trio originaire de Bâle, évolue dans le genre Psychedoom (aussi bien musicalement que visuellement) et accouche de son premier album auto-produit sobrement intitulé Echolot I.
Un sens certain du riff, quelques lignes vocales clairsemées, une touche de psychédélisme musical, des samples cinématographiques , tous les ingrédients sont donc réunis pour satisfaire les plus curieux de nos lecteurs. Si vous aimez ce que propose un groupe comme Glowsun, ou le plus planant des gangs de Gary Arce (sur la partie 3), si une ligne de basse funky ne vous laisse pas indifférent, ou si vénérez les vocaux Torche-esques, allez de ce pas jeter une oreille attentive aux trois parties qui composent ce Echolot I : un album en forme de belle surprise qui est un peu tout ça à la fois, mais aussi bien plus encore.

Fut un temps, le siècle dernier en gros, où, Fatso Jetson, tête de prou d’un desert rock bariolé emblématique du haut désert californien et de ses émanations les plus barrées, enquillait un album tous les deux ans, peu ou prou, comme autant de classiques jetés en pâture à un public rare (undeground) mais toujours satisfait. Puis le virage des années 2000 vit le barycentre géographique de ce qui commençait à s’appeler stoner se déplacer subrepticement, puis éclater complètement avec l’explosions de combos de provenances et mouvances musicales hétéroclites. Même si Fatso Jetson a survécu à cette période, leur présence musicale s’est raréfiée, diluée aussi car devenus vétérans d’une scène locale qui n’existe plus vraiment en tant que telle et dans sa forme originelle. Il faut désormais attendre plusieurs années entre chaque disque, à l’image de ce nouveau Idle Hands, qui sort 6 ans après Archaic Volume (on ne comptera pas les quelques EP, live et autres amuse-bouches). Dans l’intervalle, Fatso est toutefois redevenu actif en live, avec quelques tournées européennes notamment : le groupe, au line up à géométrie variable, reste une force vive du genre. Le doute subsistait encore quant à leur inspiration dans l’écriture, à confirmer à travers un véritable album de nouvelles compos.
Les premières écoutes, chaotiques, font aussi peur qu’elles font sourire : on a retrouvé le Fatso qu’on connaissait, cet animal baroque et débridé, imprévisible et instable musicalement. Riffs et licks immédiatement mémorables, breaks improbables, chant fiévreux, arrangements rococo ou plus subtils… La musique du groupe est directement identifiable. En revanche, leur inspiration est-elle toujours au rendez-vous ? Après des dizaines d’écoutes insatiables, on peut répondre par l’affirmative, sans ambage. Il y a des titres plus efficaces que d’autres, certes, mais tous s’engramment durablement dans le lobe temporal ; passées les premières écoutes, il deviendra très difficile de les en déloger. Qualitativement, on est bien lotis ici avec des titres qui se placent instantanément dans les meilleures compos du groupe. On pense par exemple à l’instrumental « The Vincent letter », le catchy « Royal Family », le groovy et si emblématique « Nervous Eater » et même le mélancolique instrumental « Seroquel », qui réussit le tour de force de ne jamais verser dans le sirupeux ou l’ennuyeux. Jamais à court d’idées et d’innovations, Fatso, bien aidés par leur producteur Mathias Schneeberger, expérimente, se frotte à de nouveaux arrangements. « Then and Now » par exemple, concentre tout ce que l’on aime chez le Fatso Jetson « classique » (?!), en proposant le subtil ajout de chœurs féminins discrets mais décisifs (ces vocaux, assurés par la propre fille Lalli, assurent une présence tout aussi discrète et bienvenue sur d’autres titres). Autre illustration de cet esprit frondeur : le déjanté « Portuguese Dream », lancinant et rageur, et son chant complètement déjanté.
Bref, en quarante mots comme en mille, ce Idle Hands trouve sa place sans forcer dans le meilleur de la discographie d’un groupe pourtant habitué aux sommets de son art (il y a peu de concurrence dans sa « niche », faut dire…). Dit autrement : si vous n’aimiez pas Fatso Jetson jusqu’ici, leur dernière production ne vous fera pas changer d’avis. Si vous ne connaissez pas ou mal, en revanche, c’est un très bon cru pour découvrir leur univers. Quant aux fans : vous pouvez vous réjouir de la qualité de cette production et des perspectives qu’elle apporte à la carrière d’un groupe manifestement encore loin du déclin.

Moins de deux ans, voilà le temps qu’il aura fallu attendre pour voir apparaître le successeur de Black Power Flower. La remarque n’est pas anodine puisque plus de six années s’étaient écoulées entre le huitième et neuvième album (Très Dias mis à part) de Mr Cool. Et là je vous vois faire un rapide calcul… mais oui, c’est bien cela, Brant Bjork nous donne avec cette nouvelle livraison son dixième album solo.
Difficile de croire en 1999 lors de la sortie de son premier album alors qu’il est batteur à plein temps pour Fu Manchu que l’ami Brant sera finalement aussi prolifique dans sa carrière individuelle.
Tout comme pour le précédent opus, on retrouve Bubba DuPree à la guitare et Dave Dinsmore à la basse. Seul le batteur change cette fois ci avec l’arrivée de Ryan Gut qui a déjà pas mal roulé sa bosse et ce dans tout un tas de styles différents. Et pour les puristes, Ryan joue sur un kit très similaire à celui qu’utilisait Brant Bjork lui-même.
Côté écriture, Bubba DuPree prête main forte à Brant Bjork ce qui est nouveau, même si au final il est difficile de mesurer réellement son degré d’implication.
Effectivement il n’est pas évident de voir en quoi Bubba Dupree a pu influencer Brant Bjork puisque le résultat ne dénote pas spécialement du reste de sa discographie. Mais loin de moi l’envie de dire que c’est un peu la même chose que les précédents car même si on peut reprocher à Brant un manque de prise de risque, vous ne me ferez jamais dire que Jalamanta, The Operators et Saved by Magic sont des albums qui se ressemblent par exemple. Toujours est-il que nous avons avec Tao of the Devil un album 100% Brant Bjork de la première à la dernière seconde. Très homogène dans sa qualité d’écriture, les huit titres sont autant de motifs de satisfaction d’autant que la production est on ne peut plus parfaite. Point de remplissage avec un ou deux titres plus faibles, c’est du tout bon. Ce degré d’exigence est sans doute responsable de la courte durée de l’album puisqu’en 37 minutes tout est plié. C’est court certes mais souvenez-vous de l’inoubliable Keep Your Cool qui arborait lui aussi huit titres pour à peine 33 minutes.
Et la comparaison ne s’arrête pas là car même si les deux opus sont assez différents dans leur écriture, ils ont une similarité flagrante. Keep Your Cool avait pris toute sa dimension en redécouvrant les titres en concert. “Rock-N-Rol’e” et “I Miss My Chick” devenaient alors des monuments d’improvisation, de jam et d’ambiance groovy à souhait. Ici ce sont des titres comme “Dave’s War” et son long jam final ou encore “Greeheen” au changement de rythme imparable qui révéleront tout leur potentiel en live à n’en pas douter.
Car n’oublions jamais qu’un album studio nous donne à écouter une composition à un certain moment de son existence, composition qui, chez Brant Bjork aura souvent tendance à changer, évoluer. Rien n’est fixé avec lui, tout est mouvant.
Souvent comparé à quelqu’un de cool, qui prend son temps et ne se presse pas forcément, Brant Bjork n’en reste pas moins quelqu’un qui avance encore et sans cesse, à son rythme et sans s’arrêter. Dixième album que je vous dis !
Tao of the Devil est très varié, excellemment produit et sans point faible. Un très bon cru que vous prendrez plaisir à déguster c’est certain.
Rien de bien nouveau donc sous le soleil californien mais il fait toujours aussi bon s’y prélasser en sirotant une boisson fraîche en se disant que quand même, ça a du bon tout cela et que la vie est faite de petit plaisir, comme un album de Brant Bjork version 2016.

Endless Floods est assez discret sur la toile pour m’empêcher de faire une introduction avec un tant soit peu de contenu (merci les gars). On rejettera la faute sur la jeunesse du groupe dans le doom-game, rare chose sur laquelle je suis à peu près certain. À la courte liste de mes connaissances, établie après une investigation qui ferait pâlir Columbo (l’inspecteur, pas le plat), on peut aussi ajouter qu’ils sont trois, originaires de Bordeaux, et qu’ils ont sorti cette année un split album avec Uur, une formation des Pays Bas dont le patronyme tapé sur Google m’a mené à l’horloge parlante en néerlandais. Il faut parfois savoir essuyer des défaites en tant qu’inspecteur.
Mais n’oublions pas l’objet de cet article, la sortie de leur premier EP éponyme, Endless Floods, donc.
4 morceaux aux titres précédés d’un chiffre romain pour 35 minutes d’écoute, et une couverture très sobre en noir et blanc, voilà ce que nous propose Endless Floods avec cet EP. Sobriété, les bordelais en ont fait bon usage sur cet album.
Amateurs d’effets à outrance, de champignon psychédélique à s’en faire une omelette et de go-go-gadget-au-poing, passez votre route. Ici, on fait les choses simplement.
Le premier titre, “I – Setting Fire To The Shelter”, compte bien nous le démontrer. Il ouvre l’album sur un dialogue entre la guitare et la basse si calme qu’il faut tendre l’oreille et lui trouver un chemin à travers les cymbales de batterie se perdant dans le lointain si vous souhaitez l’entendre. Vient ensuite le moment du cyclone, avec en son œil un chant hurlé aux baragouinages incompréhensibles et un duo guitare/basse qui n’a rien à envier à Katrina. Ballotté entre ces deux mondes où la violence s’exprime toujours plus ou moins fort, la mélancolie et le chagrin ne quittent jamais le morceau. Poignant.
La suite de l’album est construite sur cette alternance entre neurasthénie et colère. “II – Carpathe”s nous donne l’impression d’assister à l’enterrement d’un homme vivant qu’on tente d’étouffer sous des couches de décibels. Déconseillé aux claustrophobes. “III-Floods” est peut être le morceau synthétisant le mieux le groupe (en plus y’a “Floods” dans le titre, comme le nom du groupe Endless Floods, CQFD) : 14 minutes au total, avec 7 minutes d’une navigation sans heurt où quelques notes errantes cherchent leur chemin aux côtés d’une caisse claire caressée, puis 7 minutes où l’on se fait bouffer par un doom funèbre et terrorisant. Le dernier morceau, “IV- Eternal Failure”, est le plus court de l’album mais aussi celui présentant le moins d’intérêt. Sans être mauvais, il est le plus classique des quatre, si l’on omet sa fin avec un solo aussi inattendu qu’inélégant.
Sur le papier, Endless Floods pourrait paraître un poil monotone. Les ambiances ne sont pas vraiment variées mais toutes sont bien construites et très prenantes, et cette dépouille volontaire, cette volonté d’un retour à l’essentiel, fait du bien à entendre. Voilà un groupe qui avance loin de la surenchère pour délivrer un doom brut mais pas du tout idiot, arrivant à faire voyager l’auditeur entre folie et sagesse avec une grande aisance. Tout ça nous pousse à croire que l’on a face à nous des gens sincères et énormément investis dans leur musique, ce qui la rend d’autant plus saisissante.

Truckfighters signe son grand retour avec V, histoire de rappeler à chacun que c’est déjà la cinquième aventure studio pour un groupe né il y a presque quinze ans maintenant. Autant dire que l’attente a été ressentie de manière posée puisque les Suédois ont toujours su faire plaisir à leurs fans à travers une large hyperactivité, avec leur précédant opus Universe en 2014, l’album Live In London cette année en 2016, les innombrables concerts donnés un peu partout en Europe, et, enfin en France. Ce nouvel album arrive à point nommé afin de nous préparer à l’hiver.
Quand on prend connaissance d’une cinquième œuvre musicale dans la carrière d’un groupe, on peut être confronté à deux possibilités : soit le groupe en profite pour créer quelque chose de nouveau, soit il décide de repartir sur les bases des premiers albums. Ici, vous serez face à un opus qui surprend puisque V compile ces deux possibilités artistiques. En effet, la maturité est clairement mise en avant, ce qui nécessitera pour certains d’apprivoiser la bête au travers de nombreuses nuances et de choix inattendus. Mais au final, quand on connaît bien la discographie de Truckfighters, cette galette apparaît peut-être de manière plus naturelle dans sa fonction « clin d’œil ». Façon de dire qu’on est face à un métissage de l’intégralité de l’œuvre du groupe.
Ce ressenti est flagrant notamment avec « The 1 » et « Fiend » puisqu’on retrouve les grosses pêches rythmiques qui ont fait le succès du magnifique Gravity X. Puis on va redécouvrir les charmantes nuances que Ozo (chanteur/bassiste) et Dango (guitariste) avaient réussi à dompter sur les album Phi et Mania avec les chansons « Hawkshaw » ou encore « Gehenna ». Néanmoins, cette dernière ainsi que « The Contract » sont les titres les moins efficaces par rapport au reste de l’album. En même temps on récupère aussi, avec une grande franchisse, les associations rythmiques et mélodiques qui avaient porté Universe, cette ouverture à un Rock plus large, plus progressif, voire jazzique. Découvrez en introduction « Calm before the storm » qui offre un clip formidable : une véritable histoire associée au titre avec un dénouement terrible. Une chanson qui rappelle d’ailleurs un peu « Get Lifted ». Puis terminez l’album avec « Storyline », titre le plus touchant et le plus marquant par son originalité. Vous comprendrez ainsi que ce cinquième opus respire l’authenticité.
Côté ambiance, il n’est pas utile de décortiquer l’aspect rythmique et le groupe puisqu’il reste fidèle à lui-même. C’est toujours aussi excellent et aussi groovy. Peut-être, la chose qui peut surprendre sera la progression vocale d’Ozo : son exploitation va très loin puisqu’il se risque dans les harmonies et les voix de têtes approfondies. On espère que le résultat sera aussi bon en concert. Enfin, ils ont toujours ce son extraordinaire de trompette de la mort électrique : cette Fuzz nous ensorcellera toujours.
On est donc face à un album qui va fonctionner comme le bon vin français : il se bonifiera au fil des ans. Et pour ceux qui ne l’auront pas apprécié à sa juste valeur, il est certain qu’ils y reviendront au bout de quelques semaines ou quelques mois. Car il est difficile de ne pas se laisser envouter par V : une œuvre plus solennelle, plus mature et aussi plus intime.
Le point vinyle :
Truckfighters sort plusieurs éditions vinyle de son dernier album, sur… plusieurs labels différents ! Un plaisir de collectionneurs :
- Un jaune, chez Finest Vinyl
- Un rouge (200 exs) et un doré (600 ex) sur leur propre label Fuzzorama
- Un blanc et un noir chez Century Media.
|
|