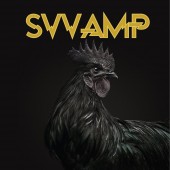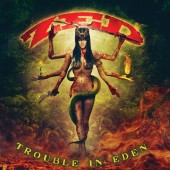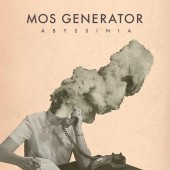|
|

Quand on a besoin de deux CD pour contenir la totalité d’un album, on sait que le voyage risque de prendre un petit peu de temps. Et rien de mieux pour remplir l’espace et le temps qu’une base de doom/drone agrémentée de couches de sludge, d’experimental et d’ambient. En 7 morceaux pour 84 minutes, les deux ukrainiens de Nonsun prennent places dans votre salon, sur fond de bruit blanc.
Comme d’habitude, le genre réclame patience voire abnégation, le temps d’une première écoute durant laquelle il arrive de vérifier la sono, au cas où un câble serait débranché… Une fois fait, les premières sonorités accouches d’un limon sourd dans lequel germe de temps à autres un quelque chose. Un quelque chose tour à tour intriguant et pesant, qui étrangement gagne en intérêt plus on avance sur le fil de ce Black Snow Desert. Sans parler de génie, quelques embardées sortent du lot. Et puis il se dégage une vraie personnalité et un réel investissement dans cette production définitivement ambitieuse. Pour les aficionados du genre, ne boudez pas votre plaisir.

Le cv de Nick Oliveri a une putain de gueule (tout comme Nick lui-même). Le multi instrumentiste étasunien ayant participé au mythe fondateur de la scène que nous chérissons de tous nos cœurs : Kyuss. A la basse sur quelques productions avant que Scott Reeder reprenne le poste, il demeurera à jamais l’un des protagonistes du joyau que tout être humain qui lit ces lignes normalement constitué se doit de posséder : « Blues For The Red Sun ». Il était donc assez concevable qu’on croise sa silhouette dans les tentatives de rebouter le feu que furent Vista Chino et Kyuss Lives ! avec qui il assura, avec brio, moult prestations avant de se retirer dans des circonstances digne d’une série télé à rebondissements.
La carrière visible du grand chauve tatoué ne s’arrête pas à un mythe puisque notre lascar a aussi été une partie bien prenante de Queens Of The Stone Age. Je ne vous cause pas ici des sorties récentes de ce band désormais très bankable, mais de la trilogie originelle qui marqua plus d’un d’entre nous et contribua certainement à ramener une pellée de rockers velus dans le sillage de la scène stoner.
La carrière de Nick Oliveri et ses frasques ne s’arrêtent pourtant pas à ces deux incroyables formations puisqu’il a œuvré aussi, dans un style un chouïa plus punk, avec les Dwarves et Bl’ast en plus de se taper un nombre de featuring dont la liste est presqu’aussi longue qu’un jour sans riffs.
En dehors de ses aventures en collectif, l’Américain a développé son propre collectif : Mondo Generator regroupant à la fois la provoc et l’urgence du punk ainsi que les sonorités californiennes du stoner originel. Distillant ses compos sous diverses formes et auprès de différentes maisons actives dans le bon son, Mondo Generator ou plus précisément Nick Oliveri’s Mondo Generator fait l’objet d’une compilation de son meilleur sur le label transalpin Heavy Psych Sounds Records.
On va tout de suite stopper tout suspens : il n’y a pas l’ombre d’un inédit sur cette plaque, enfin sur ces deux plaques de bon vieux vinyle. Les nombreux inconditionnels qui se pressent à chacune des nombreuses apparitions européennes de Nick peuvent skipper jusqu’au point vinyle ci-dessous pour trouver une nouvelle excuse afin de claquer leur pognon si durement gagné. Les autres n’apprendront pas grand chose des quelques lignes qui suivent si ce n’est que passer à côté des tribulations de cette formation frise l’acte criminel !
On retrouve dans ces sillons 21 perles qui passent du rentre-dedans accompagné des hurlements du concepteur en chef, genre au hasard « 13th Floor » (premier titre de la première face) aux joyaux de la couronne plus apaisés que sont le cuivré « Take Me Away » ou ma préférée : l’énorme « Paper Thin » (dernier titre de la dernière face) sur laquelle la voix habitée de Nick fait un job incroyable. Question provenance, la palme revient à « Dead Planet: SonicSlowMotionTrails » qui contribue au tiers de cette sortie (parce qu’elle le vaut bien). Nous trouvons ensuite une bonne contribution de « Cocaine Rodeo » – le premier long format de ces agités – puis un soupçon de l’album « Hell Comes To Your Heart » (je précise vu que ces as de la déconne ont sorti un lp et un ep avec le même titre).
En dehors de cette pioche repartie de manière cohérente en ce qui concerne le style (répartition intéressante sur les quatre faces), on trouve quelques trucs un peu plus confidentiels genre « Dog Food » tiré du ep du même patronyme, des extraits d’un album solo du maître de cérémonie ainsi que « Turbonegro Must Be Destroyed » de la compilation hommage aux gens de bon goût « Omega Motherfuckers ». Comme mentionné plus haut, rien de bien transcendant pour les – très – nombreux suiveurs de cette légende de la scène originelle, mais un objet de plus à ajouter à leur collection de Kyusseries. Pour les ceusses qui ne seraient pas encore converti, une excellente manière de se plonger dans l’univers musical du type à qui nous devons, entre autres, l’excellent « Mondo Generator » de la plaque sacrée qu’est « Blues For The Red Sun » de Kyuss.
Point vinyle :
En plus du truc-machin-chose digital et numérique en digipak, la crémerie italienne nous propose une version double vinyle ordinaire ainsi qu’une version limitée en clear blue (pas pour le soleil rouge) qui peut s’agrémenter d’un cabas et d’un t-shirt pour les groupiles confirmés que vous savez parfois être.
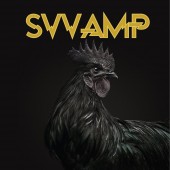
Du désormais incontournable label californien Riding Easy Records, chacun connaît les grandes réussites doom, aux accents souvent psychédéliques (Monolord, Salem’s Pot, Spelljammer ou plus récemment Holy Serpent) voire les saillies retro rock, à originalité variable (Electric Citizen, Mondo Drag, The Well, Slow Season, Old Man’s Will et surtout les « nuggets » Brown Acid), mais peu se sont penchés sur les quelques étrangetés dont Daniel Hall, patron du label, nous a gratifiés de ça de là, selon l’humeur de ses publications. Ainsi il est fortement conseillé de jeter une oreille à la bizarrerie doomy berlinoise Aleph Null ou à la sauvagerie du duo blues The Picturebooks (quel premier disque !) et désormais de se ruer sur la sortie du premier album d’un trio suédois dont le nom ne vous sera désormais plus jamais étranger : Svvamp.
A l’heure où le retour au son des 70’s est une tendance dont on ne peut globalement que se féliciter, malgré de nombreuses resucées sans saveur et pillages sans vergogne, le disque de Svvamp apparaît comme une véritable salvation. Comme l’était, en son temps, la découverte du premier album de Witchcraft. Sauf qu’au lieu de ressusciter Pentagram, les trois gamins Jönköping se réfèrent à toute une vague blues rock, mêlant groove et urgence. Creedance, Cream, Mountain, Blue Cheer… tout ici respire la gamme pentatonique et le son rond d’une basse plus caressante que galopante. Ce ne sont pas les premiers, me direz vous, à réanimer la flamme de cette époque où le rock se durcissait lentement mais sûrement, mais Svvamp le fait tout simplement mieux que les autres. Vraiment. Comme Witchcraft en son temps. Des onze titres de leur premier effort, rien à jeter, le trio trouvant même le moyen de nous proposer quelques riffs passionnés et originaux sans sortir du cadre d’une formule que l’on croyait pourtant explorée jusqu’à ses moindres recoins. Leur secret ? Le chant probablement. Il s’échappe de chaque ligne vocale comme une pulsion de vie et le fait qu’il soit l’œuvre du batteur du groupe n’y est sûrement pas étranger. Au milieu de ce voyage vers le passé, « Burning Down » et son flot de paroles noyé par les effets, s’impose comme le plus beau moment de la traversée.
Tout simplement saisissant, le premier disque de Svvamp éclabousse par sa classe et son insolente décontraction. Enregistré sur du matériel vintage, joué avec simplicité et passion, il est, en sus d’un des albums de l’année, une véritable gifle portée à ceux et celles qui ont, par fainéantise musicale, travesti la cause à grands renforts de disques calibrés et publications tièdes. Le blues, comme l’amour se vit avec passion et ne se consomme pas en pilules.
Point Vinyle.
Riding easy l’a joué soft avec 100 LPs pressés en clear, 100 en violet, 100 autres en rouge en sus du black standard heavydement.

En traînant sur scène la reprise d’une version par Richie Havens du morceau « Freedom », issu originellement du gospel et des « slaves song », Lorenzo Woodrose eu l’idée de tourner entièrement l’écriture de son septième album au sein du groupe Baby Woodrose, figure historique de la scène psyché danoise, sur leur pendant moderne. Une foule de thèmes se bouscule alors au portillon, que ce soit le lavage de cerveaux ou encore le contrôle des esprits et des idées. Un engagement sérieux, supporté par ce poing fermement levé et dégageant des ondes psyché, pour mieux libérer nos consciences des entraves de l’oppression moderne.
Avec ce type de sujet sur les bras, pas question de tricher. Les vibes transmises par le support audio doivent être les plus authentiques possibles, et c’est pourquoi l’enregistrement analogique a été très justement choisi. Pas de coupes, peu d’overdubs et voilà un son organique au possible. Et c’est une franche réussite grâce à un mixage expert. Le son y est fin, détaillé et met si bien en valeur la recherche sonore intense qui a visiblement précédée l’enregistrement.
Pour le style, précisons qu’outre le psyché et le stoner, il faut inclure un pan garage. Une somme qui n’est pas sans rappeler (toutes proportions gardées car pas de pompage ici), certains morceaux de Brant Bjork ou de Monster Magnet (sur « Reality », « Mind Control Machine ») mais aussi pourquoi pas un peu de Fu Manchu (sur « Red The Signpost »). Ce tout s’étale sur neuf morceaux (dont le fameux « Freedom »), avec une qualité d’écriture trop rare dans ce monde. Seul « 21st Century Slave » possède un refrain irritant car entêtant en diable… Mais que dire de « Termination », qui vient justement en conclusion ? Et bien qu’il me semble que tous les albums devraient posséder quelque chose d’aussi beau.
Avec presque vingt ans à travailler sur le genre, Baby Woodrose va peut-être s’ouvrir à vous sur cet album. Il semble assez évident que vous vous dirigerez rapidement vers tout ce qui pourra vous connectez avec l’univers de ces danois, et cela pour un bon moment. Donc je pense qu’il est temps de vous y mettre, là, maintenant, tout de suite.
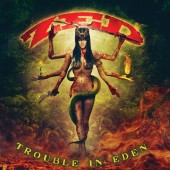 La scène rock de la Bay Area de San Francisco n’a plus à se faire un nom, ancrée désormais dans l’imaginaire collectif comme, si ce n’est le berceau parfois, le creuset dans lequel s’est développé nombre de combos incandescents. Appartenir à cette scène revient à inscrire sur son CV que notre niveau de pratique de rock est “langue maternelle” et non juste “courant”. C’est sans subir la pression mais en la relâchant groovement que ZED sort son nouvel album “Trouble In Eden”, 10 titres chaudement présentés par une déesse guerrière (qui fascine autant que l’on a pas envie de venir lui chercher des noises) en couverture. L’arsenal en ses mains est aussi classique que la facture des chansons du quatuor américain mais armes courantes n’empêchent une maîtrise originale. La scène rock de la Bay Area de San Francisco n’a plus à se faire un nom, ancrée désormais dans l’imaginaire collectif comme, si ce n’est le berceau parfois, le creuset dans lequel s’est développé nombre de combos incandescents. Appartenir à cette scène revient à inscrire sur son CV que notre niveau de pratique de rock est “langue maternelle” et non juste “courant”. C’est sans subir la pression mais en la relâchant groovement que ZED sort son nouvel album “Trouble In Eden”, 10 titres chaudement présentés par une déesse guerrière (qui fascine autant que l’on a pas envie de venir lui chercher des noises) en couverture. L’arsenal en ses mains est aussi classique que la facture des chansons du quatuor américain mais armes courantes n’empêchent une maîtrise originale.
Ce qui distingue ZED de la tripoté de earth rockers nord-américain qui se vautre dans la tournerie facile et le groove ultra bavant, c’est sa capacité à sortir des sentiers battus avec des plans inattendus de bon aloi. Autour d’un riffing efficace savamment balancé, la section rythmique et particulièrement la basse offre son lot d’incursions funk, de lignes slapées, et se décroche ainsi du mix par son jeu et ce son aussi gras que percutant. Les gratteux ne sont pas en reste avec entre deux bucheries, quelques soli sachant chatoyer autant le blueseux que le heavy-metalleux. Avec tout ça, vos pieds ne résisteront pas à la furieuse envie d’entrainer le bas de votre bassin à onduler en accord avec ces morceaux entraînants aussi efficaces, sans sa classieuse sobriété, qu’un Clutch compensée par une débauche de riffs d’artificier aux arrangements multi-colorés.
Variant ainsi au fil de l’album les révérences aux diverses pierres angulaires de la musique amplifiée des 40 dernières années tout en se les appropriant, les californiens enfilent les tubes comme d’autres les perles. Tenu sur toute sa longueur par ce chant entre Chris Cornell et Ian Astbury grattant sur certaines lignes le Maynard James Keenan de A Perfect Circle, “Trouble In Eden” vaut plus que la somme de ses parties. La répétition des écoutes vous permettant de souligner et/ou de repérer ce petit “je ne sais quoi” qui fera vibrer votre for intérieur dès les préliminaires de chaque titre. Un troisième album et encore beaucoup sous la pédale, ZED est loin d’être dead et a certainement encore beaucoup de kilomètres de promesses à nous enquiller.

Chantre du stoner psychédélique, actif depuis l’aube des années 2000, Monkey 3 fait partie des historiques de la scène Européenne sous le haut patronage de Colour Haze, quelque part entre My Sleeping Karma et Glowsun en somme. Et ce n’est pas un hasard si les suisses, habitués à changer de labels à chaque publication (Buzzville, Stickman, Spinning Goblin – déjà une émanation de Napalm records) ont trouvé refuge confortablement chez la maison-mère Napalm, terre d’accueil de leurs cousins germains et français suscités. Avec une précision d’horloger (suisse évidemment), Monkey 3 a pris l’habitude de nous gratifier d’un nouvel album tous les trois ans*, ainsi sort cette année le successeur attendu du passionnant The 5th Sun (2013 donc). Le nom de cette nouvelle offrande, Astra Symmetry, ainsi que sa splendide pochette nous invite, une fois n’est pas coutume, à une longue traversée.
Car la musique de Monkey 3 a toujours eu en elle quelque chose de céleste. Porté par un clavier aux nappes cosmiques, traversé par des thèmes spatiaux, le son du groupe nous force à quitter la terre. Il y a bien sûr une vraie obsession pour Pink Floyd derrière tout ça, s’il en fallait une preuve, « Seeds » nous revient de l’espace comme un lointain écho au « Fearless » du Floyd sur Meddle. Mais il n’y a pas que ça, comme l’indique le rythme menaçant de « Crossroads » ou « Dead Planet’s Eyes » aux sonorités orientales, voyant Tony Jelencovic se proposer une nouvelle fois en guest vocal (Après la reprise de « Kashmir » sur l’EP Undercover). Car, à l’instar de l’excellent album de Blaak Heat paru un peu plus tôt cette année, Monkey 3 a pris le parti de mêler l’orient aux distorsions occidentales, pont nécessaire entre deux musiques ayant pour point commun la notion de transe. Le single “Abyss” est un très bel exemple de ce mariage réussi et passionnant. Que les puristes se rassurent quelques plages de cet album (« Moon », « Arch ») convoquent tout de même ce qui, historiquement, a fait le sel de Monkey3, et permet de garder une certaines cohérence avec le reste de la discographie du groupe. Gageons tout de même que ce disque apportera quelques perles supplémentaires aux lives du groupe, car c’est bien là que se doit de finir le voyage, finalement.
Point vinyle :
Napalm Records propose l’objet en 3 versions : 200 exemplaires en gold, 300 en transparent plus une version noire classique.
* les plus observateurs d’entre vous répliqueront en précisant qu’il ne s’est passé « que » deux ans entre Undercover et Beyond The Black Sky mais n’est-on pas finalement toujours plus pressé lorsque l’on sort d’un EP ?

Nous avions croisé ces Etasuniens il y a quelques années au Desertfest de Berlin et ils nous avaient sacrément foutu la gaule avec leur doom bien trapu à l’américaine. C’était à l’époque où le groupe commençait à radiner sa bobine en dehors des circuits underground et préparait l’arrivée de « Under Siege » son dernier long format en date. Peu présents dans nos contrées, peu actifs sur les réseaux sociaux et pas poussés par une mégastructure de l’industrie phonographique, les Ricains étaient sortis de nos radars et c’est avec plaisir que nous avons appris au début de l’année que la fin de la partie silencieuse était sifflée.
Le quatrième album de la bande de San Francisco ne surprendra guère les amateurs de ce trio puisqu’il contient les ingrédients principaux de la recette qui a fait leur honorable renommée, laquelle leur permet d’afficher plus de deux-cent concerts sur leur CV et d’embarquer cette année pour une énorme tournée sur plusieurs continent durant plusieurs mois. S’illustrant dans le sous-genre doom à la sauce US en y incorporant les éléments de base de la fameuse nouvelle vague du rock lourd so British (faites péter les vestes à patchs), Castle se distingue par une sacrée maîtrise (voire finesse) du riff ainsi que par ses vocaux féminins.
Les huit pistes enregistrées par Billy Anderson à Portland durant l’hiver (ça vend du rêve la saison froide dans l’Oregon) ne sont pas encombrées d’effets divers et variés : elles vont à l’essentiel de manière fort pertinente et évitent soigneusement de tomber dans le piège de la redondance ce qui n’était pas gagné d’avance vu le mode d’expression et la limitation de jeu imposée par le nombre de protagonistes. Mat se fait plus discret au micro sur ce coup-ci, mais il envoie une sacrée débauche de riffs bien inspirés ; « Veil Of Death » pile poil au milieu de l’album en est une bonne illustration. Le métronome Al martèle tel la mule en forçant parfois le trait comme sur « Black Widow » le morceau rentre-dedans qui sert d’ouverture à cet album. Finalement (et ouais on est des misogynes pur sucre par ici) Liz, à la basse et au chant, nous propose des plans parfois envoûtant, « Down in the Cauldron Bog », ou enragés, « Flash of the Pentagram », en se rapprochant des grandes hurleuses des années quatre-vingt comme la regrettée Wendy Orlean Williams.
Une nouvelle plaque qui tient toutes ses promesses et comble nos attentes avec justesse. Espérons qu’elle soit aussi celle de la reconnaissance pour cette formation inspirée par le monde occulte qui affronte en 2016 sa septième année d’existence car des joyaux comme le titre « Welcome to the Graveyard », empreint d’effluves seventies, ou « Hammer and the Cross », nettement plus pugnace, ça ne se trouve pas sous le sabot d’un bouc !

Spider Kitten fait parti de ces GVNIs (Groupe Volant Non Identifié) qui, échappant au radar pourtant aiguisé des amateurs du genre, reste un nom que l’on croise sur une affiche (le dernier Desertfest Londres) ou lors d’un partage sur les réseaux sociaux. Il est de fait que les Gallois se targuent d’un esprit DIY et le revendiquent en ces mots qu’ils tiennent pour biographie: “Nous enregistrons et mixons toute notre musique nous-mêmes. Nous ne faisons pas de tournée. Nous faisons des concerts quand nous le voulons. Nous nous réservons le droit de devenir un groupe différent… chaque nuit. Nous avons évolué d’un exercice de catharsis en quelque chose que nous trouvons bien plus intéressant. Nous sommes à 99% sincères”. Evidemment vu de cet angle, ils ne risquent pas de faire la une de la presse, ni être en haut de l’affiche. Ce qui est aussi dommage que louable.
26 sorties diverses et variées après la genèse du groupe en 2001, voici Ark of Octofelis 27ème production de Spider Kitten. Vous avez bien lu 27. Entre EP, live, LP et autres split albums, le groupe en est bien à cet effarant chiffre signe d’une productivité maladive voguant sur les flots d’un doom éclectique. Se jouant des styles, grignotant du grunge au psychédélisme le plus pur en goutant à l’indus et à la pop, leur discographie aussi cohérente que variée est une perpétuelle invitation à la découverte. Ark of Octofelis, le dernier né (en attendant le prochain album en cours d’enregistrement, évidemment), est une nouvelle étape dans la richesse des offrandes du groupe basé sur un concept à en arrondir le visage des frères Bogdanoff. Profitez de toute la quintessence de l’histoire expliqué par ces géniteurs magnifiée par Google Trad: “Ark of Octofelis raconte l’histoire d’ un groupe de rock psychédélique fictif qui vivent sur une planète appelée Octofelis , où il a toujours milieu des années 1970 sud de la Californie . Le groupe crée un composé dans le désert et convaincre des centaines d’adolescents sans méfiance à se joindre à un culte quasi-religieux , avec l’ objectif de construire une arche géante de l’espace en bois. Le plan est d’ équiper dehors avec un état du studio d’enregistrement de l’art et de voler à travers l’univers de répandre leur message d’harmonie psychédélique. Le groupe , cependant, sont des gens terribles , et ils volent hors de leur propre laissant leurs partisans derrière , seulement pour découvrir que dans leur hâte d’obtenir l’arche construite qu’ils ont oublié d’inclure et la méthode de direction. Donc, la bande de dérive à jamais dans l’espace profond , capable seulement de faisceau leur musique jusqu’à la surface de la planète la plus proche de servir comme un récit édifiant dans la cupidité et le pouvoir”.
Aouch, digérez. L’album est ainsi présenté en deux parties. La première, pièce maîtresse autour du morceau fleuve de 22 minutes, repose sur une entêtante basse mélodie fluctuant au gré des arrangements vocaux, des montées contenues des grattes et d’une section rythmique déployant une richesse maîtrisée de ses futs et cordes. Véritable joyaux de psychédélisme à la Pink Floyd. Le doom massif des premiers albums semble lointain et à chaque détour de la mélodie on ne serait surpris de se prendre une déflagration sonore. Spider Kitten ne se laissant jamais emporter dans cette dynamique, déploie tous ces atours d’arrangeur pour rendre cette épique mélopée toute en fluidité aussi passionnante à décortiquer qu’à se laisser porter. Par chance l’Arche est passé près de notre planète et nous voilà bercé de ses fameuses harmonies psychédéliques. Beaucoup plus variée la seconde partie de l’Arche découpée en 6 mouvements rappellent le doom premier pression à froid que le groupe sait si bien suinter sur “One from the Heart”, voire un doom encore plus lourd quasi indus sur “Launch”. Le tout alterné avec des titres tout en accoustique (“Hymn” et “Duplicitious”) et lancé par une intro qui résonne comme un traditionnel celte de l’espace.
Concept y compris, Ark of Octofelis est un album délicat à aborder. Les deux parties se complètent autant qu’elles s’opposent. L’une ne plaira pas forcément aux amateurs de l’autre. Cette 27ème œuvre et ce groupe reste à découvrir. Odyssée dans les multiples et riches influences de Spider Kitten… laissez vous prendre dans la toile de ces maîtres.

Il est de ces groupes évoluant aux confins des musiques extrêmes, mêlant chant death, lugubres ambiances black metal et lourdeur du doom, dans un fatras métallique aussi maitrisé que classieux. Il est de ces groupes dont les visuels sont superbes, reflétant à la perfection la noirceur du propos, n’ayant pas peur de sortir des EP ne contenant qu’une chanson de 45 minutes. Il y a en un en tout cas, et il s’appelle Inter Arma. Le quintet venu de Richmond, Virginie, avait surpris son monde avec la publication de Sky Burial en 2013, se proposant comme alternative plus que valable aux amateurs de mélange des genres, entre blast et sensibilités mélodiques, sur fond d’apocalypse. Beaucoup de déçus des orientations de Baroness ou Mastodon avaient trouvé en eux le refuge idéal pour nourrir leurs noirs desseins. The Cavern, fameux EP de trois quart d’heure publié en 2014 avait quand à lui rallié les plus exigeants mélomanes à la cause d’Inter Arma, passé de promesse doom à force tranquille du genre avec ces quelques publications. La sortie de Paradise Gallows, toujours chez Relapse Records devrait sans nul doute les propulser sur les plus hautes marches de la reconnaissance sur la planète heavy.
Écouter ce disque en contemplant le sublime artwork d’Orion Landau – artiste maison de Relapse signant là l’un des plus beaux visuels de sa riche et longue carrière d’illustrateur – est un voyage dont on ne revient pas indemne. En effet, Paradise Gallows est de ces merveilles qui ne vous lâchent qu’à la dernière note, dont la traversée, parfois éprouvante, permet néanmoins d’admirer toute l’ampleur musicale d’un groupe décidément touché par la grâce. Derrière un riff/fil conducteur que n’aurait pas renié Baroness sur le Blue Record (ce thème ouvre l’album avec « Nomini » puis revient au début de « Potomac », les deux titres faisant référence à la rivière Potomac, traversant la Virginie), Inter Arma flotte sur les eaux opaques d’un metal aussi extrême que sophistiqué, appesanti par des rythmes lourds, chargé comme la cale d’un navire marchand en perdition. Pourtant plus lumineux que les précédentes production du groupe, cet album respire néanmoins les abysses jusqu’au dernier souffle. Mariant avantageusement la sombre puissance dont les cinq musiciens de Virginie se sont toujours revendiqués avec un aplomb mélodique sublime, les potences du paradis nous promènent le long de la frontière prog sans jamais tomber dans la démonstration. Il y a quelque chose de sublime dans ces grandes saillies doom des enfers, assagies par de longues plages contemplatives. Derrière l’impeccable cavalcade crépusculaire qu’est « An Archer in the Emptiness », de nombreux moments de génie émaillent cet album âpre et sombre, comme finalement devrait toujours l’être la musique. Autre point d’orgue de ce voyage aux confins de la noirceur, les presque 12 minutes du morceau éponyme, longue dérive sur les côtes neurosiennes, voyage au bout de l’enfer.
Paradise Gallows est un des albums de l’année, de ceux que l’on ressort encore et encore et à bord desquels on embarque, sachant pourtant ce que nous coûtera la traversée.
Point vinyle :
Relapse records a inondé la monde de jolies galettes, ornées du navire en perdition, déclinées en quatre couleurs pour le premier pressage.
100 clear, réservées aux musiciens et à quelques chanceux, 300 « Halloween Orange / Mustard Merge » uniquement sur le site de relapse, 500 « Electric Blue with Gold Splatter » au même endroit et 500 « Blood Red with Metallic Gold / Sea Blue / Mint Green Splatter » que les membres d’Inter Arma auront avec eux sur leur tournée. Sans oublier bien sûr 2200 copies en noir, pour les puristes.

Los Disidentes Del Sucio Motel signe son grand retour avec un troisième album s’intitulant Human Collapse. Bien que cela faisait déjà trois ans que le quintet strasbourgeois n’avait pas sorti d’albums, il n’en demeure pas moins que la productivité ne s’est jamais épuisée. Il suffit de comptabiliser les nombreuses dates données un peu partout en France et en Europe depuis 2013, mais aussi de se souvenir de leur collaboration en 2015 avec Thomas Shoeffler Jr sur un charmant deux titres qui annonçait déjà une suite placée sous le signe du changement.
A la découverte de ce nouvel opus, le premier sorti chez Ripple Music, il est clair que la période des délires cinématographiques de série B et Z tend à disparaître pour laisser place à une musique plus littéraire. Une volonté pour le groupe de créer un Concept album qui se concentre sur une histoire : celle dressant un bilan sur les sociétés humaines à travers les crises sociales et environnementales. Comme le font remarquer les titres d’intro et d’outro de l’opus, il est temps de faire les « bons choix » et de trouver un « point d’arrivée ». N’empêche que la « collision humaine » est imminente, et, semble impossible à stopper. Façon de dire que l’Homme avec un grand H est en train de se diriger vers sa fin. Le débat est lancé. En tout cas, ce troisième album entend faire ressentir tous ces doutes et interrogations à travers une ambiance sombre et profonde.
Le rendu final nous offre ainsi la démonstration d’un groupe qui a su gagner en maturité et en maîtrise artistique. Pour cela, il suffit de tendre l’oreille et de récolter toutes les nuances rythmiques, les mélodies des guitares et la plus-value sonore apportée par Dany et son clavier. Une production époustouflante qui s’explique à travers la collaboration entre cinq excellents musiciens et un magicien du son qu’est Kurt Ballou (Converge). N’oublions pas non plus le remarquable travail de mastering fait par Alan Douches. Si vous ne l’avez pas compris, vous êtes en présence d’un son qui respire l’Amérique.
Dès lors, il est difficile de parler influences, tant elles sont noyées dans la masse de cet opus : Heavy, Sludge, Prog, Hardcore, …. Autant dire qu’on s’éloigne de plus en plus du Stoner pour laisser place à de lointaines inspirations. On pense tout de suite à une musicalité très proche de groupes tels que Korn, Deftones ou encore Sevendust à travers les nombreuses subtilités mélodiques à l’américaine. Prenez le temps de ressentir cela avec « Decision » et « Departure ». Ces deux morceaux forment le noyau dur de l’album à travers des riffs qui savent trancher dans le vif. Bien lents, poignants, des refrains qui restent dans la tête et un gros travail sur les voix : du bon gros Heavy. Néanmoins et paradoxalement, on trouve en position centrale de l’opus « Community » et « Downfall », sans doute les titres les moins charismatiques de l’album, qui semblent ne pas trouver leur place sur cette galette.
Fort heureusement, c’est en domestiquant progressivement Human Collapse qu’on se rend compte que LDDSM a réussi à aller bien plus loin en s’approchant d’une ambiance à la Pink Floyd. On le ressent timidement sur l’introduction « 7PM Choice », peut-être un peu plus sur « Rebirth » avec son ambiance très Prog. Mais c’est surtout la grosse tuerie qu’est « Border » qui nous fait dire ça. A la fois diabolique, pesante mais aussi aérienne, c’est certainement la chanson la plus originale de toute la carrière du groupe. On pourrait croire qu’on est face à du Will Haven ou du Refused, puis vers la quatrième minute on se retrouve projeté en 1973 à la manière Dark Side Of The Moon et de la mythique « Time ». En même temps, ne vous détrompez pas, les fantômes de Alice in Chains ou encore Clutch hantent toujours le son des guitares de Nico et Romain. « Determination » et le final « 5PM Arrival » sont d’ailleurs les titres qui se rapprochent le plus de la fabrique musicale antérieure du groupe, mais avec une énergie plus proche du Sludge.
Cet album marque donc un changement radical dans l’univers de LDDSM . Peut-être que pour certains il faudra laisser murir les écoutes progressives afin d’apprécier cet album à sa juste valeur. Il n’empêche que le pari est réussi et qu’on ne peut que saluer toute l’énergie, l’authenticité et la volonté qui a été mise en œuvre dans ce Human Collapse.

En cinq ans et trois albums, les berlinois de Earth Ship avaient tracé une voie bien à eux à travers le monde un peu chaotique et trouble du sludge européen, un genre de plus en plus vaste musicalement (et fourre-tout, disons-le) vers lequel il s’est naturellement dirigé après avoir digéré et synthétisé les tendances doom et post-metal (voire prog) de ses débuts. Le solide Withered, notamment, sorti il y a deux ans chez les discrets Pelagic Records (hôte bienveillant mais méconnu de leurs premiers pas discographiques), avait fait forte impression. Napalm records, qui sait avoir du flair, les a donc signés sur ce postulat, et a sorti cet été le nouvel album du quatuor, Hollowed. Les attentes étaient fortes…
De fait, pas de surprise radicale, Hollowed reprend peu ou prou musicalement là où Withered nous avait laissé, mais le titre introductif, « Reduced To Ashes » éclaire très vite l’intention et la prétention du disque : le Navire de la Terre nous emmène avec cette quatrième galette encore plus loin musicalement que ses prédécesseurs. Pas un mince exploit, de fait. Hollowed délivre en onze morceaux autant de séquences bien distinctes, tapant chacune dans des champs musicaux complexes et variés. Déjà, on sait que la digestion devra se faire lentement car le plat est difficile à avaler d’une seule traite. Et petit à petit, donc, se font jour des influences non pas nouvelles, mais plus prégnantes chez le groupe, à l’image des penchants « grunge classieux » emblématiques de groupes comme Alice In Chains, par exemple, ou les travaux sonores quasi-prog des derniers Mastodon. Mais le combo élargit bel et bien son spectre musical, il ne le déplace pas : les amateurs des débuts y reconnaîtront leurs poulains sans problème ! Cette richesse musicale, bien retranscrite dans une prod lourde et efficace, alimente et justifie des dizaines d’écoutes sans le moindre ennui à l’horizon, des écoutes successives qui mettent petit à petit en lumière des compos solides, différentes, très souvent audacieuses et, au bout du bout, accrocheuses. Le travail mélodique est poussé dans ses retranchements… Pas une mince affaire au vu de la complexité de l’appareil et du genre musical pratiqué ! Un groupe lambda se serait perdu sur la chanson titre ou le très mastodon-ien “Valley Of Thorns”, mais ils assurent sur toute la ligne (riff, structures, mélodies, soli, vocaux …). Au final, chaque titre comporte ses moments de grâce : le riff sur-heavy de “In Fire’s Light”, le très catchy “Red Leaves”, un “Castle of Sorrow” qui invoque tour à tour Entombed et… les vieux Metallica ! Une orgie de compos, et très peu de ratés au compteur.
Bref, on se l’imaginait bien ainsi, donc on ne va pas simuler la surprise : Hollowed est riche et complexe, et c’est un album puissant, qui sur la durée se révèle attachant. Il finit en tous les cas de nous convaincre sur le potentiel de Earth Ship : probablement trop discret médiatiquement et trop lourdement enfoncé dans un metal exigeant, on ne peut pas décemment leur prédire une carrière à la Mastodon. Mais à leur échelle, et dans un genre musical plus fermé, on s’en rapproche un peu, l’air de rien. On en reparlera dans quelques années.

Beastmaker c’est un peu la success story du moment. Venu de Fresno, Californie, soit le néant culturel et artistique à 3 heures de route de Los Angeles, le trio se passionne pour les films de série Z, l’occultisme cheap et le hard rock dans son écrin le plus rétro. Une sorte de réponse américaine à Uncle & The Deadbeats en somme et, malgré une absence totale de références, Alejandro Saldate Jr, John Tucker et Trevor William Church réussissent à intéresser Rise Above Records, sur la base de quelques vidéos et pistes démo. Un album, une tournée Européenne avec Blood Ceremony, puis une autre US avec Monolord (et les indispensables Sweat Lodge) plus tard, les lettres ensanglantées du logo délicieusement désuet de Beastmaker se sont désormais affichées un peu partout. Pourtant, leur première publication, Lusus Naturae, sortie dans le flot de 2016 aura mis du temps pour atteindre mes oreilles. Il faudra du temps désormais, c’est une certitude, pour l’en déloger.
Par bien des aspects, Beastmaker peut être associé à la vague rétro/occult rock qui sévit ces temps-ci. Lusus Naturae suinte par tout les pores de ces références désuètes, de ce son anachronique, réussissant, en un sens, à créer un pont entre la mélasse doomy d’Electric Wizard et le son horror-pop d’Uncle Acid. Un poil primitif donc, Beastmaker assène son doom à haute teneur en T.H.C. à grand renfort de riffs plombés, bénéficiant toutefois de la voix de Church pour éclaircir son propos. Les titres s’enchainent sans troubler l’écoute et si bien sûr l’inspiration des aînés se fait souvent sentir, quelques véritables moments de bravoure suffisent à hisser le disque sur la bonne pente, celle des albums qui véhiculent le cool : j’en veux pour preuve « Find The Stranger », dont la ligne vocale sur le refrain, obsédante, n’a toujours pas fini de revenir inlassablement me hanter jour et nuit (si quelqu’un arrive à me dire pourquoi elle ne m’est pas étrangère, je suis preneur). Émaillé tout du long de titres entêtants, souvent pertinent, quoiqu’un peu long, le premier album de Beastmaker démontre avec brio qu’il y a un avenir dans la musique, même pour trois freaks de Fresno, CA.
Point vinyle :
Rise Above propose la galette en Die Hard (150 copies, avec 7’ et patch inclus. Autant vous dire qu’ils sont sold-out depuis longtemps), en rouge (500 ex), en violet (500 exemplaires), en blanc (189 pressés) et pour finir en vert sur la tournée du groupe (406 disques disponibles en cette couleur).

Lee Dorrian est un mec fidèle. Aux prémisses de Rise Above et de Cathedral, les deux grands amours de sa vie (considérant, pour d’évidentes raisons, que Napalm Death a plus des allures d’éjaculation précoce dans les toilettes d’un bar), il y avait Penance, quintet doom, relativement en avance sur son temps dont les têtes pensantes, Brian Lawrence et Mike Smail était également aux commandes chez Dream Death. Penance est l’une des premières publications du label, appelle à devenir mythique et a partagé, en 1993, avec Cathedral une tournée mémorable à laquelle Sleep avait également pris part pour ce qui devait être leurs seules apparitions européennes (avant reformation donc). C’est donc par fidélité, deux décennies plus tard que Dorrian offre à Dream Death, formation oubliée, l’exposition que procure Rise Above par le truchement de la sortie de Dissemination, album de heavy metal aux accents hardcore, n’ayant que peu a voir avec le reste du catalogue.
Il faut dire que l’on était un peu sans nouvelles du groupe de Pittsburg. Depuis leur classique Journey Into Mystery en 1987, deux albums certes mais passés complètement inaperçus. Somnium Excessum en 2013 n’avait même pas trouvé de label à l’époque pour le publier. A l’écoute de Dissemination, il apparaît pourtant que cette situation n’aurait pas dû évoluer. En effet la musique de Dream Death revendique d’excellentes références (Celtic Frost, Angel Witch) et tartine son heavy sous stéroïde de quelques relents hardcore comme… Et bien comme des centaines de formations finalement. Alors pour quelques moments intéressants (le morceau titre, Dominion et son thrash sans concession), le reste de l’album nous plonge dans un ennui certain, voire dans une gène profonde (« Crawling »).
A y regarder de plus près, Dream Death souffre principalement d’une erreur d’aiguillage, n’ayant que peu à voir avec ce que propose Rise Above habituellement. Fans d’Uncle Acid & The Deadbeats s’abstenir, le choc pourrait être fatal.
Point Vinyle :
150 lps en clear, 200 en red, 500 en Purple plus quelques cartons en black standard. Ca va en faire du stock chez Rise Above !
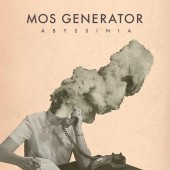
« Pourquoi changer une formule qui fonctionne ? », « C’est dans les vieux pots qu’on n’apprend pas à un singe à faire la grimace », « Mais qu’est-ce que t’as fais des tuyaux ? » car voici que déroule Abyssinia le nouveau Mos Generator édité chez Listenable Records et travaillé dans le même pétrin que son prédécesseur, « Electric Moutain Majesty ». Rien de neuf sous le soleil donc, on reste dans l’efficace et le ciselé, l’énergie rock et le savoir-faire (CtrlC/CtrlV) question saintes écritures et reliques 70s.
On se retrouve donc plongé dans un melting-pot d’influences un peu passéistes, un peu psychés, un peu pop (trop?) et finalement, difficilement acceptable et immersif. On traverse l’album de manière pataude et sans réel intérêt. Le trio joue son southern rock depuis 16 ans déjà et l’on sent l’envie de recherche et de s’amuser derrière chaque compo de l’album. Mais à trop vouloir faire on se retrouve avec un disque sans réelle identité. Connaissant les gonzes on ne peut douter de la sincérité de la démarche mais le compte n’y est pas.
A dire le vrai, le paysage actuel est tellement embourbé dans son revival 70s que sortir du lot n’est pas chose aisée. Reste qu’en recentrant le débat, Mos Generator pourrait avoir de sérieux arguments à faire valoir. Il suffit d’écouter le morceau de clôture « Outlander » pour s’en convaincre, ou le début de « There’s no return from nowhere ». A mon sens une volonté sombre et folk sied plus aux américains que leurs expérimentations acides et pop/psychées.
La facture technique de l’album est bonne, on est toujours attaché à la bonhomie du trio mais Abyssinia ne restera pas dans les annales. Une semi-déception donc quand on connaît les qualités du combo. On ne doute pas que ce dernier saura rebondir, ré-affirmant son identité en clarifiant le parti-pris de ses lignes esthétiques.

En direct de la belle Aquitaine, le groupe The Twin Stoners s’invite à la fête avec un deuxième EP s’intitulant sobrement II. Histoire de ne pas perdre l’auditeur, vous serez prévenus qu’il s’agit bien d’un Stoner sans artifice ou dénivelé stylistique à la simple prise de connaissance du fil d’actualité facebook du duo. En effet, on parle bien d’un duo guitare/chant et batterie : simple, efficace et tellement plus pratique quand on décide de faire la tournée des clubs et bars de France !
Avec ce deuxième EP, les comparses de Capbreton proposent cinq titres relativement homogènes. On ressent tout de suite la principale influence musicale qui n’est autre que QOTSA. Il suffit de se mettre « Desert » ou bien encore « White Glove Lady » qui suffisent à ressentir cette grosse inspiration à la voix ou encore à la guitare. Ainsi, on est plongé direct dans les années 1990 à la façon « Avon ». Puis, on a de charmantes prises de risques qui pointent le bout de leur nez avec « Gambade (jeune loup) », morceau chanté en français s’il vous plait, et, ça marche super bien ! Donc un grand bravo pour cette réussite d’intégration de la langue de Molière dans un univers clairement shakespearien. Enfin, n’oublions pas de toucher quelques mots sur la prestance rythmique qu’on peut féliciter aussi puisque ici, il n’y a pas de lignes de basses et la batterie doit se charger de tout : on s’en rendra surtout compte avec le dernier titre « Son of the sun ». Puis l’EP se termine sur une touche métallique où quelqu’un prend un certain plaisir à jouer de la barre de fer ou autre pour laisser place à une simple et très courte chanson acoustique.
The Twin Stoners propose donc un très bon EP qui est à la fois énergique et inspiré. Peu de surprise ou de révolutions sonores, mais un opus qui ne triche pas. On attend la suite maintenant.
|
|