Voilà l’exemple type de la plaque qui provoque une grosse turgescence aux inconditionnels du desert rock en provenance directe de son berceau originel californien rien qu’en lisant le blaze des types qui ont engendré cette plaque ! Vous voulez des noms ? Gary Arce à la gratte, Mario Lalli qui vient filer un coup de main sur un titre et Scott Reeder sur un autre. Excusez du peu, mais c’est le genre de pedigree qui rigole pas.
Mais cette nouvelle formation ne s’arrête pas à ça puisque Yawning Sons est un peu la fusion de deux entités actives de part et d’autre de l’Océan Atlantique avec à ma droite une portion de Yawning Man et à ma gauche l’intégralité du combo britannique Sons Of Alpha Centauri. Alors là j’imagine déjà les sourires narquois qui naissent sur le visage de certains lecteurs qui se disent que Gary Arce nous enfile son nouveau délire après Yawning Man et Ten East qui faisait aussi pas mal le job sur le papier et qui les a laissé sur leur faim à l’écoute de leurs galettes respectives.
Et bien rassurez-vous braves gens ! J’avais à peu près la même appréhension en abordant ce nouveau phénomène stoner très orienté vers l’instrumental. Appréhension qui s’est rapidement estompée à l’écoute de ce skeud qui ne se résume pas à la nouvelle escroquerie du guitariste étasunien. Bon, autant l’avouer de suite : ‘Ceremony To The Sunset’ n’est pas l’album de l’année, mais c’est une production qui dépasse de la tête et des épaules ‘Extraterrestrial Highway’ et ‘Rock Formations’ !
Les ambiances chaudes et désertiques prennent rapidement le pas sur les plans slide influencés par Dick Dale dont ‘Tomahawk Watercress’ et ‘Wetlands’ sont les seul représentants parmi les sept nouvelles compositions alignées sur ce premier effort. Ces plages qui sentent un peu le réchauffé de la part d’un des gratteux de la bande ont néanmoins le mérite d’être spécialement bien foutue pour des morceaux de ce registre (ce qui n’a pas toujours été le cas si l’on considère la discographie de certains des artistes ayant collaboré à cet album, mais on ne va pas trop s’étendre non plus et on va passer aux choses positives que recèle ce cd).
En ouverture, les Yawning juniors balancent leur titre le plus long : ‘Ghostship, Deadwater’ qui est constitué de plus de huit minutes de guitares aériennes et presque lancinantes soutenues par une rythmique au tempo ralenti qui sont mixées de manière à laisser les parties vocales s’insérer avec maestria sur la seconde partie du titre. Ce petit plus vocal atmosphérique amène une dynamique fort agréable à l’écoute et il brise un peu le style déjà-vu au rayon instrumental. Ça commence vraiment bien me dis-je à moi-même ! Ensuite on se tape dans la foulée les deux titres qui se rapprochent des Yawning seniors avant que ces grosses pointures de la scène stoner balancent à mi-disque un ovni à base de nappes synthétiques qui fait bien le job dans le style interlude post tout.
Passé les presque trois minutes de plan aérien, la formation sort de ses tiroirs Le Titre de l’album : ‘Meadows’ sur lequel Mario vient pousser la chansonnette et c’est le délire ou presque sur ma platine. C’est plein de volutes, on croirait Orquesta Del Desierto ! Après cette excellente surprise on embraye sur ‘Garden Sessions III’ qui mixe les influences seventies et les rythmiques tribales au son du désert et aux plans des Pink Floyd qui datent (pas les récents efforts sous forme de trio). Un peu déconcertant à la première approche, cette plage convainc assez rapidement avec les vocaux de Scott Reeder et les roulements de bongos ; ça doit être ça le talent.
Pour finir, ‘Japanese Garden’ explore un univers à base de sonorités nippones et de slides. Très vite entêtante dans le bon sens du terme, cette expérimentation novatrice est à l’image de cet album qui est bourré de qualités sur le plan musical et qui prouve que ceux dont les narquois se sont ris en abordant cette chronique sont capables de renouveler un style qu’ils avaient déjà éprouvés par le passé avec brio.
Les inconditionnels des formations citées plus haut peuvent y aller les yeux fermés et les autres se dispenseront en ces temps de crise où un sous est un sous ! Pour ceux qui se donneront la peine de claquer quelques thunes gagnées à la sueur de leurs fronts, il y aura le plaisir de humer l’entêtant encre d’imprimerie qui a permit la confection d’un livret de qualité regroupant des photos soignées des géniteurs de cette production dont le côté pas bourrin de moi-même attend la suite !
|
||||||||||||||||
 Plus consensuels qu’à l’accoutumé en ce qui concerne l’aspect graphique de l’objet, Gluecifer n’a rien changé au propos musicalement parlant. Cette nouvelle pierre ajoutée à l’édifice rock de ces Norvégiens est un concentré d’énergie rock’n’rollienne brut de décoffrage, sobre mais terriblement efficace. Pour vous faire une idée de ce que peut être ‘Automatic Truth’ il vous faut imaginer le croisement improbable d’Ac/dc pour les riffs de guitares, des Ramones pour le côté binaire, de Jerry Lee Lewis pour les parties claviers endiablées qui jalonnent cette production, des Rolling Stones du début pour le côté rock simple mais efficace et des Stooges pour l’urgence. Si la formule vous tente plongez-vous sur ‘Shaking So Bab’ qui est à mes yeux le meilleur morceau de ce disque de pur rock.  Des Allemands qui s’accaparent un jeu de mots tiré d’une légendaire marque de motos italiennes, c’est pas tous les jours qu’on en rencontre. Ca démarre sur une suite de contre-temps pour embrayer sur un riff bien envoyé et un refrain peut-être un peu trop évident. Le son des grattes est un peu light mais largement compensé par la dynamique appréciable des gratteux qui possèdent une belle attaque. La voix est très correct sans pour autant être spécialement typée, un peu le genre de voix qui remplit bien son rôle et le spectre sonore mais ne vous laisse pas un souvenir indélébile. Tout est bien en place sur cette plaque de 14 plages mais on pourrait obtenir plus de patate si le son – surtout son grain – était plus gros. On pense aisément à un Orange Goblin amaigri avec certes beaucoup de finesse mais un je-ne-sais-quoi qui manque au niveau du final pour y apposer sa marque de fabrique au fer rouge et transporter l’auditeur. Il convient néanmoins de souligner que les musicos sont très bien coordonnés entre eux et que leur homogénéité est une qualité indéniable de cet album. Mondo Guzzi culitve également les nuances et alterne les tempos avec aisance. Une section rythmique parfaitement en place assure une base solide à l’ensemble. Il est important de comprendre qu’on n’a pas affaire à des débutants mais bien à des musiciens confirmés. Maintenant que les éléments d’ordre technique sont parfaitement maîtrisés, ce qui serait la cerise sur le gâteau, c’est une plus grande touche de personnalité et un mix plus péchu dans un envoi de guitares sans retenue. Ce groupe mérite d’être suivi.  Alors là… Avant de recevoir ce skeud, jamais je n’avais entendu parler de ce combo. Mais le fait qu’ils sortent sur l’un des labels les plus excitants de toute l’Amérique du Nord pousse forcément à la curiosité… Et bien je suis bluffé. Bluffé parce que même si le groupe est aux antipodes du stoner pur jus que propose généralement cet excellent label, Small Stone arrive à maintenir un niveau de qualité remarquable, et se positionne non plus comme un label “stoner”, mais un label de groupes. Des groupes excitants, tout simplement, au même titre qu’un Five Horse Johnson, un Puny Human, un Dixie Witch ou un Erik Larson. Comme ces derniers groupes, Honky se positionne avant tout par son talent, mais aussi son style très lié à son enracinement géographique. Car Honky est texan. Et ça ne se voit pas qu’à la pochette du skeud ou au nom de l’album, naïvement groivois : dès les premiers accords de guitare, ça ne fait plus l’ombre d’un doute. Slide à la Raging Slab (“Broken days and endless nights”), choeurs à la Allman Brothers ou Lynyrd Skynyrd (“Love to smoke your weed”), gratte poisseuse mais incisive à la Billy Gibbons / ZZ Top (“Undertaker”), tous les ingrédients sont là, sans jamais être plagiaires. C’est donc bien du stoner sudiste qui nous rince les esgourdes, sans hésitation possible. Un peu comme les collègues de Dixie Witch, mais encore plus… “texan”, si tant est que l’on puisse l’être plus encore ! Honky est un petit joyau dans l’univers trop morne, depuis ce nouveau millénaire, du rock sudiste. Ses travers résolument stoner ne le rendent que plus excitant.  Petite déception que cet album. J’avais bien apprécié le premier album de Duster 69, frondeur, décomplexé et pêchu. Même si on retrouve un peu de ces qualités dans cet album, il n’arrive pas au niveau de son prédécesseur, par un excès de “sérieux”, sans doute ? Le plus décevant revient directement au son de l’album. Franchement, certains titres pourraient être tirés de la démo merdique enregistrée sur le 4 pistes d’un groupe de metal amateur au rabais. Témoin les beuglements du refrain de “My brother” et le son de guitare freluquet, limite punkoïde qui l’accompagne. Le son de batterie sur “Upcoming” rappelle celui de Lars Ulrich sur le St Anger de Metallica (ce n’est pas un compliment), et l’intro de “Nighttrain”, avec son chant clair fluet, n’apporte rien de plus glorieux. Pourtant l’équipe de production (le batteur Peter d’abord, et Tobbe Bovik de The Awesome Machine au mixage) n’avait pas démérité jusqu’ici, mais là, les choix sont mauvais, tout simplement. Plus étrange, l’intro de “Personal navigator” sonne comme une intro de Danzig ! C’est très drôle, sérieusement, je vous encourage à l’écouter ! Tout comme “Velvet mind” aurait pu sans problème figurer sur un album de Life Of Agony (tant bien qu’on croirait un hommage !). Parfois, des éclairs de fulgurance heavy traversent ce skeud, reconnaissons-le (“Velvet mind” est bien foutu, comme “Disappear”). Mais au final, on retient une prod qui ne parvient pas à relever les chansons, faisant que cette dizaine de compos sympathiques aurait pu être un bon disque de gros heavy rock bien cintré, la révélation d’un groupe en devenir, alors qu’il n’est finalement qu’un disque de plus dans sa carrière, et pas le meilleur. Dommage. 3 ans après Blind, Corrosion of Conformity est au sommet de son art avec le magistral Deliverance. Exit Karl Agell et son potentiel vocal très limité (même si j’adore un morceau comme ‘Mine are the Eyes of God’). Place aux vocaux de Pepper Keenan (Down), guitariste du groupe depuis Blind, et bien plus charismatique que son prédécesseur. Et retour gagnant de Mike Dean, le bassiste fou, après une pause de quelques années. Et c’est sans doute de ces 2 lascars que vient cette Deliverance salvatrice pour nos compères de COC. Car si Woody Weatherman et Reed Mullin sont les leaders historiques du combo, Pepper Keenan s’impose comme un véritable meneur (crédité sur 12 des 14 titres de l’album) et Mike Dean apporte cette petite touche de folie qui manquait au groupe pour enfin décoller.Du coup, on se délecte de bout en bout de ce nouvel opus, bien plus accessible tant les compositions sont simples et directes. Chaque riff est une pure merveille, de Heaven’s Not Overflowing’ au furieux ‘My Grain’, en passant par les sublimes ‘Clean my Wounds’ et ‘Broken Man’. Idem pour les interludes instrumentaux (‘Without Wings’, ‘Mano de Mono’) qui permettent à l’auditeur une brève respiration avant de repartir en apnée pour 3 ou 4 titres de rock comme on l’aime. Et quand COC s’écarte des sentiers battus pour nous livrer des compos décalés, il met toujours dans le mille. J’en veut pour preuve le très calme ‘Shelter’ (chapeau Monsieur Keenan) et le très groovy ‘Deliverance’ sur lequel Mike Dean pousse la chansonnette. Au fil des ans, COC a su se créer une identité musicale à part dans le monde du rock, et Deliverance est sans doute le meilleur moyen de se familiariser avec l’univers du Combo américain.  Kinch et Shard nous viennent d’Allemagne. Les premiers nous proposent six titres contre quatre pour les seconds. Le combat est d’emblée inégal. Kinch assène le premier coup. Les choses sont claires : ils sont dopés au Kyuss, substance qui fait actuellement fureur Outre-Rhin. Soit du groove rock bien exécuté, avec le son et tout. Vraiment agréable. Leur point fort : le chant. Loin de l’amigo Garcia, le freund Haris dispose d’un organe vocal réellement intéressant. Une voix de tête (de nez ?) assez particulière, mélodique et puissante qui confère sa part d’originalité à l’ensemble. Pourtant c’est « Cadu », morceau instrumental que je préfère. Allez comprendre. Mais déjà Shard entre en scène et frappe. A la basse on retrouve un certain Sascha. Est-ce le même qui officia il y a quelques années dans un groupe fabuleux du nom de Nonoyesno ? Auquel cas le combat redevient plus équilibré au privilège de l’expérience. Mais bon sang. Eux aussi sont dopés. Au Fu Manchu pour ce qui les concerne. Au troisième morceau, changement de produit, ils optent pour du Hellacopters. Ça frappe vite. Kinch est à leur portée. Ils essaient de les achever par une manchette rock’n’roll mid-tempo. Le coup part, mais non, Kinch se relève. La timbale retentit, le combat est fini. Les adversaires se regardent dans les yeux en attendant le verdict de l’arbitre : ex-aequo. Un vrai Jacques Martin cet arbitre.  Au dos de la pochette de cet album, on trouve cette phrase : « Of course Bury Me In Smoke is a DOWN song. We love it. We recorded this song in our way only to send our respect to the band. Hail to them !. En ces temps de recyclage intense où le moindre groupe revendique fièrement un style unique tout en admettant quelques influences incontournables, cette déclaration teintée de naïveté séduit par son honnêteté. Et effectivement, à l’écoute de ce deuxième album, on songe immédiatement à la scène de la Nouvelle Orléans et plus particulièrement à deux de ces membres les plus éminents, C.O.C. et Down. Le choix des hongrois de Stereochrist est osé au vu de la reconnaissance dont disposent les deux groupes précités et on pourrait même penser que l’idée d’aller se frotter à de tels monstres sacrés a quelque chose de suicidaire, la comparaison ayant de fortes chances de pencher en faveur des américains. Mais alors que le premier effort de ce groupe composé pour moitié d’anciens membres de Mood, groupe de Doom traditionnel culte (c’est-à-dire uniquement connu et apprécié des spécialistes du genre), laissait un peu sur sa faim malgré des qualités indéniables, ce Live Like A Man (Die As A God) propulse le groupe dans la catégorie supérieure et tous ceux pour qui Nola, l’album, demeure un monument inégalable risquent bien d’y trouver leur compte. Une des raisons de l’énorme progression réalisée entre ces deux sorties réside dans le changement de personnel, Stereochrist s’étant adjoint les services d’un nouveau batteur qui alourdit considérablement la rythmique mais surtout d’un nouveau chanteur en la personne de Dávid Makó dont l’aisance et la puissance vocale constitue l’un des atouts essentiels de l’album. Cette voix vient offrir un contrepoint mélodique parfait au riffs féroces de Kolos Hegyi dont l’inspiration semble illimitée. Enchaînant leads immédiatement mémorisables, breaks percutants et solos toujours pertinents, le guitariste ne se laisse jamais aller à la facilité, truffant les morceaux d’idées qui font mouche. Le refus de la facilité est d’ailleurs l’un des autres atouts de cet album bourré d’arrangements, chaque morceau ayant été peaufiné dans les moindres détails bien que toujours basé sur un riff efficace. Il n’y a pas de travail bâclé ici et bien que Stereochrist évoque fortement Down, on est très loin du vulgaire repiquage de plans. On évoquera plutôt une démarche commune consistant à mêler l’aspect mélodique des groupes heavy 70’s à la puissance du thrash de la fin des 90’s et la lourdeur du doom, le résultat offrant une musique tournée vers le passé mais jamais passéiste, définitivement moderne dans le traitement du son, énorme de bout en bout. Un dernier mot sur cette version fidèle de Bury Me In Smoke placée judicieusement en fin d’album, exercice casse-gueule réussit haut la main que Stereochrist parvient sans problème à s’approprier, à tel point qu’on en oublierait presque qu’il s’agit d’une reprise.  Déjà le patronyme du groupe met la puce à l’oreille. Au bout de quelques minutes, on réalise qu’au-delà de l’intention, c’est plus un soucis de transparence qui a amené le quatuor instrumental teuton à choisir son nom : “Massif” est même euphémistique pour décrire leur son. Evoluant donc simplement à la force de ses instruments (!?), Omega Massif bastonne copieusement au gré de 6 titres gorgés de riffs gras du bide, de gratte lead criarde, sur fond de basse obèse. Là où d’aucuns se laisseraient engoncer dans une mécanique instrumentale trop bien huilée (un gros riff qui tourne 2 minutes, quelques soli, 2 breaks, et on passe à la plage suivante), les 4 massifs construisent des morceaux longs, parfois épiques, qui posent une ambiance en même temps qu’ils labourent les tympans. L’approche du groupe n’est pas transcendentale d’originalité en soit : si vous aimez Pelican (similitude accentuée par le côté instru), Isis et les groupes du même acabit (vous savez, de ceux dont le genre musical hérite de noms commençant par “post-quelque chose” dans les mags de musique de djeunz), Omega Massif est fait pour vous ; et quand comme moi ça fait belle lurette que vous n’aimez plus ce que font ces groupes, vous aimerez sans doute quand même Omega Massif. Parce que c’est carré, que ça défourraille bien, que ça s’écoute d’une traite (après 2-3 écoutes un peu rêches), que c’est bien composé, et globalement, parce que l’intention est bonne. On pourra en revanche reprocher (ou apprécier, c’est selon) quelques astuces de prod qui apportent peu (l’accordéon, les bruitages) et ont déjà été entendus mille fois dans d’autres skeuds de genres proches (instru ou pas). Au final, une bonne surprise, et une acquisition intéressante pour quiconque aime se faire vendanger les oreilles à grands coups de lattes.  Voilà un album que l’on attendait avec impatience ! Il y a un an, les canadiens de Sea Of Green nous sortaient un mini album rempli de bonnes choses, du bon stoner rock des familles, tendance heavy et mélodique, avec quelques relents doomesques pour faire bonne mesure. Les compos accrocheuses, le son énorme, tout indiquait un groupe ultra-prometteur. C’est donc avec une (très) légère déception que nous avons accueilli cet album. Mettons les choses au clair tout de suite : c’est un excellent disque, aucun doute là-dessus. Toutefois, on pouvait s’attendre à mieux. Il semble que le groupe n’ait pas beaucoup évolué depuis son dernier mini-album, et, justement, semble stagner musicalement. Autant sur six morceaux, la musique était vraiment accrocheuse, autant sur douze ça devient à peine un peu répétitif. Le trio canadien se complait peut-être un peu trop dans les morceaux mid tempo pour vraiment parvenir à faire ‘monter la sauce’ comme il le faisait sur ce mini-album. ‘Time To Fly’ est néanmoins un excellent album de stoner, le son de guitare notamment est énorme, les riffs catchy, le chant très caractéristique, les grooves de batterie judicieux et la musique carrée bien comme il faut. C’est déjà si rare de nos jours, qu’on aurait quand même tort de s’en priver.  Voici le grand retour d’un guitariste injustement négligé : Victor Griffin, membre fondateur de Death Row, puis du Pentagram des années 80. On est d’abord frappé par la qualité du son de guitare. Ample et chaleureux. Carrément prodigieux. Que l’on se rassure, le traitement est équivalent pour les autres instruments. Du feu ! Ardent et rutilant. Voilà du true heavy doom à l’ancienne (mais d’aujourd’hui). On navigue clairement dans un périmètre allant de Black Sabbath, Pentagram, The Obsessed, Spirit Caravan et Serpent. Autant dire un mouchoir de poche droite. Perpétuer une tradition is not a crime. Au contraire, c’est plutôt rassurant. On à ses petits repères, on jouit sans effort. Ce n’est pas forcément ce qu’il y a de plus excitant, mais cela continue de faire bander. Valeur sûre et plaisir bourgeois. Safe sex. Telle est la morale de ce disque. Le nouvel album du groupe « With vision » est annoncé pour le mois de juillet. De plus, l’immense Scott « Wino » Weinrich fait désormais partie du groupe. Nouvelle qui vaut très largement son pesant de gingembre.  Troisième livraison pour le Delta 72 qui signe là le plus bel objet de ce premier semestre 2000. Je les avais trouvé catalogué comme un groupe pas mal jusque là. Sans plus. Et voilà qu’arrive ce « 000 » qui se retrouve propulsé dans mon top 10 de l’année. Transcendant. Ça commence très fort avec « Are you ready ? », chanson et question à la fois très bien formulée. Pour l’approfondir quelque peu, je la poserai de la manière suivante : le fan de stoner rock, avide de guitares gorgées de fuzz et de rythmes lents et lourds, peut-il aimer ce disque ? Oui. Trois fois oui. Car ce sont des racines dont il est question ici. De rock’n’roll, rien moins. Du rock’n’roll qui balance bougrement. Amplis Vox, wah-wah, orgue Hammond, batterie chaleureuse et sautillante, congas, vocaux masculins, tantôt à la Mick Jagger, tantôt à la James Brown, chœurs féminins. Bref, tout l’attirail de l’orchestre de rock qui se la donne. Et ça swingue et ça groove grave ! C’est beau. Ça transpire. C’est inspiré. C’est influencé aussi. Et pas par n’importe qui. Par la musique noire de la moitié des années 60, la plus torride. Par le rhythm’n’blues sauvage de la même époque. Mais pas seulement. Ecoutez ce break de bossa sur « Incident @ 23rd ». De quoi laisser tomber l’appartement loué à Argeles-sur-Mer, pour partir en cargo direction Rio de Janeiro dans le quart d’heure. Ecoutez ces chœurs sur « I feel fine ». A prendre un bain moussant dans sa douche en chantant à tue-tête. Les enchevêtrements de voix vous dynamisent, non, vous dynamitent pour la journée. Puis c’est à un break de slide guitar sur « Hip Coat » de vous dérégler la thyroïde. Alors qu’il était lui-même déjà introduit par un riff zeppelinien à en faire frissonner la peau des couilles. Oui, ce disque est d’une richesse inouïe. Le sens du mot variété prend ici tout son sens. Débarrassé de ses scories pour nous livrer ce qu’il a de plus beau : 1. dérouter, 2. faire vibrer. Il y a du monde pour cela. Et du beau. Sont convoqués les plus grands noms du rock’n’roll de la fin des sixties. Des Rolling Stones à Ike and Tina, de James Brown aux Who en passant par Led Zeppelin et Aretha Franklin. Ce disque est une merveille. Un peu comme le fut le disque des Big Chief avec Thornetta Davis. Fan de stoner rock, cette musique tu aimeras.  Wow ! Une veritable orgie stoner que cet album ! Une fois passée le premier effet de surprise, il suffit de s’attarder quelques secondes sur la liste des musiciens pour mieux comprendre : on y retrouve pêle-mêle des membres de Dozer, Demon Cleaner, Lowrider, etc… Soit les fines gâchettes du stoner rock actuel, une sorte de dream team, tout simplement ! Alors évidemment, on ne peut pas se tromper sur la qualité de cet album : même s’il ne révolutionne absolument pas le genre, il représente ce qui se fait certainement de mieux dans cette ‘veine’ spécifique du stoner, à savoir la section la plus ‘classique’ du genre, la plus traditionnelle aussi, mais en aucun cas ni la moins intéressante ni la moins excitante, bien au contraire, et cet album en est la preuve ! Restant perpétuellement dans les limites balisées du ‘genre’, Greenleaf s’épanouit et nous livre une rondelle remplie jusqu’à la gueule de soli épiques, de nappes de claviers typiques seventies, de basse ronflante, de passages instrumentaux et de grattes heavy. Ainsi, hors du temps mais surtout pas ni démodé ni passéiste, Greenleaf propose un échantillon de ce qui se fait de mieux dans le stoner le plus conventionnel, tout en participant à donner ses lettres de noblesse au genre. Excellent. 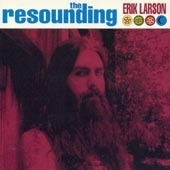 Erik Larson n’est autre que le guitariste des furieux Alabama Thunderpussy, et cet album est bien l’œuvre d’un véritable artisan-riffeur. Plus encore que cela, “The Resounding” regorge de chansons, de compositions remarquables, que le barbu gratteux (aussi batteur et chanteur sur l’album) a mûri pendant cinq longues années avant de les poser, parfaitement finies, sur vinyle. Des chansons de tous genres d’ailleurs, allant du gros metal stonerien (typique des Alabama Thunderpussy, “Rede”, “Scoliosis”) aux balades acoustiques poignantes (“Make it”, “Of storms”, “Unresolved”), en passant par quelques passages rock, hard, boogie, souvent teintés de chaleureuses sonorités sudistes et empreints de gros rock 70’s. Au final, ce disque est délectable, il se déguste de bout en bout sans jamais s’en lasser, il est empreint de sincérité et de passion (même les paroles sont intéressantes), et cela se sent à chaque seconde. Composé de vétérans de la scène rock genevoise ayant déjà œuvrés au sein de Last Torridas, Prejudice, Forge, Fragment ainsi que de Seaplane Harbor, ce quatuor puissant et inventif se situe quelque part dans la grande galaxie communément qualifiée de stoner. C’est sur un label permanent de l’Usine de Genève : Urgence Disk Records que ces quatre jeunes gens d’horizons musicaux différents ont décidé de graver leur première trace dans le sillon. A l’image du visuel apposé sur la galette qui va 20 à 200 MPH (Macadam Pale Horses, notez ici que ces gens-là sont plein d’humour) ce disque évite les plans redondants et propose 9 compos variées dans un style furieusement rock’n’roll.Allant de morceaux menées tambour battant dans la plus pure tradition de formation comme Isis à l’image de ‘At the rate of the medusa’ où les parties vocales se posent non pas comme un chant, mais comme un instrument supplémentaire et complémentaire au trio basse-guitare- batterie, à des morceaux plus aériens comme ‘J’embrasserai ta plaie’ dans un style proche des français de La Chair mais tout en restant nettement plus rock’n’roll, ce groupe se joue des frontières linguistiques en utilisant tour à tour le français en l’anglais pour déclamer ses textes introspectifs et poétiques. Les paroles n’étant pas un des points les plus forts des formations dont nous traitons en ces pages, leur verbe apparaît comme une bouffée d’air vivifiante et ces helvètes font donc partie des rares formations à avoir des textes qui font du sens. Les backings féminins de Barbara apportent aussi une bouffée rafraîchissante dans cet univers trusté par des vocalistes masculins. |
||||||||||||||||
|
Copyright © 2004-2026 - Tous droits réservés |
||||||||||||||||




