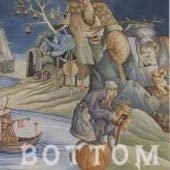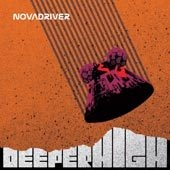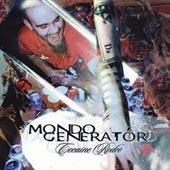|
|
Eddie Glass et Ruben Romano ont quitté le navire (et ont formé Nebula, excusez du peu). Bob Balch et Brant Bjork (ex-Kyuss) arrivent dans le groupe.
50% du line up vient donc de changer et l’album précédent était, à mon sens, une semi réussite. De là à dire que Fu Manchu avait au moment d’entrer en studio une jolie pression sur les épaules.
Bien que commençant avec un titre à la construction typique du répertoire du groupe et laissant augurer un album trop semblable au précédent, The Action Is Go est bien plus varié et au combien plus intéressant que In Search Of. Burning Road par exemple est un titre très plaisant et nous laisse entrevoir une facette du groupe jusque là peu exploitée. Tout comme sur Trackside Hoax, le groupe semble presque imperceptiblement vouloir tester, expérimenter et découvrir de nouveaux sons, une nouvelle façon d’aborder l’écriture et la construction d’un morceau. Faut il y voir une corrélation avec le départ d’Eddie Glass, je ne vais pas me lancer dans ce débat. Mais un titre comme Grandel, Snowman aurait il pu être enregistré par le groupe avant ? Je n’ai pas véritablement la réponse mais si je pose la question c’est que j’ai tout de même ma petite idée là-dessus.
Evidemment, la marque de fabrique du groupe est encore bien présente, et avouons que même si on a tendance à se plaindre d’une certaine répétition, un bon gros riff « fumanchesque » ça fait du bien quand même et Evil Eye en est d’ailleurs le meilleur exemple. D’ailleurs les premiers titres de cet album ne vous dépayseront pas, comme si le groupe avait une crainte viscérale de surprendre et un instinct de conservation d’un modèle pas forcément dépassé mais sûrement un peu usé. Mais si vous poussez l’écouter jusqu’au bout des quatorze titres, alors vous ne pourrez pas être déçu, en tout cas c’est mon cas !
Au final, après une très forte déception engendrée par In Search Of, Fu Manchu aura su se remettre en question et nous pondre un bon album et aussi indirectement participer à la création d’un autre groupe incontournable (Nebula pour ceux qui n’ont pas suivi) et ça c’est déjà pas mal, non ?
Bottom est à ce jour l’un des derniers vestiges de “l’empire” Man’s Ruin… J’entends par là qu’il s’agit d’un des derniers groupes qui évolue encore dans cette veine de stoner bien caractéristique du label de Frank Kozik, où les groupes étaient entièrement libres de ce qu’ils souhaitaient mettre sur leur disque : pas de contrainte d’un certain type de compos, on n’hésitait pas à faire traîner des morceaux en longueur si l’ambiance le justifiait, on mixait le tout au feeling, et on sortait des disques “authentiques”, bruts de décoffrage, mais tellement sincères…
Et bien “You’rNext” c’est exactement ça : le trio de jeunes femmes s’est enfermé 4 jours dans un studio de San Francisco et a enfanté cette galette ovni, ce disque qui défie les lois de l’espace-temps.
La musique, c’est du pur stoner, des grattes graisseuses et accordées plusieurs tons plus bas, une basse vrombissante (vous savez, du genre à faire grésiller vos haut parleurs – pourtant plutôt performants dans les basses fréquences !), de longs passages qui peuvent paraître improvisés, mais que l’on sent “hantés”, avec des musiciennes en état second derrière leurs instruments (“Distordo II”), des envolées de cymbales sur des tempos lents et lancinants, mais aussi de vraies chansons efficaces et accrocheuses (“The Same”)… Une véritable bande son pour un road movie d’outre-tombes, du pur doom “à l’américaine” (peu de points communs avec Cathedral ou Electric Wizard par exemple).
Au final, ce disque se “ressent” (je vous promets, les sons de l’album, à volume “raisonnable”, vous font vibrer “physiquement” !) plus qu’il ne s’écoute… Abrutissant dans le BON sens du terme. Il doit tourner en boucle sur vos platines pour l’apprécier en tant qu’expérience plutôt que simple disque. Certes, c’est un essai expérimental, mais c’est une réussite ! Vraiment un bon disque.
 Si vous allez faire un tour sur le myspace du groupe, vous verrez qu’ils se sont étiquetés “Down-tempo / Psychédélique / Progressif”. Et bien c’est exactement cela!Largement influencés par le son des années 70, clavier en tête, le quintet de Los Angeles y apporte un souffle nouveau, une touche personnelle qui pourrait bien plaire à bon nombre d’entre vous. Hormis les transitions et un morceau ne durant “que” six minutes, on trouve principalement quatre compositions tournant autour du quart d’heure, amateur de punk rock rapide et concis, passez votre chemin. On se laisse donc emporter par des rythmes lents mais pas forcément lourds, bien au contraire. la guitare est tantôt aérienne tantôt à l’état brut avec des envolées d’excellente facture. L’omniprésence de clavier, sonorité 70 incomparable, apporte une touche psychédélique indéniable et bien sentie. La batterie me rappelle là encore les années 60/70 dans ce qu’elles ont de meilleur, des batteurs comme John Bonham ou encore Mitch Mitchell qui sur un canevas de base semblent improviser, ajouter une touche personnelle, un son très live. La basse n’est pas en reste non plus avec un background solide.Bref, vous l’avez deviné, je suis tombé sous le charme.Je ne peux que vous conseiller de visiter leur myspace pour découvrir tout cela, qui sait, vous serez peut être conquis vous aussi.
 Il y a moins de deux ans, Nebula nous collait une baffe mémorable avec son premier ‘véritable’ album, ‘To The Center’. On était donc impatient de savoir ce qu’allait nous proposer le trio californien. Pas de révolution au menu ! Une sorte de ‘confirmation’, plutôt, de tout le bien que l’on pense d’eux : toujours du bon stoner, aux rythmiques enlevées (ou plus lentes parfois : on retrouve aussi une petite poignée de mid-tempos sur l’album), au son de guitare énorme, aux solos de Wah-wah, aux vocaux bien accrocheurs, à la basse vrombissante, etc… Pas d’erreur possible, on sent bien l’influence des dissidents de Fu Manchu, sans jamais pourtant trop se rapprocher de leurs potes sud-californiens. Nebula se lance même parfois dans des ‘expérimentations’ plutôt heureuses, une prise de risque qui manque trop souvent aux groupes du genre : la slide guitar sur ‘Travellin’ mans blues’, ou encore de la guitare acoustique sur ‘This one’. Au final, l’album contient bien assez de pépites pour justifier l’achat immédiat, que ce soit pour ‘Giant’, ‘Do it now’ ou encore ‘Ignition’ pour n’en citer que quelques uns. Et dire qu’ils sont encore meilleurs sur scène !
La nouvelle livraison de Clutch met les points sur les “i”. Alors que “Robot hive” leur prédécesseur montrait une variété de tonalités musicales inédites, et une maîtrise remarquable de bout en bout, “From Beale Street To Oblivion” récupère tout ça, mélange le tout, et le rebalance comme un uppercut en pleine gueule ! Comment sinon expliquer le démarrage du disque par deux titres qui ne dépassent pas les 3 minutes ? On se rappelle du début de “Pure Rock Fury”, qui marquait un virage dans la carrière du groupe, le faisant passer d’un combo assez “direct” à un groupe plus posé, à la recherche du riff ultime, du groove céleste, et du jam qui transcende le tout. Nouveau virage, donc, avec ce disque qui, en fait, prend le meilleur de leurs derniers albums précédents, et le canalise dans une veine plus directe, plus franche, plus homogène aussi.
Et pourtant, il y en a pour tout le monde ! Si les premiers titres sont plus “In Your Face”, et que “The Devil & Me” sonne comme du Clutch, pur jus, la première “balade”, “White’s ferry”, sonne simplement terriblement juste. Mais c’est avec “Child Of The City” que la bête se réveille et prend son ampleur : ce monstre de morceau ravage tout sur son passage, avec son riff volé aux meilleures heures de ZZ Top, ses passages de slide, d’orgue et d’harmonica orgasmiques, la chanson dégueule de boogie, totalement vicieux. Wow! Clutch s’essaiera d’ailleurs à nouveau à la slide pour un autre grand moment de l’album, “When vegans attack”, aux influences sudistes assumées (le groupe a décidément beaucoup tourné avec Five Horse Johnson). Chacun de ces deux morceaux justifie à lui seul l’achat de l’album. D’autres grands moments sont encore en réserve avec un “Black umbrella” gorgé d’orgues et d’harmonica, aux relents soul discrets et bien sentis.
Les premières écoutes ne font que confirmer que le talent instrumental du quintette (je pense qu’on peut désormais dire que Mick Shauer, l’organiste, fait partie du groupe, et c’est pas volé) est toujours la clé de voûte de la musique de Clutch, renforcée par un sens du riff et du groove poisseux constamment mis en avant. Pas de révolution, donc, de ce côté-là. En revanche on notera l’excellent boulot de Joe Barresi (QOTSA, Tool, Melvins) derrière les manettes, qui apporte une dimension redoutable à la musique du groupe.
Comme une évidence, “From Beale Street” se positionne en synthèse parfaite des 3 derniers albums du groupe, avec un recentrage efficace vers l’essence de Clutch : finies les tentatives country ou blues, Clutch refait parler la poudre, et y met les moyens. Un des meilleurs albums du groupe, peut-être le meilleur. Vous savez ce que ça veut dire.
2007 sera finalement l’année de Ramesses. Après les sorties en 2004 et 2005 de leur 2 ep’s qui, s’ils s’annonçaient prometteurs, nous laissaient un peu sur notre faim, voici enfin venir l’obscure entité, annoncée depuis décembre 2005, « Misanthropic Alchemy ». Si l’attente fut longue, elle ne fut pas inutile.
Après un départ en fanfare qui pourrait nous laisser nous méprendre, rapide, véloce et venimeux, la seconde plage débutant à peine deux minutes après nous fait revenir sur nos pas. Ramesses est toujours ce mastodonte rampant et vicieux.
Avec un son très proche de celui de The Tomb, enregistré au même moment, on retrouve ce déluge de saturation duquel émerge une quantité non négligeable de riffs tétaniques et râpeux, répétés dans une boucle quasi infinie de saturation. Le trio avait expliqué lors d’interview leur façon de composer se résumant à des jams à forte teneur en THC. C’est aujourd’hui une confirmation : l’écoute de Misanthropic Alchemy transpire ce coté aventureux et délétère. Une masse sonique nocive se répandant comme une brume toxique respirant l’occulte, comme l’atteste les samples fréquents de films d’horreur old school des 70’s (les meilleurs donc, simple avis personnel), utilisés plus intelligemment qu’en ouverture de morceaux comme il est souvent coutume, certains revenant même en tant que ‘refrain’ si tant ce terme puisse être employé ici pour décrire ces longs jams hypnotiques et psychotiques.
Cette impression malfaisante est finalement parachevée par la voix gutturale d’Adam Richardson, ajoutant, comme s’il en avait été encore besoin, une touche de malaise supplémentaire.
Misanthropic Alchemy tient au final toutes ses promesses. On nous avait annoncé un album grandiloquent, tenant autant du doom metal le plus insidieux que du rock psychédélique et si toutefois les forces telluriques semblent l’emporter, difficile de trouver une quelconque accroche durant les premières écoutes tant l’essence de la musique se fait insaisissable, les rythmes parfois quasi tribaux de Mark Greening se mélangeant aux riffs acides pour mieux nous noyer.
Ramesses avait besoin de confirmer son potentiel, c’est chose faite avec cet album à la musique plus qu’imagée et de l’écoute de laquelle on ressort avec la vision d’une Angleterre profonde, brumeuse et ésotérique. La parfaite représentation sonore des indicibles horreurs qu’a pu tenter de décrire Lovecraft. Dérangeant.

Après la sortie de California Crossing, Fu Manchu s’embarque pour une longue tournée de promotion qui les emmènera un peu partout sur la planète. Ayant très certainement déjà en tête le projet de sortir leur premier album live à l’issue de cette tournée, le groupe décide d’enregistrer un certain nombre de concerts. Et c’est une compilation de tout cela que l’on retrouve sur Go For It…Live !
Je ne vais pas revenir sur les titres par eux-mêmes car ce n’est pas le but ici, chacun figurant déjà sur un album studio. Par contre, je peux vous dire que c’est du lourd et du bien fourni que nous offre le groupe. Un double album live pour une bonne vingtaine de titres couvrant toute la carrière du groupe. Autant dire que si vous êtes fan vous allez être servi. Les énormes classiques sont là : Hell On Wheels, Asphalt Risin (d’enfer !), Evil Eye etc.…, mais aussi quelques chansons plus anciennes comme Ojo Rojo et bien entendu quelques titres du dernier album studio en date.
Le son, assez puissant, n’ai pas avare de basse et fait ressortir à juste dose la bonne ambiance du public. On voit tout de suite que les moyens ont été mis pour faire quelque chose de qualité. En fait, il ne manque que l’image et on s’y croirait !
La performance est aussi de très bonne facture même si on se doute que seul les enregistrements sans reproche ont été conservés pour ce cd. En ce qui me concerne, le seul défaut de cet album live est qu’il s’agit d’une compilation plutôt que d’un seul concert entier. Détail vous me direz, par forcement je vous répondrai. Le fait d’avoir l’enregistrement d’un seul concert peut apporter une matière plus concrète, plus brute et donc plus réaliste. En même temps, nous n’aurions peut être eu qu’un seul cd à la place des deux. L’échange me semble avantageux au final.
Au final, un double album live que je vous recommande vivement, y compris à ceux qui ont été déçus par les dernières productions studio du groupe.
Quelques années après la sortie de “Sucking the 70’s”, compil jouissive éditée par le label Small Stone, basée sur un concept miraculeux (les chantres du stoner rock ricain se prennent à nous rebalancer leur version des plus grands classiques rock 70’s), voici que déboule le volume 2 de cette mare aux délices.
Pas à tortiller, on a beau renifler le renard dans tous les sens, pour le prix d’un skeud, cette double compil’ remplie jusqu’à la gueule de petites perles vaut sa poignée de biftons. Tout n’est pas génial sur les 31 (!!!) chansons de l’album, mais au final, on compte quand même une ou deux dizaines de pépites. Ca attaque TRES TRES fort avec une triplette purement jouissive : Sasquatch (le “Are you ready” du Grand Funk Railroad), suivis des excellents Puny Human (une reprise des Osmond Bros, groovy à tout casser) puis du “duo” Clutch/Five Horse Johnson, qui rend justice à une reprise funky du standard “Red Hot Mama”. Fin de la plage 3, déja le disque est inattaquable. S’ensuivent plusieurs plages ma foi bien affutées et efficaces, à l’image des groupes qui les reprennent (boogie-rock sudiste pour The Brought Low, gros rock graisseux pour Dixie Witch). Novadriver se fend d’une des deux reprises d’AC/DC de l’album (ici “Sin City”, très fidèle à l’originale, comme “Rock’n’roll singer” par le Glasspack), et laisse Alabama Thunderpussy nous livrer une reprise de Rainbow où leur précédent chanteur nous montrait à quel point il était un bon chanteur de heavy (un peu trop pour rester chez ATP !). L’Europe est bien représentée avec une version super couillue du “Mongoloid” de Devo, par Dozer, et laisse la place à un bon morceau de Acid King, avant un brûlot de Halfway To Gone. Antler et Brad Davis (de Fu Manchu) ne cassent pas trois pattes à un canard, tandis que Whitey Morgan And The Waycross Georgia Farmboys (??!!) balance une hilarante (mais honnête) reprise du “Running with the devil” version country, qui a propulsé au firmament… Van Halen !!
Passage au CD2, à mon sens un peu moins bon, mais qui commence bien avec Throttlerod et leur superbe reprise du “I just wanna make love to you” de Willie Dixon (popularisé par une pub bien connue, mais aussi par son nombre incalculable d’interprètes, de Muddy Waters aux Yardbirds, en passant par les Stones, le Grateful Dead ou Paul Rodgers), puis Red Giant et leur honnête reprise du “Saturday night special” de Skynyrd. Après quelques plages moyennes, Roadsaw se frotte à Led Zep et son “When the levee breaks”, de manière couillue, fidèle et enlevée. Retour à quelques chansons sympa mais sans plus, pour débouler sur nos latinos préférés, j’ai nommé Los Natas, et leur reprise barrée de “Born to be wild”, un peu trop décalée sans doute, mais toujours sympa. Scott Reeder, histoire de bien enfoncer le clou, nous rappelle comme il est loin le temps des lignes de basse pachydermiques et du metal sablonneux, avec la reprise du peu connu et poppysant “Two of us” des Beatles. Les britanniques de Orange Goblin donnent un gros coup de pied dans la fourmilière et crachent sur ces derniers morceaux un peu trop mielleux à leur goût, en ravivant à notre souvenir une reprise punkisante du leader de The Damned, Brian James. Vivifiant ! Encore quelques tranches d’americana, et la galette se termine sur une reprise psyché-planante du “Dreamweaver” de Gary Wright par Valis.
Ce second volet (d’une collection qui on l’espère ne s’arrêtera pas là) transforme l’essai, on y retrouve des dizaines de groupes totalement référentiels dans le petit monde du stoner, se fendant de reprises tour à tour audacieuses ou convenues, mais toujours sincères. On remarquera aussi que la frilosité passée fait place à quelque audace dans le choix des chansons (Led Zep, les Beatles, etc…), toujours avec réussite. Pas le meilleur album de la décennie, mais un sacré bon moment, et des heures de plaisir auditif, partagé entre nostalgie des 70’s et plaisir d’entendre ces groupes furieusement modernes et jouissifs.
 L’homologue de Kozik en Europe est, comme vous le savez, Lee Dorian, leader de CATHEDRAL et boss du label Rise Above. Il a eu l’idée géniale de ressortir les deux premiers LP d’ELECTRIC WIZARD en prenant soin d’y rajouter quelques inédits. L’album, Electric Wizard reste de facture assez classique. Une curiosité agréable à écouter pour comprendre le cheminement du groupe quoique manquant de détachement par rapport à leurs idoles : WYTCHFINDER GENERAL. On s’attardera tout particulièrement sur le magnifique Mountains of mars, très, très spatialo-hyppie avant d’attaquer la pièce maîtresse. Album de la maturité, Come my fanatics, bénéficie d’un traitement des guitares, certainement le plus dingue qui soit. Return trip, le morceau qui ouvre l’album dégueule de la fuzz la plus grasse qu’il m’ait été donné d’entendre. ELECTRIC WIZARD à inventé ce qui pourrait être une sorte d’ « elephant rock », de « mammoth swing » qui aurait le pouvoir hypnotique de faire headbanger jusqu’à épuisement n’importe quelle équipe de derviches tourneurs. Attention à la nuque !
On les croyait disparus, morts pour la cause, mais il n’en est rien : Puny Human nous revient avec une galette bien burnée, de la trempe de ses deux torgnoles précédentes. Certes, le quatuor n’est pas vraiment un groupe “full time” : après quelques concerts ils se disloquent et déboulent quelques années plus tard une nouvelle galette sous le bras… pour notre plus grand bonheur !
Depuis leur dernier album, Iann Robinson (aussi connu comme VJ de MTV US !) a quitté les fûts, remplacé par un autre charpentier qui, non content de bastonner ses peaux à la massue comme un taré, déborde de groove, une composante essentielle du combo… mais pas la seule, car pour résumer, c’est dans son goût immodéré de la gratte cinglante et grassouillette que s’éclate Puny Human. Leur marque de fabrique est là : pondre des morceaux super catchy, totalement radicaux, avec une énergie toute punk (si, si ! Ecoutez “Up not out” ou “Northern Drawl” pour voir) baignée de riffs glaireux et de leads tranchants comme un sécateur rouillé.
Mais sous ces atours de gros camionneurs bedonnants, se cache un talent redoutable pour empaqueter des morceaux originaux, de ceux que l’on fredonne très rapidement en choeur avec l’album. Aucun ne se ressemble, et la surprise est toujours présente au détour de la touche “next” de la télécommande : les plages défilent sans temps mort, et on cogne du pied comme un malade. “The real Johnny Charm” dont le chant peut rappeler au choix Jello Biaffra ou Serj Tankian (et que dire du cameo électrisant de Danko Jones ?!), “The bus…” et “Planting my impatience” avec leurs intro superbes, “Number of the beauty” et son break boogiesant (marque de fabrique absolue du groupe), etc… Les titres défilent sans faiblir.
“Universal freak out” est sans doute l’album le plus mature de Puny Human, et à ce titre un excellent point d’entrée pour découvrir ce combo impeccable. Maintenant, si vous n’aimez pas la musique, je ne peux rien pour vous. Mais dans le cas contraire, cet album vous attend, la bave aux lèvres, prêt à en découdre.
J’ai jamais eu l’occasion d’écouter l’album précédent de Novadriver, “Void”… Allez comprendre, aucune raison particulière.
Bon ben là je me dis que j’ai peut-être raté quelque chose. Parce que Novadriver, putain, c’est bien (oui, je sais, avec un tel talent de plume, j’aurais dû écrire des traités philosophiques).
Trève de plaisanteries, c’est quand même méchamment jouissif comme musique. C’est en gros le collègue dissident d’un Fu Manchu (qui se la pète un peu trop depuis qu’ils sont adultes)… Novadriver, c’est du pur stoner totalement décomplexé, un quintette de Detroit que l’on aurait plutôt imaginé ancré dans une culture californienne parfaitement digérée et assumée : tout dans l’attitude, avec pour seule finalité le fun. Zéro prise de tête, que du plaisir.
Leur musique baigne dans d’épaisses nappes de groove (“Dark Aftermath”, ou encore “Machine”, qui nous fait jouer de l'”air tambourin” – ben oui, on dit bien de l'”air guitar” !!), bien aidé par un producteur et un ingénieur du son qui ont respectivement officié avec Big Chief et Raging Slab. Le riff reste seul maître à bord et porte fièrement l’étendard stoner (“Roll you”, ou le riff à 4 notes de “Bury me alive”).
Bon, bref, ce disque est tout simplement excellent. Encore une fois, rien de révolutionnaire, mais le ratio bonheur/prix de l’album est imbattable. De la jouissance en rondelle. Un plaisir.
 La mer Baltique serait-elle, via la Tamise, un affluent du Mississipi ? A l’instant ou ce disque a été posé sur ma platine, la réponse se fit sans appel. Oui trois fois. Une curiosité dont les géographes n’avaient probablement pas idée avant ce jour. Par conséquent, contrairement aux idées reçues, la Terre reste à un territoire d’exploration infini. Comme le blues. Nous savions ce dernier séminal. Il l’est foutrement ! Sa semence continue de se diffuser urbi et orbi et vient de donner naissance à une « moitié d’homme ». En fait de moitié, ils sont quatre suédois au talent fou. Après une période de maturation de treize années passées à revisiter les standards du blues dans les rades du pays, ils sortent enfin le disque dont il est question dans ces colonnes. Ce parcours singulier leur a permis de façonner une bien jolie pépite de heavy blues rock. Il concentre l’esprit du meilleur de John Mayall, de Peter Green, de Robin Trower, de Cream, de Ten Years After et de Gov’t Mule réunis. Excusez du peu. Un ravissement pour les conduits auditifs. Les superlatifs me font défaut pour qualifier le timbre de voix, clair, chaud et puissant de Jan. Restons sobre : magnifique ! Idem pour la musique. Groove de la basse omniprésent, guitares psychédéliques et batterie métronomique. Vous comprendrez que l’aiguille à vite fait de taper dans le rouge à l’intérieur de mon bulbe rachidien. Oui, le fil d’Ariane de cet album est implacablement blues. Une savoureuse alternance entre le blues le plus traditionnel avec harmonica « Blues ain’t nothin’, When the train comes back, Two drinks of wine », de boogies taillés pour les très longues distances sur l’autoroute « Insane, Rodney’s song » ou l’immense « Hardly wait » (reprise incroyable d’un morceau de PJ Harvey) et d’instrumentaux habiles s’autorisant quelquefois le luxe d’un décrochage salsa « Two perverted men in the swamp ». En somme Half Man a redéfini de nouvelles frontières pour le blues. Un blues terriblement dynamique qui, dans l’idée seulement, rejoint le mouvement engagé un temps par Mule et poursuivi par Zen Guerilla. En affichant ostensiblement ses racines et en les traitant avec un son actuel, il se pourrait bien que Half Man réussisse à initier un genre nouveau. C’est tout le mal qu’on leur souhaite. Ces mecs sont tout le contraire d’une moitié d’homme ! En fait, ce disque nous rappelle si besoin était, que le heavy actuel est irrémédiablement redevable du blues. Il s’agit donc bel et bien d’un album didactique dont la qualité (c’est loin d’être la seule) serait de pouvoir ouvrir les oreilles aux plus irréductibles des fans de stoner rock dont l’univers est quelquefois trop étriqué. Oui, ce disque a de multiples vertus. Premièrement en ce qu’il nous conduit à porter un regard sur nos origines. Deuxièmement parce qu’il contribue à élargir notre champ musical. Troisièmement, parce qu’il fonde (je l’espère tout du moins) de nouvelles perspectives. Un disque intelligent et racé à la fois. C’est très rare.
Voila un disque enregistré en 1997 qui nous arrive en 2000. Avec du beau linge. Nick Oliveri à la prod., Josh Homme et Brant Bjork (tous trois ex-Kyuss) pour quelques apparitions au volant de leurs instruments habituels. Le reste des contributeurs, à part Chris Goss des Masters Of Reality qui vient faire des chœurs, me sont inconnus. L’ensemble est assez punk hurlé tendance franchement chiant. Sans le moindre intérêt. Une session d’enregistrement de copains qui se la donnent et qui parviennent à en faire une galette que des pèlerins comme j’en connais (moi y compris) sont capables d’acheter par le seul fait de la présence des quelques illustres participants précédemment cités. Ça pue l’arnaque à plein nez. Et ne vous laissez pas avoir par le premier titre qui paraît être intéressant, ce n’est qu’un alléchant attrape-gogos. Seul le morceau qui a donné son titre à l’album, une brève chanson country vaut le coup. C’est peu.
 On prend les mêmes et on recommence. Un an après la sortie des volumes 3 & 4, Josh Homme remet le couvert et réunit à nouveau tous ses potes afin de nous offrir deux nouvelles aventures des Desert Sessions. On notera parmi les invités Mario Lalli, Fred Drake, Dave Catching, Brant Bjork, Gene Troutman, j’en passe et des meilleurs.Ces deux nouveaux volumes ont un concept bien particulier : les paroles ont été sélectionnés aux terme d’un jeu concours, ouverts aux « poètes » du monde entier. Résultat, le disque part dans tous les sens et on adore ça. Il faut avouer qu’embrayer sur l’hilarant ‘Letters to Mommy’ et son chant larmoyant, après avoir goûté au furieux ‘You think i Ain’t Worth a Dollar, But i Feel Like a Millionaire’ (qui sera repris plus tard par Queens Of The Stone Age), il fallait oser. Et c’est comme ça durant 40 minutes. Simplement hallucinant. Les délires s’enchaînent les uns après les autres (‘Punk Rock Caveman Living in a Prehistoric Age’, ‘Goin’ to a Hangin”) pour mieux surprendre l’heureux auditeur avec des morceaux plus conventionnels et diablement bien écrits (‘A#1’, ‘Like a Drug’, ‘Rickshaw’).Enregistrés en seulement 3 jours, ces 11 titres sonnent comme des titres enregistrés par des potes au fond de leur garage. Voilà toute l’idée et toute la force du concept. Au final, le disque est un vrai trip (qui ferait pâlir d’envie le Johnny Depp de ‘Las Vegas Parano’) qui étonne pourtant par sa cohérence.Malheureusement, comme à l’accoutumée, ces Desert Sessions bénéficient d’une sortie confidentielle et sont tirés à très peu d’exemplaires. Si vous êtes du genre aventurier, essayer de vous procurer cet album (disquaire spécialisé, Ebay,..) car vous ne serez pas déçus. Pour les âmes sensibles, voici mon conseil : s’abstenir.
 Pfffiou, en voilà un qui n’a pas volé son patronyme. Pachydermique, la musique de Mastodon l’est assurément. Mélangeant gaiement hardcore, metal, thrash, power et autres joyeusetés pour midinettes, dans le domaine de l’ultra-violence, Mastodon se pose là. Et pourtant, de metal dit ‘extrême’ il n’est pas ici question. Restant ‘écoutable’ par les oreilles les plus chastes, Mastodon, sous ses apparences de gros balèse bruitiste, joue la subtilité : s’appuyant sur des ex-Today Is The Day, ils ont le riff cinglant, la rythmique sèche, et le chant qui déchire. A écouter notamment ce batteur incroyable, à la fois lourd, rapide et précis. Ne parlons même pas de ces duos de guitare en harmonie menant à des parties rythmiques imparables. Le son est parfait, le soin apporté aux guitares est très perceptible, que ce soit dans les instrumentaux, magiques (‘Ol’e Nessie’ ou le splendide et épique ‘Elephant man’), ou les parties plus ‘radicales’. Impossible à l’écoute de cet album de ne pas se remémorer les plus grandes heures de Slayer (‘Where strides the Behemoth’ et ses soli aériens), mixés à une dose de Meshuggah (la rapidité et la technicité du jeu sans jamais tomber dans des travers ‘prog’ énervants) et de Pantera (la puissance du chant et le jeu de basse), le tout avec une identité hardcore (la furie de ‘Burning man’) qui ne fait qu’ajouter en puissance. Cet album tue. Une claque ENORME.
|
|