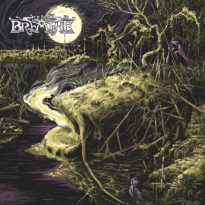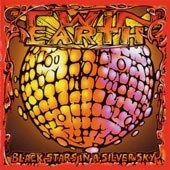|
|

Les américains de Duel ont sorti un live forgé dans un Stoner à l’ancienne où s’échangent riffs couillus et pauses respiratoires. Seulement, avec deux albums à leur actif je m’interroge, quelle est la différence au fond entre un Live et un Best of ? Le public ? Si c’est pour ça que tu es venu, passe ton chemin, l’ensemble est découpé très proprement comme un enregistrement studio et le son de la foule n’est présent qu’évasivement sur la moitié des morceaux. Il s’agirait donc plutôt d’un Best of. Seulement, comme déjà énoncé plus haut les quatre zicos n’ont à leur actif que deux albums, un peu court donc pour ce qualificatif. Que nous reste t il donc ? Un contrat à honorer avec le label ? L’avenir nous le dira.
Pour ce qui est des pistes on retrouvera une bonne part du premier album “Fear of the Dead” soit quatre morceaux sur six tout de même avec “This Old Crow” (titre à l’énergie idéale pour entamer un set) , “Electricity”, “Fear Of The Dead”, “Locked Outside” (pour lequel je mets une mention spéciale pour son intro Kadavaresque) et seulement deux titres du dernier album studio avec “Snake Queen” et “Heart Of The Sun” (Deux pistes qui équilibrent l’album tant la première comme un repos entre deux suées de fosse que la seconde avec sa mélodie énergique qui ne sombre pas dans le sucré)
Au final qu’apporte cet album à ce début de discographie? L’impact live du groupe permet aux morceaux de prendre en puissance ce qui n’étant pas bien surprenant est ma foi bien appréciable. De plus la voix trouve une profondeur, qu’on aurait pu craindre de perdre entre le studio et la scène, grâce au duo de chant. La qualité majeure de cet album réside dans la très bonne définition de l’enregistrement et du traitement.On en perd pas une miette rien n’est plat ou mal balancé, un très bel équilibre au final.
Le choix des morceaux est tout à fait cohérent et je ne déplore l’absence d’aucune composition essentielle à mon sens bien que quelques titres de plus n’auraient pas été de refus, une petite trentaine de minutes étant toujours insuffisante quand un groupe est bon.
Au final cet album n’aura aucun impact majeur pour ceux qui connaissaient déjà Duel mais il permettra de se faire une idée alléchante de ce que les texans peuvent offrir en live ou constituera une porte d’entrée idéale pour la découverte du groupe. Sans être un must, ce “Live at The Electric Church” sera (on l’espère) un intercalaire plutôt sympa dans la discographie de Duel.

Glory or Death est un petit label discret, modeste probablement (au site web famélique voire approximatif), dont la démarche commerciale est pour le moins cryptique. En l’occurence, Bow to your Masters : Thin Lizzy est un double album (vendu sous format 2 LP) dont le 1er volume (1er LP ?) est déjà dispo (en tout cas en digital) et le second… pas encore enregistré ? Plein de bonnes intentions à l’évidence, il faut un peu s’accrocher pour acquérir leurs produits toutefois. On s’est donc plongé dans cette première partie de cet hommage au joyau Irlandais, emmené par une batterie de groupes qu’on adore.
Impossible d’adresser un album “tribute” sans tomber dans l’exercice du “track by track”, d’autant plus lorsque, comme ici, chaque groupe intervenant a une identité si différente. Le label dégaîne l’une de ses plus sérieuses cartouches avec la reprise de “Are you Ready” par Mothership. Pas un choix méga original (souvent repris par Motörhead, Danko Jones, Rollins Band sur album…), mais le riff marche toujours autant, et les soli de Kelley Juett font bien le job. C’est ensuite Mos Generator, une véritable machine à reprises (Tony Reed les enquille en groupe ou en solo) qui se frotte à “Massacre” pour un exercice à la fois très fidèle et très bien exécuté.
Un peu plus loin c’est les très attendus Egypt (RIP) qui se frottent au plus rare “Suicide” : encore une fois, même socle rythmique, même structure, même tonalité… Bien fait, très bien fait, mais on reste très proche, et cette petite touche de folie du groupe U.S. n’apparaît que superficiellement à travers les vocaux graisseux d’Esterby. Mêmes constats pour White Dog et Red Wizard. Les peu fameux Kook se démarquent un peu en levant le pied sur le tempo de “Thunder & Lightning”, mais ça ne suffit pas à transcender le titre.
Dans un exercice où on les attendait pas vraiment, Slow Season s’en sort bien, en apportant un traitement intéressant au discret “She Knows”, lui apportant un groove subtilement différent. Sympa. Approche différente de Great Electric Quest qui “métallise” un brulot qui l’était déjà bien à la base, “Cold Sweat”, avec une prod clinquante qui apporte un atour “gros heavy US” à l’original. Et on finit sur le standard “Cowboy Song” un peu défiguré par Goya : pleins de bonnes intentions, les américains se la jouent dissonances, pesanteur et densité. Audacieux, bien effectué, intrigant. Pas transcendant, mais louable.
Qu’est-ce qui fait la qualité d’un tribute ? La liberté prise par les interprètes d’un jour ? La fidélité à l’original ? La qualité propre des groupes impliqués ? L’intérêt du groupe objet du tribute ? Il n’y a pas de réponse unique. Par ailleurs, évaluer un double LP à l’aune d’une de ses moitiés seulement est un exercice pour le moins peu délicat. En l’état, l’album est court. Trop court pour marquer durablement et développer une identité propre ou un sentiment général. Le sentiment global est plutôt bon, sans pour autant jamais mettre les compteurs dans le rouge, jamais.
A noter que le second volume proposera des prestations de High On Fire, Duel, Wo Fat, des membres de Yob, Poison Idea, Earthless, etc… Ça sera donc inévitablement intéressant. Restera à voir si l’essai sera transformé.
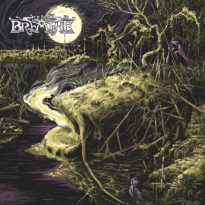
Sortis peu de nulle part (du Minnesota…) le trio Let It Breathe est néanmoins composé de trois vieux potes de fac, qui avaient abandonné leur groupe pendant plusieurs années avant de rebrancher les amplis récemment… Pas manchots, les bougres attirent l’attention du label culte STB Records, qui signe direct leur premier album. De quoi titiller notre curiosité, pour le moins.
Les premières écoutes du disque sont un peu laborieuses : peu original à première vue, le groupe convoque autour de gros riffs sabbathiens des sonorités qui empruntent autant au heavy qu’au doom ou au rock psyche. Difficile de s’en dépêtrer et la tentation de passer à autre chose est tentante. Mais les quelques écoutes qui s’ensuivent (notez le professionnalisme et l’abnégation du chroniqueur…) viendront progressivement dévoiler des perspectives plus enthousiasmantes. Facteur le plus remarquable émergeant après plusieurs écoutes : ce sens de la composition catchy et de l’arrangement qui fait mouche, typiquement américain (amis du cliché…), est l’une des principales forces de cette galette. Là, le lecteur lambda dénonce un lieu commun de la plus triste engeance. C’est son droit. Sauf que je l’encourage à jeter une oreille curieuse à des compos comme “Bucket of Bullheads” (quel refrain…) ou encore “Greater Than I” (quel refrain, bis…) ou encore l’audacieux “Mauler”. Voilà.
Leur variété séduit aussi, entre les très sabbath “Wanderer” et “Fat Lip”, “Mauler” qui oscille entre doom, sludge et grunge (!), un “Coramoor” pas si éloigné des classiques de Pentagram (et au chant très Ozzy-esque sur la fin)… En sept petits titres, Let It Breathe concatène et fait siennes les plus grandes heures du heavy rock U.S., sans perdre son âme.
Le trio a construit une identité intéressante, et montre aussi un talent d’écriture remarquable. S’il assure autant sur scène, on lui prédit une belle carrière. A suivre sur la longueur tout de même.

Le second album des Quebecquois de Death Wheelers est un bout d’asphalte sur lequel le groupe veut construire son histoire comme une légende. Cet album pourrait figurer sur la B.O d’un film de Tarantino ou de Rodriguez. C’est une invitation à la violence et à la grosse bouffe bitumée dans les espaces vierges des États Unis tout proches.
Si j’aborde cette écoute d’un point de vue cinématographique, c’est que l’album est ainsi construit, se voulant comme l’histoire d’un gang de bikers assassinés et revenus d’entre les morts pour recruter une légion d’âmes damnées d’un bout à l’autre du continent. L’album entièrement instrumental déroule kilomètre après kilomètre les inspirations Doom, Psyché dans un esprit Stoner des plus gras. On y ressent les méfaits de nos bikers infernaux passant de la candidature à la mort-vivance à la chevauchée mortuaire à toute blinde. De “Roadkill 69” à “Motö Vampiro” l’écoute est un roadtrip qui enchaîne les influences avec pour presque chaque titre une introduction tirée de film de serie B. (tout comme le nom du groupe qui est le sous-titre de “Psychomania”, film d’horreur britannique de 73.). De la côte Est on aboutit à la côte Ouest sur “Motö Vampiro” qui joue allègrement sur les codes de la musique surf. Au milieu de tout ça, “Death Wheelers/Marche Funèbre” mets la gomme sur une basse interprétant les notes de la Marche funèbre.
“Purple Wing (Necrophonic psych-out)” est une étape dans un bar blues halte de toute la racaille du monde et la bagarre générale éclate sur “Backstabber” avec une batterie qui enchaîne coups de boules et uppercuts. On remonte en vitesses sur nos cylindres en V et on fonce poignée dans les coins sur “RIP XXXlast rideXXX” persuadé que c’est la fin. La clôture de l’album se fait réellement sur une reprise goûtue et actuelle du sublime titre de Led Zeppelin “Moby Dick”. Il en conserve toute la structure y compris une réinterprétation du solo de batterie qui n’en atteint malheureusement pas la finesse, mais qu’importe le morceau est là, il clôture l’album comme un générique de fin de film et il y a fort à parier que le vieux capitaine Achab a remplacé ses voiles par un putain de gros moteur !
Comme toute série B qui se respecte, le mot “fin” n’est jamais définitif semble t il, alors on espère un troisième volet tout aussi velu que “I tread on your grave” prochainement sur nos écrans.

Au vu de l’émulation permanente que l’on y constate et du nombre de musiciens qui y résident / jouent / jamment, il y a proportionnellement peu de groupes remarquables qui émergent de Los Angeles. Mais parfois, une perle apparaît, comme par accident. Aboleth est de ces petits trésors cachés, un groupe hors norme, qui propose quelque chose de spécial. Le groupe s’est formé il y a 2 ans à l’initiative de Collyn McCoy, qui est aussi le bassiste du Ultra Electric Mega Galactic de Ed Mundell – et quiconque a vu sur scène le combo monté par l’ancien soliste de Monster Magnet a probablement gardé en mémoire le talent de ce bassiste extraordinaire. Après avoir rencontré la jeune Brigitte Roka, ils décident de monter Aboleth, s’adjoignant les services de plusieurs batteurs plus ou moins dispensables. Après un EP en 2016 (qui leur permet de trouver des dates de concert, en Californie principalement), ils enregistrent l’année suivante un véritable album, ce Benthos, qui sort cette année sur un discret label californien.
Attention cliché : il est peu probable que vous ayez entendu quelque chose comme Aboleth auparavant. Non pas que le style musical du trio soit révolutionnaire : ils évoluent dans un hard rock nerveux et fuzzé, calé sur une bonne base blues racée et fiévreuse. Sauf que les vocaux de Roka apportent au groupe le principal facteur “choc” : la jeune chanteuse a un coffre et une tessiture que peuvent lui envier de grandes vocalistes, dans sa diversité (son chant clair chaleureux, ses montées en tension, ou ses passages rocailleux en diable qui deviennent sa marque de fabrique) mais surtout dans sa puissance ! Toujours sur la brèche, à la limite de la rupture, la chanteuse ne tombe jamais du mauvais côté de la barrière et est l’une des pièces maîtresses de la musique du groupe. Mais comme Aboleth n’est pas “un groupe à chanteuse”, l’autre pilier du combo repose sur les épaules de McCoy, qui assure à lui seul toutes les parties “à cordes”… avec un seul instrument ! Armé d’une “baguitar”, une sorte d’hybride entre… une basse et une guitare, le bonhomme se la joue one-man band en mode basique : un instrument, deux amplis branchés (un basse et un guitare), et il crache la sauce. Pas d’overdubs, pas de pistes de gratte dans tous les sens, rien : un gros son, de bons riffs, des soli au top, et globalement un superbe doigté. Et côté batteur, pas un manchot non plus : Marco Minnemann, qui a joué avec Satriani ou Steven Wilson, et qui a craqué sur le groupe et proposé ses services (même s’il n’assure pas les tournées, ses autres employeurs étant trop “prenants”).
Les ingrédients sont donc particulièrement bariolés, restait à voir si la cuisine allait être réussie. La réponse est un grand “oui”. On ressort immanquablement séduit par tous les développements proposés à travers les trois quart d’heure de Benthos, il n’y a jamais matière à s’ennuyer. On est d’abord cueilli par ce son gras bien particulier dès l’intro de “Wovenloaf”, leur titre le plus représentatif probablement (avec un impeccable solo de slide). Après le mid-tempo catchy “Fork in the road” on rentre sur une autre pièce maîtresse, “No Good”, portée par un son copieusement saturé et fuzzé, et une performance vocale toute en feeling. Et ça continue ainsi, on passe de titres plus lents à des morceaux sanguins comme ce nerveux “Glass Cutter”, en passant par le fluet blues acoustique “Shark Town Blues” ou encore la balade “The Devil”, deux titres où la voix éraillée de Roka file presque le frisson.
Le duo/trio contourne avec grâce et talent le piège du “groupe à gimmick”, en se concentrant sur sa musique, ses compos, et en se rodant en live dès qu’un bout de scène miteux leur est proposé. Là où d’autres passent plus de temps à réfléchir stratégie marketing, look, et études de marché, cette approche assure au groupe des fondations robustes et saines. Espérons maintenant que ce premier effort, porteur de beaucoup d’espoir, permette au groupe de prendre une dimension suffisante pour que non seulement on ait l’opportunité de les voir jouer sur nos scènes, mais aussi pouvoir entendre encore d’autres albums du groupe. On croise les doigts.

Quelle drôle d’idée de la part d’Ecstatic Vision que de sortir un EP de reprises, après deux albums excellents, dont on attendait tous la suite. Autre surprise, la sortie dudit EP chez Heavy Psych Sounds jette un petit froid : ont-ils quitté leur belle maison Relapse ? Peu de promo, peu d’infos, sortie discrète…On hésite entre enthousiasme timide et inquiétude froide (oui, on reste des gens émotivement modérés hein…).
On s’enfile quand même la galette sans réticence, et on commence par être un peu déstabilisés par un son brut, garage, aux saturations un peu branques… Mixage à la truelle jumelé à un mastering avec des moufles ; même si le groupe a toujours eu pour lui ce son un peu “garage” et vintage, là le bouchon est parti loin.
La clé d’un album de reprises tient en deux points : le choix des titres, et leur interprétation (ou appropriation). Les titres retenus par les américains alternent entre évidences (deux titres des maîtres du space rock Hawkwind, rien que ça – les méga catchy “Born to Go” et “Master of the Universe” – et un du MC5) et découvertes (l’artiste de zamrock Chrissy Zebby Tembo, Keith Mlevhu…). Côté interprétation, la touche Ecstatic Vision explose au visage, aucune ambigüité possible. Le groupe a su faire siennes ces chansons, ou plus précisément les injecter dans leur ADN pour en ressortir de fidèles hommages, empreints de tout ce qui fait l’intérêt du groupe : son son, son jeu, son sens du groove épidermique et son psychédélisme rampant…
Au final, on a beau être un peu déstabilisés par… à peu près tous les paramètres de ce disque, il n’empêche qu’il s’agit d’un bon album de reprises, et accessoirement une bonne production à ajouter à leur courte discographie. Mais bon, on attend quand même impatiemment la vraie suite…

20 ans ! 20 ans déjà que le trio psyche de Jason Simon et Steve Kille trace sa route (bah oui, Laughlin est parti… encore…). 20 ans et huitième véritable album, bilan correct pour un groupe (même s’il a un peu levé le pied sur la deuxième partie de sa carrière) qui n’a toujours pas de faux-pas à son actif. The Nothing They Need sort comme une large part de sa discographie sur le propre label du groupe, qui joue depuis longtemps sans pression.
Levons immédiatement un suspense qui n’a que trop duré : The Nothing They Need ne révolutionne en rien la disco du groupe et ne devrait pas vraiment chambouler les aficionados des américains ; pour autant, c’est un excellent cru. Alors attention, si vous avez lâché l’affaire lors de la dernière décennie, vous allez peut-être quand même être un peu surpris : l’urgence et l’aspect brut des premiers disques du trio a progressivement évolué vers quelque chose de plus travaillé, aux compos soignées et à la production impeccable. Mais fondamentalement, les bases du groupe restent les mêmes, on a toujours une base psyche solide et des mélodies catchy. “Keep Your Head” nous en offre dès l’intro le plus bel aide-mémoire : sirupeux, mélancolique, le titre déroule sa nonchalance arrogante, parfois transpercé par le chant toujours sur la brèche de Simon et plus généralement tiré par des plans instrumentaux impeccablement maîtrisés. Tout est à peu près là, décliné en huit variations pour 35 minutes de grande classe. Les mélodies infectieuses se donnent le relais sans interruption, portées par des atmosphères variées, évoluant toujours dans une veine mélancolique, toujours sur la brèche entre allégresse (“Here with the hawk”) ou tristesse (le superbe “This shaky hand is not mine”).
The Nothing They Need n’est rien moins qu’un très bon album de Dead Meadow. Le classer comme meilleur disque de leur discographie est un exercice un peu stérile (spoiler : non), mais il mérite une belle place dans la discographie de tout fan de rock psyche US, apportant une nouvelle belle pièce dans le parcours d’un groupe clairement à part.

Actifs depuis le début des années 2000, les vétérans de Mos Generator reviennent sur le devant de la scène avec leur nouvel opus intitulé Shadowlands.
Peut-être un poil plus direct que le Abyssinia de 2016, ce nouvel album va vite se faire une place sur les platines des amateurs de heavy rock rétro estampillé 70s, décennie bénie qui a vue nombre de chroniqueurs de ce site ramper à quatre pattes avec des couches Peaudouce collées aux fesses. Mais, familier que vous êtes avec la discographie du combo, vous le savez sûrement déjà : Mos Generator ne renouvellera ici ni le style musical en général, ni le style Mos Generator en particulier.
Oui, le trio excelle lorsqu’il s’agit de livrer du southern rock sans artifices ni fioritures. L’éponyme « Shadowlands » ou le brutal « The Destroyer » le démontrent fort bien, tout comme le diptyque « Stolen Ages », véritable pépite de cet album, ou comment faire cohabiter un instrumental plus groovy que le chef de South Park avec du pur rock’n’roll affûté au refrain fédérateur.
Mais voilà, le bien nommé « Blasting concept », qui explose à la gueule après qu’une sournoise mèche de 90 secondes se soit consumée ou encore le décalé « Gamma Hydra » et son intro à la limite du kraut survitaminé viennent une nouvelle fois témoigner de la multitude (du trop-plein?) d’influences du combo, influences qui nuisent parfois à l’homogénéité de leurs skeuds. Shadowlands ne déroge pas à cette règle et s’essouffle donc à mi-parcours.
Ni révolutionnaire, ni fondamentalement mauvais, ce Shadowlands ne restera pas dans les annales. Les fans de Mos Generator y trouveront toutefois leur compte… avant le prochain album du combo qui espérons le sera un cran au-dessus.

Bienvenue dans l’espace. Plus qu’un album, le nouvel opus de Bong intitulé « Thought and existence » est clairement un concept drone- psyché-doom bien barré mais loin d’être inintéressant. La galette ne compte que deux titres pour 36 minutes de voyage vers de nouvelles contrées musicales, mais suffisant pour rassasier les oreilles de l’auditeur. Et puis avec une pochette comme celle-ci, on doit au moins tenter le coup.
« The Golden fields », premier morceau de l’album, nous donne l’impression de flotter dans le néant avec comme seul horizon un trou noir à perte de vue. Bong ne révolutionne pas le genre mais propose tout de même quelque chose de différent. Chaque coup de cymbale ou de grosse caisse est millimétré pour créer cette atmosphère à la fois lourde, pesante et apaisante. C’est bien la batterie qui mène la danse tout au long de l’album, appuyée par une guitare faisant ici explicitement référence à un certain Matt Pike, prouvant que trois notes répétées en boucles pendant de longues minutes peuvent avoir beaucoup d’effet sur nos âmes si sensibles. La lourdeur de la batterie et de la basse se mêle parfaitement aux envolées fuziennes de la gratte qui semblent ne jamais vouloir s’arrêter…
Seul (petit) bémol: la voix. Un genre de borborygme calé sans trop de raison en plein milieu de la chanson et qui n’a que très peu d’intérêt. Il y en a trop ou pas assez, et les vocalises nous laissent un petit goût amer en bouche… mais que pour quelques instants, heureusement.
« Tlön, Uqbar, Orbis Tertius » deuxième (et dernier) titre de l’album est dans la même lignée que son prédécesseur: envoûtant et ravageur. Même thème, même ambiance et même puissance pour 19 minutes de plaisir supplémentaires. On s’envole même un peu plus haut dans cet espace infini et malgré la durée de la chanson, on est quelque peu déçu quand la section rythmique se volatilise définitivement, ne laissant que ces trois-quatre notes de guitares planantes se désagreger… Dès la première écoute, l’envie de rembobiner et de recommencer au début se fait ressentir, pour mieux capter les détails de ce concept qui vaut plus que le détour.

Détour par la Finlande aujourd’hui pour y découvrir le second opus d’un trio au stoner crasseux bien accrocheur. Après un double EP, fusionné en 2016 pour constituer un seul et même album, appelé Monsternaut, Heavy Psych Sounds signe à nouveau avec le groupe deux ans plus tard et produit Enter The Storm. Douze pistes d’une galette difficile à manipuler tant elle est lourde.
Écouter cet album équivaut à conduire une machine de guerre. Dès l’intro de « Winter », les riffs évoquent d’énormes V8 montés avec turbo qui démolissent toute tentative de résistance. Ici les arbres sont couchés par terre, le sol recouvert de cendre, et le ciel crache des flammes. On parle davantage d’hiver nucléaire.
Cette lourdeur bestiale est assurée par un jeu de batterie efficace, et par une fuzz crade au possible branchée à la fois sur la basse de Jani Kuusela et sur la gratte de Tuomas Heiskanen. Pourtant, c’est la voix de ce dernier qui nous suggère le plus vite l’influence majeure du groupe. Car si Fu Manchu incarne l’aîné maigrelet et talentueux qui passe ses après-midi à sillonner les skateparks avec ses potes, Monsternaut est sans conteste son frère obèse qui roule à fond de balle dans son pickup dégueulasse et défonce les boites aux lettres à coup de batte de baseball. Une parenté qui, une fois remarquée dans des morceaux tels que « Landslide » ou « Filled with Vain », se révèle difficile à ignorer.
En dépit de la qualité des compositions, on peut leur reprocher une certaine redondance. Une fois passé « Back to universe » l’album semble s’essouffler. Les riffs ne séduisent plus autant, les solos surviennent quasi toujours au même moment et le chant ne s’ose guère en dehors des sentiers battus. On déplore presque le trop plein d’énergie qu’on bénissait au départ. Puis arrive « Enter the storm »…
Avec son rythme galopant, ce titre nous retire toute réticence. L’écriture permet de souffler pendant le refrain là où le couplet nous désarticule totalement les vertèbres cervicales. Une pièce équilibrée et aboutie qui mérite de donner son nom à l’album. Elle s’éteint à peine que « Swallowed by the earth » nous cueille. Presque sans prévenir, on se retrouve balloté dans un groove lancinant mais tout ce qui existe de plus burné. On y déniche même un passage doom qui trouve en fin de compte parfaitement sa place. Il viendra d’ailleurs clôturer cet album sur de francs accents pyschés et ainsi nous prouver que le trio finlandais reste capable de nous surprendre. S’ils se décident à tout mêler lors de leur prochain album, on pourrait bien obtenir une incontournable pièce maîtresse.

Nous vous avions déjà parlé de The Freeks, la formation de Ruben Romano, ex-Fu Manchu, ex-Nebula et bien figurez vous que sa bande de monstres frappe encore avec la sortie de Crazy World, signé chez Heavy Psych Sounds (Décidément, rien ne les arrête!). Toujours plus éloigné de la planète Fuzz sans pour autant totalement la renier, ce quatrième album de huit pistes a le mérite d’être à écouter par les amateurs de rock rétro et de références classiques du genre aussi bien que par les férus de plans psyché.
Du côté psychédélisme on est servi en particulier avec les morceaux “American Lightning” et “Mothership to Mother Earth” tous deux sur une base différente ils reconstituent l’histoire d’un genre qui sait être aussi bien généreusement amplifiée que teinté de guitare acoustique ce qui tombe bien car les morceaux respectivement ouvrent et clôturent l’album.
Véritable mille-feuilles de référence “Crazy World” fait appel aux plus classiques des formations, On y retrouve les Stones dans leur version fin 70 avec un “Easy Way Out” où se superposent à la perfection gratte et piano. On pense également aux Stooges en découvrant “Hypnotize my Heart” morceau plus grave et pesant où la ligne de basse assure en duo avec l’orgue une montée de came dure. l’OVNI de l’album est clairement “Take 9” car en rupture totale avec le reste, les références y sont plus Jazz Fusion pour ce morceau entièrement instrumental, une sorte de pont de légèreté en somme. Sur toutes les autres pistes ou presque les chœurs sonnent tels un tablée de Freaks chantant “[…] One of us! one of us! Gooble-gobble, gooble-gobble!”, Sensation particulièrement évidente sur “This is Love”, c’est dire si cette assemblée porte bien son nom. Même si on s’éloigne de nos préoccupations habituelles, on retrouve des passages jouissifs comme sur “Chronic Abduction” qui fait penser à l’esprit d’un “Uncle Acid and the Deadbeats” toujours grâce à cette voix éraillée à la limite du malsain amplifiée par le chant en chœur.
Il faut aussi saluer la pochette de l’album, qui réalise un retour vers l’esprit “Métal Hurlant” qui animait déjà celle du premier disque. Dès la première écoute je suis tombé sous le charme de cet album polymorphe. Il fait appel à bien des souvenirs , à des expériences profondes relatives à la découverte de la musique, une sorte de traversée des âges et des espaces pour nous conduire sur la voie de nos genres de prédilection plus actuels.

Sans la moindre promo, ni même la moindre annonce (tout juste savait-on que le groupe était rentré en studio l’an dernier), Sleep a choisi de livrer ce 20 avril 2018 le successeur de Dopesmoker (presque 20 ans après), surprenant tout le monde en lâchant l’album complet en streaming sans que la moindre rumeur ne soit venue gâcher l’effet de surprise. Bien sûr on s’y attendait, l’annonce d’une tournée nous laissait bien supposer qu’un nouveau long format se préparait, mais Sleep a réussi son coup. D’un côté les fans de toujours, de l’autres celles et ceux que Sleep laissent indifférents depuis toujours ; tout le monde y va de son commentaire. Le trio est de retour, que cela soit dit haut et fort ! Mais que vaut ce retour ? Que peut-on attendre d’un groupe qui, en presque 20 ans, ne nous a proposé qu’un titre de 10 minutes (“The Clarity” en 2014, très bon au demeurant) ? Est-ce dans un vieux « pot » (attention, à partir de là je ne signale plus mes allusions à la drogue) que l’on fait la meilleure soupe ?
Au niveau des thèmes abordés, on a vite fait le tour. “Marijuanaut’s Theme“, deuxième plage de l’album (avec le son d’un bong en intro), résume le tout, avec des paroles assez tordues mais explicites : “Inhaler of the rifftree, Initiate burn, never to return” ou encore “Through the hashteroid fields” en passant par “Marijuanaut loads of a new bowl”. Bref, Sleep, tout en utilisant des métaphores ne se privent pas d’exposer clairement son thème et de développer ses idées. Sortir un album entièrement à la gloire de la weed un 20 avril (4-20 en anglais, je vous invite à rechercher la signification si vous ne la connaissez pas), qui plus est avec une pochette des plus explicites, voilà comment Sleep a choisi d’effectuer son retour sur le devant de la scène après des années d’attente. Aucune concession, mais pouvait-on en douter ?
Musicalement et avant d’entrer dans le détail, la référence est claire et nette. “Through Iommosphere”, “Giza Butler”, “on the Sabbath Day walks alone”… Black Sabbath est encore et toujours le moteur, la flamme qui allume le joint de nos comparses. Reste maintenant à savoir si l’herbe que nous propose Sleep est toujours aussi bonne et si “The Sciences” trouvera sa place aux côtés des mythiques Dospesmoker/Jerusalem et Sleep’s Holy Mountain.
Prenons en considération que pour ce nouvel album, les deux têtes pensantes du groupe ne sont plus les mêmes. Je ne vous parle pas d’un changement de line-up mais de Al Cineros qui entre temps a sorti un paquet de trucs avec Om (et un projet solo genre dub pas mal foutu) et de Matt Pike qui au sein de High on Fire aura lui aussi bien roulé sa bosse. J’ai envie de dire que ce nouveau Sleep, c’est tout cela à la fois. C’est le mythe du Sleep des années 90, le mystique de Om et la maîtrise de High on Fire. La quintessence même des origines du groupe et de l’histoire de ses membres fondateurs.
Matt Pike est au sommet de son art et de son inspiration. Les riffs, les soli, le choix des accords, du son, du rythme, tout y est. Les fans de Sleep retrouveront ce qui leur a permis de vivre leur premier trip, rien n’a changé. C’est planant, lourd, solide, brut. Al Cisneros avec sa basse accordée au plus bas accompagne, se cale en embuscade derrière la guitare et donne un relief supplémentaire qui vous prend aux tripes. Egalement au chant, il se rapproche de façon flagrante de ce qu’il a produit avec Om. Ce chant méditatif pour atteindre un état supérieur, hypnotique, un état second nécessaire pour goûter pleinement le sens de son récit. Jason Roeder, batteur du groupe depuis 2010 (et de Neurosis depuis toujours, excusez du peu) abat un boulot phénoménal. Impossible de le mettre en défaut, il n’est pas qu’un figurant qui marque le rythme en tapant sur ses futs. Il enrobe le tout avec un jeu varié et riche.
Les compositions sont réellement abouties et on sent que le tout a été peaufiné, travaillé tout en gardant un aspect naturel qui évite cette sensation d’avoir un produit de synthèse devant soi. Ecoutez le travail de la basse durant le solo de guitare sur “Marijuanaut’s Theme”, ou encore les mille variations de batterie sur “Sonic Titan”. Rien n’a été laissé au hasard. A noter d’ailleurs que oui, “Sonic titan” est bien le même titre présent en live sur l’édition “discutable” de Dopesmoker sortie par Tee Pee Records, mais ralenti et ré-arrangé – il s’intègre d’ailleurs parfaitement au disque. Plus globalement, l’album se rapproche plutôt de Holy Mountain dans le sens où il est effectivement constitué de six chansons bien distinctes ; l’approche jusqu’au-boutiste (et exigeante) de Dopesmoker ne pouvant pas être dépassée, le trio s’est orienté vers quelque chose de plus “traditionnel” dans sa démarche (tout est relatif, bien sûr : vous aurez du mal à trouver des chansons intro-couplet-refrain-couplet-refrain…).
De fait, le trio livre avec “The Sciences” la quintessence de sa musique : il ne synthétise pas, il n’explore pas non plus de nouveaux territoires musicaux (ceux qui attendaient une version “moderne” de Sleep en seront pour leurs frais), mais propose un complément naturel, une nouvelle étape à la fois sans prétention et non discutable : Sleep se rappelle à notre souvenir et réaffirme à grands coups de riffs massue son statut référentiel dans le paysage musical actuel.
Sleep vient de sortir une pièce maîtresse qui devrait ravir les fans du groupe. Et pour celles et ceux qui n’ont jamais été réceptifs, je vous en conjure, écoutez ce disque. Plusieurs fois. Et sans forcément vous inciter à l’usage de psychotropes divers (pas notre genre…) recalez-vous sur un état de perception différent, plus ouvert, moins traditionnel peut-être, pour enfin mieux cerner l’approche du groupe. “The Sciences” est un excellent album, de bout en bout. 53 minutes de pur trip, montée et descente incluses. Le groupe fait montre d’une maîtrise totale de son sujet et apporte au Doom une nouvelle pièce incontournable.
Point Vinyle :
Third Man Records [ndlr : petit label indépendant créé par Jack White] propose un double vinyle (noir pour l’édition classique et vert pour l’édition limitée).
A noter la mise en vente dans un certain nombre de disquaires sélectionnés par le groupe aux USA et en Angleterre d’une version sur vinyles noir et vert (chaque disque est noir et vert, pas l’un noir et l’autre vert) avec pochette alternative limitée à 1000 exemplaires.

Heavy Psych Sounds affirme son ouverture en signant Tons, quatuor Turinois de Sludge assez lointain des atmosphères psyché proposées généralement au catalogue.
Le fait est que ce groupe ne manque pas de dérision pour intituler ses morceaux, cherchant la plus improbable des blagues et référence alambiquée. allant de “Abbath’s Psychedelic Breakfast” à “Sailin’ the seas of buddha cheese” en passant par un “99 Weed Balloons”, “Those of the Underlighter” et “Girl Scout Cookie Monster” et se référant ainsi en vrac à des titres de Pink Floyd, Primus, Nena, Marduk et SaraBeth (Je me serai d’ailleurs bien passé de trouver cette référence Country). “Filthy Flower of Doom” (qui pourrait être traduit par “Fleur crasseuse de Doom”) porte bien son nom avec une musique sale à souhait.
Coté face donc un style crasse et sombre avec une voix Sludge qui dérive bien souvent vers le Black et on pourra en dire de même au sujet de la batterie qui oscille entre frappe rapide de la double grosse caisse (“Sailin’ the seas of Buddah Cheese” notamment) et tempo plus modéré sur la majeure partie de pistes. La filiation avec Bongzilla est évidente tant du point de vue vocal que rythmique (et une utilisation massive de discours samplés en plus du style) Tons garde pour autant un je ne sais quoi de personnalité qui marque la différence, sans doute à cause de ces touches Black de-ci de-là.
Côté pile on a de la maîtrise instrumentale. Les claviers sont barrés comme un film de SF (Abbath’s Psychedelic Breakfast). On déniche des atmosphères boueuses façon lap steel (“99 weed Balloons”; “Girl Scout Cookie Monster”) avec des boucles à la Weedeater (“99 weed Balloons”) et des riffs lourds et répétés à l’envie. On ingère la galette comme une poutine (En 38 minutes environ) et cela reste très appétissant tout du long grâce à un format court.
Du côté de l’artwork Tons poursuit dans la ligné du premier album “”Musineè Doom Session Volume 1”(Sorti en 2012) ou figuraient déjà soucoupes et triangles mystiques, ce second opus installe donc la signature graphique du groupe. Cet album ne fera sans doute pas date dans l’histoire du Sludge, cependant et c’est là l’essentiel il est sans fausse note et on ne boude pas son plaisir en riant avant l’écoute et en planant lors de celle-ci.

Venu tout droit de l’Oregon, ce quartet vient de sortir son tout premier album éponyme chez RidingEasy Records. Comme le laisse deviner la typographie sur la pochette aux couleurs surannées, Blackwater Holylight prend racine dans un terreau highly seventies, âge d’or du psychédélisme of course. Cet album ne devrait donc pas décevoir ceux tournés vers le passé et pour qui c’était mieux avant.
Les membres de BHL (pour éviter toute confusion, on vous rappelle que cet acronyme fait bien référence à Blackwater Holylight et non à l’humoriste français bien connu) savent composer des chansons entêtantes et comptent bien nous le faire savoir. Pour exemple, « Willow » ou « Wave Of Conscience », aux riffs extrêmement simples, répétitifs, mais parfaitement efficaces, sont de vrais réussites que vous garderez longtemps en tête. Cette façon sournoise de balancer un riff clean qui ne paye pas de mine mais qui s’insinue en douce au plus profond de votre crâne nous fait penser aux Black Angels, ou encore au Brian Jonestown Massacre.
BHL partage d’ailleurs avec ces deux groupes de rock psychédélique le côté garage, avec un son poussiéreux et une fuzz bien dosée. Car oui, les amateurs de grosses guitares bien lourdes ne seront pas non plus en reste, comme avec le titre « Slow Hole » , le titre le plus lent et pesant de l’album, ou bien sur « Sunrise » et son envolé à mi parcours. Toujours dans un registre très psyché, le titre « Carry Her » nous fait presque penser à de la cold wave, avec une batterie métronomique et sans vie accompagnée d’une guitare glaciale.
Les 4 filles dans le vent (BHL est un groupe 100% féminin, fait malheureusement assez rare pour qu’il soit signalé) de l’Oregon nous pondent ici un album qui ne révolutionne pas grand chose, ce n’est de toute façon pas son ambition, mais ma foi bien sympathique et loin d’être ennuyeux. Les 8 titres de BHL passeront comme un buvard sous la langue et vous n’aurez pas vu le temps passer. Si vous aimez la fuzz et le rétro vintage, foncez !

Sorti il y a plus d’an et passé un peu inaperçu, le premier EP de IAH a tout de même fait son petit bonhomme de chemin et aura su charmer les oreilles de Kozmik Artifactz puisque le label nous le ressort agrémenté de deux titres bonus (sortis six mois après l’EP et regroupés ici sur la même galette). Et c’est ma foi une bonne nouvelle et une belle opportunité autant pour eux que pour nous.
Les argentins de IAH nous délivrent un stoner rock psyché entièrement instrumental de très bonne facture et il n’est pas étonnant de voir un label s’occuper de distribuer enfin correctement leur production. Ils ne révolutionnent pas le style mais y apportent une belle pièce très agréable à écouter, bien produite, sans réel défaut et qui surtout, laisse espérer l’émergence d’un nouveau bon groupe dans ce style.
Si vous êtes à la recherche de nouveauté totale, de sons inédits et d’une claque musicale, ce disque ne comblera pas vos attentes. Par contre si vous cherchez de quoi avoir votre dose quotidienne d’instru psyché bien foutu, alliant compositions variées et riches avec quelques solos bien sentis, voilà un disque qui vous intéressera.
Privilégiant dans l’ensemble le côté planant du style en limitant les incartades noisy ou lourdes, IAH sait tout de même parfois se régaler d’un son un peu gras. En ce sens vous pouvez découvrir le groupe en allant écouter le troisième titre, “Stolas”, qui résume assez bien la palette musicale du groupe.
IAH pose donc là la première pierre d’un édifice qu’on espère se voir construire avec toujours autant de sérieux et laisser entrevoir une marge de progression qui pourrait bien dans les mois et années à venir faire ressortir ce groupe du lot.
Point Vinyle :
Kozmik Artifactz nous propose de bien jolies galettes. Outre le vinyle noir limité à 100 exemplaires, on trouvera aussi un très beau vinyle marbré bleu/rouge/blanc limité à 200 exemplaires, les 111 premiers étant numérotés à la main.
|
|