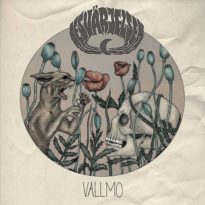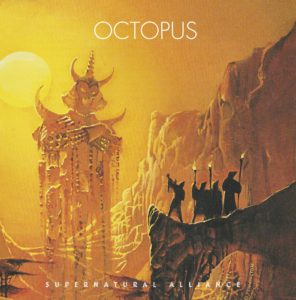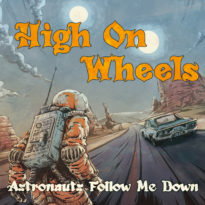|
|

Salut à toi cher lecteur/chère lectrice. Alors il parait que tu recherches un nouveau truc à écouter. Dis moi tout ! J’ai plein de bonnes choses en stock.
Un truc franchement inspiré début 70’s ? Ok, j’ai ça.
Un power trio au son un peu gras, mais pas trop? Hum… voyons voir…
Quoi? Tu veux des bons riffs, une batterie solide et une basse qui se défend? ok ok mon ami(e), je cherche.
Un truc pas trop prise de tête, bien fait et bien solide? No problem, je commence à voir ce qu’il te faut.
Une voix qui sonne vraie, sans chichi ni artifice superficiel ? Et bien je vois que tu sais exactement ce que tu veux!
Hein? Tu cherches un disque sans temps mort et avec un max de temps forts ? Un album où on ne zappe aucun titre ? Et dis, tu me donnes un challenge là !
Mais pas de souci, j’ai ça.
Blacklight Barbarian tu connais ? Non ? Pas encore ?
Et bien tu me donnes une bonne demi heure et je suis certain de te convaincre de l’absolue nécessité pour toi d’acheter ce disque ou de le télécharger sur leur bandcamp. J’en suis sûr car figure-toi que cet album répond positivement à toutes tes demandes et même plus.
C’est du tout bon de la première à la dernière seconde et franchement ça fait plaisir de voir des groupes se sortir les tripes comme cela pour nous pondre un album authentiquement rock.
Hein ? Comment tu as pu passer à côté de cet album?
Ah la la… tout le monde me dit ça… Mais maintenant que tu connais, n’hésite pas à prêcher la bonne parole et à faire découvrir ce groupe à tout ton entourage, à ta famille, à tes collègues.
Et tiens, comme je suis sympa, je te donne le lien bandcamp pour que tu puisses acheter l’album et même l’écouter autant que tu veux!
https://blacklightbarbarian.bandcamp.com/
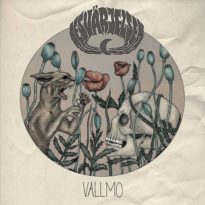
Les suédois de Besvärjelsen (à vos souhaits – qui est le génie du marketing qui s’est dit qu’un groupe ainsi nommé aurait plus de facilité à conquérir un public international ?!) ne sont ni tout jeunes ni très anciens non plus… en tout cas sous cette forme. Le quintette s’est formé en 2014, et a déjà sorti une paire de EP par leurs propres moyens, sans faire trop de vagues. Depuis quelques semaines, le petit cercle promotionnel doom/stoner bruisse de ce nom imprononçable, à gands coups de « avec des anciens Dozer et Greenleaf dedans, entre autres groupes ». Calmons les ardeurs. Certes, l’on retrouve sans déplaisir une des sections rythmiques de Dozer (le bassiste Johan Rockner vient d’intégrer le groupe, rejoignant le batteur Erik Bäckwall qui officia effectivement un temps chez la merveille de Börlange). Mais pour le reste, quelques zicos dont le CV comporte une mini collection de groupes suédois plutôt très underground, pas matière à vendre Besvärjelsen comme un groupe de « all stars » non plus…
Plus dubitatif qu’enthousiaste, on se plonge dans ce disque avec l’envie d’en savoir plus. Les premières écoutes désarçonnent. Chant féminin en suédois (sauf deux titres en anglais, mais avec un fort accent), sons doom, plans dark, structures parfois prog, mélodies limites stoner, ambiance quasi-folk ici ou là… Tout se mélange. Faut dire que « Besvärjelsen » signifie en quelque sorte « Incantation », et effectivement tous les genres musicaux liés à l’occulte ne sont jamais très loin. Après plusieurs écoutes, c’est moins confus, le tout formant quand même quelque chose de plutôt cohérent, voire consistant.
Le constat a priori plutôt contrasté dans les premières écoutes laisse donc progressivement place à une impression plus favorable. D’autant plus qu’au fil des écoutes, la qualité mélodique de l’ensemble émerge progressivement, en particulier sur les lignes vovales de Lea Amling Alazam : sans être une chanteuse à la technique vocale remarquable (on pense très fort à une autre chanteuse suédoise que nous affectionnons tant… Cœur avec les mains) force est de reconnaître que ses mélodies vocales sont très efficaces (« Röda Rummet », « Falsarium »). Globalement les compos sont au rendez-vous et l’interprétation de bon niveau : l’ensemble est varié et dynamique (on passe du rapide et percutant « Öken » au très doom « Return to No return », en passant par un très bon « Alone » de plus de 10 minutes, un titre vallonné et sinueux qui rappellera occasionnellement les derniers Greenleaf) et laisse à chaque fois une bonne place aux instrumentistes (notamment à travers quelques soli efficaces, par exemple sur « I Skuggan Av Ditt Mörker »).
Niveau production, le compte n’y est pas totalement, la mise en son étant souvent un peu le cul entre deux chaises, entre la volonté d’une rondeur massive et diffuse plutôt doom, et l’exigence de clarté des influences plus atmosphériques de la musique du groupe. Quelques choix d’arrangements un peu douteux apparaissent aussi ici ou là, plutôt le fruit d’une mauvaise inspiration (ex : ces chœurs très « QOTSA nouvelle époque » sur « Mara », le refrain braillard mais un peu trop fluet instrumentalement de « Röda Rummet »…). Mais rien de trop pénalisant non plus…
Besvärjelsen propose finalement un premier album plus intéressant que ne le laissaient présager les premières écoutes et les speeches promo un peu pompeux et volontaristes. En proposant une musique riche, un peu exigeante sans être rebutante pour le profane, le groupe pourrait voir une petite fan base se constituer autour de sa démarche et construire un début de carrière que nous suivrons de près. Un bon début, à confirmer.

Qu’est ce qui peut pousser un chroniqueur de ce site à écrire sur un EP de trois titres sorti en autoproduction sans sollicitation du groupe ?
Et bien le coup de cœur tout simplement !
Brunt est un groupe que j’ai découvert un peu au hasard, vous savez avec les différents sites qui vous conseillent tels ou tels groupes suivant vos statistiques d’écoutes. Parfois cela n’aboutit sur rien de concluant mais il y a aussi des moments où cela vous permet de découvrir un groupe qui vous était jusque-là inconnu et qui retient votre attention. C’est le cas avec Brunt, trio instrumental originaire de Guernsey.
Trois titres qui tournent chacun autour de 9 minutes, autant de belles pièces bourrées de bonnes intentions et qui font naître un certain espoir pour l’avenir.
Un bon mix de psyché teinté de doom le tout saupoudré de sludge à l’arrière-gout drone. Oui je sais, je vous vends du rêve mais quand on veut que son coup de cœur suscite l’intérêt, il faut bien exagérer un peu non ?
Je ne suis pas en train de dire que Brunt révolutionne tout et que c’est le groupe de l’avenir. Je vous dis juste que Brunt pourrait si le temps leur en laisse la possibilité, révolutionner le genre et être le groupe de l’avenir.
Pour le moment le groupe fait ses gammes. Nous sommes en terrain connu et déjà parcouru mille fois par mille autres groupes. Mais le boulot est bien fait, l’identité sonore se construit et l’indéniable envie de bien faire est évidente.
Brunt est un groupe à surveiller et j’attends la suite avec impatience.
Le lien bandcamp
Point Vinyle :
300 magnifiques galettes marbrées (orange et bleue) épuisées au moment où vous lisez ces lignes.
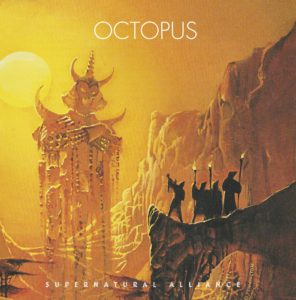
Parmi la myriade de groupes qui se nomment Octopus, allant de l’inoffensif jazz de salon au virulent Djent de garage, un en particulier navigue à proximité du territoire stoner. Il emprunte en vérité bien davantage au rétro rock et au psyché qu’autre chose, et saura sans doute charmer les amateurs d’énergie vintage.
À l’origine, la chanteuse Masha Marjieh et l’ancien guitariste d’Electric Six : J. Frezzato forment le groupe en provenance de Détroit courant 2008. Afin de partir en quête, ils ajouteront un an plus tard le clavier d’Adam Cox avec qui ils réaliseront quelques singles. Puis il faudra attendre l’arrivée des hardis Matt O’Brien et Todd Glass, respectivement armés de basse et de batterie en 2012 pour compléter la compagnie.
Avec Supernatural Alliance, les Américains nous embarquent dans une campagne se voulant épique et pleine de rebondissements. On glisse entre de franches pièces d’Heavy rock avec des riffs à la Black Sabbath et des constructions DeepPurplesque, comme en témoigne « The Unknown » ou « The Center », à de douces balades aux portes de l’onirisme comme « All the love ». À la découverte de « Child of Destiny », on comprend que le côté psyché du mélange est assuré par le clavier, là où la guitare se contente de faire ce qu’elle sait faire de mieux, à savoir estampiller à grand renfort de riffs son appartenance à la sacrosainte époque des seventies.
La thématique de ce premier album est guidée de bout en bout par la Fantasy, notamment grâce à des titres comme « Sword and the stone » et « Dragonhead ». Le genre va même jusqu’à imposer sa marque sur la pochette de l’album avec un artwork tout ce qui existe de plus évocateur.
À bien des égards, tous les amateurs du propos vintage, qui semble très en vogue en ce moment, trouveront leur bonheur dans ces dix chapitres alliant bonne composition et richesse d’écriture. Une épopée tant dans l’univers des groupes d’un autre temps que dans celui des romans de série B de notre enfance.

Rapide, brutal et technique, tel était Ricky “The Dragon” Steamboat, légende du catch de la fin des eighties. Rapide, brutal et technique, tel est “Ricky “The Dragon” Steamboat”, morceau qui ouvre cet Equilibrium, le quatrième opus de la saga Gozu.
L’auditeur est donc tout de suite dans le bain, projeté dans les cordes et recevant une belle savate dès la première des huit pistes qui composent cette galette. Vous l’aurez compris, Gozu revient pour en découdre sérieusement. Mais attention le gang de Boston ne cherche pas le KO immédiat. La preuve avec le deuxième titre, “The People vs. Mr. T”, sur lequel le groupe ralentit le rythme. Le morceau, servi par un riff lourd et puissant est rutilant à l’image de la quincaillerie portée par le bonhomme.
Déjà sonné après à peine dix minutes de musique, et Gozu qui poursuit son travail de sape. Avec son riff d’intro qui tourne en boucle, et le timbre posé de Mark Gaffney, “King Cobra” vient clairement lorgner du côté d’un Soundgarden. Et tandis que l’on se laisse docilement entraîner vers Seattle par le combo de Boston…..ce dernier nous rattrape sauvagement par le colback et nous ramène sur la côte est où un matraquage en règle nous attend.
Car c’est là que réside tout l’art de Gozu : réussir à nous maintenir captifs de ses grands écarts et à nous balader au gré de son humeur. La section rythmique Grotto/Hubbard, en ébullition permanente, tient la baraque à bout de bras. Ces fondations solides permettent ainsi à Doug Sherman de poser ça et là des soli incroyablement incandescents comme celui, sorti de nulle part, de “Manimal”. L’alchimie est parfaite.
Les coups pleuvent. Manchettes et clés de bras s’enchaînent, et l’auditeur étourdi ne sait plus où donner de la tête. Après une grosse demi-heure de groove et de démonstration technique, le moment est propice à l’assaut final. Entre riffs diaboliques et rythmique assassine, “Stacy Keach”, figure légendaire des séries télévisées, va nous essouffler puis grimper sur la troisième corde, venir se jeter droit sur nous et nous aplatir comme une crêpe.
L’heure est venue pour les bostoniens de venir clore les débats, comme à leur habitude, avec un morceau long. Durant les trois premières minutes de ce “Ballad of ODB”, Gozu vient mettre un pied dans un terrain où reverb et incantations mystiques se tirent la bourre. C’est ensuite au tour de la voix irrésistible de Gaffney d’entrer en scène et de nous attirer dans ses filets, telles les sirènes avec les plus valeureux des marins. La prise de soumission est parfaite et, après ces onze minutes, nous sommes à terre au centre du ring, les deux épaules rivées au sol et complètement groggy. 1, 2, 3 : le gong retentit. Gozu est déclaré vainqueur de ce match à sens unique.
Le groupe reste un véritable ovni dans la scène stoner, scène dont il semble s’éloigner lentement mais sûrement pour se tourner vers une obédience plus metal. Et contrairement au catch, Gozu c’est pas du chiqué ! Cet Equilibrium, tout aussi riche que ses prédécesseurs, profite pleinement de la stabilité du line-up du combo depuis maintenant quelques années. Nous ne saurions donc trop vous conseiller d’aller écouter le groupe si vous ne le connaissez pas déjà, et de vous jeter avidement sur cette nouvelle plaque de qualité. Gozu a trouvé son point d’équilibre.
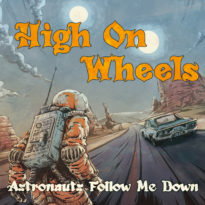
Un esprit à la Mammoth Mammoth, un humour gras et sans gêne, High On Wheels est un power trio Parisien découvert l’an passé en première partie de Geezer. Leur prétention ? Faire du Stonaire et prêcher la bonne parole Doume !
Le son sent le bon vieux blues oui, mais avec quelques pulsations en plus dans le cul histoire de ne pas s’endormir. Leur premier EP, « HoW » était sorti en 2015 et j’attendais patiemment la sortie du nouvel album Astronauts Follow Me Down. Je n’ai pas été déçu par un enregistrement studio Live qui colle tout à fait à l’esprit du groupe et en délivre toute l’énergie. Le rythme effréné sait devenir pesant comme une marche sous le soleil du désert, on étanche sa soif et on repart de plus belle.
La gratte est souvent fuzzy, les rythmes à la limite d’un esprit punk donnent une dimension corrosive et pêchue à l’ensemble. La galette est émaillée d’extraits sonores historiques, marche militaire, extraits de films ou enregistrements de la NASA et permet le voyage dans les thèmes de l’univers du groupe. Le trio ne donne pas dans la dentelle, les compositions sont livrées brutes et palpitantes. Côté influences, on passe du Kyuss au Red Fang ce qui ne fait pas bondir d’originalité et même si il y a encore quelques faiblesses du côté de la maîtrise, le plaisir pris est réel, l’essentiel est donc là.
Finalement la cinquantaine de minutes que dure l’album se digère agréablement, haut perchée sur les roues du bolide. Donc si tu vois passer sur les routes de ta campagne une Mustang 67 montée en Low Rider avec un cosmonaute à l’arrière, fonce, c’est que High on Wheels joue pas loin de chez toi.

L’élément eaux est une intarissable source d’inspiration au sein du microcosme des musiques énervées. Entre Ahab et ses obsessions pour l’œuvre d’Herman Melville, Sulphur Aeon, l’album Leviathan de Mastodon (d’aucun diront leur meilleur) et bien évidemment toutes les références à Cthulu, les exemples ne manquent pas. A sa façon, Messa fait partie du club, calquant son tempo doom et ses préoccupations jazzy sur l’inquiétant clapotis d’une eau endormie. La pochette de Belfry, leur premier album, montrait d’ailleurs le beffroi du lac de Resia, édifice dressé au milieu de la vaste étendue liquide.
Formé en 2014 à Cittadella, le quatuor italien honore les grands aînés du doom, avec des riffs bas du tempo et, par la voix envoutante de sa chanteuse, s’invite à la table de ceux et celles qui parent l’occulte de pourtours enchanteurs, aux côté de Jex Thoth, Windhand ou Mammoth Weed Wizard Bastards. Mais ce n’est pas tout. Quelque chose attend, tapi dans les profondeurs. Quelque chose de jazz. Le saxophone sur « Blood », l’une des grandes réussites de Belfry annonçait déjà la couleur et Feast For Water se retrouve à l’exacte confluence des genres.
L’album s’ouvre sur « Naunet » (déesse égyptienne de l’eau) et suit le cours agité d’un fleuve en crue, amarrant son talent le temps de deux grands moments, mêlant le doom le plus pur à un irrésistible torrent de jazz : « Leah » et « The Seer » (ce riff mais ce riff !). Deux perles qui ne sauraient pourtant masquer la profondeur de ce disque, que Messa inonde de sa classe morceau après morceau. Serpentant agilement entre nos émotions, « She Knows » s’écoule paisiblement puis débouche sur « Tulsi » alternant entre cascades métalliques et ruissèlement jazz, écoulant son émotion par quelques jets discrets de saxophone en fin de titre. Loin des berges de la tradition, la musique de Messa est un geyser de libertés jazz, parfois drone, souvent heavy, toujours brillant. « Da Tariki Tariqat », instrumental s’égrainant sur quelques notes sensibles, clôture ce superbe album par les parfums d’un ailleurs, par delà l’estuaire, apaisant le bouillonnement d’idées par lequel Feast For Water est traversé.
Qui aurait cru que le doom, musique sédimentaire réticente à toute idée de modernité s’offrirait une telle jouvence et qui aurait cru que la vague viendrait d’Italie ? Qui aurait pensé que c’est traversé par le jazz que ce genre si conservateur s’offrirait un nouveau (ultime ?) tourbillon artistique ? Feast For Water est un album que l’on peut placer, sans trop se mouiller, parmi les plus grandes réussites de l’année.
Point Vinyle :
Aural music l’a joué sobre : 200 disques en orange/black. Le reste en orange. De quoi nager dans le bonheur.

« J’en appelle aux forces infernales, Behemoth, Astaroth, Azazel ! Je vous invoque !
– Si ? Ciao !
– Hein ? Bordel, mais vous ressemblez vachement aux mecs de Black Rainbows !
– Normal, c’est nous, venus tout expliquer aux mortels sur les mondes infernaux le 6 avril avec la sortie de notre sixième album, “Pandaemonium” et nous t’en offrons la primeur, toi qui nous lie par la connaissance de nos vrais noms. »
Voici donc cher lecteur comment m’est arrivée cette œuvre diabolique à l’efficacité démoniaque. Le Fuzz des morceaux est toujours bien là et il est toujours aussi prenant, si “Sunrise” est une attaque velue, elle reste bien tranquille au vu du reste de l’album mais déjà transpire la référence à Fu Manchu. Dès le second morceau “High to Hell”, la basse vient nous rappeler que le trio est maître de l’accord gras et lourd et elle pose toute la puissance et l’agressivité du groupe à l’instar du son d’un Kadavar dans ses moments les plus énervés. Le chant nasillard et rugueux à la fois de Gabriele apporte toujours la couche psychédélique magistrale qu’on attend des Black Rainbows et le nouveau batteur Tommaso Moretti délivre une frappe ferme et lourde là où son prédécesseur (victime de problèmes de santé) avait la baguette plus sèche, le groupe y a donc gagné au change ce qui n’était pas évident.
“The sacrifice” m’a giflé tout du long comme une descente de bobsleigh au sein de l’Enfer de Dante. Pandaemonium est un album qui s’écoute à plus de 150 à l’heure (Ami lecteur, essaye sur l’autoroute, tu verras) et même si j’ai eu un temps d’arrêt sur “Grindstone” qui est un morceau où l’on hésite entre la retenue et l’atteinte des limites vocales de Gabriele, on se laisse prendre par les bandes sons
retravaillées en loop qui nous plongent dans une atmosphère de folie. C’est donc peut-être finalement un effet voulu que cette impression de douleur vocale car elle justifie le titre de l’album et à la réécoute ce titre est d’une sensibilité incroyable et d’une intensité folle. Du côté du mixage, “Riding Fast Till The End Of Time” permet d’en apprécier tout l’équilibre, chacun trouve sa place lors de l’audition et on appréciera une guitare addictive avec des Solis que l’on aimerait sans fin au sein d’une composition pleine de maestria et de puissance.
L’album clôture avec deux morceaux notables, “The Abyss” qui est une possession rythmique, de celles où le corps devient esclave de la musique et laisse une empreinte sur l’esprit. Enfin “13th Step Of The Pyramid” nous fait gravir le Pandémonium et nous met à genoux pour adorer Méphistophélès tout puissant. L’atmosphère de ce titre de clôture est si lourde une fois de plus grâce à la basse, qu’on flirterait presque avec des rythmiques Doom.
Au final cet album confirme la place de Black Rainbows dans le panthéon du Heavy Psych et du Fuzz, une place de choix qu’ils défendent bec et ongle, considérant qu’ils ont livré avec Pandaemonium leur album le plus complet et ce n’est pas moi qui remettrait cette perception en question! Sur ce, je vais aller me repasser l’album à l’envers et signer mon pacte avec nos trois Démons…

Ça fait un bail maintenant que la maison Desert-Rock.com suit les pérégrinations musicales de la bande de Virginie et franchement, même si pas toujours hyper emballés je le concède, nous n’avons jamais été déçu par ces Ricains qui suivent une ligne fort cohérente depuis le début de leur carrière. Il y a les groupes qui évoluent, ceux qui nous déçoivent et ceux qui confortent années après années l’intérêt que nous leur manifestions à nos débuts : Freedom Hawk fait clairement partie de cette dernière catégorie. C’est un brin rassurant d’ailleurs dans ce présent devenu liquide de pouvoir s’accrocher à du solide presque aussi vieux que notre site (c’est dire si nous n’avons pas affaire à des rookies ici !).
La continuité et la continuation sont de rigueur avec Beast Remains qui évolue dans un style que les Étasuniens maitrisent à merveille : du stoner rock heavy très abordable avec de gros riffs à la Black Sabbath et des soli hérités des glorieuses eighties. Pas de grosse prise de risque donc pour la suite de « Into Your Mind », mais une inflation en ce qui concerne la qualité générale des titres puisqu’en misant sur un alignement congru – huit titre et la messe noire est dite – il n’y a pas de déchet (même si je suppute que toutes les plages ne sont pas vouées à devenir des standards du rock estampillé stoner).
La fluidité de cette production, fort homogène, en fait un tout fort agréable non seulement à la première écoute, mais aussi lors des suivantes. Alors bien évidemment, les grincheux avanceront le fait que Freedom Hawk ne révolutionne pas le genre avec cette plaque et c’est correct, mais cette dernière vaut son pesant d’arachides tant la science est maîtrisée dans tous les registres empruntés. Avec le titre éponyme, la formation US sait ralentir le tempo pour aller flirter avec l’œuvre de la bande d’Iommi (et je me réfère ici aux albums de mon enfance dans les années soixante-dix ou septante selon votre provenance) tout en gardant une identité propre avec une ligne de voix qui ne singe pas les tout grands, mais se déploie dans son spectre concis usuel (et donc confortable) ; le lustre des riffs bien fuzzés saupoudrés sur ce savant mélange lui donnant un rendu final fort actuel. Avec « Deep Inside » nous rejoignons presque la planète hard rock des quatre-vingt glorieuses : riff efficace répété durant presque 4 minutes, tempo rapide et solo de guitare bien chiadé. Cette ambiance se prolonge par ailleurs avec « Coming After You » qui lui emboîte le bas.
Toute ces jolies choses se terminent au bout d’une quarantaine de minutes sur « Champ » qui fait péter le bouchon avec une retenue plutôt plaisante durant 6 minutes et se termine en feu d’artifice avec juste ce qu’il faut d’énergie débridée pour inciter l’auditeur à commander une nouvelle tournée du millésime 2018 de Freedom Hawk.
Si ça vous intéresse, allez donc poser vos oreilles sur « Danger » – le second titre – qui est carrément mortel : le riff de base a le potentiel de faire mouiller leurs petites culottes aux – indécrottables – fans des Pères Fondateurs de Birmingham ; c’est clairement la plus belle réussite d’une plaque qui en est définitivement une. Les nombreuses prestations à venir sous nos latitudes du groupe de la Côte Est devraient endiguer une nouvelle vague d’apôtres de sa bonne parole car il le mérite amplement. Cette sortie pourrait bien permettre aux Virginiens de propager leur son en-dehors du cercle des initiés qui sont déjà acquis à leur art traditionnel !

Quand on a appris que Guillaume et Benjamin Colin, rien moins que la charnière rythmique de Abrahma, se lançaient dans un projet musical en duo, forcément on a suivi le projet de près. Petit à petit, WuW a commencé à construire l’imagerie du groupe-projet, énigmatique et dark, teasant quelques extraits sonores froids et brumeux, annonçant des titres de chansons post-pétiques intrigants, et dévoilant un artwork travaillé, en osmose avec le fond musical… Pas plus d’infos, on se jette donc dans ce LP sans idée préconçue, comme un saut vers l’inconnu.
WuW produit un mélange de plusieurs genres musicaux proches, pour finalement aboutir à un disque cohérent. Difficile de dire que ce n’est pas ce que l’on attendait : on ne savait pas à quoi s’attendre ! 100% instrumental, l’album se situe dans un environnement musical où vont se mêler plans ambient, doom, indus, post-machin, etc… Le gros du travail porte sur l’ambiance, avec des compositions qui sont autant d’histoires sonores et de parcours émotionnels. Prenez “Pour ce qu’il en restera » qui introduit l’album à l’occasion d’un fade in prenant, avec son élégante montée en régime et ses changements d’ambiance, en tension d’abord puis plus détendue sur la fin. On peut l’associer en miroir à “A l’écart des chemins fatigués de nos habitudes », finissant le disque sur un fade out gracieux, qui commence très oppressant et finit tendu, comme un élan de pessimisme dur et froid.
Le reste de l’album est expérimentations et parcours mélodiques dans la même tendance, où se mêlent des plans de tous horizons, sonorités ésotériques, teintes orientales (« Vivre à la splendeur des crépuscules »), plans quasi-Tooliens (« Voir en même temps l’humour et la tragédie, en toute chose, à chaque instant »), et plus largement recherches sur le son : entre sons de guitare ou de basse travaillés et délires bruitistes (« Une barque sans rames »), tout y passe.
On sort de l’album étonné, un peu déstabilisé et agréablement surpris par la démarche intellectuelle, quasi-poétique de l’objet. Il y a de l’audace, de l’envie et de l’inspiration derrière. En revanche, prévenons nos lecteurs les plus assidus : côté guitares, on n’est pas dans un assaut doom en bonne et due forme, loin s’en faut. Plus d’une fois l’on se prend à attendre le débarquement d’une légitime armada de grattes, d’autres fois l’on imagine au détour d’une intro oppressante la libération venir d’une grosse disto, puis plus loin au détour d’un break reposant se manger en pleine poire un mur d’amplis… Mais rien de tel. En même temps, la promesse n’est pas trahie et le disque reste très intéressant, pour un public ouvert d’esprit.

En dix ans d’existence, les cinq graisseux d’Ilsa ont roulé leur bosse dans des sphères essentiellement underground, pondant quatre galettes bitumeuses pour des labels obscurs, ainsi qu’une poignée de splits, avec des invités qui donnent un peu le ton de leur musique (Hooded Menace, Seven Sisters of Sleep, Coffins…). Les voir atterrir direct chez les seigneurs Relapse a quelque chose d’étonnant, et en même temps (!) pas illégitime.
Pour leur première sortie “exposée”, sur un gros label, les gaillards veulent en mettre plein la gueule et ne laissent rien au hasard : Corpse Fortress est à la fois l’album-somme et la quintessence de leur parcours musical. Se l’enfiler d’une traite est un effort : le disque nous embarque comme si on était accroché au pare-choc d’un gros camion de chantier lancé dans un terrain boueux et rocailleux, dont on finirait démembré après trois gros quarts d’heure de dérapages au frein à main dans la boue et le gravier. Chaotique, sombre, graisseux, sale, physique… L’expérience est marquante.
Musicalement, la musique d’Ilsa n’est pas monolithique : on y côtoie une large proportion de doom bien froid (à la Hooded Menace, on y revient…), de bonnes doses de sludge plombé (tendance Noothgrush), mais on peut aussi y rencontrer Mantar (le terrible “Ruckenfigur”, parfait, le riff de “Nasty, Bruitish”, évidence, ou “Old Maid”), ou encore des groupes comme Winter pour les plans les plus death/doom (“Cosmos Antinomos”, lardée de blast beats, “Polly Vaughn” aux relents de My Dying Bride), voire des thrasheux pur jus (“Prosector” démarre pas trop loin des vieux Slayer, tout comme le refrain de “Long Lost Friend”). Aucune linéarité, on se laisse bousculer par chaque titre comme une nouvelle expérience, aux rythmiques variées, au service de compos matures.
Ça ratisse large, mais ce n’est quand même pas pour tout le monde. Le growl d’Orion, par exemple, va clairement rebuter les inconditionnels de Blues Pills. Soit ; c’est sûr que ça décape un peu. De même, les assauts de guitare, notamment les segments les plus incisifs en harmonie, devraient défriser les inconditionnels mono-maniaques de jam bands psyche. Soit. Enfin, la prod, au service du gras avant tout, risque de ne pas satisfaire les amateurs de jazz prog au son cristallin. Soit encore. Mais si on aime le côté obscur de la force, si on aime pousser l’expérience doom dans ses retranchements, que les pans musicaux les plus extrêmes ne font pas peur… Alors là, le terrain est propice et on peut se considérer prêt à encaisser ce disque. L’expérience vaut d’être tentée. On n’en ressort pas complètement indemne, évidemment, mais on a hâte d’y revenir. Du lourd.

Il nous arrive de temps à autre de chroniquer des albums un peu en dehors de notre (déjà large) ligne éditoriale habituelle. La raison principale qui nous pousse à ce genre de chroniques, c’est la plupart du temps un membre du groupe qui a déjà officié dans un combo résolument dans nos styles favoris. Je vous présente donc Avon et son deuxième album Dave’s Dungeon. Avon, c’est Alfredo Hernandez à la batterie, le voilà le fameux lien qu’on ne présente plus.
J’avais eu l’occasion de chroniquer la dernière collaboration de monsieur Hernandez au sein du groupe Black Black Sea en 2014 sans être pleinement convaincu. Me voici ici avec une toute autre opinion.
Mais (re)situons un peu les choses. James Childs et Alfredo Hernandez se connaissent depuis un petit moment déjà. Car oui les plus attentifs auront reconnus là deux membres de Vic du Monte’s (Idiot Prayer/Persona non Grata). Durant une tournée européenne de Vic du Monte’s Persona Non Grata, ils ont l’occasion de rencontrer Charles Pasarell, alors membres de Waxy (on tourne du côté du desert rock là même si le gars fait aussi du punk rock).
De cette rencontre va naître Avon qui sortira son premier album, Mad Marco, en 2016. Passé un peu inaperçu malgré ces qualités indéniables, le groupe ne se décourage pas pour autant et nous offre donc un deuxième album et mes amis, c’est du tout bon.
Même si l’affiche de la tournée nous estampille le groupe dans la catégorie « Desert Rock », soyons honnête, ce serait plutôt Rock tout court. Mais voilà un trio basse/batterie/guitare des plus classiques qui peut clamer haut et fort savoir ce que c’est que le Rock. 10 titres et presque autant de pépites. Hero with a Gun me semble un peu en dessous, sans pour autant gâcher la galette mais à part ça, c’est de l’excellent.
Yellow entame ce LP avec une énergie débordante et s’avère fichtrement efficace. Du rock teinté de punk, hyper bien arrangé. 2 minutes 10 rondement menées, solo compris. Un jeu de batterie bougrement sympathique et fourni, dans la meilleure veine de ce qu’a pu faire Alfredo Hernandez par le passé, une guitare enragée qui semble se lâcher après avoir été retenue des années et une basse aux petits oignons qui vous réhausse le tout chaudement. Les arrangements et petits ajouts ainsi que le chant sont parfaitement maitrisés. De la belle œuvre à n’en pas douter.
Vous appliquez grosso modo la même recette en augmentant ou diminuant le coefficient punk au reste des titres et vous avec au final un album qui s’écoute, se ré-écoute et s’avère être la pépite rock surprise du premier trimestre 2018.
Je vous ajoute à cela une qualité de production supérieure à celle du premier album et particulièrement agréable aux oreilles et vous avez (enfin) là un groupe qui comblent toutes les attentes en matière d’album Rock bien pensé, construit et réalisé.
Vous aimez le rock ? foncez ! Tout simplement.
Point Vinyle :
Heavy Psych Sounds vous propose la galette en deux versions jaune ou noire.

Les deux premières sorties de Eagle Twin sont passées sous la plupart des radars. Et pourtant, l’aura du groupe auprès des autres musiciens ne se dément pas (citations, premières parties…). Gentry Densley, son fondateur, a toujours été, il faut le dire, très ancré dans les sphères d’influence underground les plus exigeantes, notamment au travers du projet Iceburn (derrière lequel il agglomérait de multiples musiciens autour d’un concept musical bariolé, piochant autant dans le punk que dans le metal, avec des structures prog ou jazzy bien barrées…). C’est en s’appuyant sur cette reconnaissance de ses homologues et cette légitimité qu’il monte Eagle Twin à la fin des années 2000, en s’associant au batteur Tyler Smith. Un duo, donc. Après un premier album (The Unkindness of Crows) un peu barré, assez expérimental dans son approche, mais déjà très lourd, le groupe se révèle avec The Feather Tipped The Serpents Scale il y a six ans, en apportant un objet plus construit, plus musical ; le début de « l’accessibilité » pour certains (« première marche vers le mainstream » pouvait-on entendre à l’époque… Légère exagération quand on écoute le bestiau, austère, froid et hermétique…). Cette troisième production nous intéresse donc au plus haut point.
En première approche, l’objet est dense : quatre titres posés là, comme quatre gros os à ronger. On s’attèle à la tâche avec la bave aux lèvres. Les premières écoutes, on le savait, sont dures, la musique intriquée, complexe et rugueuse du duo faisant un peu obstacle à la digestion. Mais petit à petit, les couches disparaissent et des strates d’une musicalité exceptionnelle se font jour. Densley n’est pas qu’un beugleur-gratteux généreux en décibels et en saturation. Le bonhomme, avec ses deux instruments, apporte une densité et une richesse exceptionnelles à sa musique. Par un travail du son d’abord (réputé pour construire son matériel seul – guitare, amplis, etc…), puis par ses compétences instrumentales : le spectre sonore couvert par ses instruments de destruction massive est dantesque, les riffs occupent toute la place, se fondent dans une démarche rythmique et mélodique superbement ciselée. Un travail d’orfèvre. Certes, le gaillard mixe parfois une ou deux lignes de guitare supplémentaires (le live sera le juge de paix – mais on sait déjà que c’est loin d’être leur point faible), mais la plupart des plans gardent le dépouillement instrumental attendu de la part d’un duo, sans que jamais ça ne fasse « trop léger ». Le reste, c’est du feeling : sons différents, styles de jeu variés, breaks dissonants, ruptures de rythmes, leads harmonisés, riffs bitumeux… Tout ce que 6 cordes, un peu d’électronique et beaucoup de talent peuvent proposer.
Mais son deuxième instrument est plus surprenant : ses vocaux, graves et rocailleux, en imposent. Mais sa technique diphonique est plus surprenante : le bonhomme développe un chant de gorge comme on n’est habitué à en entendre que dans des chants rituels (à l’image de certaines ethnies mongoles, tibétaines, etc…). L’usage (jamais gratuit) de cette technique vient apporter une touche quasi-spirituelle à certains passages, développant une atmosphère complètement inédite, à ma connaissance, dans ce genre musical (voir les premières minutes quasi-incantatoires de « Quanah Un Rama » qui donnent le ton de l’album, ou le refrain de « Elk Wolfv Hymn » pour un autre exemple d’usage subtil de la diaphonie).
Ainsi habillées, les chansons développent chacune leur propre identité, généralement structurées autour d’un riff fondateur : on est alors emmené dans des environnements tour à tout oppressants, jubilatoires, froids, chaleureux… bien aidés en cela par une mise en son appropriée, et une structure rythmique riche et propice à quelques soli discrets mais impeccables.
Pièce maîtresse selon votre serviteur, « Elk Wolfv Hymn » traîne sa classe sur plus de huit minutes de véritable beauté. Vous prenez un mix de YOB, de Neurosis et de Sleep, avec une touche de Earth (voire de Sunn o))) ), et vous commencez à toucher du doigt ce que ça peut donner. Plus classiques « Quanah Un Rama » et « Heavy Roof » restent délectables. Puis la galette se clôture sur le quart d’heure de « Antlers of Lightning », plus complexe encore que les autres. Porté par un riffing que ne renierait pas Greg Anderson, et cadré par la frappe martiale et brutale de Smith, le titre, épique mais sans jamais se disperser, fracasse, passant de plans quasi-atmosphériques à des coups de latte dans la nuque d’une brutalité sans nom.
The Thundering Heard, mis en perspective, suit quand même la logique portée par son prédécesseur : plus construit, plus solide, plus équilibré, le duo se perfectionne et touche à l’excellence. Ceux qui appréciaient le côté plus « barré » de leur musique pourront noter le changement, mais difficile d’imaginer que ça puisse occasionner une quelconque frustration, tant la qualité et l’efficacité sont au rendez-vous. Un nectar.

Autant vous prévenir tout de suite, le deuxième opus des Suédoises de MaidaVale n’a rien de bouleversant. Comme (trop ?) souvent en ce moment, on plonge, ou on se replonge, pour les plus vieux, dans les sonorités made in seventies et ce côté blues rock à la mode. Alors oui, c’est toujours mieux que de s’inspirer de la tecktonik (on vient de perdre les anciens) mais sans apporter une pointe d’originalité, on s’ennuie assez vite.
Madness is Too Pure nous propose tout de même quelques belles ballades teintées de fuzz et de crunch, où la voix de Matilda Roth nous emmène doucement vers de lointains espaces psychédéliques, comme sur « Oh Hysteria ! ». Grace Slick et sa bande d’aviateurs semblent si proches…
On flirte ensuite avec le côté rock, plus brut avec « Gold Mind » et sa rythmique basse/batterie simple au possible mais bougrement efficace. La prise de risque est quasi inexistante mais le groove est bon, c’est déjà ça.
Les parties instrumentales s’enchaînent pendant de longues minutes sur certains titres, dommage quand le groupe possède un potentiel vocal comme celui-ci. Les instrus font le boulot sans se mettre trop en avant, oscillant entre calme planant et délires fuzziens.
Il faut attendre la fin de l’album (« Dark Clouds » et « Another Dimension ») pour capter ces sonorités tribales que MaidaVale semble ne pas oser exploiter. Dommage, c’est un des rares moments où l’on perçoit cette légère pointe d’originalité.
Ne soyons tout de même pas trop mauvaise langue, ce deuxième opus est loin d’être inécoutable. Bien produit, bien pensé et surtout bien exécuté par les quatre Suédoises, Madness is Too Pure vous fera danser, tripper ou simplement hocher de la tête, avec ou sans LSD, mais ne passera pas complètement inaperçu. Une récente chronique de Desert-rock nous livre même au creux de l’oreille que les quatre nanas assurent carrément en live… C’est le principal.

Habituellement, les bougies et l’encens sont plutôt réservés à une séance de massage californien. Mais depuis peu, la panoplie de l’aromathérapeute s’est invitée chez une pléthore de groupes qui pensent pouvoir ainsi donner de la profondeur à leur musique alors qu’ils feraient mieux de poser leurs guitares et de sortir les huiles essentielles parce que, décidément, la musique n’est pas faite pour eux . C’est pour cette raison que je me méfie de la récente recrudescence de ces groupes jouant la carte de l’occultisme d’occasion, qui décident de jouer avec des capuches après avoir vu un documentaire sur Aleister Crowley. Ajoutez le mot « Buddha » au nom de votre groupe, et on fait un pas de plus vers le bord de la falaise du bon goût. Heureusement, II, le nouvel EP de Dark Buddha Rising sort chez Neurot Recordings, un label AOC 100% qualité certifié bio et sans OGM qui se plante très rarement sur la came. Ouf, sauvé.
Les cinq membres de DBR viennent de Tampere en Finlande et font tous partie de plusieurs groupes de tous horizons (notamment de Hexvessel, un groupe de folk psyché). Les gars partagent aussi leur salle de répét’ avec Oranssi Pazuzu. Bref, toutes ses infos moyennement utiles pour dire que la ville de Tampere est une ville très riche musicalement. II fait directement suite à la toute première sortie du groupe, logiquement intitulée, je vous le donne en mille, I. Pas con ces finlandais. II est un EP de deux titres sobrement appelés “Mahathgata I” et “Mahathgata II”. Comme le laisse comprendre l’imagerie du groupe, DBR évolue dans un univers sombre et psychédélique, où les morceaux s’étirent longuement et baladent l’auditeur entre coups de massue, hurlements et incantations divines. Le premier titre ne se base que sur un ou deux riffs, joués en boucle et rallongés jusqu’à l’atteinte du nirvana sonore. Le deuxième morceau laisse de côté le riffing pour développer une musique d’ambiance beaucoup plus méditative et planante, à gros renforts de multiples voix païennes chargées d’échos, de vibrations stomacales, de couinements pulmonaires et de bols chantants. Pour autant, impossible de se relaxer dans ce climat toujours inquiétant et oppressant.
Le premier titre de II reste finalement assez classique et on regrette un peu que le groupe n’ait pas tenté de creuser plus profondément le mélange entre le Tibet et l’Enfer. “Mahathgata II” est quant à lui plus convaincant, même si l’on quitte largement les frontières du doom pour entrer dans l’ambient. Un disque à moitié convaincant d’un groupe qui reste quand même à surveiller.
|
|