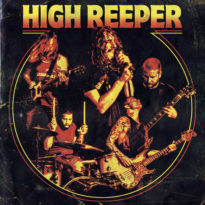|
|

Il y a un paquet d’années, je fis partie des nombreux quidams à se ruer sur Age Of Winters, le premier opus des Texans qui était un peu pour moi l’incarnation du mix parfait entre deux tueries sorties les années précédentes : Through The Eyes Of Heathens de Dozer et Leviathan de Mastodon. S’ensuit une autre production tirée d’un tonneau voisin : Gods Of The Earth qui fit rudement bien le job car empreinte de la même urgence. La fin du tiercé : Warp Riders, à la production plus soignée, amorça un changement de cap vers des compositions plus psychédéliques déjà un peu perceptibles sur la plaque précédente, mais en conservant le côté sévèrement couillu de la formation US.
Avec Apocryphon – qui a par ailleurs un artwork de grande classe internationale – les Américains ont définitivement tourné le dos au format bourrin qui leur allait pourtant si bien à leurs débuts (et ce n’est pas la chronique de leur dernier live que vous trouverez dans ces pages qui me contredira) donc j’ai aussi tourné le dos à ce groupe dont l’avenir semblait derrière lui. Autant le mentionner ici : ce n’est pas avec ce Used Future que le groupe effectue un retour en arrière puisqu’il persiste dans un registre psychédélique empreint de nappages synthétiques plus ou moins dispensables.
Avec 13 plages – en comptant les intros et autre intermèdes – et 44 minutes, The Sword assure le minimum syndical pour un groupe de cette pointure. Débutant par une « Prelude » faisant partie intégrante du premier titre « Deadly Nightshade », la bande de Ricains se commet dans le vintage psychédélique le plus banal et enchaîne directement par un titre du même acabit. Il faudra attendre la seconde partie du quatrième morceau pour que je commence à trouver un zeste d’intérêt à cette sortie qui embraie dans le style plus direct après avoir fait tourner un riff entre ambiance tribale et soirée de camp scout sous les étoiles. « The Wild Sky », puisque c’est ainsi que se nomme ce titre instrumental, revoit les fantômes de leur première production venir hanter la bande sonore avec un déluge de décibels qui fait bigrement du bien par où il passe.
La suite de cet opus oscille entre plans à la Vangelis et plans de la new wave of psychedelic stoner rock : c’est clairement soigné aux petit oignons, mais ça manque d’épices pour en faire une sortie vraiment indispensable sauf en ce qui concerne un deuxième instrumental plutôt sympathique et apaisé : « Brown Moutain » ; ces plus de cinq minutes – marquant presque déjà la fin de cette sortie – sont orchestrées autour d’un riff qui tourne et se décline jusqu’à obséder l’auditeur et elles me confirment que tout espoir n’est pas perdu pour que les lourds adeptes des premiers albums se voient un jour gratifiés d’une nouvelle sortie décoiffante de The Sword.
Les nombreux amateurs de sensations plus vintage se délecteront peut-être avec des plages comme « Sea Of Green » qui viennent un peu marcher sur les platebandes de Mr Cool ou de Graveyard de manière assez remarquable. Tant mieux pour eux : je passe mon tour sur ce coup-là !

Death Alley est un combo Néerlandais de Proto-Punk/Proto-Metal incorporant dans sa formule de nombreux éléments psychédéliques et space-rock fondé par Oeds Beydals, l’ancien guitariste de The Devil’s Blood. En quelques mots, ça joue vite (mais pas que), fort et c’est diablement efficace. Ajoutez à cela une solide réputation de groupe de live (vérifiée et approuvée par votre serviteur) pour obtenir un combo à la formule particulièrement attrayante.
Après son excellent premier album Black Magic Boogieland (2015) et le très Space-Rock Live at Roadburn sorti l’an dernier, le groupe, paré de sa nouvelle section rythmique, nous propose cette année son deuxième effort studio avec le tout nouveau, tout beau, tout chaud Superbia qui sort chez Century Media Records et que nous allons nous empresser d’analyser.
Constat immédiat : Death Alley choisit sur cet album de sortir de sa zone de confort et de faire évoluer sa formule en tentant une réelle prise de risque stylistique. Si les racines « revival » du groupe sont toujours présentes, on sent de sa part une volonté de s’extirper d’un schéma afin de proposer quelque chose de différent, moins roots que son prédécesseur, moins psychédélique que le live, mieux produit et peut-être légèrement plus taillé pour marcher (sans que cela soit nécessairement négatif).
Le chant de Douwe Truijens est, lui, toujours aussi efficace, le riffing de Beydals est toujours aussi riche et pertinent et les gimmicks habituels du groupe (morceaux proto-punk aux tempi rapides, longs passages space-rock, esprit rock’n roll qui pue le cuir et la sueur) sont toujours au rendez-vous. D’une manière globale, la formule est remaniée sans que le fond du propos ne soit pour autant dénaturé. Les morceaux sont à la fois très cohérents entre eux et avec les précédentes sorties du groupe mais également suffisamment variés et saillants pour rendre riche l’écoute et la réécoute de l’album.
Morceau coup de coeur: “Daemon”, morceau de plus de 9 minutes qui ouvre cet album avec son intro qui reprend le propos là où “Supernatural Predator” (morceau de clôture de Black Magic Boogieland et du Live at Roadburn) l’avait laissé puis débouche sur un chant qui guide le morceau comme il guidera le reste de l’album. Les transitions entre les différents passages du morceau y sont (comme c’est souvent le cas chez Death Alley) très fluides et aboutissent sur une accélération rythmique progressive qui met fin à un morceau qui résume à lui seul la richesse de l’album.
Plus tout à fait revival mais toujours très rétro, plus efficace que jamais, Death Alley entame une mue qui pourrait en surprendre plus d’un mais met ses talents de songwriting au service de la qualité de ses compositions. Le groupe nous propose un album d’une très grande qualité, à la fois très accrocheur et efficace mais également riche et racé et passe haut la main le très délicat test du second album en sortant la tête haute de sa prise de risques stylistique. Chapeau Bas!

En 2017 sortait le sublime album آكتئاب : sorte de voyage poétique et initiatique Post-Metal aux accents industriels. Seulement un an après, Ddent remet le couvert avec Toro, un opus qui ose flirter avec l’excellence.
Si plus haut nous vous parlions d’éventuels styles musicaux, il serait bien trop facile de classer les Parisiens dans une catégorie plutôt que dans une autre, tant ce deuxième album entend rassembler de nombreuses inspirations. Ce constat se fait avec les premières secondes du titre introductif « Dans la roseraie » : on croirait avoir mis un bon vieux CD de Trip Hop. Puis des guitares lointaines se rapprochent, des rythmiques exotiques et tribales nous entrainent, le corps basse/batterie marque le temps : le nouveau voyage peut enfin commencer. Un effet de pesanteur et d’envol envahissent nos sens au fur et à mesure que les morceaux s’enchainent : « Dis à la lune qu’elle vienne » et « Longue, obscure et triste lune » en sont de parfaits exemples. Il y a aussi quelques expérimentations plus lourdes et plus rythmées avec « L.s cloch.s d’Ars.nic.t la fum.. », ce n’est pas pour nous déplaire.
Et alors qu’on pensait que le groupe avait tout donné avec son précédent disque, les magnifiques « Torse de marbre » et « Noir taureau de douleur » explosent dans nos oreilles. Les influences sont vastes : Post-Metal/Rock, encore du Trip Hop et une forme mature de ce qui pourrait le plus se rapprocher d’une musique « instrumentale » digne des plus belles B.O de films. Mais le titre qui sort véritablement du lot est « La Pluie emplit sa bouche ». Son introduction mystique nous emmène en plein désert, face à un temple maudit qu’on a envie d’explorer. Il suffit d’entendre ensuite ce riff de guitare entêtant, rejoint par une gracieuse séquence de toms, et d’une ligne de basse droite et massive.
Toro est donc certainement l’œuvre la plus aboutie de Ddent : un album riche en nuances, mature, maîtrisé et beau.

Pour qui s’intéresse à Sunnata, la nouvelle livraison est forcément attendue de pied ferme tant leur précédente galette nous avait claqué le séant avec classe et fracas. « Zorya » en 2016 était un vaisseau onirique et admirablement bien membré qui laissait peu de répit au palpitant.
Quid de ce « Outlands » ? Les eaux troubles brassées par le groupe se sont-elles éclaircies ? La vase est-elle plus poisseuse chez le voisin d’à côté ?
Ne vous laissez pas berner par la première écoute. Cette coquinette se pare trop souvent des habits du jugement hâtif et pourrait vous faire passer à côté de ce bel album. Pourquoi ? Car « Outlands » est moins direct que « Zorya », moins rentre-dedans. Ses guitares semblent moins énormes, moins tranchantes. Les riffs ici ne sont plus façonnés pour exploser les entrailles. Sunnata est passé à un autre niveau. Ils vous décortiquent les tréfonds de l’âme avant de vous cuisiner les boyaux et le cortex façon Lecter.
Prenez « Scars » par exemple. Plus ramassé dans le temps que ces grandes frangines, le titre réussit la prouesse de faire cohabiter montée messianique et conclusion cataclysmique en moins de temps qu’il n’en faut. Sunnata fait un grand pas en avant sur ce nouvel album concernant son songwriting. Les gonzes ont appris à gérer les frustrations et les attentes, un signe de maturité évident qui parcourt l’ensemble de la production.
Mais voilà, pour apprécier « Outlands » à sa juste mesure il va vous falloir l’écouter encore et encore. Car l’album regorge de détails, dans le traitement des voix, le son de la basse, le jeu de batterie. Chaque écoute apporte son lot de nouveautés, de précisions. L’album n’est pas aussi « tubesque » que son prédécesseur mais il est assurément plus adulte, plus angoissé. Moins certain de ses forces et de sa fougue, le groupe est plus à même de se poser de bonnes questions, de se remettre en cause et d’évoluer. Il le fait magistralement sur le morceau de clôture « Hollow Kingdom » où les musiciens développent sur quasiment 13 minutes une complainte mélangeant noirceur doom, psychédélisme froid et interrogation majeure.
Il est tout de même étonnant de constater que les polonais naviguent encore sans label. Quand on voit le nombre de groupes fadasses qui en dégotent un, on se demande comment il est possible qu’aucune structure ne se soit penchée sur les polonais. Ils signent avec ce « Outlands » une belle progression dans leur carrière, un vrai gros disque, mature et sérieux. Il manque peut-être un ou deux titres plus faciles d’accès pour en faire un objet complet mais c’est encore une franche réussite pour Sunnata.

Ne nous voilons pas la face: rares sont les groupes phares de nos émois fuzzés des 90’s encore pertinents aujourd’hui, quasiment trois décennies plus tard. Le peu qui ont survécu ne semblent avoir d’autre choix que de s’auto-parodier. Et il y a Monster Magnet. Pas que le groupe soit plus malin que les autres, non, mais un événement tragique – une overdose, suivie d’une grosse dépression – à démonté les obsessions de rock star décadente de Dave Wyndorf, pour lui permettre de rentrer humblement dans sa seconde partie de carrière, ce segment de la vie d’un artiste, souvent gênant, consistant à rechercher constamment l’équilibre entre ses aspirations créatrices et la zone de confort de son auditoire. Faire du neuf en rassurant les vieux en somme. Depuis 2006 donc, le Magnet assume son rôle de trublion rock aux énergies enfumées, son obsession pour Hawkwind et sa notoriété divisée par dix. Eux qui dès 1998 avaient cherché par tous les moyens à s’extirper de l’étiquette stoner, aspirant à devenir les nouveau Aerosmith (Powertrip), noyés dans l’égotrip de leur leader, sont aujourd’hui conscients de leurs limites et embrassent la cause et la scène, headlinant les festivals, acceptant volontiers la place de parrains du genre que l’histoire et internet leur ont donné.
Finies les poses cuir et les lunettes noires sur les pochettes de ses disques, depuis 4 Way Diablo, le Magnet a appris (de force) l’humilité et publie à intervalles réguliers des albums notables, certes bien moins iconiques que l’insurpassable période s’étirant de 91 à 98, mais ayant l’honnêteté de ce qu’ils proposent, soit de nouvelles saillies électriques parfois traversées de génie. Confiant en son sens de la composition, le groupe a même par deux fois proposé des relectures et réarrangements de leurs récents travaux (Milking The Stars et Cobras and Fire). Une démarche unique permettant au public de choisir entre aventure ou efficacité, ou d’embrasser les deux facettes d’une source créative décidément pas prête de se tarir.
Mindfucker, 10ème (ou 12 selon le mode de calcul) album du groupe est à rapprocher de Mastermind (et pas que pour leur pochette, reprenant leur logo, hommage à peine dissimulé au Snaggletooth de Motörhead), en plus concis, mais moins tubesque. Le contrat est clair : 10 titres pour 50 minutes de (hard) rock efficace, capturant, à l’instar de l’esprit des compilations Nuggets, le meilleur du savoir faire de Wyndorf et sa bande en la matière. En sus du morceau titre, l’album a quelques autres chouettes raisons de s’enthousiasmer : l’infini solo de « I’m God », le nerveux « Ejection » ou le typique « When The Hammer Comes Down » sur lequel Wyndorf cabotine comme on aime. Les influences n’ont pas changé (MC5, Hawkwind, un peu de grunge, un peu de punk) et le morceau titre, « Mindfucker » aura sa place au sein des set-lists du combo pour les années à venir. Si ce n’est pas un contrat dûment rempli, je ne sais pas comment ça s’appelle.
Vivement l’album de remix l’année prochaine tiens!
Point Vinyle :
Napalm records a fait sa spéciale, avec quelques versions couleurs (Gold/200 ex ; Red/300 ; Yellow/500, le tout à commander via leur site) et une version noire classique pour inonder le monde entier. A noter qu’une box existe pour ceux qui aiment les gros objets mais qu’elle ne contient pas de vinyle (mais un patch, une boucle de ceinture, un pendentif et le CD en digipack. Inutilement indispensable quoi.

Shit City, leur album précédent, a pu représenter une sorte de plateau pour les norvégiens : le groupe perfectionnait son style et ronronnait humblement sa musique, un peu en mode automatique. L’album contient son lot de moments forts, tout en ne s’éloignant pas trop du cahier des charges espéré par Napalm Records à l’époque. Pas de révolution, prise de risque limitée, efficacité au taquet. Les prestations live du groupe ont été à l’avenant : solides et puissantes, sans folie toutefois ; on en a toujours eu pour notre argent. Mais la jolie mécanique scandinave a connu quelques ratés : Lukas Paulsen, soliste flamboyant et caution cool du groupe en live, a quitté le groupe. Contraint par l’obligation d’assurer une série de dates quelques semaines plus tard, le désormais trio jette vite son dévolu sur leur pote, le jeune Vegard Strand Holthe, qui fait le job. Plus que ça : le six-cordiste se retrouve impliqué dans la composition de ce Death‘s-Head Hawkmoth (atchoum) et par la même bombardé quatrième membre officiel du groupe. Plus étrange encore : alors que sur une autre série de dates le nouveau venu se retrouve lui-même indisponible, le groupe demande à Jøran Normann de le remplacer et… l’embauche lui aussi ! Lonely Kamel est donc désormais officiellement un quintette (!!), sans que l’on sache vraiment ce que ça signifiera concrètement, notamment en live. Pour couronner le tout, le groupe a changé d’écurie, passant chez les excellents Stickman. Un plus petit label toutefois, bien moins exposé que Napalm, dont ils faisaient pourtant partie des plus anciennes signatures… Et cerise sur le gâteau, Death‘s-Head Hawkmoth (à vos souhaits) marque aussi les dix ans de carrière du groupe. Bref, toutes les bases d’un album WTF sont posées, on est bien…
Death’s-Head Hawkmoth(à vos amours) est un album ramassé, dense : six “vrais” titres seulement, allant de 5 min à 11 min (on ne comptera pas l’intermède « Move On » qui est en réalité l’intro de « Inside »), pour un peu moins de 45 minutes au total. Pas de gras dans la viande, que du muscle. Comme sur tous les albums du chameau solitaire, il y a quelques titres plus dispensables en revanche : même s’ils ne font pas du remplissage, des morceaux comme « Psychedelic Warfare » n’apportent pas grand-chose au global : ça riffe bien, ça chante bien, ça groove bien, ça joue bien… Mais l’étincelle ne jaillit jamais vraiment. Idem pour le très génant « More Weed Less Hate », hommage up peu trop évident et un peu lourdingue à Motörhead, qui n’apporte pas grand-chose au final. En revanche, le disque comporte un lot assez remarquable de très belles pièces, à l’image de ce « Inside » de belle facture, somptueuse pièce maîtresse allant même taper dans des contrées space rock à la Monster Magnet pour amener une orgie de guitares (leads, riffs, soli, harmonies…) du plus bel effet. On mettra aussi en avant le très bon « Inebriated », du Lonely Kamel classique, mais exécuté à la perfection : mid-tempo riffu à souhait, dense en soli et doté d’un refrain bien catchy. Dernière pièce maîtresse du disque « the Day I’m Gone », morceau fleuve de onze minutes à l’intro pourtant un peu mièvre, qui amène l’auditeur vers des sentiers étriqués ouvrant la voie à une armada de nappes de guitare enchevêtrées dans une sorte de jam orgiaque aux frontières du psyche. De quoi finir son trip avec la banane.
Quoi qu’il en soit, avec cet excellent Death’s-Head Hawkmoth (un mouchoir ?), Lonely Kamel ne propose toujours pas la pièce maîtresse qu’il a probablement le talent de produire, l’album parfait et référentiel qu’il a certainement encore sous la pédale. En revanche, le potentiel qu’il confirme ici, sur un album qui constitue de tant de manières un virage dans la carrière du groupe, laisse entrevoir de grandes choses pour le groupe, s’ils se donnent les moyens de s’appuyer sur ces acquis et parviennent à réunir les conditions ad’hoc. Si l’on tient compte du fait que ces enregistrements datent déjà d’il y a plus d’un an ( !!) , espérons que les prochaines prestations live du groupe nous donneront confirmation de la solidité et de l’efficacité de son line-up actuel. Auquel cas le prochain effort pourrait bien être dantesque.

Après l’excellent Sonic Prayer signé en 2005 chez Gravity Records, ce sont deux productions d’égale qualité plus un split avec Harsh Toke qui sortent chez Tee Pee Record les années suivantes. Puis en ce début d’année 2018, Nuclear Blast Entertainment reprend la main et offre à Earthless une nouvelle occasion de nous en mettre plein les oreilles.
Et faut-il encore présenter ce trio californien ? Du jam instrumental survolté au space rock en passant par un krautrock teinté de psyché, Earthless conduit un bus dans lequel il vaut mieux attacher sa ceinture. Un manque apparent de structure au profit d’une sensation de jam permanent. La batterie de Mario Rubalcaba, véritable locomotive fiévreuse, installe le décor, épaulé par les lignes de basse à casser des bûches et tout aussi inébranlables de Mike Eginton. Là-dessus, une fois le four à température, Isaiah Mitchell abandonne ses riffs et s’envole dans d’interminables soli. On est littéralement arraché à notre chaise et recraché quelque cent kilomètres plus loin par ce cyclone. Lessivés.
Avec Black Heaven, si nous nous délectons toujours de la substance d’Earthless, certaines constantes ont cependant évolué. Déjà le nombre de pistes de la galette : six, ce qui peut sembler maigre, mais se révèle un record pour le groupe habitué à presque la moitié moins. Par ailleurs et conséquence directe du précédent point, pas de morceau de vingt voire trente minutes ici. On va même jusqu’à pousser le bouchon à moins de deux minutes avec « Volt Rush ». Un condensé cristallisé de tout ce qui fait l’âme du groupe.
Autre nouveauté : la voix. Si la présence du chant demeurait anecdotique dans la discographie du groupe, son utilisation apporte sur Black Heaven un vrai plus. Monsieur Mitchell nous prouve ainsi qu’entre deux soli frénétiques il est capable d’entraîner aussi par ses lyrics. « Gifted by the Wind » en est l’exemple typique. À l’instar d’« End to end » ou d’« Electric Flame » on s’aperçoit que ce chant vient cadrer la musique en lui apportant une structure un tantinet plus classique.
Le titre éponyme reste à bien des égards la pièce maîtresse de l’album. Des soli qui n’en finissent plus, un groove puissant qui danse sur un solide riff dont les premières notes rappellent sans mal le « Good Times, Bad Times » de Led Zeppelin. De manière générale, il s’avère difficile durant l’écoute d’omettre Black Sabbath, Led Zep ou encore Hendrix. En cela le groupe conserve sa patine. Et ce jusqu’à « Sudden End », morceau aux accents plus mélancoliques doté d’une mélodie lancinante sur laquelle la guitare vient pleurer son solo comme si tout s’arrêtait. On sent que la course s’achève et que l’on est de nouveau autorisé à respirer.
Un album plus standard dans sa construction donc, mais aussi sans doute plus accessible aux néophytes. Il emprunte sans conteste plus au hard rock que ses frères, sans pour autant décevoir les amoureux de jam déjanté et de fièvre électrique qui constituaient et constituent toujours l’essence d’Earthless.

C’est à l’occasion de l’édition 2016 de la version allemande du DesertFest, que j’ai fait connaissance avec ce quintette britannique qui ouvrait le troisième jour avec un panache certain. J’ai donc rapidement rattrapé mon retard en me jetant sur la discographie de ce groupe qui n’a pas inventé la poudre, mais la fait parler avec beaucoup de talent ! Je n’ai donc pas eu à attendre 4 ans comme les initiés entre le précédent long-format (« Omniscient ») et cette nouvelle débauche de décibels au groove fort proche de celui que développait Pantera jadis (bravo la référence stoner !).
C’est à Londres que la bande d’Oxford a mis en boîte ces 10 nouveaux titres en considérant l’ « Outro » qui trombe bien son monde puisque, de fait, cette plage de moins de 3 minutes s’avère être une petite perle qui rivalise avec certaines compositions brèves de leurs compatriotes d’Orange Goblin en mixant habilement rythmiques lentes et riffs dans la plus pure tradition metal. C’est APF Records, une boîte spécialisée dans le rock à moustache anglais, qui commercialise cette nouvelle plaque dont l’artwork est dans le plus pure style de la scène heavy : auditeur te voilà averti !
Musicalement, le registre demeure identique à ce qu’il était sur les précédentes livraisons : du metal bien lourd teinté d’accents sludge et de pointes de blues qui déboîte sacrément sa génitrice sans se perdre dans un registre à l’attention des bourrins uniquement, même si ceux-ci se délecteront avec cette production si tant est que les relents heavy metal ne leur soit pas rédhibitoires. Il y a même un titre pour faire cœur avec les doigts : « Capsized » qui est un slove de 6 minutes avec une énorme paire de balloches et un solo dégoulinant pour les amateurs du genre. « Kingdom Of Horns » est l’autre instant ralenti remarquable de la chose même si sur cette plage les Britanniques tapent plutôt dans le titre épique très ralenti sur lequel se côtoient grognements et incursions aériennes (ça dépareille, mais ne dénature pas le produit).
Outre ces sensations moins fortes, nous retrouvons une belle poignée de compositions épicées avec la recette miracle de la Louisiane dont « Journey’s End » est certainement la meilleure illustration. Le groove impeccable à la guitare semble provenir en direct des marigots du sud profond et la rythmique pugnace appuie avec précision la hargne des vocalises : un bel effort de 6 minutes (comme à la télé). Plus empreints d’urgence et plus sauvages encore, « The Extrovert » ainsi que « The Brawl » (qui tournent toutes deux autour des 3 minutes) rappelleront aux plus anciens les sensations qui les envahirent naguère lorsqu’ils posèrent « NOLA » sur leurs platines !
Au final, cette production intemporelle est clairement une acquisition conseillée car elle a la patine des bons vieux lp d’antan et se profile comme indémodable car pas à la mode. Son orientation très ouverte et sa production fort soignée peuvent s’avérer déroutantes lors des premières écoutes, s’avèrent bénéfiques lors des suivantes grâce au soin apporté par les Anglais pour éviter avec finesse les plans redondants tout en demeurant homogène en ce qui concerne la vigueur de l’exécution.

Sur leur fiche Facebook on retrouve cette inscription : « Nothing to do with the actor. At all. », ce qui sonne à nos oreilles de français comme le « Aucun lien, fils unique » du Serge Karamasov de la Cité de la peur. Car la vérité est aussi bête que simple : Jeremy Irons & The Ratgang Malibus a commencé comme une activité récréative, comme souvent, avant de se faire dépasser par les événements. Bloom en 2011 rendait un hommage sublime aux 70’s, avec un son retro psychédélique délicieux puis Spirit Knife trois ans plus tard, signé sur Small Stone Records, apportait une dimension fuzz supplémentaire, faisant du groupe une pépite que les plus avertis écoutent sans relâche. Un label et un son qui lui permettait d’entrer dans le club stoner, lui ouvrant ainsi les portes des festivals et tournées au sein de cet actif microcosme. Reste que leur nom, certes fun mais long et trompeur (le groupe raconte qu’à leurs débuts un promoteur suédois avait placardé des affiches de l’acteur dans la ville, l’annonçant en concert avec son « Ratgang ») sonnait souvent comme un handicap ; alors, au moment de publier son troisième album, le second chez Small Stone, les suédois optent pour les initiales.
JIRM continue donc à creuser (« Dig ») le sillon stoner et Surge Ex Monumentis se positionne dans la droite lignée de son prédécesseur. Heavy rock suédois par le son (une filiation évidente avec Horisont ou Hällas), psychédélique de nature, la musique de JIRM joue sur les ruptures de ton, sur des vocaux cosmiques et parfois, pris en flagrant délit d’excès de zèle, se rapproche d’un générique de dessin animé (« The Cultist »). Mais malgré ces quelques sorties de piste (« Isle Of Solitude » ou l’intro gênante de « Nature Of The Damned »), l’inexpugnable arrogance de leur talent nous asperge. Hélas, trois fois Hällas, le tout manque parfois un peu de cette autenticité qui faisait le sel des productions précédentes. Une probable envie de coller à la mode nouvelle d’un revival quelconque dont Docteur Jeremy avait réussi à se prémunir, Mister JIRM, lui par contre, tombe dans de nombreux écueils et se vautre parfois trop dans le facile à écouter. Un peu à l’image de sa pochette, Surge Ex Monumentis n’évite pas le piège du cliché, en fait trop parfois mais propose tout de même un son et une qualité de composition franchement au dessus de la masse. Est-ce suffisant de nos jours ? Non. Mais si cela vous permet de (re)découvrir leurs travaux précédents, mon rôle ici prendra tout son sens.
Point vinyle :
Un seul pressage pour ce double album, classique Small Stone, combinant moyens limités et désinvolture totale quant à la promotion et la vente des groupes que le label produit, 500 exemplaires avec un LP rouge et l’autre jaune (enfin “2 shades of Orange” qu’il disent, je dois être dyslexique). Le site de Small Stone n’étant pas d’une fiabilité à toute épreuve (et les frais de ports depuis les USA étant prohibitifs), je vous conseille pour ce disque de passer par Bilocation Records, le dealer allemand que tout fan de stoner se doit de connaître.
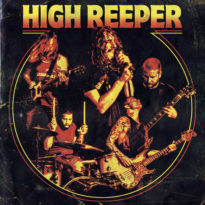
Sortie d’un peu nulle part, la galette de ce quintette ricain arrive dans notre mange disque digital par le truchement du label transalpin omniprésent depuis quelques mois, Heavy Psych Sounds. Un peu circonspects par ce groupe inconnu, on se penche sur la bio des bonhommes : non, on n’a rien raté jusqu’ici, le combo est tout jeune ! Formation en 2016, premiers concerts en 2017 et… premier album sous nos yeux !
Enfin, quand on dit « tout jeune »… on dirait en réalité l’album sorti en droite ligne des grandes heures 80s (fin des 70s), le doute est donc permis ! Le son trahit un peu la génération réelle du disque fraîchement sorti : on est sur du costaud, niveau prod, et même si on sent la volonté d’accentuer le tout à la sauce vintage (bon travail sur le mix, notamment des vocaux), globalement le son est net, puissant et sans trop de bavure.
Les titres défilent et on n’est jamais trop loin des sentiers déjà battus par le grand Sabbath Noir, clairement. Le riffing, évidemment, évoque plus qu’à son tour papa Iommi (sans jamais arriver à produire Ze riff quintessentiel non plus, malheureusement – c’est pas donné à tout le monde). On entend pas mal aussi de plans se rapprochant du jeu de Victor Griffin (à l’époque des débuts de Pentagram), notamment dans les soli, sans non plus tomber dans le trip passéiste béat. Mais il n’y a pas que les guitares, le reste est à l’avenant dans la sauce « rétro » : le mix des voix (encore), avec option « cris depuis le lointain à la Ozzy », les lignes de basse (le bassiste – et l’ingénieur du son – ont clairement beaucoup écouté Geezer, on est bien sur le même type de son rond et claquant), … tout nous conforte.
Côté compos, l’ensemble est fort agréable, soyons honnêtes : du bondissant et punchy « Chrome Hammer » au Pentagram-esque « Soul Taker », en passant par les trois Sabbath-esques « Reeper Deadly Reeper » (oui, on est pas loin du « Sabbath Bloddy Sabbath »…), « Weed & Speed » ou « High Reeper », le tout s’écoute sans bouder notre plaisir. Aucun faux pas ni titre de remplissage un peu grossier. Du bon travail d’artisan.
Pour autant… on passe rapidement à autre chose. Sans être un ersatz, High Reeper nous ressort une recette déjà très connue (et très appréciée). La démarche est donc sympathique (d’autant qu’elle semble honnête et assumée) mais donne-t-elle la bave aux lèvres pour autant ? Le groupe a beau produire quelques très bons moments de musique, il reste ancré dans ce socle référentiel qui s’apparente plus ici à une sorte de carcan. S’en dépêtrer un peu l’amènerait peut-être à développer une identité un peu plus marquée et une musique plus attachante, plus incarnée… Ce premier album est à voir donc comme une première trace d’un groupe à potentiel, peut-être, mais sans assurance sur sa capacité à exploser. Trop tôt, bien trop tôt. Attendons de voir la suite, et là on saura si Heavy Psych Sounds a fait un pari payant… ou bien a eu les yeux plus gros que le ventre. On leur souhaite qu’il s’agisse de la première option.

Formé à Oslo en 2011 par quelques activistes de la scène black metal régionale (Black Magic, Aura Noir…), Spectral Haze se place sans honte sous le haut patronage du grand planant : j’ai nommé Hawkwind. Guide spirituel de quiconque veut explorer l’infinité de la galaxie, les anglais sont à n’en pas douter l’influence principale de cette chouette récréation qui a déjà, à l’heure où sont écrites ces lignes, pris fin : le groupe a splitté. Le quintet, dont les alias nous plongent dans un bonheur de second degré (Spacewulff, Sonik Sloth, Doomdogg, Celestial Cobra, Electric Starling, Power Panther sans oublier Freedom Fox, qui vient placer un solo sur « Ajaghandi »), ne se prend définitivement pas au sérieux tout en publiant à intervalles réguliers d’honnêtes preuves de leur talent. Turning Electric faisant office dans ce contexte de troisième (et meilleure) empreinte cosmique.
Oui mais voilà, au milieu d’un très honnête disque de rock psychédélique, fuzzé jusqu’à l’os et franchement agréable à l’écoute, se dissimule « Turning Electric », 3’43 d’orgasme sonore dont les vertus spaciales sont incontestables. Un morceau de bravoure transformant le plomb en or et conférant à l’album, en sus de son nom, un potentiel aussi infini que le cosmos dans lequel il nous laisse dériver. D’autres titres bien sûr ont de quoi passionner, tels l’envolée nébuleuse « They Live » ou la doomesque « Ajaghandi », faisant de ce troisième (et donc probablement ultime) album de Spectral Haze, un témoignage parfait des qualités du groupe.
Court et percutant, Turning Electric est bien plus qu’un album pour nostalgiques d’Hawkwind, c’est un véritable voyage dans l’infini espace, qui ne peut que nous faire regretter que le groupe ne soit plus. Et ce n’est pas tous les jours que se dissimule un véritable hit dans les disques embrumés dont nous vous parlons ici.
Point vinyle :
Totem Cat, label et distro française chaudement recommandable propose cet album en différentes versions (en sus du test press):
- 50 exemplaires en « Falcon Edition» avec une pochette alternative chic et choc, le tout numéroté à la main.
- 250 exemplaires en « Falcon splatter » sans la pochette alternative chic et choc, le tout numéroté à la main quand même.
- 300 exemplaires noirs, tout simple, tout sage, mais qui fait planer quand même.

Du Fuzz au Garage en passant par le doom psyché le trio de Brooklyn, River Cult, a mis au monde son premier album « Halcyon Daze » le 9 Février. C’est l’histoire d’un power trio qui bat la campagne de ses pairs pour mieux tracer son propre chemin sonore.
River Cult ouvre son album sur un Stoner fuzzé qui sent bon l’arrière salle pleine de sueur et de bière, dans l’atmosphère vibrante on ressent encore la présence passée des Fu Manchu. Une des grandes réussites de cet album est indéniablement d’avoir su disséminer la voix tout du long sans jamais la rendre indispensable dans le voyage dense qu’est « Halcyon Daze ».
On est parfois étouffé par la teneur du propos et les surimpressions, en particulier sur le titre éponyme qui envoie explorer des terres Post-Rock. On trouve de l’autre côté du spectre « Point of Failure », une composition garage avec voix déstructurée, plaintive sur fond de basse lourde, de gratte aux riffs incisifs et de frappe tranquille du batteur. Dans sa dernière partie le morceau évolue vers le grunge et c’est ce sentiment de Jam Session qui restera comme perception globale de l’album.
On pourrait se tromper et assimiler River Cult à un de ces groupe de lycée à la maitrise prometteuse mais indéniablement ils vont plus loin que ça et si « The Sophist » prend une mauvaise tournure dans ses premières mesures, la crainte d’un morceau poussif est vite chassée par les blocs lourds et intenses qui clôturent l’album dans un esprit Doom, nous faisant relancer l’écoute pour mieux comprendre le tout.
Cet album laisse un sentiment partagé entre quelque chose d’inabouti et la promesse de riffs ravageurs encore en gestation. Quoi qu’il en soit, la réécoute est nécessaire pour bien appréhender l’objet et il est clair que si tout se déroule au mieux on devrait reparler de River Cult ici dès leur prochaine sortie.

Véritable stakhanoviste du stoner, Gabriele Fiori est non seulement à la tête des excellents Black Rainbows (nouvel album dans les prochaines semaines, tournée européenne dans les tuyaux…), mais aussi du label Heavy Psych Sounds (723 sorties mensuelles environ…), d’une structure de booking concerts en développement… Du coup, comme il s’ennuyait un peu, le bonhomme relance son projet parallèle Killer Boogie, un trio de boogie rock 70’s fuzzé dont la philosophie semble se borner à recracher sans complexe leurs influs acid rock.
Le programme inquiète autant qu’il est appétissant. Inquiétude, car la vague de retro rock émergeante depuis le début de notre décennie environ est plus forte que jamais ces derniers mois : pic de production conjoncturel ? Hasard ? Dynamique de croissance avérée ? Quoi qu’il en soit, on est noyé de disques estampillés 70’s, voire 60’s. La sélection naturelle va opérer, froide et cinglante, et seuls les meilleurs s’en sortiront. Mais ce nouveau disque de Killer Boogie nous intéresse quand même, car l’on connaît l’intégrité de la démarche de Fiori, et sa réelle et sincère affection pour le genre musical. Par ailleurs, on ne peut qu’accueillir les bras ouvert une formation qui invoque aussi bien Cream que les Stooges, Blue Cheer ou le MC5 dans sa bio !
La promesse est là, notre circonspection en embuscade, on enfourne donc la galette virtuelle dans notre mange disque dématérialisé. Pas de surprise : tout ce qui était attendu est là et bien là, par le menu. La promesse est tenue. Assauts de guitare juste saturée, fuzz insolente, caisse claire nerveuse, subtil écho sur les vocaux et nappes space rock de bon aloi : la recette est simple, et parfaitement exécutée. Et en y ajoutant quelques jouissifs soli parfaitement intemporels, on y est, en plein dedans.
Le cahier des charges étant parfaitement rempli, c’est dans les compos qu’on va faire la différence avec la meute de collègues et « concurrents » susmentionnés qui se tirent la bourre sur le créneau saturé de ce revival qui porte bien son nom. Là aussi, on est biens : plans acid rock planants et riffs bien ciselés se tirent la bourre comme on pouvait l’espérer. Au bout de quelques écoutes les titres les plus catchy émergent et rentrent bien en tête : le boogie « Am I Daemon », le groovy et entêtant « Dino-Sour », le plus heavy « The Black Widow » ou le stoogien « Escape from Reality » montreront un peu l’étendue stylistique du groupe.
Alors, acquisition ou pas ? Quitte à paraître lourd et répétitif, dans le torrent de production actuel, on ne captera que ceux qui sortent la tête de l’eau. C’est plutôt le cas de Killer Boogie. Honnête, bien exécuté, le trio a pour lui une tonalité fun et nerveuse en directe émergence de ses influences les plus punchy (MC5 en tête) qui le distingue un peu des ersatz Zeppelinesques qui se bousculent au portillon. La prod bien vintage et l’absence de prétention du trio en font un disque fort plaisant à faire tourner sur sa platine. En revanche, la promesse d’une bonne rasade de fun en live est encore plus séduisante, et on espère que le groupe développe son activité scénique dans les prochains mois…

Les pochettes d’album de Hangman’s Chair sont toujours un excellent indicateur du contenu que les parisiens cherchent à distiller au gré de leurs livraisons. Celle du nouvel opus Banlieue Triste ne déroge pas à la règle. Un homme tête baissée, inexistante même, jambes écartées. Un contrôle ? Une posture d’abandon ? Une caravane posée devant un pavillon, cernée par des immeubles, changement immuable de nos périphéries des années 70-80 et son cortège de pertes de repères. L’analyse est succincte bien sûr mais représentative de Banlieue Triste.
L’album est un condensé de tout cela. La patine déjà. Marquée, scellée même, par une production typée. Les guitares, leur réverbération, cette caisse claire, on nage dans les années 80 sur toute une partie spectrale du champ auditif. Contrebalancée bien sûr par un traitement massif des efforts saturés (cette basse tudieu !). L’écrin respecte donc la grammaire esthétique que Hangman’s Chair entend développer depuis son précédent effort et qui participe fortement à son identité.
Le tout sert les compétences du quartet. On le sait maintenant. Les gonzes savent écrire des riffs, des complaintes, des chansons. Et des putains de bonnes même. Tellement qu’on aimerait les entendre en acoustique soutenues par la voix merveilleuse de Cédric Toufouti.
Après une première partie d’album dantesque où le point culminant « Touch the Razor – Tara – 040916 » nous laisse exsangues, coupés en petites lamelles, dépecés devant la maîtrise de son ambition, sa capacité à gérer une tension coupée au cordeau, Banlieue Triste s’essouffle quelque peu à l’écoute en seconde partie. La faute peut-être à son point de vue esthétique et sonore étouffant trop le propos. L’exercice instrumental de « Sidi Bel Abbes » par exemple tourne en rond et se cherche un peu trop à notre goût, écrasé par une production par trop envahissante.
Alors certes, Banlieue Triste n’a peut-être pas la consistance de son prédécesseur, le liant y est peut-être moins prégnant mais le nouvel effort des parisiens n’en reste pas moins une suite solide, élégante et forte. La carrière du quartet semble épouser ses envies. On y ressent le besoin de s’élever, de décoller les deux pieds du sol, de s’extirper de la poisse. Hangman’s Chair n’ira jamais tutoyer les étoiles musicalement, tel n’est pas son credo. Sa musique sera toujours puissante, lourde, le combo cherchera, j’en suis sûr ou je l’espère, à intégrer plus de sagesse et de douceur à sa mélancolie future. Amer béton.

J’ai découvert le quatuor instrumental Astrodome à l’occasion de leur passage à Paris il y a un peu plus d’un an. L’atmosphère live en imposait pour ce groupe de p’tits jeunes venus du Portugal et j’ai vite pu me rendre compte que leur maitrise du style et des instruments valait le détour.
Le second album du groupe n’a rien à envier au premier et on assiste à la confirmation qu’il faut d’ores et déjà compter sur eux dans le monde du Psych. II est un savant distillat de Colour Haze, et de Causa Sui avec une macération de bouts de Samsara Blues Experiment pour lequel il aura tout de même fallu 27 mois de barrique pour faire ressortir toutes les saveurs des 70’s et obtenir cette liqueur suave aux arômes éprouvés et bien connus qui fait tourner la tête sans violence.
Astrodome maitrise un langage universel, le thème est souvent limpide. « Mirage » est une composition faite de vent et de sable où brulent les hallucinations, « Secular Fields » une danse tropicale sous peyotl qui laisse les jambes de plomb lors de la redescente. J’ai particulièrement arrêté mon écoute sur la quatrième piste, « Sunrite » où la basse et la batterie s’imposent d’un bloc derrières des guitares qui montent comme des volutes de fumée et ou le synthé s’insinue en offrant plus de profondeur à cette composition chamanique. L’album court de 5 pistes se termine sur “Atlas” avec de beaux moments de batterie après 41 minutes d’un voyage qu’on aurait aimé un peu plus long.
Pour cet album, vous pourrez vous fournir en direct du producteur lors de leur tournée d’avril 2018 et un conseil, prévoyez un stock d’écoutes dans votre cave car ce produit de garde se consomme en toute occasion.
|
|