|
|

Mystérieux quintet suédois, aux membres masqués, Salem’s Pot est apparu aux yeux du monde en 2012 avec Sweeden, Lp contenant deux magnifiques ode à la suède, la weed, les films d’horreur et la musique 70’s sur son versant le plus psychédélique, le tout mâtiné d’un son lourd et organique, qu’il convient bien sûr de qualifier de doom. La discographie du groupe s’est depuis étoffé d’un album (… Lurar Ut Dig På Prärien, indispensable), d’un Ep (Watch Me Kill You, indispensable également et réédité récemment), d’un 7’ (Ego trip) et d’un split avec Windhand, probablement la plus belle pièce d’entre toutes.
Sans doute amusé par les terribles difficultés qu’éprouvons, nous autres non-nordiques, à prononcer le nom de leur premier album, Salem’s Pot a décidé d’intituler le second « Prononce This ! » et, au delà de l’anecdote, propose par la même l’une des meilleures raisons de croire qu’il est possible de faire du stoner de très haute qualité en 2016, tout simplement.
Car de doom il en est de moins en moins question, c’est une évidence. Lentement mais surement, la musique de Salem’s Pot a glissé vers quelque chose de plus rock, sans perdre pour autant une once du psychédélisme qui barbouillait déjà ses productions précédentes. Apaisé surement mais bien plus intelligent aussi, la musique du groupe semble en perpétuelle mutation. Ainsi les 50 minutes que durent l’album ne sont rien d’autre qu’un long trip halluciné durant lequel on croise quelques drôles de personnages (« Tranny takes a trip » rien à ajouter), caressant le sublime (« The Vampire Strikes Back » et sa vibe complètement 70’s, « Coal Mind », la plus évidente mais tubesque « Just For Kicks »…) et s’autorisant même quelques escapades dans de lointaines contrées (« So Gone, So Dead » braconnant, sur les terres de la country dans ce qui semble être une métaphore de la descente.). Le tout rehaussé par de nombreux claviers bien sentis, renforçant un peu plus encore l’ambiance psychotrope de l’ensemble.
Salem’s Pot semble avoir découvert, une recette secrète, celle, enchanteresse, du parfait mélange entre chansons immédiates, saillies psychédéliques et énormités stoner. La recette que tous les groupes du genre cherche à appliquer certes, mais soyons sérieux, on ne batifole pas avec la plèbe ici, on caresse l’Olympe. Reste aux suédois à prouver leur valeur en live désormais, puisqu’il s’agit là encore de leur (gros) point faible pour le moment.
Point Vinyle :
Je ne m’en suis jamais caché, de toutes les crèmeries que j’aime à fréquenter, Riding Easy est de celles qui me font le plus saliver. Pour la publication du second (vrai) album de Salem’s Pot, Daniel Hall propose le LP, en sus du test press, en noir, en violet (500 exemplaires pressés) et en Die Hard, avec une couverture alternative, se focalisant sur un des musiciens. Pressé en clear à 300 exemplaires (50 par musiciens), cette version est tout simplement sublime quoi que chère (45 dollars en sus des frais de port). Mais quand on aime…

Le moins que l’on puisse dire concernant -16- c’est que leur carrière, longue aujourd’hui de près de 25 ans, aura été tout sauf tranquille. Implacable machine à sludge, pendant « west coast » du noise/hardcore new yorkais d’Unsane ou Helmet, -16- aura connu de nombreux changements de personnel avant de finir par splitter en 2004, rongé de l’intérieur par les diverses addictions, à l’alcool ou aux drogues, de ses principaux membres. Leur résurrection avec Bridges To Burn en 2009 chez Relapse Records aura eu le mérite de remettre au goût du jour cette formation trop souvent oubliée et de permettre à Cris Jerue, Bobby Ferry et leur bande d’enfin accéder à la notoriété à laquelle ils aspiraient.
Lifepan of a Moth, 7ème production d’une discographie dont on aura particulièrement retenu Drop Out et Bridges To Burn, LPs les plus prompst à revenir sur la platine, est dans la droite lignée de ses prédécesseurs. C’est à dire qu’il capture, tout au long de ses 40 minutes, l’essence même du sludge. Toujours pris dans la réalité crue de ses paroles, non sans y ajouter une pincée de dérision et d’humour, Jerue crache avec puissance son mal-être, idéalement soutenu par le foisonnement de riffs déversés à mesure que l’album déroule. « Landloper », idéalement choisi pour ouvrir les hostilités est d’une très grande qualité tandis que le single, répondant au doux nom de « Peaches, Cream, And The Placenta » s’impose sans sourciller comme la pièce du choix de la fournée. Gavé raz la gueule d’ambiance boueuse, tout en s’éclaircissant le museau par quelques touches mélodiques, Lifespan of a Moth est un album aussi grossier à la première approche qu’il est puissant une fois bien assimilé. « Gallows Humor », rouleau compresseur instrumental de près de huit minutes, en est l’exemple le plus flagrant.
Alors qu’il semble qu’une partie du personnel ait encore valsé et que les prochains concerts soient assurés en trio, -16- publie pourtant un album parfait pour accompagner vos chaudes journées d’été. On parle, je le rappelle, d’un groupe dont le nom vient de leur passion, à la vingtaine, pour les filles mineures. Ils avaient alors décidé de s’appeler -15-, puisque c’était là l’âge moyen de leurs copines avant de s’apercevoir que le patronyme était déjà utilisé dans la région. Ils n’ont donc eu d’autre idée que de vieillir la moyenne d’une année. Vous avez dit génie ?
Point Vinyle :
Relapse a pressé le nouvel album de -16- en trois versions mais n’en propose que deux à la vente (les 100 clear étant reservés aux membres du groupe et à leurs proches). Ainsi il est possible d’acquérir la version bleu et rouge limités à 300 exemplaires, ou la version noire, simple, tirée elle à 1000 unités.

Foghound sort son second album chez Ripple, une bonne nouvelle pour nous : signé sur le label américain qui a le vent en poupe, le quatuor gagne en exposition et incidemment en notoriété. Il faut dire que leur premier album, sorti il y a deux ans sur un obscur label, n’avait pas franchement rencontré son public, comme on dit pudiquement… Or, co-fondé par la section rythmique badass de Sixty Watt Shaman (Rev. Jim Forrester à la basse et Charles Dukeheart III à la batterie), le groupe de Baltimore a de quoi susciter un vif intérêt. Le line-up est complété de Dee Settar et Bob Sipes aux 6-cordes.
Fanatiques du Shaman de 60W, on s’est jetés corps et âmes dans cette rondelle en attendant notre dose de gros riffs gras et de compos coups-de-poing subtilement parfumées au sable chaud et de sonorités sudistes. Et bien de ce point de vue, la chute fut rude ! Car ce qui choque (le mot n’est pas galvaudé quand on s’attendait à un ersatz de SWS) c’est la variété des compos et des sonorités proposées : ainsi enrichi d’un travail d’écriture très élaboré, l’album s’avère finalement assez difficile à appréhender. Le chant partagé entre Dukehard et Sipes ajoute à ce sentiment « d’éclatement » et perturbe un peu plus les radars. Et à partir de là, deux options : on se casse le nez sur cet album massif et difficile d’accès, ou bien on le fait tourner et tourner… jusqu’à détecter les interstices permettant de s’y immerger.
Fondamentalement, ce qui marque, c’est la prod massive de l’objet : l’enregistrement par Mike Dean (de COC) n’y est peut-être pas étranger, mais quoi qu’il en soit, le son très travaillé, parfaitement adéquat, sert impeccablement ces compos. Des compos qui explorent tous types de territoires, donc, avec toujours une vraie réussite : du mid-tempo puissant (« Above the wake » étrangement placé en intro), des titres rythmiquement percutants, presque typés « neo » (« Message in the sky » avec sa basse saturée et son son de caisse claire rappelleront les productions de la fin du millénaire, type Sugar Ray), de l’instru électro-acoustique planant (« Bridge of Stonebows ») et d’autres titres formellement inclassables : un « Serpentine » qui fleure bon Clutch, « On a roll » et « Rockin’ & Rollin » qui rappellent furieusement Fu Manchu… Et globalement une production de riffs de haute volée (« Give up the ghost », « On a roll », « Never return »). N’en jetez plus !
Après de très nombreuses écoutes, on va être honnête : on ne sait toujours pas quoi faire de cet album. Sa qualité de composition et d’interprétation sont indéniables : à coup sûr on n’aura aucun mal à le sortir de son boîtier dans un an ou dix ans et l’apprécier tout autant. Sa qualité intrinsèque ne fait pas débat. En revanche, il manque quelque chose pour le trouver attachant et créer le lien affectif (que l’on a avec Sixty Watt Shaman, par exemple) : un manque de cohérence, de clarté et de vision dans l’intention musicale… quel est le projet ?? Si vous aimez vous perdre dans un album, vous laisser porter par la musique, sans forte attache, sans ligne directrice rigide, vous aimerez probablement ce disque, qui déborde de points positifs. Si vous cherchez plutôt l’âme d’un groupe, entendre des musiciens tracer une piste musicale, défricher leur chemin dans une direction qui se fait jour une fois arrivée la fin de l’album… dans ce cas vous aurez peut-être du mal à rentrer dans ce « Never Return ».

La diversité culturelle aura toujours du bon, surtout lorsqu’elle réussit à se mélanger d’une manière très subtile. C’est un peu l’effet que nous procure la découverte et l’écoute d’un groupe comme Samavayo. Avec leur nouvel album Dakota, disponible depuis juin 2016, le power-trio a décidé de frapper fort en ne s’imposant aucune limite.
Formé depuis une bonne dizaine d’années, le line-up actuel a surtout pris ses marques vers 2013. Car, petite subtilité, le groupe porté par deux frères Berlinois va s’amorcer grâce au chanteur/guitariste Behrang Alavi, Iranien de naissance alors réfugié en Allemagne. Une belle histoire qui ne peut que se répercuter dans le son de la bande. Alors, oui, sept titres peuvent paraitre un peu court, mais ce n’est finalement qu’un détail. En effet, cet album rassemble une masse d’influences stylistiques qui va en ravir plus d’un. Car ici, on peut retrouver des inspirations Rock allant des années 1960 à aujourd’hui. Le panel de genres est maîtrisé tout en étant très bien compilé. Cela permet donc de détacher le groupe d’une façon originale. Du coup, on se retrouve à dire que tel ou tel passage peut nous rappeler de nombreux groupes, mais, il y a quand même quelque chose de frais qui ne s’explique que par l’énergie déployée par le groupe. Puis la cohésion de groupe est très bonne : personne n’est mis en avant ou en arrière. On ressent bien la volonté de conserver l’efficacité live d’un power-trio. Du coup, ça chante bien, ça joue bien, ça tape du pied et c’est tout ce qu’on attend. Enfin, la production sonore est bonne même si elle ne révolutionne rien, mais tout ce qui compte, c’est ce charmant équilibre entre les instruments et la voix.
Alors parlons un peu de cet album, qui emprunte de nombreuses voies, en commençant par « Arezooye Bahar ». C’est une bonne entrée en matière qui ne cherche pas forcément à surprendre, ni à emprunter des airs d’artifices. N’empêche que le résultat donne envie d’écouter la suite. On peut aussi citer « Cross The Line » et « Overrun » qui sont des morceaux classiques à la base avec de grosses influences comme Kyuss, Black Sabbath, Alice in Chains ou bien encore Soundgarden. On obtient un son lourd, lent avec des couplets classiques et des refrains et ambiances corrects qui font leur effet. Samavayo n’hésite pas non plus à creuser un peu dans le sludge avec le final « Kodokushi », puis surtout à exploiter l’univers Noise avec « Intergalactic Hunt ». Ce morceau instrumental est le véritable ovni de l’album en donnant un effet hyper plaisant et en dévoilant tout le potentiel du groupe. On en redemande sans modération. Enfin, terminons par les deux bijoux de cet album avec tout d’abord « Iktsuarpok ». Ce titre est une tuerie infligeant à nos oreilles une grosse lourdeur, un son massif, une voix puissante : un morceau efficace, mature et tout en nuance. Puis « Dakota » est l’exemple même de la parfaite réussite du mélange des différents univers Rock à travers les âges. C’est comme si QOTSA faisait sauvagement l’amour avec Led Zeppelin : on pense forcément à Them Croocked Vultures !!! Car entre la rythmique démoniaque et ce refrain qui reste en tête, vous ne pourrez que ressentir ce flux énergique de la bande.
On peut donc dire que Dakota est un album très complet, mature et révélateur d’un groupe qui ne se fige pas dans un carcan stylistique mais qui veut expérimenter à foison. Bravo !!!

Throttlerod construit (un peu dans la confidentialité) son parcours discographique comme un cheminement vers l’aboutissement stylistique, la consécration, l’album référence. Sera-ce ce Turncoat ? En tous les cas, on est heureux de les retrouver: on pensait le trio ricain perdu dans les eaux qui ont mis Small Stone, leur label, à genoux il y a une paire d’années. Tandis que le label remonte la pente, cahin-caha, Throttlerod lui est resté fidèle, et aura attendu une demi-douzaine d’années avant de donner un successeur au très bon Pig Charmer.
Musicalement, le groupe de Matt Whitehead reste sur sa voie : son stoner-metal se détache de plus en plus de ses atours sudistes, pour mieux se concentrer sur la perspective de la compo ultime. En conséquence, on retrouve sur cet album non pas une heure de bonne musique, mais plutôt douze bons titres… Nuance s’il en est en terme d’approche d’écriture, tant chaque chanson paraît ciselée, conçue comme un sous-ensemble propre, et chacune convoquant les atours stylistiques les plus efficaces… tous genres confondus ou presque ! Ce Turncoat manque singulièrement d’une trame claire : il emprunte à tant de tonalités, de styles (tous liés au metal quintessentiel) que l’on a du mal à caractériser l’empreinte du groupe. Est-ce un mal ? J’ai tendance à dire que non… tout du moins tant que la qualité des titres est de ce niveau. Il n’empêche, quand vient l’inéluctable moment où l’on aimerait pouvoir raccrocher la musique du combo à du « déjà entendu », la difficulté est symptomatique : le son de basse et les plans de guitare de « Lazy Susan » empruntent directement au White Zombie du XXème siècle, le cérébral et solennel « Never was a farmer » pourra rappeler des groupes comme Channel Zero dans sa montée en puissance (et sa conclusion superbement montée en épingle force au respect en terme de composition), le vicieux « You kicked my ass at losing » est une directe émanation des groupes de power metal US, « Gainer » rappellera les excellents ASG, etc…
Et c’est comme ça tout du long ! On entend du sludge, du metal, du grunge, du noise, du neo … Mais toujours à bon escient, sans lourdeur, avec talent et efficacité. Et mélodiquement, on est clairement dans le haut du panier. Alors non, toujours pas : Turncoat n’est pas l’album « sommet » attendu de la part des excellents Throttlerod, la faute justement à ce jeu de piste qui peut perdre l’auditeur dans certains cas. Il n’empêche que le talent développé par ces trois musiciens, musicalement et en terme d’écriture, force le respect. Et en cela notamment, Turncoat est un très bon album.

Tout droit venu de Manchester, Boss Keloid a sorti son premier album en 2013, The Calming Influence Of Teeth, survolé par l’influence d’un Mastodon dans ce qu’il a de plus groovy et de progressif. Sans s’être vraiment éloigné de ce chemin, les anglais se sont accordés quelques petits détours sur des sentiers un peu plus paumés. À la fin de leur randonnée, ils nous sont revenus avec des ampoules aux pieds et surtout Herb Your Enthusiasm, leur nouvel album sorti cette année chez Black Bow Records.
En plus d’avoir les mêmes initiales, Boss Keloid partage avec le géant du burger la même générosité calorique. Et d’emblée, le premier titre « Lung Mountain » devrait vous en persuader : ça balance du riff à t’en décrocher la mâchoire et c’est puissant comme un moteur 14 cylindres. Pas étonnant, lorsque l’on sait que l’album a été enregistré au Skyhammer Studio par Chris Fielding, producteur, bassiste de Conan, et homme multifonctions dans le domaine du gras, n’étant pas à son premier coup d’essai. Le chanteur Alex Hurst (d’ailleurs rejoint ici par Jon Davis de Conan) accompagne le tout d’une voix profonde, grave et caverneuse. On pense ici à du Crowbar en plein essor. Convaincu ? Nous aussi.
Fidèle à ses influences, Boss Keloid aime aussi surprendre en intégrant divers changements de tempo et autres passages inattendus, comme sur « Harleem Struggle », ne laissant pas vraiment de repos à l’auditeur.
Mais la vraie originalité de l’album réside dans l’utilisation régulière d’un effet transformant la guitare de Paul Swarbrick en un espèce d’orgue de barbarie suranné, ronflant et vacillant. Son timbre vieillot nous plonge comme spectateur d’un spectacle burlesque dans un cirque déglingué, avec quelques bêtes de foires çà et là. Dans un premier temps surprenant, on adhère rapidement à cet instrument non identifié, dont l’utilisation est toujours intelligente et jamais excessive. Quasiment tous les morceaux pourraient être cité en exemple, mais on peut vous donner en vrac « Axis Of Green », « Lung Valley » ou encore « Elegant Odyssey », pour les plus savoureux d’entre eux.
« Hot Priest », le dixième et dernier morceau (le plus long également), se permet de donner le dernier coup de marteau sur le clou du psychédélisme colorant l’album du début à la fin, avec une wah-wah enflammée et toujours ce fameux orgue de la quatrième dimension.
Dans un genre où les vraies nouveautés ne sont pas monnaie courante, Boss Keloid réussit à combiner des sonorités improbables et déconcertantes à des influences classiques, et cela s’avère vite séduisant. On pourrait même déplorer certains passages finalement bien trop ordinaires au regard d’autres carrément plus originaux. Mais ce serait chercher la petite bête, car quoiqu’il en soit, Herb Your Enthusiasm place directement Boss Keloid dans la catégorie « Procol Harum du Sludge », avec pour seul concurrent eux-mêmes.
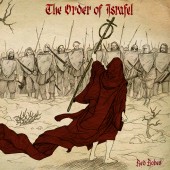
C’est à l’automne 2013 que se forme The Order Of Israfel, entité doom épique, dans la plus pure tradition suédoise dont la principale attraction réside en la présence de Tom Sutton, le blondinet au milieu des japonais de Church Of Misery entre 2006 et 2013. Respectueux de ses ainés, le groupe convoque les grandes figures du genre, Candlemass en tête, à la table ronde des chevaliers du heavy lent. Leur premier album, Wisdom, signé chez Napalm Records avait sucité un émoi certain sur le vieux continent, porté par quelques titres fort bien achalandés (« Wisdom », « Morning Sun ») et les tournées successives avec Lonely Kamel, puis Pentagram (Sutton est guitar tech pour Griffin) ont fait définitivement des suédois (d’adoption pour le très british Sutton) un groupe installé dans le giron des formations sur lesquelles tout amateur sensé de doom dans son apparat le plus traditionnel se doit de garder un œil.
La publication de Red Robes deux ans plus tard mérite alors que l’on y porte une attention toute particulière. Dans la droite lignée de son prédécesseur, ce disque est traversé par un souffle presque médiéval (la pochette est d’ailleurs une représentation moyenâgeuse et transposée de l’image du moine de la révolution de Safran en Birmanie en 2007), soulignant un peu plus les aspirations traditionnelles d’Order Of Israfel. Red Robes est parsemé de trouvailles (les vocaux sur « The Red Robes », les quelques notes acoustiques en ouverture de « Swords To The Sky », les aspiration à la Saint Vitus sur « Fallen Children » etc.) et recèle de nombreuses raisons de s’enthousiasmer, faisant oublier certains riffs faciles et la voix, pas toujours prenante de Tom Sutton.
Creusant un peu plus encore la voie que Wisdom avait défrichée, Red Robes s’enfonce un peu plus dans l’épaisse forêt du heavy doom traditionnel, rendant hommage aux maîtres du genre et si rien ici n’est véritablement nouveau, l’atmosphère nordique et les grandes envolée mélodiques charmeront ceux qui se laisseront porter. Et tant pis pour les autres.
Point Vinyle :
Napalm fait du Napalm et propose 3 versions en LP :
- 100 en Gold, avec DVD
- 100 en Red
- Le LP classique en noir.
A noter que les deux versions couleur et certains noirs s’accompagnent d’un DVD de la prestation live d’Order Of Israfel au Sweden Rock Festival 2015.

Avec cinq albums dans leurs bagages et des kilomètres de route internationale au compteur, Radio Moscow a compris que c’était l’heure pour un album live, d’autant que pour ne rien gâcher, leur maîtrise sur scène n’est pas à démontrer. Enregistré sur deux dates au club The Satellite à Los Angeles, ce live propose donc de nouveaux arrangements des morceaux connus et la reprise de « Chance Of Fate » du groupe Sainte Anthony’s Fyre.
Pour rappel, Radio Moscow est un trio de San Diego cataloguable 70’s avec tout le groove, le psyché et la technique que cela sous-entend. Il faut surtout souligner le travail de Parker Griggs, incontestablement maître de sa guitare, en plus de proposer un chant de facture classique mais reconnaissable, bref on s’attend à un déluge de soli aboutis aptes à nous faire acheter des pattes d’eph’.
Très propre, la capture sonore rend honneur à la performance avec un mixage impeccable des différents instruments et de la voix. Les clameurs du public et l’ambiance sont disséminés çà et là en début et fin de morceaux, comme on pouvait s’y attendre. Étrangement, on note un côté parfois brillant du son, qui a tendance à user rapidement l’oreille à fort volume. On perd également en nuances pour le chant, que l’on sent plus forcé mais toujours juste. C’est du live, c’est la vraie vie, c’est les tripes et l’énergie avant tout quoi.
On baisse donc légèrement le volume et c’est parti. Les arrangements pullulent définitivement et à tous les niveaux, des effets aux instruments. On peut par exemple noter une batterie complètement différente sur “These Days” et un “Before It Burns” multiplié par deux dans la longueur (et pas pour des prunes).
Il reste que les morceaux de Magical Dirt, le dernier album en date, semblent tout nus si écoutés juste après ce live. C’est d’ailleurs, à mon avis, le meilleur argument en faveur de cette production qui pousse tous les curseurs bien plus loin que les originaux pour un résultat moins propre mais très généreux.

Venu des terres australes, Filthy Lucre, duo guitare-batterie pose, mine antipersonnel de rien, une petite bombinette de stoner-blues crasseux et pourtant frais avec leur dernier album en date, Mara, paru début 2016.
Le coup d’une tracklist à 14 morceaux n’arrive finalement plus si souvent que ça, alors quand on découvre ce nombre sur la galette, on se dit qu’on va peut-être se fader une petite indigestion à la moitié du skeud. Que nenni par ici. Les titres sont cuisinés façon cassolette, ptite poêlée fringante de riffs inventifs et production léchée. Alliant le groove d’un Loading Data, la hargne d’un Black Pistol Fire et la sexytude d’un Picturebooks, les australiens invitent à une danse des corps inévitablement salace et partageuse. Et l’album de dérouler sans qu’on n’y baille aux corneilles. On passe avec justesse d’effets de production à la rudesse d’un bottleneck, de lignes fuzzy et sèches au martèlement d’accords plombés de gras, de frappes de grosses caisses façon Mike Tyson à la danse de cymbales stylée Mohammed Ali.
Au sortir du voyage, le groupe se fend même d’une reprise cambouis du « Sail » de Awolnation, un titre radiophonique tout naze qui, une fois couvert de boue, dévoile un ptit côté sexy, un peu comme Bugs Bunny quand il se déguisait en fille et qu’il ressemblait à une lapine.
Pour conclure…gros coup de cœur voilà tout ! Luke Marsh et Ed Noble, nouveau hérauts de la cause rock vont venir dégueulasser régulièrement mes oreilles de leur titres coquins et enlevés. J’ai l’épiderme encore tout sensible de cet enchaînement « Mara », « Boundless Plains ». Filthy Lucre rules !

Depuis 2001, Fistula, quatuor sludge cracra de l’Ohio, s’évertue sans relâche à faire couler la boue dans les sales oreilles de ses suiveurs. Resté longtemps underground, en publiant des dizaines de splits, 45T et autres formats sur autant de labels DIY ou distro, le groupe a aujourd’hui attiré une plus large lumière, ralliant même l’Europe et le Roadburn Festival. Ceux qui furent longtemps considérés comme l’un des groupes les plus sales de leur génération ont finit par mettre de l’eau dans leur cubi de vin, par prendre un peu de distance avec les milieux crust à mycose pour intégrer gentiment de grandes doses de metal dans leurs punks attitudes. Le résultat, bien sûr, à de quoi écœurer les plus anciens amateurs du combo mais ouvre à Fistula les portes en acier d’un monde où le sludge se consomme au petit déjeuner. Le groupe se présente alors sur des tempi tendant vers le doom et un son de guitare aux inflexions clairement plus métalliques. Exit le punk crasse à tous les étages, la Fistule se soigne et ça s’entend. L’apport de Dan Harrington, au chant depuis fin 2013, semble d’ailleurs y être pour beaucoup dans cette lente mais sûre transformation.
Longing For Infection se présente alors comme un disque plus proche d’EyeHateGod que de Grief et, après une introduction cultissime dans son genre, l’album déroule, sur 7 plages, un sludge bas du front certes, mais bien plus écoutable pour le tout venant que leurs publications précédentes. De la production au son des guitares, tout est bien plus léché que ce que cette hideuse pochette laissait présager. Si « Too Many Devils And Drugs » fait encore un peu le pont avec le punk hardcore qui a fait la renommée du gang, les breaks lourds comme l’acier et les tempi de marécages finissent, au fur et à mesure des titres, par installer Fistula dans sa nouvelle demeure, celle d’un sludge plus calculateur, mais gagnant en intérêt ce qu’il a perdu en danger. Ainsi « Morgue Attendant » se permet un riff presque hard rock et se pose, sans forcer, comme le morceau phare du disque. Notons également le délicat « Smoke Acid Shoot Pills » au rayon des morceaux composés dans l’unique but de froisser quelques cervicales.
Il est évident, à l’écoute de Longing For Infection que ceux qui criaient déjà depuis quelques temps à la traitrise de Fistula ne changeront pas leur fusil d’épaule ; pour les autres ce disque est un défouloir tout à fait valable. Alors, amateurs de Dopethrone, Weedeater ou EyeHateGod, tenez-le vous pour dit.

Est-ce le fait de venir de Grenoble l’enclavée, bordée de ses montagnes, coupant le souffle de leur imposante présence qui pousse Jagannatha à développer ses espaces sonores, à les étirer et les faire pousser jusqu’aux étoiles ?
C’est un tout cas un bel ouvrage de jams hallucinés que propose le combo le long des 4 titres couvrant 50 minutes de galette éponyme. On se dit Earthless, on pense Domadora aussi, en plus spectrale et imagé. Et l’on est, ma foi, assez facilement convaincu par le propos du quartet. Malgré des compos inégales, quelques erreurs de justesse ou de placement, des choix de sons de guitares un peu datés, il reste que cette musique puise sa force dans la progression et que les gonzes ont quelques qualités à faire valoir de ce côté-là. Le morceau introductif, Krishna, justifie à lui seul que l’on suive avec attention l’évolution des grenoblois.
Pari réussi pour Jagannatha puisque l’on se laisse finalement transporter par les ambiances poilues et les canevas psychédéliques de leurs efforts. Si les zicos arrivent à recréer live ces paysages, c’est du tout bon qui se profile sur les planches. On attend la suite avec impatience.

On sait vraiment peu de choses sur Dunsmuir. Clairement, le groupe (projet ?) dont on entendait des rumeurs d’existence depuis quelques années, a commencé à faire le buzz en ce début d’année avec l’arrivée de quelques premières bribes de son. Un buzz clairement lié à la présence au micro de Neil Fallon – autre illustration si besoin de la notoriété atteinte par Clutch depuis quelques années. Autour de lui, pour autant, on ne trouve pas vraiment des perdreaux de l’année : Brad Davis, le bassiste de Fu Manchu, Dave Bone, le guitariste de The Company Band (autre projet où officient Fallon et… Brad Davis !) viennent épauler le vocaliste, tandis que Vinny Appice vient compléter la section rythmique, en apportant le poids de son expérience derrière les futs… et quelle expérience ! Appice, mythique mercenaire des baguettes, a martelé les toms de Black Sabbath et Dio, et des dizaines (aucune exagération) d’autres groupes ou projets hard rock et metal depuis plusieurs décennies (oui, le gars arrive sur sa soixantaine de printemps, quand même). Une pointure, quoi, que le trio a contacté sur le tard pour compléter le line up idéal qu’ils avaient en tête pour le groupe. Donc oui, sur le papier, Dunsmuir suscite la curiosité.
Composé et enregistré à l’arrache (la distance géographique étant comme souvent compensée par des échanges de fichiers électroniques), l’album se voit sortir cet été en pur mode DIY (sur un label obscur, Hall of Records, probablement bricolé par nos lascars). On avait eu un avant-goût il y a quelques mois de la musique du groupe, via ce single comportant deux premiers extraits de l’album : « Our Only Master » et « The Bats (are Hungry Tonight) ». Il s’avère par ailleurs que ces deux titres proposent un très bon résumé du contenu de l’album – mais nous y reviendrons…
Il y a fort à parier que la plupart des lecteurs de cette chronique se demandent présentement à quel point Dunsmuir est proche musicalement de Clutch, bien sûr. Difficile à dire en réalité : si la contribution de Neil Fallon à la musique de Clutch est aussi significative que celle de ses trois collègues musiciens, il est évident que sa voix porte à elle-seule au moins la moitié du « son » de Clutch – au moins sur une écoute superficielle. Et à ce titre, sur le même principe, les similitudes sont criantes dans les premières écoutes (tout autant qu’elles pouvaient l’être avec The Company Band, par exemple). Après un peu de temps, toutefois, le besoin de nuance s’impose : il s’avère que chaque musicien apporte une pierre bien spécifique à cet édifice finalement plutôt robuste. Inutile d’aborder le cas Fallon, ses vocaux puissants et son phrasé typique apportent énormément à l’identité de Dunsmuir. Dave Bone amène pour sa part des riffs et des plans de guitare incisifs, pointus (« Hung On The Rocks », « Deceiver », « … And Madness », le riff groovy de « Orb of Empire », …), et ne se cache pas dès qu’il s’agit d’aligner un solo ici ou là. Ses lignes sont plus connotées hard rock et metal que pour The Company Band, autre exemple de l’identité propre de Dunsmuir. Brad Davis, peu démonstratif, la joue « team player », et concentre son jeu sur l’efficacité du morceau. Quant à Vinny Appice, gageons que les experts batteurs sauront reconnaître sa patte… Le commun des mortels, lui, notera a minima le poids remarquable de la batterie dans l’alchimie du groupe (voir comment il joue son rôle dans « The Bats (Are Hungry Tonight) », à titre d’illustration), probablement impossible sans un batteur de cette trempe.
Les compos sont massives, plutôt dans la veine des dernières productions de Clutch (pour focaliser vers la référence la plus directe), et efficaces dans la durée (plusieurs écoutes sont nécessaires pour en saisir la pleine valeur). Difficile du coup de mettre la lumière sur certains d’entre eux : on est dans du haut niveau, les gars ne sont pas manchots. On proposera volontiers pour les impatients de se plonger en premier sur le duo « Deceiver » / « … And Madness », ou sur « Crawling Chaos », et notamment sa deuxième partie, plus originale.
Difficile de dire du mal de ce disque en tous les cas : on l’attendait évidemment au tournant (tout le monde n’étant pas fanatique de l’orientation de Clutch ces dernières années, prêt à tomber en embuscade sur la moindre incartade d’un des membres du groupe) mais force est de reconnaître ici sinon l’authenticité, au moins la vraie identité du groupe, à travers ce très bon disque, consistant et cohérent de bout en bout, sans point faible. Trop beau pour être honnête ? Trop hard, pas assez [insérez ici le terme qui vous convient dans la sphère stoner] ? A vous de voir. Mais attention à ne pas trop bouder votre plaisir…

Les ricains de Valient Thorr affublés de leur dad-bod leader, Valient Himself, nous reviennent dans un nouvel opus, Old Salt, toujours plus rock’n’roll, toujours plus direct mais jamais facile. Flanqué de sa nouvelle section rythmique aperçue lors des derniers concerts européens, le quintet déroule un 11 titres efficace mais déroutant pour qui ne posera pas son écoute plus que nécessaire.
Il y a chez Valient Thorr un aspect Turbonegro, le grimage en moins, le côté arty en plus. Chaque titre comporte ses nécessaires cassures pour faire de leur rock un théâtre branlant, absurde mais néanmoins rentre-dedans. Il n’y a qu’à prendre « Mirakuru » ou « Lil Knife », les deux premiers titres. Écrins swinguant en diable pourtant contre-fracassés par de fréquentes ruptures rythmiques, autoroutes efficaces de rock sauvagement asphaltés de dissonances, plusieurs écoutes seront nécessaires pour appréhender cette nouvelle production.
Côté production justement rien à redire. Ça joue juste et foutrement bien, le tout serti dans un espace sonore peut-être un peu trop propre tant les Valient’s guitares sonnent garage, Budweiser chaude et médiator ensanglanté.
Mais cet édifice ne trouve son absolu intérêt que par l’intervention de Valient Himself. A l’instar de ses interventions live, ses paroles naviguent entre sur-réalisme, absurdité bourbonnnante, froide colère, constat lunaire. Et le patchwork insensé de tenir bon. Car oui, malgré l’apparence claudicante de l’édifice, Old Salt tient la route et promet encore de beaux moments foutraques en live.
Il conviendra d’aiguiser sa curiosité pour pouvoir saisir le potentiel de ce nouvel opus. Valient Thorr ne ré-invente pas sa grammaire mais se pose une fois de plus en trublion, cherchant toujours l’absurde dans la simplicité, le nid de poule dans l’autoroute. Dans la démarche, ils me font penser à des Jean Tardieu ou Pierre Dac du rock, des génies de la dérision, du mot qui fera basculer la phrase, du grain de sable qui fera basculer la dune. Pour les plus sanguins d’entre-vous, une simple écoute de titres tels que « The Shroud » ou « Spellbroke » saura vous convaincre de la qualité de cet album.
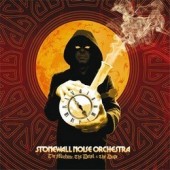
Tel un « Big Bang » temporel, Stonewall Noise Orchestra est de retour avec un cinquième opus s’intitulant The Machine, The Devil & The Dope. Amis du bon gros Rock-Metal des plus alternatifs et amoureux des solos fins, la route vous est toute ouverte.
Le quintuor nous offre un confortable panel de neuf morceaux formidablement bien construits d’un point de vue sonore. En effet, la production studio est très propre, bien ficelée et on s’attache très vite aux dynamiques du son. De plus, on apprécie le fait que le voyage se prolonge pendant près de quarante minutes, ce qui s’avère être de plus en plus rare aujourd’hui. Ainsi, on obtient une bonne voix rock’n’roll, des instruments carrés avec une bonne mise en avant des guitares : une production des plus classiques pour une efficacité au rendez-vous.
Mais alors, qu’en est-il de la forme de cet album ? Autant dire que l’ensemble demeure très proche de ce qu’on peut déjà entendre dans ce genre musical : pas de réelle volonté de réinventer, mais pourtant, on note une touche d’originalité. En effet, le choix d’alourdir des titres tels que « I, The Servant », qui est une grosse pépite, détache un peu plus la base rythmique (basse/batterie) du reste, ce qui provoque une charmante tendance au bon gros groove. Et ce doux caractère se retrouve tout aussi bien dans « Welcome Home », qui est THE morceau de la galette avec un clip qui reflète bien leur univers, que dans « Superior #1 » : une grosse tuerie rythmique et mélodique.
Néanmoins, on dénote parfois un certain manque de subtilité dans quelques morceaux tels que « On A Program » ou encore « Into The Fire » pour ne citer qu’eux. D’ailleurs « Stone Crazy » marque bel et bien le fossé entre ces deux positions musicales : d’un côté, on apprécie vraiment l’aspect clair et limpide du titre, et en même temps on a l’impression qu’il manque quelque chose pour en faire un gros monstre Stoner. Mais, il ne faut pas se reposer uniquement sur ces bémols, car s’il y a parfois un manque d’innovation, il est évident que The Machine, The Devil & The Dope reflète une très bonne cohésion de groupe comme l’attestent les morceaux « The Fever », qui est une très bonne mise en bouche, et le dernier titre (portant le nom éponyme de l’album).
Ce cinquième album est donc une bonne occasion pour découvrir ou redécouvrir SNO dans de très bonnes conditions. Car même si parfois on aurait apprécié un peu plus de prise de risque, cet opus entend tout de même rafraîchir les rangs de l’univers Rock-Metal.
![HVSK-1213-400x400[1]](https://desert-rock.com/dr/chrocd/files/2016/07/HVSK-1213-400x4001-170x170.jpg)
Gorilla et Grifter sont deux groupes anglais dont nous avons trop peu d’échos depuis quelques années – même si Grifter s’est rappelé à nos souvenirs il y a peu par la grâce (!!) de son dernier album The Return Of The Bearded Brethren. Quant à Gorilla, leurs plus récentes sorties ont été distribuées si confidentiellement qu’on avait oublié jusqu’à leur existence (même si leur « Maximum Riff Mania » a laissé quelques traces au début du millénaire, encore bien présentes jusqu’à aujourd’hui) – il faut dire que leur frontman a désormais plus de succès avec The Admiral Sir Cloudesley Shovell… Quoi qu’il en soit, ces groupes sont toujours actifs, surtout sur leurs terres grand-britanniques en réalité. Par le biais du label anglais qui a le vent en poupe, HeaviSike (Bright Curse, etc…), les deux groupes, qui partagent plus que leur nationalité (même approche musicale, même attitude…) se voient rassemblés pour un EP collaboratif qui fait bien plaisir par où il passe.
Huit titres, quatre chacun : très vite l’on comprend que l’heure n’est ni à la tergiversation ni à la subtilité. Ce « Both Barrels » de Grifter convoque Lemmy en invité unique, et l’on est vite écrasé par l’influence Motorheadienne, même si le clin d’œil grossier est clairement un hommage plutôt qu’un plagiat. Il en va de même pour un « Grind Yer Down » du même tonneau (de whisky-coca) : la voix de Johnny Gorilla, qui n’est jamais très loin de celle du bassiste légendaire sus-mentionné, apporte la dose de Houblon tiède qui porte la baraque sur ces quatre premiers titres (la face A du vinyl), et autant de petites tornades jouées pied au plancher. Il n’empêche, cette ombre de Motörhead qui couvre les quatre productions du groupe sur cet EP nous détachent trop de la qualité intrinsèque de Grifter. Plus d’originalité, et un vrai travail (conscient – il faut qu’ils ouvrent les yeux et les oreilles pour mieux se détacher de cette influence) aurait été de bon aloi ici.
De l’originalité, chez Grifter, on en trouve quand même un peu plus. Le trio anglais partage clairement avec l’autre trio anglas une certaine idée du gros rock qui tâche, et ils s’y entendent pour porter des compos qui, si elles ne visent pas à briller par leur originalité éclatante, apportent bien plus de relief que les productions de Gorilla sur le recto de cette galette. Gros riffs, compos marquées au fer rouge comme pour mieux attester de leur provenance directe de la patrie du gros rock graisseux, mais aussi quelques breaks un peu décalés ici ou là, un chant moins percutant mais tout à fait adapté aux atermoiements du groupe… Les compos de Grifter sont moins immédiates que celles de Gorilla, mais on est plus enclin à y revenir après un gros paquet d’écoutes. Un signe ? Dans tous les cas, clairement les premières écoutes jouent en la faveur de Gorilla, hôte de la face A, tandis que les écoutes suivantes incitent plutôt à user la face B de Grifter, plus riche.
On sort donc de cette grosse demi-heure un peu repus, après quatre titres de chaque groupe délivrés comme autant de parpaings, miroirs grossissant de leur musicalité respective.
|
|








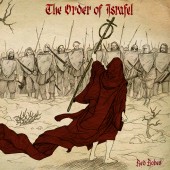






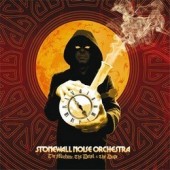
![HVSK-1213-400x400[1]](https://desert-rock.com/dr/chrocd/files/2016/07/HVSK-1213-400x4001-170x170.jpg)


