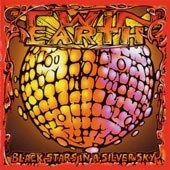|
|
 Quelle bombe ! Trop rapidement catalogués ‘stoner’ du fait de leur appartenance au prestigieux catalogue du label de Frisco ‘Man’s Ruin’, ce groupe de Cleveland pond avec ce brûlot un pur chef d’œuvre de hard rock au sens large. Certes, au stoner rock traditionnel, ils empruntent cette méchante propension à pondre des riffs en cascade et à les ensevelir sous des guitares ultra heavy, mais Disengage est tellement au dessus de cette simple étiquette ! Même si, je le répète, la guitare de Mike Callahan se taille la part du lion (et c’est rien de le dire !), autant par sa présence et son son ultra heavy que par ses superbes et discrets soli, et ses rythmiques plombées, on remarque aussi un brillant chanteur pour enjoliver l’ensemble. On notera dans son chant quelques intonations qui le rapprochent de Dexter de Offspring, mais autant dire que la musique de Disengage est bien éloignée des pop-rockers d’Offspring ! Une fois passées les premières écoutes, on remarque alors la qualité des compos, du lent et heavy ‘Exhaust’ au superbe ‘Nine lives in days’ en passant par le puissant ‘Spine of teeth’ en intro ou le vicieux ‘Tarantella’, ce genre de chansons qu’on pourra écouter dans 5 ans sans se dire ‘putain, ça a vieilli quand même’. Pour pimenter le tout, un son et une prod’ énormes apportent la cerise sur le gâteau, comme si on avait besoin de ça pour décider d’acheter ce CD !
 Le premier contact avec Duster 69, c’est un peu comme la mère d’une jeune fille de bonne famille qui rencontre son gendre pour la 1ère fois, et que ce dernier lui rôte au visage et vômit sa bière sur les tapis XIXème. Une agression, quelque chose de gras et de vulgaire, mais finalement débridé et jouissif.C’est l’effet que fait “Deep Down” en intro de l’album, où Lucki Schmidt crache ses tripes dans le micro pendant 3min30, soutenu par la guitare du père Jochen, acérée comme une lame de rasoir émoussée. Le reste de l’album est de cette trempe, avec des vraies prises de risque en terme de compo (Surprise : ya pas que du bourrin !). La mélodie est au rendez-vous, et l’accent est mis sur les compos (ça sent les chansons éprouvées et testées dans tous les sens dans le moindre bar et le moindre bout de scène de la région…), si bien que pour un premier véritable album, on a vraiment la sensation de se retrouver devant du travail de pro.Le genre abordé, difficile à décrire, ça part vraiment dans tous les sens ! Une sorte de croisement entre Motörhead et les premiers albums des Hellacopters ou de backyard Babies : une attitude rock n roll pied au plancher, un gros son bien gras, et une petite dose de hard rock “à l’allemande”… Le tout est vraiment bien gaulé, le son est nickel, les musiciens assurent super bien, et puis la voix de Lucki tient la baraque : il a une véritable identité vocale, ce qui est bien trop rare finalement chez plein d’autres groupes !Bref, un album très agréable à écouter (un peu moins pour vos voisins !), il y a des chansons pour toutes les humeurs, mais surtout les bonnes : les titres sont essentiellement rageurs et rapides, et mettent la pêche ! Pas prétentieux pour deux sous, mais naïf et frondeur comme on les aime. Que demander de plus à un album de nos jours ? Pour les fine-bouches, il y a aussi une vidéo pour “Deep Down” sur le CD, très sympa !
Le plus prolifique des labels italiens a encore frappé. Et juste. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. En intégrant les suédois de Twin Earth dans leur écurie, Beard of Stars fusionnent avec la quintessence du stoner rock. Si ce dernier pouvait se synthétiser, probablement qu’il se nommerait Twin Earth. En neuf titres, ce groupe fait la preuve d’une maîtrise inouïe de son sujet. Tout y est. Absolument tout. Il revisite la gamme complète de la climatologie du stoner rock. Attention, pas en reproduisant une tonne de gimmicks éculés, mais en proposant une nouvelle lecture d’un genre musical sur un mode à la fois original, nerveux et limpide. Quelle maestria. Cet album constitue une référence incontournable en ce qu’il se réfère constamment et respectueusement à ses influences canoniques tout en les magnifiant par l’élégance d’un traitement revigorant. L’appareil digestif de ce groupe est incontestablement en très grande forme. Un must.
Power trio de Detroit. Motor City. Celle-là même qui a produit les Stooges, le MC5 et Ted Nugent. Tout pour plaire de prime abord. La fuzz est présente à tous les étages, Malleus a encore fait un beau boulot graphique, pourtant il manque un je ne sais quoi pour rendre ce disque réellement attractif. Non pas qu’il soit mauvais. Non, simplement, il me semble handicapé par un problème d’écriture. La construction des morceaux me laisse dubitatif. Ce disque est étranger à mon métabolisme. Trop linéaire peut être. Bien qu’ayant fait effort particulier pour apprivoiser mes oreilles, il n’a pas réussi à capter mon attention. Je ne voudrais pas être injuste à son endroit. Mais si c’est l’ennui qui domine, pas la peine d’insister davantage.
 Une question me taraude en découvrant ‘X’, qu’est-ce qui fait avancer ce trio canadien ? Est-ce la rudesse du climat de Toronto, les substances illicites ou leur filiation avec le père Otis qui les pousse à composer des albums aussi glauques ? Car ces lascars sont loin d’en être à leur coup d’essai avec ce septième album qui est aussi léger que le pas d’un rhinocéros en rut qui s’en va rejoindre sa belle à un point d’eau dans la torpeur de la savane africaine. Pachydermique à l’extrême, leur lourdeur musicale sert de trame à des chants aliens, sourds et redondants tout au long de cette œuvre cosmique en sept actes. Attention : s’il n’est pas facile d’accès, je le concède, l’univers des faux frères n’en demeure pas moins digne d’intérêts pour quiconque se donnera la peine de ne pas s’arrêter à la première écoute du présent album. Le planant ‘The Pusher’ est sans conteste le morceau qui m’a le plus emballé sur cette production ; il se démarque sur cette œuvre homogène par ses guitares jouissives et son ambiance un ton plus light que les autres morceaux réunis sur cette sortie. Digne d’intérêt pour consommateur averti.
 Parfois, dans des moments d’égarement, j’éprouve une certaine lassitude face à tous ces groupes portés sur le déluge de guitares soutenu par des rythmiques binaires pendant qu’un gars, rarement doué pour çà, s’époumonent en brayant une prose peu réjouissante, parfois incompréhensible et souvent vide de sens. Dans ces moments-là, j’ai envie de légèreté, de groove dansants et d’énergie positive. Et je l’avoue, il m’arrive alors d’écouter des groupes ou artistes que je n’oserais citer ici par peur de perdre le peu de crédibilité dont je pourrais jouir. Cela dure en général quelques semaines, avant qu’un album de chevelus ne me replace sur le droit chemin. Le dernier en date s’appelle « Tempel » et il a remis de l’ordre dans mes neurones agités en moins de dix minutes, le temps pour « Aquamaria » de balayer toutes mes remises en question. Un condensé de tout ce dont Colour Haze est capable en 2006, le résultat d’une décennie passée à affiner son style, à créer son vocabulaire et à modeler son propre son. Pour présenter Colour Haze, on pourrait parler en chiffres : trois musiciens d’exception, plus de dix ans d’existence dont sept avec un line-up inchangé, huit albums et quelques splits sans parler des nombreuses apparitions sur diverses compilations, une grosse centaine de concerts dont quelques apparitions remarquées de l’autre côté de l’Atlantique. Mais « Tempel » est bien plus que la somme de tout çà, c’est l’aboutissement d’une démarche sincère et rigoureuse, l’expression d’une volonté de ne jamais stagner et de continuer à aller de l’avant sans jamais se reposer sur ses acquis. Colour Haze prétend faire du heavy psychédélique. C’est faux. Colour Haze fait du heavy ET du psychédélisme et tout son talent consiste à balader l’auditeur de l’un à l’autre sans qu’il ne s’en rende compte en balançant du gros son aux détours d’un solo moelleux marqué de la griffe unique de Stefan Koglek, le géant aux pieds nus au style reconnaissable entre milles. On suit volontiers ces trois-là dans ce voyage en terrain accidenté mais toujours fluide où la rythmique vous caresse les tympans avant de vous les exploser sans concessions en prenant des chemins détournés, guidée par une guitare inventive et excitante. Ils ne sont pas les premiers à utiliser ces structures progressives, loin de là, mais ils excellent à enchevêtrer les différentes parties d’un morceau pour le rendre homogène, créant une dynamique souvent irrésistible. Cerise sur le gâteau, Colour Haze s’est offert un son chaud et organique qui renvoie tous les pâles copieurs lécher leurs pochettes de Kyuss, apportant ce petit supplément d’âme qui fait toute la différence entre une poignée de bons musiciens et un grand groupe.
Qui eut cru qu’un Monster Magnet exsangue, boiteux, amputé, eut pu accoucher d’une si bonne galette ? La dernière année passée aurait pourtant pu être fatale à l’aimant monstrueux, entre le départ d’un gratteux, Phil Cavaino, et l’overdose de papa Wyndorf, on ne donnait pas cher d’eux. Et finalement ça ne tracassait pas grand monde, Monster Magnet restant aux yeux de beaucoup ce groupe qui se plaît tant à nous énerver, nous, fans de stoner. Le groupe s’est toujours tant moqué des étiquettes qu’il paraissait renier ses derniers albums, pierres fondatrices s’il en est du “mouvement” tout entier. Trop occupé à se faire plaisir dans des délires mégalo hard-rock-esques. Certes, le dernier album, “Monolithic Baby” contenait quelques très bonnes tranches de joie. Mais au final, “4-way Diablo”, enfanté dans la crise, dans un contexte flou, nébuleux, instable, se révèle un retour aux sources salvateur.
Ben oui, Monster Magnet refait du stoner. Dur à croire hein ? Il manque certes un peu de psyché / space rock pour nous rappeler parfaitement Spine Of God ou Superjudge, mais au final, assaini (quel groupe a vraiment besoin de deux guitares et demie ? Surtout quand l’un des gratteux n’est autre qu’Ed Mundell), Monster Magnet paraît gagner en inspiration.Niveau compo, Wyndorf fait un quasi-sans faute. Ca commence avec un “4 Way Diablo” avec un insaisissable lick de guitare cristallin lancinant, un gimmick impeccable qui porte ce morceau au chant presque larmoyant. Quelques titres se détacheront ensuite ici ou là, notamment le singulier “You’re alive” (quasiment ses uniques paroles), un exercice de style frais et réussi, ou le très oriental “Freeze and pixelate”, épique instrumental s’il en est. Le space rock n’est pas totalement absent, avec des relents bien présents sur “Cyclone”, ou même sur leur resucée du “2000 lightyears from home” des Rolling Stones. Et que dire de l’émouvant “Poguesque” “Little bag of gloom” de clôture, couillu, épuré au maximum jusque dans le chant non trafiqué de Wyndorf (assez rare pour être signalé).
Bref, sans faire table rase des dernières années, Monster Magnet puise dans cette expérience et l’injecte dans son vieux stoner “old school” pour accoucher d’une galette bâtarde mais assez bandante. D’aucuns se demanderont si ce retour aux sources ne cache pas un cruel manque d’inspiration, un pas en arrière, un regard jeté dans le rétroviseur vers leur gloire passée. Envoyez-les se faire foutre, achetez ce CD, et montez le volume en écoutant “Slap in the face”.
Le premier album de ce groupe suédois m’avait littéralement subjugué en son temps (1999). Le fort ancrage blues qu’il était parvenu à renouveler de manière très originale s’est quasiment évanoui ici. L’orientation heavy-prog qui semble désormais privilégiée par Half Man n’occulte que trop le caractère céleste de la voix de Janne. Celle-ci ne trouve à s’exprimer que dans de trop rares morceaux qui renouent alors subrepticement avec sa grandeur passée. Curieusement, l’ossature de ces morceaux a été empruntée à Franck Zappa, John Lee Hooker et à un blues traditionnel chanté a capella. Non pas qu’il s’agisse d’un mauvais album, loin de là. Un titre comme « Grass stains » d’où émerge l’harmonica est une réussite incontestable. Simplement, il manque ce trait de génie, cette inspiration, ce petit plus qui permettrait à mes oreilles de s’extasier. A trop s’éloigner des rivages du Mississippi, la musique de Half Man s’est refroidie. Espérons qu’il ne s’agira que d’une éphémère erreur de cap.
 Un abonné absent pour parler d’un groupe abonné absent depuis une décennie, cela va de soit.
Le groupe en question ? Sloth. L’anglais, qui jouait du doom teinté d’occultisme et de psychédélisme (j’en ai dénombré trois voir quatre, dur de s’y retrouver, celui incriminé est chroniqué ici-même par votre serviteur). Un one shot qui a conservé dans mon panthéon sa place tout en haut, juste en dessous d’un certain Let us prey de qui vous savez, qui jouait dans la même cour, celle d’un doom anglais aussi lourd que porté sur l’expérimentation. Bref, vous vous en souvenez ? après avoir attendu en vain durant 10 ans donc une suite, avec quelques sursauts d’excitation (live avec les sorciers du Dorset et la première mouture des capricornes qui copulaient alors avec les singes de fer et les gobelins oranges, annonce d’un second album sur leur page myspace naissante), j’ai appris de source sûre la défection définitive d’un de mes groupes favoris. Ce que j’allais le plus regretter ? le chant magistral de Gaz.
Serpent Venom, j’avoue avoir laissé filer toutes les occasions de m’intéresser de près ou de loin à leur genèse. Pourtant je fréquentais à l’époque assidûment les bonnes places. Ce n’est qu’à la sortie de ce digibook soigné, plagiant les bouquins de magie noire de Dennis Wheatley et les pubs bon marchés des pulps anglais des 70’s que j’ai tiqué. Je reste sensible aux packagings, que vous voulez-vous. Et dès les premières minutes, un « détail » m’a titillé. J’avais déjà entendu cette voix. La lecture du livret m’en a donné la confirmation, Serpent Venom est le nouvel écrin de Gaz Rickett’s. Et si j’ai toujours actuellement du mal à me refréner sur la comparaison Sloth/SV (voir ma critique sur le site ami slowend), c’est parce que ce petit lutin anglais y démontre un talent vocal qui n’a pas faiblit en 10 ans.
Si je voulais me montrer plus objectif que sur la lente fin, je dirai que musicalement, Serpent Venom est plus sage, plus respectueux des dogmes doom-atiques . moins de folie dans les riffs qui restent dans le haut panier du registre doom trad, batterie moins titanesque, ambiances moins cyclopéennes. Maiiis, il y a un je ne sais quoi de feutré, chaleureux, folklorique qui fait qu’on s’y attache vite. Ça sent bon le terroir et la magie noire, les légendes de la Perfide Albion. Un disque créé sans doute avec moins d’ambitions que son grand frère mais qui illustre à merveille la bonne santé d’un renouveau doom anglais qui pioche moins dans l’héritage sabbathien (encore que), saint vitusien ou troublien (vous m’excuserez ces barbarismes) que dans ceux de l’ancienne nouvelle garde, Cathedral, Electric Wizard et consorts qui ont défriché le terrain. Retro est le terme utilisé pour désigner ces nouveaux chevaliers, comme Jex Thoth, Serpent Throne, Blood Ceremony et autres bandes bloquée sur les saintes décennies passées. Serpent Venom en exploite certains thèmes, utilise avec gourmandise d’orgues et d’effets cosmiques, mais les associe à ce qui faisait la force de The Voice of God, The ethereal Mirror ou encore Dopethrone. Un résultat satisfaisant sublimé par l’apport de Gaz, j’y reviens. Un chant incantatoire, épique, lyrique sans être ridicule qui soyons honnête m’a fait accroché direct mais le cas aurait été le même s’il avait décidé de se mettre au zouk. Certains passages tant sur le plan instrumental que vocal valent réellement leur pesant de cacahuètes.
On en sera que plus déçu d’apprendre qu’à la fin de leur tournée européenne, le groupe ne sera déjà plus, tout du moins sous cette forme. Un des guitaristes s’en allant pour diverses raisons. Le reste de la bande a décidé de poursuivre sous un autre nom, avec de nouvelles livrées. Reste à savoir si cela prendra encore dix ans avant de réentendre ce bon vieux Gaz.
Apres quelques 45 tours plus qu’encourageant, Fu Manchu se voit enfin récompensé par la sortie d’un premier album en 1994. Eddie Glass (qui formera ensuite Nebula) vient de remplacer Scott Votaw à la guitare et le groupe demande à Brant Bjork (qui rejoindra le groupe quelques années plus tard) de les aider pour la production.
On sent avec les 8 titres qui composent ce court album (moins d’une demi heure) que Fu Manchu tente et réussit en quelques sortes à créer son propre son, sa propre identité musicale au beau milieu des années 90 très prolixes dans le milieu du rock. On ne peut pas vraiment dire que tout cela soit révolutionnaire, n’exagérons pas, mais force est de constater que le potentiel de cette machine à riff est bien là, caché derrière, prêt à bondir et à s’exprimer dès que l’occasion se présentera. D’un autre côté, ne boudons pas notre plaisir à l’écoute par exemple de « Show and Time » typique de ce que Fu Manchu est capable de faire et attendons la suite avec impatience.
Miam. Cet album venu de nulle part, oeuvre d’un combo de bouseux du sud des USA, évoluant sous le patronyme à fort capital sympathie “Stonerider”, ravira plus d’un fan de rock’n’roll. Le vrai, tendance hard sautillant, à la sauce 80’s décomplexées, avec une grosse couche de graisse et assez de riffs et de soli pour décoiffer un moine trappiste.
Pourtant, à aucun moment Stonerider ne surprend en terme de genre abordé : la somme d’influences fédérées par ce quatuor est hallucinante. C’est sûr, c’est pas du Tool ou du Neurosis. “Three legs of trouble” comporte bien plus que son lot de sonorités plus ou moins proches de groupes référentiels : on entend du AC/DC par caisses entières (l’intro de “Juice man”, celle de “Wild Child” – et le morceau entier d’ailleurs, bluffant !), du Guns’N’Roses parfois (l’intro totalement “slashesque” de “Back from the dead”, ou “Hair of the dog”), du Lynyrd Skynyrd (“Bad lovin’…”, dont le break-boogie en fin de morceau laisse augurer à lui seul des montagnes d’impros orgasmiques en live, j’en salive d’avance…), du Fu Manchu (“Juice Man” pourrait être un produit de la bande à Scott Hill), on pourrait en citer des pelles. Les amateurs de saturation et de wah wah seront aux anges, ou plus généralement ceux de grosses guitares.
Bref, si vous cherchez le groupe le plus original de la planète, Stonerider n’est pas pour vous. En revanche, si vous cherchez l’un des plus funs, excitants et chaleureux de 2008, “Three legs of trouble” est le disque que vous cherchez. Gageons que vous vous féliciterez de cet achat à chaque fois que vous presserez la touche “Repeat” de votre platine.
 Iron Monkey tout d’abord. « Arsonaut », qui ouvre le disque est un monument. Du pur Black Sabbath avec un chant ultra déchiré, un peu à la manière des chanteurs de death. Le plus incroyable c’est que cela fonctionne. Du « stoner sludge doom » ultra torturé en somme. En théorie cela m’aurait semblé assez improbable, mais il faut se rendre à l’évidence, la magie opère. Du coup, on se laisse griser par le concept et on se prend à en vouloir davantage. Si bien que les deux titres suivants (dont une reprise de Corrosion of Conformity, « Kiss of Death »), même s’ils ont un format moins seventies, sont réellement excitants. Rien à dire, ces titres sont une vraie tuerie et me donnent envie de me pencher plus avant sur leur production discographique chez Earache. Très intense comme expérience. Les trois titres suivants nous viennent des japonais de Church of Misery que j’avais découvert sur la compile « Stone deaf forever ». On passera sur leur apparente fascination pour les serial killers. Marchant dans les pas de Black Sabbath et emboîtant ceux de Sleep qui n’en ont jamais été très éloignés, ils semblent évoluer dévotement dans l’espace relativement restreint de la perpétuation de la tradition. C’est avec beaucoup de classe qu’ils alignent ces trois morceaux très lents et très lourds. Ce split a indéniablement des vertus didactiques en ce qu’il a la capacité de plaire aux fans de l’écurie Earache, qu’il pourra ensuite conduire vers des mondes plus apaisés. L’inverse est vrai également en ce que les fans du Sab pourront aller faire une incursion dans un univers plus noir et plus tourmenté que ce qu’ils ont l’habitude d’entendre. Pour les vrais curieux pas trop frileux.
De quoi vous effrayer de prime abord avec un nom pareil, ce Cortez-ci n’est pas mandaté par Charles Quint pour asservir l’empire aztèque et voler son or mais bien pour foutre le souk dans un déluge sonore aux réminiscences guerrières mais sans débordements d’agressivité.
Ceci est le premier opus des 5 du Massachusetts mais ils sont très loin d’en être à leurs débuts puisque le quintet s’est formé sur les cendres de groupes tels que Supersoul Challenger, Sin City Chainsaw et encore Fast Actin’ Fuses. A la lecture de cette info et au son du premier morceau, vous aurez vite compris qu’on n’a pas à faire à des petits joueurs.
Ici, le quintet de Boston nous livre un travail alternant puissance et finesse. Les mid-tempos ardents laissent transpirer un mur de gros son bien gras et visqueux surplombé par une voie tranchante et haut perchée sans sombrer dans le trop aigu. Ses relents sudistes sont d’ailleurs non sans rappeler un certain Neil Fannon mais il faut noter que jamais le chanteur ne tombe dans la pâle copie.
Que dire de la section rythmique? Si le bassiste assure des lignes sobres et efficaces, il remplit également parfaitement son rôle de choriste. Et la batterie? Une pure merveille: une frappe nette et puissante comme un coup de gourdin, profonde et inspirée comme le maniement d’un sabre pour, ô belle et grande surprise, alterner des roulements de grosse caisse et toms dans un superbe exercice technique sans éclabousser. Les cymbales ne sont pas épargnées non plus et en prennent même sérieusement pour leur grade.
Les tempos varient au fil des morceaux et l’on peut çà et là fleurter avec le sludge pour ensuite retomber dans des envois carrés et couillus. Imaginez une horde de guerriers sanguinaires à vos trousses, avançant inéluctablement avec la ferme intention de vous mettre en pièces, vous aurez un avant-goût des chansons de Cortez.
Un petit plus encore: le choix du plages est savamment orchestré car l’on monte en intensité au fur et à mesure de l’écoute pour atterrir sur le 5e et avant-dernier morceau: Stone The Bastards. Ce morceau est une pure merveille et contient un refrain à hurler au final éponyme que l’on ne peut s’empêcher de reprendre en chœur.
Le seul reproche que l’on puisse faire à cette plaque, c’est la longueur: 35 minutes, c’est trop peu! Ok, il vaut mieux 35 minutes de tuerie plutôt qu’une heure de daube (ou encore meubler pour meubler). Mais quand même, on en redemande. Une seule solution: faire tourner la plaque en boucle (et patienter jusqu’à la sortie du prochain album). Une toute belle sortie.
 Nouvellement signé sur le label à la tête d’hydre, Big Business est le méfait de deux acteurs de la scène de rock de Seattle. A ma gauche Jared Warren de Karp, Tight Bros et The Whip à la basse et à ma droite Coady Willis de Dead Low Tide, Broadcast Oblivian et The Murder City Devils à la batterie. Après avoir sillonné une partie du territoire américain, la structure bicéphale est allée s’enfermer avec Phil Ek en août dernier pour nous livrer ce ‘Head For The Shallow’ en début d’année.Musicalement parlant nous nous trouvons sur des terres encore très peu explorées aux confins de certaines dérives du hardcore et d’un stoner doomisant flirtant en permanence avec le chaos sonique. Vrombissant un peu à la manière de Motörhead, sur une trame musicale très sourde, martelée par une rythmique au bord de l’apoplexie, les huit plages de cette production sont dans un style qui n’est pas sans rappeler High On Fire ou certaines signatures du label qui les sort ainsi que certains groupes de chez Relapse.Ne vous fiez pas au sifflement désinvolte qui sert de prélude à ce cd, ces lascars ne sont pas là pour plaisanter. Toujours borderline, les plages se succèdent dans le créneau choisi par le groupe sans jamais être de pâles copies les unes des autres. Que ce soit avec ‘Easter Romantic’, dont la ligne de basse n’est pas sans rappeler ‘Ace Of Spade’ de la bande à Lemmy ou ‘Focus Pocus’ et son refrain aérien, ce disque fait mouche en évoluant continuellement dans un registre très éloignés des sentiers battus. Ma préférence va à ‘Eis Hexe’, composition rapide et ultra-carrée qui synthétise tous les atouts de la formation.
En 2005 et 2006, je vous ai saoulés avec un duo basse-batterie, suite aux sorties consécutives de leurs deux albums, au patronyme footbalistique et à la mystique très développée. Réjouissez-vous ! Cette année, je ne vous saoulerai pas avec Om ( enfin sauf si leur nouvel album sortait avant la fin d’année, mais bon, vous y échapperez durant la grande partie de 2007 ) ! Non, cette année, je vous saoulerai avec Serpent Throne !
On change totalement de registre, car s’il est question de mysticisme ici, il faut plutôt s’intéresser, comme le nom du disque l’indique, au coté obscur.
Serpent Throne est un combo instrumental, suite à la défection (ou à la mort, le ton de leur texte de présentation sur myspace étant difficilement déchiffrable) de leur chanteur, qui puise son inspiration dans tout un pan de la culture hard rock de la fin des 60’s jusqu’au milieu des 70’s (une époque bénie donc).
Comme la magnifique pochette l’illustre, les films d’horreur (Wherewolves on wheels, Hammer, Fulci , etc.) , les films de bikers (d’Easy Rider à Hell’s Angels on Wheels en passant par la Horde Sauvage) et le contexte de cette époque ( il n’y a qu’à lire les mémoires de Sonny Barger ou le récit romancé de Hunter S. Thompson sur les Hell’s Angels pour se rendre compte que parfois la réalité pouvait rejoindre la fiction ) sont les principaux moteurs de ce heavy-rock qui va chercher son identité sonore du côté des riffs du sacro saint Black Sabbath (eh oui, chassez le naturel, il revient au galop, pourquoi vous parlerais-je d’un groupe n’ayant pas un quelconque rapport avec la bande à Iommi ?).
Sans conteste, l’ombre sabbathienne plane, mais contrairement à nombre de groupes qui la plagie éhontément, Serpent Throne semble avoir été touchée par la grâce divi… heu satanique dans le cas présent. Ses riffs, même ceux directement transposés, son intro orageuse à la provenance indubitable, tous les composants ‘made in Birmingham’ sont intelligemment utilisés et renforce la puissance et l’accroche du rock instrumental du quatuor philadelphien.
Totalement jouissif et produit sans arrière-pensée (vouloir être Black Sabbath à la place de Black Sabbath, 40 ans après, le coche semble avoir été loupé), ‘Ride Satan Ride’ est au Sabb’ ce que le premier album de Witchcraft fut à Pentagram. Un hommage célébrant et sincère. Ride !
|
|