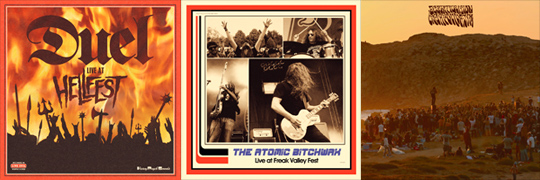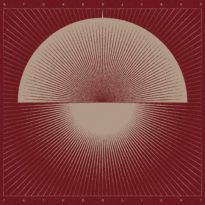|
|

Vieux routards de l’ instrumental, Rotor énumère une liste d’albums depuis 1998. Ils sortent cette année leur album Sieben, le setptième donc chez Noisolution. Nous avions pu louer les mérites de ce groupe Berlinois aux contours stylistiques mal définis mais aux compositions brillantes et fédératrice où le traitement des grattes se fait toujours dans l’originalité sur fond de rythmiques épileptiques. Voyons donc ce que nous réserve l’ovni Rotor cette fois-ci.
Le constat est qu’une fois encore le groupe a décalé son style avec ce nouvel album, allant chercher un peu plus dans ses ressorts kraut et math rock, notablement sur “Reibach” et “Schabracke”. Chaque accord est implacable, d’ une propreté saisissante marque de fabrique d’un groupe qui a longtemps fourbi ses armes sans s’attarder à coller à un style précis.
Les titres s’enchaînent cependant sans qu’ un seul soit plus mémorable que l’autre faisant de cet album comme ceux auparavant un bloc assez délicat à intégrer. Je dis qu’ aucun morceau n’est plus mémorable…c’ est aller un peu vite en besogne la perle se cache un peu il faut aller gratter du côté de “Kahlshlag” pour que le quartette se fasse plus uni, la musique plus massive et viscérale, plus doom en somme avant de conclure sur le léger “Sieben”. On le comprends dès lors avec cette transition, Rotor livre un travail en pleins et déliés les pistes sont toutes le lieu d’expérimentations entre accords percutants et compositions plus fines, ce travail étant valable tant du côté des guitares que de la rythmique.
On passe un bon moment avec Sieben, Rotor à embarqué dans cet album tout son talent de technicien et a su faire évoluer positivement sa musique pour la rendre encore plus réfléchie. Il restera cependant difficile de placer précisément le curseur de son préciation sur cet ensemble qui oscille tout de même entre le très bon et l’excellent.

Huit ans qu’on l’attend… certes, mais avant de se plaindre, rappelons-nous que nous avions attendu dix ans entre III (2005) et le dernier album en date, Middle of Nowhere, Center of Everywhere (2015). A l’image du tempo moyen de leurs compos, les californiens sont lents… Enfin, quand on dit “les californiens” – disons plutôt Lori et sa bande, car s’il en fallait encore une illustration, cette dernière production nous montre une fois de plus qu’elle est la seule maîtresse à bord, ou en tout cas le capitaine d’un navire qui change d’équipage à chaque album, chaque tournée… Il s’agit ici d’une paire d’excellents musiciens touche-à-tout ayant déjà œuvré dans des dizaines de combos peu renommés de la bay area, à savoir Bryce Shelton à la basse (et claviers), qu’on avait notamment entendu jouer du clavier sur le dernier live de HTSOB, et Jason Willer à la batterie. Mais… qu’entends-je sur cette galette ?… une seconde guitare !? Et oui, après plus de trente ans de carrière, Lori saute le pas et s’autorise l’interdit, en sortant du cadre du trio pour accueillir en second guitariste rien moins que Jason Landrian, le taciturne mais redoutable bretteur de Black Cobra… sachant, pour ceux qui suivent, que son compère Rafa Martinez au sein de Black Cobra a déjà fait certaines des plus belles heures live de Acid King à la basse (notamment lors de sa dernière prestation au Hellfest) ! Le monde est petit… Sauf que Landrian n’est pas juste une pièce rapportée : il a co-écrit le disque complet avec Lori, les deux ayant construit ces compos pendant de longs mois de répétitions.
Ce qui en est ressorti sous la forme de ce Beyond Vision est, sans la moindre ambiguïté, du pur Acid King. On est sur du doom tellurique, lent à souhait, où la science du riff absolu le dispute à la recherche de la mélodie, le tout étant à la fois bercé par les complaintes vocales lointaines et réverb-isées de Lori, et par des leads roboratives. Ces riffs fuzzés à souhait, cette basse ronde et généreuse qui supporte la plus grosse part du socle mélodique, cette batterie qui freine les velléités de frénésie et enrobe chaque séquence de déluges de crash, ces soli jamais trop techniques mais toujours enivrants, souvent à la limite de la dissonance… ce disque est globalement rassurant pour le fan.
En plusieurs aspects toutefois, Beyond Vision marque un véritable virage dans la carrière de Acid King. Pour des détails parfois (format quatuor, co-écriture…), mais plus fondamentalement pour l’ambition musicale déployée, l’impression de sortir de ce disque comme d’un cheminement dense et puissant. Lori nous prend la main dès l’intro “stellaire” de “One Light Second Away”, un titre instrumental épique, et ne nous lâche plus jusqu’à la fin, nous emmenant de planète en planète. Car il est là, bien tangible, l’autre élément clé du disque : le thème de l’Espace, qui n’est pas présent que dans le champs lexical, mais aussi dans l’ensemble des arrangements, avec des apports de nappes de synthés très subtiles (pas ou peu de contribution à la structure des titres) qui créent le liant entre les chansons, et viennent les “finir” d’un joli vernis – ce qui change un peu de l’aspect “rêche” que peuvent avoir certaines compos d’Acid King, par leur minimalisme parfois. Précisons-le à nouveau, encore et encore, cette très ingénieuse production (notons que Billy Anderson est encore aux manettes) ne fait pas ombrage au Acid King que l’on aime, qui est bien (omni)présent – par exemple dès le second titre, l’excellent “Mind’s Eye”, qui n’aurait pas dénaturé sur l’une des deux dernières galettes, avec son riff colossal et son gimmick de lead de guitare terriblement efficace, ou encore l’envoûtant “Beyond Vision”. Ces exemples illustrent parfaitement le bénéfice lié au doublon de guitare, avec une vraie ligne rythmique poids lourd et une surcouche de soli plus aériens (truchement qui avait toujours été possible en studio pour Lori, mais qui trouvait ses limites en live avec une seule guitare). Entre les deux, l’enchaînement full-instrumental du quasi drone “90 Seconds” avec le très atmosphérique et lancinant “Electro Magnetic” apportent encore la preuve que le groupe grandit, expérimente… Constat confirmé (toujours en instrumental) avec le colossal “Color Trails” en conclusion, mélant doom lugubre, rythmiques mi-martiales mi-tribales, et soli solaire tout en sobriété.
Généreux, intelligent, et surtout addictif, ce disque se déguste à chaque écoute avec un peu plus de plaisir. Largement constitué de titres instrumentaux, on aurait pu craindre la “dilution” de compos perdues au milieu de titres de remplissage ou de transition… Il n’en est rien : chaque titre est en réalité un titre de transition vers le suivant, et l’enchaînement se fait sans heurts, avec, inévitablement, un appui sur “repeat” à la fin de l’exercice. Bien joué à Blues Funeral qui sort ce disque dans le cadre de son opération PostWax II : ils pourront dans quelques années s’enorgueillir d’avoir accueilli l’un des albums les plus marquants d’Acid King. Le meilleur ? La discussion est ouverte…
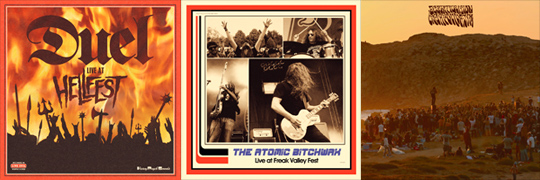
Quelle peut bien être l’intention derrière la sortie de ce quatuor de LP live (on ne parlera pas dans cette chronique des très hors sujet The Lords Of Altamont) ? C’est la vraie et seule question qui reste, une fois écoutés ces disques live… pourquoi ?
On commence par le set de Duel au Hellfest, un excellent concert certes, qui ne ressort pas grandi de son passage sur rondelle vinyle, loin s’en faut. Faute à un enregistrement probablement collecté direct sur la table de mixage, le resultat sonore est déplorable : la guitare lead geint dans le fond, le chant surnage dans un coin blindé d’une sorte d’écho lointain, la guitare rythmique grinçouille gentiment, la basse est loin, loin, loin… Un peu comme le public, strictement absent de tout le spectre sonore – un comble pour un disque live. Enregistrer un concert sous la Valley depuis la table de mixage c’est faire peu de cas du système sonore en place, qui est loin de l’équilibre d’un système hi-fi. Absurde. Quant au choix de ce set pour une trace vinylique, il permet certes de motiver un grand nombre d’acheteurs potentiels (le public présent, qui voudra en garder une trace dans sa collection) mais offre un regard bien restreint sur la carrière de cet excellent groupe (6 titres / 30 minutes…).
Le live de The Atomic Bitchwax aussi nous a séduit sur le papier. Premier constat : le son est meilleur. Est-il bon pour autant ? Correct tout au plus. L’ensemble est comme “étouffé”, oeuvre d’une captation cheap (vous vous rappelez du bon vieux temps où les live qualitatifs étaient le résultat d’un vrai travail de production, où les groupes dépêchaient des camions régie dédiés à la captation sonore ? N’espérez rien de comparable ici…). Le public est rarement audible, dommage encore une fois. Le set est un peu plus intéressant que celui de Duel en ce sens que bénéficiant de 50 minutes de set, le trio américain nous gratifie de 13 à 14 vraies chansons (à la mode TAB : entre 2 et 4 min en moyenne, avec une intro, un riff, 80% de soli, et c’est fini). Bref, une jolie set list, et un set sympa, mais sans plus.
La meilleure galette de ce malheureux trinome est celle de Ecstatic Vision. La prise de son est “un peu” meilleure (encore une prise soundboard, clairement pas en “ambiance”), avec des parties instrumentales plus claires, même si tout sonne en retrait derrière l’écrasante guitare lead et son overdose de wah-wah. De fait, l’aspect enivrant de la musique des étasuniens est bien retranscrit sur quarante minutes menées tambours battants. Dès lors, l’aspect “concert live” n’est plus vraiment prédominant dans l’écoute, et c’est plutôt la succession de ces six titres impeccablement exécutés qui emporte l’auditeur (mention spéciale pour le dévastateur “The Electric Step”). Déferlements inlassables de wah wah, hurlements de saxo, frénésie de caisse claire… toujours les mêmes ingrédients qui, adossés à une interprétation infaillible, retranscrivent une expérience scénique dans laquelle on peut (un peu) se projeter. De là à justifier l’incarnation vinylique, ça reste discutable…
Bref, à l’heure du bilan, on se pose à nouveau la même question : pourquoi ? Une certaine philanthropie probablement ?… Un souhait altruiste irrépressible de partager ces expériences musicales avec le plus grand nombre ? (16 éditions vinyliques différentes, quand même, probablement proposées pour offrir des expériences sonores inédites à chaque fois…) Les fans ont bon dos. On adore ces groupes, qui ne nous ont quasiment jamais déçu, sur disque ou en concert, mais là, c’est difficile de les suivre…

On a beau avoir des antennes chez Desert-rock (Qui a dit des cornes??) on ne capte pas tout, loin s’en faut. Il faut dire que la production mondiale du genre est pléthorique et il n’est donc pas si étonnant qu’un groupe comme Håndgemeng ait pu passer sous nos radars malgré quelques EP pas piqués des vers. Rattrapons cela donc puisque le quartette norvegien vient de sortir un album du nom de Ultraritual signé chez Ripple Music et nous donnant ainsi l’opportunité d’y jeter une oreille attentive.
Avec Håndgemeng c’est le printemps! On sent venir la montée de sève. On dira qu’Ultraritual est puissant mais pas bas du front. Énergique mais pas excité du bulbe. Håndgemeng fait du metal qui sait où il va, nous sortant pourtant des sentiers battus et rebattus du doom à papa et du stoner tendance Goblinesque. Ne déconnons pas trop quand même sur le sujet car ici et là traînent nécessairement les mégots mal éteints de Lemmy et consorts, ce qui aide sans doute les norvégiens à produire un titre comme “Tales From The Tundra”. On peut d’ailleurs prémonitoirement dire que ce dernier sera fédérateur en live tant il pousse à gueuler en chœur avec le groupe dès la première écoute. Une des autres vraies bonne surprise est dans l’intro de “Vision In Fire” qui exploite des ressorts résolument modernes et metal, chants incantatoires à la limite du dissonants à l’appui pour une glissade vers un mid tempo appuyé et brut. Puis on retrouve l’appel cultuel du chant dans “Temple of Toke” , Håndgemeng enfilant les morceaux comme autant de perles sur un fil conducteur à la densité variable et fidèle à la promesse du titre de l’album.
Le groupe n’allume pas que des cierges et un goût de poussière du désert pimente la piste Ultraritual tout en sonnant le rappel de l’introduction The Astronomer. On pourra cependant déplorer un son un peu terne peut-être; mais en deux coups de potard l’esthète saura trouver à mettre un peu plus de présence sous les rouleaux compresseurs de ce bel engin de chantier. On passe dès lors un bon, que dis-je, un excellent moment, pour peu que l’on ne soit pas trop près des enceintes pour “Occultation Of Mars” où le groupe construit patiemment un titre aérien et contemplatif avant de venir sans raison nous détruire les tympans. A mois que cela ne soit que pur malignité de leur part avant de retomber ensuite dans la torpeur éthérée du morceau.
Ultraritual est la porte d’entrée de Håndgemeng dans le grand jeu du doom stoner velu et Ripple Music ne s’y est pas trompé en prenant le groupe sous son aile. Il vient fracasser l’ennui des auditeurs usés par tant de reprises fadasses du genre et offre de quoi se faire plaisir un bon moment au fil de réécoutes à en headbanger le front contre le mur.

Quartette romain porteur d’une bacchanale instrumentale depuis quelques années, L’Ira Del Baccano a eu le temps de faire ses armes depuis 2010 et de puiser l’essence de son art sur scène. Le nouvel album, Cosmic Evoked Potentials est la promesse de retrouver l’esprit du live et la cohésion d’une bande de potes qui se connaissent sur le bout des notes pour produire encore une fois une musique hautement psychédélique et pourtant structurée à souhait derrière un artwork de pochette d’album certes chargé mais sans faute de goût.
Puissance et qualité sont les maîtres mots qui introduisent Cosmic Evoked Potentials. On voyage dans divers lieux d’un bout à l’autre des pistes. “The Strange Dream of my Old Sun” sonne à la fois lourd et léger, alterne les phases et les imbrique avec talent. Au même titre on découvre, “Genziana (Improvisation 42)”, titre classieux et éthéré qui vient démontrer la cohésion entre les musiciens lorsqu’il s’agit de produire une variation à la volée et d’introduire le dernier tiers de la piste avec des riffs enthousiasmants et qui réussissent à ré-ancrer l’auditeur dans le sol.
Parfois on pense au Floyd des dernières heures, notamment du côté des cordes mais c’est sans compter sur une batterie qui martèle virilement et relègue la chose à l’anecdotique. Cette même batterie qui fait la jonction naturellement avec “The Electric Resolution”.
C’est une pièce positivement linéaire que ce Cosmic Evoked Potentials. On divague entre fougue et contemplation totale comme sur la conclusion “Eclipse Omega” mais le tout s’enchaine sans heurt. Les titres sont tous nantis à la fois d’une indéniable qualité de composition et d’improvisation. L’Ira Del Baccano évite d’ailleurs ce qui fait souvent le point dur de l’improvisation : la lassitude face à une expression qui n’est tournée que vers le seul plaisir des musiciens. Le quartette est ouvert et offre à l’auditeur sa palabre sans jamais se rengorger de son talent et il faut saluer les répliques que s’offrent les cordes en particulier sur le titre éponyme. Le seul regret que l’on peut formuler au sortir des 40 minutes de l’enregistrement c’est qu’il n’y en ait pas une poignée de plus à se mettre sous les tympans.
Tout au long de Cosmic Evoked Potentials on est frappé par la qualité de l’enregistrement et le naturel avec lequel viennent s’intercaler les improvisations. C’est un peu plus qu’une jam session que nous offre L’Ira Del Baccano, à mi-chemin entre une friche artistique sans orientation et un album structuré avec une ligne directrice forte. Cette production est à mettre entre toutes les oreilles car elle est tout simplement hautement qualitative et il serait bien dommage de passer à côté.

Trois ans écoulés depuis la dernière cérémonie. Comme à chaque fois, les créatures des profondeurs se réveillent et requièrent un sacrifice. Les prêtres du doom metal atmosphérique que sont les gars d’REZN revêtissent donc à nouveau leurs robes rituelles, leurs instruments prophétiques, et s’évertuent à rendormirent ces démons abyssaux d’une nouvelle salve de sonorités grandioses, lourdes et envoutantes. Une messe intitulée Solace et prononcée par le truchement du label Off The Record.
Le quatuor introduit le sermon par « Allured By Feverish Visions ». Une musique qui par sa guitare planante, son synthé aérien et sa basse d’une rondeur délicieusement grasse nous renvoie de suite dans les carcans du doom atmosphérique faisant l’empreinte d’REZN. Après cinq minutes de décollage, le vol s’intensifie, porté par une batterie de plus en plus percutante et une guitare davantage grondante, tel l’orage qui s’approche inexorablement. Néanmoins, aucun coup de foudre, aucun vent violent, l’ambiance redescend finalement en douceur et laisse place à « Possession ». Deuxième titre invoquant pour sa part le chant éthéré de McWilliams, qui après 4 minutes d’ensorcellement nous livre sans pitié à la brutalité d’un groove dévastateur et puissant. La tempête est enfin arrivée…
Ces enchainements de textures musicales et de profondeurs de composition nous permettent par ailleurs de saluer la qualité du mixage, qui on ne va pas se mentir est en grande partie responsable du succès du groupe. La richesse de « Reversal », tiraillée par les hauteurs stratosphériques d’un chant diphonique et les profondeurs insondables d’un lent groove malsain, ne saurait s’épanouir autant sans le secours d’un équilibrage et d’un assemblage d’une telle qualité.
Après ces trois morceaux, une certaine confiance s’installe, atténuant la vigilance au profit du plaisir de se retrouver en terrain connu. L’on secoue naïvement la nuque sur la rythmique entêtante de « Stasis », on ferme les yeux sur les délicats phrasés de guitare qui lui succèdent, non conscient du coup du massue qui vient nous cueillir à la cinquième minute. Ce dernier nous projette sans prévenir dans une dimension nouvelle, dérangeante, pleine de sonorités singulières, et pourtant d’une indéniable beauté. Transformation qui mène donc au majestueux intermède qu’est « Faded and Fleetine », royaume dans lequel siège le fameux saxophone du groupe. Ici, le musicien multidisciplinaire Spencer Ouellette s’en donne à cœur joie sur son cuivre, désormais intégré aux productions d’REZN. Il va mène pousser le vice jusqu’à s’accommoder de la complicité d’une flûte à de rares occasions.
« Webbed Roots » clôture la cérémonie en résumant du haut de ses presque huit minutes toute la complexité structurelle de l’album. Une attaque puissante, mêlant lent groove hypnotique et voix envoutante (Marie Davidson + Rob McWilliams) en une grandiose ascension vers les cieux. Puis survient une rupture implacable, arrachant leurs riffs électriques aux guitares et sa substance psychédélique au clavier. Par la suite, tandis que la tempête semble se calmer, la batterie nous ranime et nous fait poursuivre le voyage. Un trip porté par une voix nouvelle, prophétique, et déterminée à nous guider vers une nouvelle apothéose écrasante.
Au regard de leur précédent opus, l’on pourrait juger Solace un peu court. Et même en oubliant qu’il ne s’agit que de la première partie d’une série qui viendra prochainement se compléter, ce bilan reste nuancé par une richesse d’écriture et une profondeur toujours plus impressionnante de composition. Cet album est plus court, cependant chaque piste recèle plus de mystères, offre plus de relief, davantage de possibilités d’explorer et en définitive peut-être plus de matière à prendre son pied. La dimension atmosphérique est ici portée à son paroxysme, offrant des possibilités infinies dans lesquelles il ne faut pas hésiter à aller se perdre.

Dans les milieux interlopes du doom occulte on l’ attendait de pied ferme le prochain Witchthroat Serpent. Les Toulousains n’avaient plus donné de nouvelles aux bacs de nos disquaires depuis 2018 (exception faite d’une maigre apparition en 2022 lors d’un Split avec Dead Witches) et les voilà enfin de retour avec Trove Of Oddities At The Devil’s Driveway, un album sur de nouvelle bases, signé chez Heavy Psych Sounds avec un line up grandement changé et qui explique probablement une partie du temps qu’il leur aura fallu pour sortir ce troisième album
Un album tout en analogique s’il en est, que le groupe a voulu comme un hommage à l’âge d’or où le cinoche faisait encore du film d’horreur classieux et plein de mystère, en témoigne le titre “Nosferatu’s Mastery” et la composition “The Gorgon” avec ses nappes de mellotron autant que les extraits de pistes de film.
Exit donc le numérique et bienvenue pureté du son à l’ancienne. Witchthroat enchaîne les titres hommages au prince des ténèbres avec “The House That Dripped Blood” ou “Mountain Temple of Blackness”. Les samples de films tantôt et la lourdeur des riffs ensuite sonnent comme autant d’ invocations démoniaques et tribales.
Trove Of Oddities At The Devil’s Driveway est écrit avec le sang d’un tempo au bord de son dernier souffle, une lenteur d’ exécution que le groupe pousse dans ses retranchements quitte à frôler le passage ad patres, le dernier sursaut de vitalité était réservé à “Yellow Nacre” qui retrouve l’allant des précédentes plaques.
Pour cet album on ne trouve pas autre chose que de la lenteur et de la noirceur, en rupture partielle avec un chemin qui semblait tout tracé, Witchthroat fait le choix de plonger dans un univers plus ténébreux que jamais et s’affuble d’une robe de prêtre occulte doom portée par de nombreux autres de ses pairs, poursuivant leur œuvre maléfique, mais la livrée est lourde, lourde comme les riffs de basse qui collent à la peau de l’auditeur. Lourde comme chacun de ces riffm qui enchainent celui qui pose les oreilles dessus alors que la batterie enfonce ses coups avec méthode et puissance. A ce titre, admettons que le split de 2022 avec Dead Witches n’aura pas été sans impact et si l’on allait plus loin sans doute y verrait-on la raison profonde de ce ralentissement de tempo. Il n’est pas impossible non plus qu’une certaine collusion se soit faite avec les confrères de Witchfinder (la sororité, t’as vu, que des Witch?!) qui ont cette année produit une plaque dont l’ADN n’est pas sans rappeler celui de “The House That Dripped Blood”.
Une fois de plus je me prends à me dire que ce style n’est clairement pas dans le champ de mes favoris mais soyons honnêtes Witchthroat fait peau neuve alors qu’on était en droit de ne pas attendre autre chose que la suite d’une œuvre qui avait déjà capté son public. Le désormais quartette (On t’a dit qu’il y avait un mellotron, soit à c’qu’on t’dit un peu!) se risque dans un exercice d’évolution plutôt que de jouer la complaisance et c’est louable voire même réussi. A ce titre, saluons particulièrement les effets d’ambiance cinématographique et les plongées psychédéliques qui donnent une consistance supplémentaire à l’album.
Trove Of Oddities At The Devil’s Driveway fera date au moins dans la carrière de Witchthroat Serpent avec une recomposition qui n’est pas due au hasard et un chemin pris qui ravira les plus radicaux des doomsters de l’ombre. Allez préparer vos poignards sacrificiels, tendez un écran blanc, projetez les meilleurs extraits de votre cinémathèque horrifique et headbanguez capuche sur la tête voici une nouvelle invocation à l’Etoile du Matin.
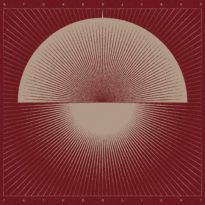
Cinq années après la sortie de Pilgrim en 2018, Stoned Jesus réapparait une nouvelle production en main. Le trio d’Ukraine aura su traverser les épreuves et garder la force pour admirablement servir à son audimat un cinquième album intitulé Father Light. On délaisse l’usinage by Napalm record, qui est cette fois-ci effectué chez un nouveau crémier : Season of Mist ; choix qui colle pour le coup pas mal au thème de la galette.
Tout s’ouvre sur le titre éponyme de l’album, un conte narré par une tendre guitare sèche et une voix aussi claire que mélancolique. Un départ donc un peu frileux pour qui s’imagine retrouver l’effervescence de « Wound » ou l’énergie endiablée d’un « Here come the Robots », mais qui ne sera pas sans rappeler l’intro/outro de « I’m the Mountain » dans sa version intégrale. Néanmoins, une fois n’est pas coutume, cette jolie fable s’arrête d’un coup, mise au silence par un singulier son de clochette, lequel nous livre aussitôt à un riff d’une lourdeur familière.
« Season of the Witch » commence par un son caverneux, brut et arborant toutes les caractéristiques d’un doom de garage. Toutefois les 11minutes 30 que propose ce morceau ne se limitent guère à de lancinants et répétitifs brisages de nuque. Brusquement, le rythme s’accélère, la guitare s’emporte, suivie par la batterie de Dmytro qui se met à trotter. Très vite, tout ce beau monde engendre une superbe séquence instrumentale pleine de cette substance groove chaleureuse faisant la patte de Stoned Jesus. Aussi soudainement qu’il est advenu, ce revirement se substitue ensuite à d’aériens couplets pleins de douceur et de mélodies. La voix d’Igor ainsi que les guitares nous portent jusque dans les nuages, et nous laissent rêveurs. Hélas, depuis ce perchoir, notre chute n’en est que plus belle. Car il s’agit bientôt de redescendre vers le sol, vers ce doom minéral que rien n’arrête, et qui clôture cette belle histoire. Le morceau nous apparait telle une parabole éprouvante ; comme la trajectoire d’un missile, comme un rêve qui s’effondre après être monté trop haut.
Une succession de structures qui se retrouvent également dans « Get What You Deserve » ou encore « Thoughts and Prayers », dont le clip est disponible sur votre plateforme préférée depuis quelque temps. Un morceau plus sombre dans son propos ; sorte de lamentation sur les prières et pensées, toutes adressées à un dieu qui n’existe pas et condamne donc aux affres de la solitude. Affliction portée par le ton de voix de Sydorenko qui par ses douces mélodies hypnotiques nous offre au fil des pistes quelque chose de nouveau. Une poésie ambivalente, et porteuse d’un lourd fardeau.
De manière générale, les membres du groupe n’ont jamais été connus pour rester dans leur zone de confort. Au fil des années et des albums, ils ont continué d’explorer de nouvelles façons d’écrire, de nouveaux moyens d’intriquer les différents territoires de ce genre musical qu’on sait si vaste, d’inventer et de s’approprier, tout en conservant cette empreinte rythmique, ce cachet fuzzé qui fait leur identité intrinsèque. On ne peut que les féliciter pour ce nouveau trophée.

Comment ça marche? Vous allez voir que ce n’est pas bien compliqué. Westing c’est le nom du dernier album que Slow Season sort en 2016, c’est signé chez Riding Easy et c’est très bien. Puis au tournant de 2021, profitant de l’arrivée d’un second guitariste (Ben McLeod), le désormais quartette Californien change de nom, ou s’agrège à celui de Westing (Sur ce point les Sources varient). C’est bon pour vous ? Ok ? On peut donc faire la checklist de la séquence temporelle Westing:
Chemise ouverte sur le torse √
Pantalon patte d’eph à poutre apparente √
Grosse boucle de ceinture bling bling √
Initialisation de la séquence temporelle √
Slow Season a changé de nom mais il ne faut pas croire que ce soit un vrai nouveau départ, à écouter Future c’est du Led zeppelin dans ce qu’ il a de moins blues et de plus léger, j’ai de nouveau 15 piges. Je découvre les plaques usées par la précédente génération. Voilà ce que je ressens dès les premières écoutes de cet album, autant dire qu’on ne pouvait pas rêver d’un nom aussi mal choisi comme titre… Future… A moins qu’il ne s’agisse justement de quelque astuce pour nous faire dire que le passé est une base pour construire le présent soit le futur d’avant. Compris Marty ?
Quelle que soit l’intention des californiens il faut noter que la plaque s’inscrit dans une cohérence totale, puisant çà et là ses inspirations dans le zeppelin de Physical graffiti, le Sabbath et autres Creedence Clearwater même si plus atténué. Le groupe produit comme par le passé un son suiveur de ses aînés mais sans aucune fausse note. Allez écouter “Big Trouble (In The City of Love)” rien que le titre dit ce que joue le groupe et les notes finiront par vous dire ce qu’il en est. A ce titre le détail compte et convoque des aînés encore plus anciens comme avec ce petit son de clavier presque caché dans les dernières secondes de “Coming Back to Me”, ce même clavier qui joue le psyché moderne dans les premières secondes de “Artemisia Coming Down” ou au travers de “Lost Riders Intro”.
Au fond cet album marque une fois encore le talent de ceux qui l’ont composé. Qu’ils se fassent appeler Slow Season ou Westing qu’importe, on pourra emmener les titres partout que ce soit pour une écoute attentive ou pour un fond sonore, que ce soit avec l’esprit contemplatif (“Silent Shout”) ou concentré sur le mouvement (“Lost Riders”). Là ou Future se démarque des productions de Slow Season c’est qu’il a perdu en puissance pour livrer des titres moins bruts avec une batterie qui trouve une place un peu moins centrale et un rééquilibrage des parties de gratte et de chant. La qualité de l’enregistrement également est plus polie et sans doute un peu plus froide.
Westing offre aux oreilles un pur moment de bonheur et au souvenir une occasion de revenir sur le devant de la scène. Même si dans cette recomposition Westing perd un peu de son originalité échevelée du temps de Slow Season, le quartette dépeint un futur à sa sauce, souvent joyeux et contemplatif quand il faut, un futur que l’on se prend à follement désirer avec eux.

Egypt n’est plus, vive Egypt ! Après que le groupe ait splitté, Chad le batteur et Neal le gratteux ont fait le choix de se joindre à El Supremo en 2019, un navire psyché qui traçait sans bruit sa route de one man band depuis 2008. Il n’y avait plus qu’à embarquer un clavier et voici que El Supremo pouvait faire de nouveau route avec dans sa cale une nouvelle cargaison de galettes du nom de Clarity Through Distortion. Arrivé à bon port il est passé sous pavillon Argonauta Records et à présent il vogue la soute pleine d’un nouveau projet du nom de Acid Universe.
Le précédent opus cherchait à gommer l’histoire d’un groupe composé de 50% d’Egypt, ce qui n’était que partiellement réussi. A l’abordage de la nouvelle œuvre, Acid Universe, j’ai été frappé par la grandiloquence de l’ orgue sur fond de lourdeur rythmique, et de me dire qu’on est pas si loin semble-t-il d’Egypt avec ce “Crowley Magick” d’introduction.
On cherche tout de suite à se départir du mirage possible du groupe à l’identité si forte dont les restes composent la moitié de l’équipage. L’aspect instrumental de Acid Universe pourrait lui offrir un ancrage plus profond dans les fondamentaux rock psychédélique. “To Lisbon” le confirme, cette piste qui se libère de l’influence du groupe sus-cité pour attaquer un bon morceau de psyché kraut que l’orgue renforce totalement et qui crie : “nous sommes El Supremo, bordel!”
Si les quatre comparses ambitionnent de valoriser le nom d’El Supremo, ce qu’ils réussissent d’ailleurs toujours grâce à cet orgue dont les notes frôlent la lysergie, on verra cependant tout au long de la plaque le nom d’Egypt transparaître. Du réglage de la gratte à la rythmique tantôt lancinante, tantôt groovy, il n’y a rien à faire, on ne parvient pas à réaliser son deuil : “The Ghost Of…” où le clavier n’intervient qu’avec peu de force ne masque pas grand chose, cette frappe de cymbale crush, ce rocailleux de la gratte, rien à faire. Et même lorsque le susdit clavier intervient sur “White Hot Fever Dream” et attaque plus sévèrement le devant de la scène et bien… on est sur du Egypt tuné au Deep Purple.
Au fil des réécoutes, en prenant son temps, en les espaçant, bourré ou à jeun, dans la tempête comme sur une mer d’huile, rien à faire ça a toujours le goût du sable du désert et comme il se trouve que j’adore voyager et que comme tout bon amateur de stoner j’aime être tiré en arrière, je ne vais pas m’en plaindre, bien au contraire. Nous étions nombreux à être malheureux de voir disparaître le prédécesseur d’El Supremo. Et soyons juste, le rejeton apporte son lot de bonnes choses, Cam Dewald à la basse et Chris Gould au clavier n’ont pas à rougir de leur participation, ils ne servent pas la soupe à leurs comparses mais les complètent avec talent comme le démontre l’enthousiasmant titre de conclusion, l’éponyme “Acid Universe”. Il sublime le reste de la plaque, et anime dans une jam parfaitement calibrée, démonstrations de styles et vives émotions.
Finies les métaphores vaseuses pour masquer la réalité ! El Supremo est fils d’Egypt ! Acclamons Pharaon ! Qu’on lui pose sur la tête les couronnes du bas et du haut stoner, que lui soit remis le sceptre de feu son père, acclamons-le, que son règne soit sans partage et qu’il réchauffe nos âmes encore tristes du départ de son prédécesseur : ce dernier vit de nouveau au travers d’El Supremo et de ce très bon Acid Universe.

Ai-je été trop méchant avec ma chronique du dernier album de Stöner ? C’est la question que je me suis posée avant de me mettre à celle-ci. Alors j’ai écouté à nouveau l’album et définitivement non, c’est vraiment un ratage presque complet. Ensuite je me suis dit, ok, pour cet EP, tu essayes de ne pas trop insister sur le côté répétitif, tu essayes de positiver pour ne pas toi-même te répéter.
Positivons donc avec un constat simple, même si les défauts sont encore là, les aspects positifs sont plus prononcés et le résultat final plus encourageant et moins lassant.
Passons le “Stöner Theme (Baja Version)”, reprise d’un titre du précédent album dans une version différente, qui ouvre le disque et qui est très dispensable. La touche Oliveri me semble bien plus visible comme le prouve le choix de la reprise du titre “City Kids” des Pinks Faeries. Ce titre est frais, avec son petit côté rock’n roll et punk léger assez sympa.
“Night Tripper vs No Brainer” embraye sur un riff cool avec quelques effets de fuzz par-ci par-là. On ne criera pas au génie mais ça se laisse écouter. L’alternance de chant entre Brant et Nick est aussi très bienvenue. On agrémente le tout d’un joli changement de rythme après le tiers du titre, d’un solo un peu gras et on obtient un résultat assez convaincant.
“It ain’t Free” a aussi clairement le tampon Oliveri. 2 minutes 30, ça ne se pose pas de question, c’est direct et vif.
“Boogie to Raja” clot cet EP avec ses 10 minutes. L’intro est excellente. Ça part vite et bien avec un bon riff et une envie d’en découdre évidente. On est proche d’un jam improvisé et c’est vraiment bon. En concert ce titre peut être explosif.
Le résultat est donc bien meilleur que l’album Totally et espérons que l’on poursuivra avec le même état d’esprit pour la suite de leurs aventures.
Reste quand même deux gros défauts. Le groupe nous dit « During the recording of Totally, we were having a blast and the music just kept rollin’ out so we decided to also put together a tasty EP ». De là à dire que Totally aurait pu être un album bien plus long et qualitatif, cela accroit cette impression de loupé. Ensuite, cet EP est proposé au prix d’un album et c‘est abusé. Une reprise, une auto-reprise et juste trois titres originaux, ça n’atteint pas les trente minutes et pourtant on vous en demande le prix d’une galette bien remplie. Le tout décliné bien sûr en CD et 6 versions vinyles différentes. Business is Business…

Ce premier album du jeune trio parisien est aussi l’une des premières sorties du label Chien Noir, structure collective montée par et pour une poignée de groupes français. Derrière Cerbère se cachent trois musiciens ayant usé pas mal de locaux de répèts ou de coins de scènes élimés, dans diverses formations de sludge, noise, punk… bref, un peu tout ce qui peut se faire de sale, en gros. Sur le papier, pas forcément quelque chose qui rentre dans nos cordes en revanche… sauf que nos trois gaillards ont beau méler toutes leurs influences dans cette sinistre tambouille, ils ralentissent bien les tempi et délivrent leur production sur un bitumeux tapis de pur doom fuzzé. trois titres pour à peine plus de quarante minutes de musique ; pas la peine de vous faire un dessin…
On rentre dans la galette en se frayant un premier chemin dans le bien glaireux “Cendre”, emmené par un riff doom lent et impeccablement saturé, plombé par une rythmique tellurique et d’où surgissent quelques growls sludge de bon aloi (notons que les passages vocaux sont très rares sur le disque). On est sur du monolithique, avec de très faibles variations mélodiques : c’est répétitif, c’est lancinant, c’est lourd. On pense à un bon riff de Conan badigeonné de sludge – mais plus gras et sombre. Aux deux tiers du morceau, une petite fantaisie mélodique groovy nous emmène directement dans le sillage d’Eyehategod. Pas le temps de reprendre notre souffle que le très subtil “Sale Chien” vient apporter une touche de légèreté : toujours un gros riff, à peine un peu moins lent, mais tout aussi adipeux que son prédécesseur, qui tourne, qui tourne… Les relents blackened doom finissent de caresser nos nuques entre lourdes, tandis que “Les Tours de Set” vient clore la galette par un tour de force de ving-deux minutes : le titre commence par une torgnole hardcore sludge pour vite s’effondrer dans les lenteurs d’un territoire glauque tout en dissonance sous-accordée, sorte de mélange d’un Bongripper bruitiste et d’un Thou énervé. Passé ce premier acte, Cerbère nous amène sur quelque chose de plus construit (on entend même des leads de guitare…) après le premier tiers du morceau, puis entame une lente chute noise tendance drone, qui vient s’étirer sur un très gros dernier tiers de la chanson. Un peu trop longuement sans doute : consacrer près de dix minutes à cette séquence froide et sans grand relief est un pari risqué, pas forcément payant au fil des écoutes… Dommage.
Mais on reste sur un ressenti très positif (façon de parler pour une galette aussi sombre et poisseuse…) à l’écoute de ce Cendre globalement très réussi. Un galop d’essai qui, s’il ne réussit pas tout ce qu’il tente, constitue quand même une large réussite : le tout jeune combo s’est déjà constitué une forte identité (plusieurs références marquantes, mais parfaitement assimilées) et distille une véritable science du riff sur une grosse demi-heure dont on a du mal à se lasser. Du vrai bon doom-sludge de qualité… et c’est français, monsieur !

Ah, Montréal, cette terre fertile du stoner rock, ses dizaines de groupes fuzzés sentant bon le sable chaud… Sauf que pas vraiment, et quand on voit débarquer ce groupe on se dit que ça vaut sans doute le coup de se pencher dessus. Actifs depuis 2019, ces quatre québecois ont sorti une poignée de singles ici ou là, et ont commencé à oeuvrer sur leur premier album à l’époque du COVID, pour une sortie… ces derniers mois (sorti sur différents supports entre lrété dernier et récemment, en gros…).
Comme son nom le laisse présumer, le groupe est largement influencé par Dune, et développe l’univers de Frank Herbert sur l’ensemble de l’album. Du Space rock donc ? Ben non. Sons of Arrakis proposent une sorte de stoner heavy testostéroné, solide et non dénué d’un groove assez saisissant. Trois Gibson fuzzées (oui, même la basse !) s’y entendent pour proposer un son croustillant à souhait, le petit facteur qui suffit à convaincre d’écouter l’ensemble avec d’autant plus de curiosité. C’est alors là, progressivement, que l’on se fait cueillir par ce songwriting aguicheur : riffs nerveux et catchy (“The Black Mirror”, “Temple of the Desert”…), mélodies immédiatement mémorables (“Omniscient Messiah”, “Lonesome Preacher”…), soli impeccables (“Complete Obliteration”…), tous les éléments semblent réunis pour le plaisir du stoner head “de base”.
Le groupe se permet par ailleurs de ne sonner comme personne (ou en tout cas pas directement : on pense à la musicalité d’un ASG par exemple, plus qu’à son tour). Petit reproche en revanche : trente minutes (pour six vraies chansons, hors intro/outro) c’est un peu léger pour un premier LP, et on n’aurait pas craché sur une paire de compos supplémentaires. Mais pas de quoi chouiner : Sons of Arrakis est une jolie découverte, et peut-être la démonstration (après Dopethrone dans une autre veine) que Montréal est peut-être une terre musicale apte à proposer quelques intéressantes pépites musicales.

Une bien agréable découverte aujourd’hui que ce disque de Condenados, un combo qui, s’il était jusqu’ici inconnu de votre serviteur, propose pourtant aujourd’hui son déjà troisième LP, après plus de douze ans d’existence. Tandis que leurs deux précédents disques étaient sortis sur un label obscur (Shadow Kingdom Records), ce El Camino de la Serpiente, qui paraît sur un petit label chilien peu productif, ne semble pas non plus promis à exploser dans les charts. Un label chilien, oui, puisque, comme son patronyme aura pu vous le laisser présumer, Condenados est un groupe chilien. Et comme ils ne font pas les choses à moitié, ils chantent en espagnol.
Conséquemment, les écoutes s’enchaînent et on est souvent ramené une ou deux décennies en arrière, croyant entendre des volutes de Los Natas (les argentins chantant aussi en espagnol). Condenados partage aussi avec leurs voisins argentins cette prod austère et râpeuse qui ne triche pas. Passés ces détails formels, on s’attache enfin au fond des choses, à savoir la musique. Avec simplement deux paires de bras (le batteur assure aussi le jeu de basse pour le studio) les gars se concentrent sur l’essentiel, et élaborent une douzaine de titres qui vont taper dans toutes les variantes du heavy rock / doom metal, à mi-chemin entre révérence old school et l’énergie frondeuse de musiciens qui n’ont rien à perdre. On pense beaucoup à R.I.P. sur ce disque, cette énergie revival authentique donne le sourire, même si ici on est dans du pur premier degré.
On se laisse donc porter par ces riffs AOP doom metal (sud) américain, qu’on encaisse les uns après les autres en se disant que, décidément, ces gars sont inspirés et savent écrire. “El Diablo”, le groovy “Condenados”, le presque punk “El Carro y la Torre”, le jovial et entraînant “El Camino de la Serpiente”… Du riff encore et toujours. Et quand ils s’éloignent un peu du sillon doom, c’est pour mieux y revenir avec des tempi lents en diable (“Mi Maldiciòn”, “Humo Negro”, “Tierra de Cementario”…). Que des compos à fredonner sous la douche, le bras tendu en l’air et le poing rageur.
Ces gars ne sortiront peut-être jamais de disque de l’année, ils auront probablement du mal à trouver une poignée de concerts dans l’année dans leur région, ne parlons même pas de la perspective de les voir monter sur des scènes nord-américaines, voire européennes… Ils ne seront probablement pas mentionnés comme référence musicale pour d’autres musiciens, et globalement laisseront une trace modeste dans le paysage musical. Pourtant, que leur intégrité fait du bien à entendre ! Le plaisir provoqué par l’écoute approfondie de ce disque est réel. Evidemment, la plaque est perfectible, quelques titres peuvent apparaître plus faibles, la prod aurait pu apporter plus de relief ici ou là, mais ce ne sont que des détails qui ne viennent jamais vraiment dénaturer l’authenticité de cet ouvrage de passionnés.

Il aura fallu 7 ans pour voir les allemands d’Ahab reprendre la mer et nous livrer le successeur de The Boats of The Glen Carrig. Maître incontesté du “Nautik Doom”, Ahab a pris le temps de façonner son cinquième album The Coral Tombs en s’enfonçant dans de profonds abysses. Car si le groupe s’appuyait sur des récits de Melville (Moby Dick) ou de William Hope Hodgson (The Boats of The Glen Carrig) pour nous transporter dans l’enfer des océans et dans la survie horrifiques de naufragés, il vient avec The Coral Tombs puiser dans l’oeuvre de Jules Vernes 20 000 lieues sous les mers ! En guise d’appât, “Prof. Arronax’ descent into the vast oceans” annonçait d’ailleurs un album bien plus sombre, violent, avec un chant grind que l’on n’avait plus entendu depuis leur second opus The Divinity of Oceans.
Ouvrant The Coral Tombs, “Prof. Arronax’ Descent Into the Vast Ocean” fait l’effet d’une chute d’un bateau en pleine tempête dans une mer glacée. Encore glacé par le chant que l’on est submergé par la fureur de la batterie et la puissance de la basse. Une entrée dans l’album par la violence pure qui s’estompe rapidement dès que l’on entame notre descente vers les profondeurs. Ahab brille alors par leur capacité à nous faire ressentir l’immensité immuable de l’océan et nous montre au loin des créatures gigantesques se mouvant avec lenteur. “Colossus of the Liquid Graves” et “Mobilis in Mobili” nous confrontent à ces monstres tentaculaires qui, visiblement mécontents d’être dérangés par de si petits êtres, cherchent à nous précipiter dans les abysses. Les riffs sont épais, le chant est tout aussi gras, et chaque ligne de basse vient résonner dans nos scaphandres… même la batterie souhaite notre perte ! Les notes aiguës sur “Mobilis in Mobili” laissent même penser que notre vaisseau sous-marin n’est pas loin de craquer …
La seconde partie de l’album se veut plus contemplative tout en continuant de nous imprégner de ce sentiment de menace permanente, la folie grandissante de l’équipage n’aidant pas… “The Sea as a Desert” image parfaitement cette face plus posée de l’album en nous projetant devant d’immenses paysages abandonnés voire dévastés par l’Homme. “A Coral Tomb” prend le temps d’explorer un univers composé de structures sans âge. Le chant devient ici majoritairement clair, et diffuse une mélancolie collant parfaitement avec la lenteur de ces morceaux. D’ailleurs on se perd devant une telle lenteur… la notion de temps disparaît petit à petit… c’est quel morceau déjà ? Ah il n’a duré que 12 minutes ?! L’album se clôture comme il a débuté dans la tourmente et la puissance, avec un solo de guitare bouclant avec celui du premier morceau, nous faisant définitivement sombrer dans les abîmes.
Difficile de remonter à la surface après l’écoute de The Coral Tomb. L’album retranscrit assez étonnamment cette perte de repère et de notion de temps que l’on peut avoir sous l’eau et nous happe dès les premières notes dans son univers sous-marin touchant au lovecraftien, notamment sur l’intro bouillonnante et les riffs de “Mobilis in Mobili”. L’apport du chant (très) guttural est une réussite et, en plus d’appuyer ce côté monstre innommable, donne envie de se replonger dans les premiers albums du groupe. L’attente aura été longue pour voir ce nouvel album d’Ahab mais c’est une grande réussite ! Allez remettons la combinaison, il reste des choses à découvrir dans cet océan !
|
|