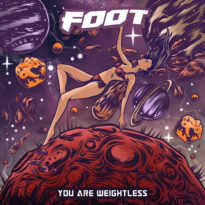|
|

Mantar – le duo Allemand le plus bruyant de l’histoire – revient avec un album au titre particulièrement positif : Pain is Forever and This Is The End. Il faut dire que la pandémie a pas mal affecté ce groupe qui ne vit quasiment que de concerts, sans compter l’éprouvante phase de composition de l’album : Hanno Klärhardt (guitare/chant et unique compositeur du groupe) ayant dans un premier temps jeté l’intégralité de ses compostions, peu convaincu du rendu de ces dernières. Une fois l’inspiration retrouvée, il lui a fallu quitter la Floride (et son écureuil domestique) où il s’est installé, pour rejoindre Brême pour l’enregistrement. Par deux fois il s’est rendu sur place et par deux fois il a dû rentrer pour se faire opérer du genou, suite à d’infortunés accidents (d’abord en prenant une photo de son collègue batteur au mariage de ce dernier, puis en glissant dans un centre commercial). Bref quand ça veut pas, ça veut pas. Sans parler de l’actualité déprimante, les despotes succédant aux crises qui se transforment parfois en guerre. Alors oui, la douleur semble perdurer et qui contre-argumenterait si on parle de fin du monde?
Pourtant…
Pourtant PIFATITE (non ce n’est pas un nouveau virus) a fini par sortir et il s’agit probablement du meilleur album du groupe à cette date.
Prenez les molards imparables que sont « White Nights » (Death by Burning/2014) ou “Era Borealis” (Ode To The Flame/2016) et imaginez tout un album composé avec cette efficacité : Vous avez PIFATITE. Pas que The Modern Art Of Seting An Ablaze (2018) ait déçu, quoiqu’un peu long à mon goût, mais ce quatrième essai est une totale réussite. L’énergie punk sous-jacente au sludge/black’n’roll du duo explose en surface, accompagnant des riffs simples et efficaces, sur rythmiques puissantes – « comme si je cognais quelqu’un » confesse Erinç Sakarya lorsqu’on lui demande comment est son jeu de batterie. « Grim Reaping » saisit par son efficacité, « Hang’em Low (so the Rats Can Get’em) » par son énergie (et sa poésie), tout l’album marque, jusqu’aux dernières notes d’« Odysseus », dernier et meilleur morceau de l’album. De sa pochette au sample en ouverture d’« Orbital Plus », l’album est traversé par cette idée des dangers du culte, qu’il soit personnel ou en groupe. Mantar ironise sur cette société obsédée par l’opinion, par l’obsession du flux offrant des réponses simplistes aux questions complexes.
Pain is Forever and This Is The End, avec sa fureur et ses ambiances sombres tout en gardant chacun de ses morceaux extrêmement reconnaissables, réussit le tour de force d’apporter de la lumière dans sa noirceur, du refrain dans sa bouille sludge, du rock dans son vacarme. Un grand, grand album.
Point vinyle:
Preuve que Metal Blade croit en son nouveau poulain, pas moins de 8 versions couleurs limitées disponibles, plus une box et la version noire. Bref il y en a pour tous les goûts (et pour les amateurs de CD, mais collectionneurs quand même, un édition japonaise est dispo à l’import chez Chaos Reign).

Un groupe du nom de Smoke ça peut jouer que dans une seule catégorie, celle du stoner (faites un effort, le rapprochement est pas bien difficile). De plus le groupe étant signé chez Argonauta rien d’étonnant à cette hypothèse. Pourtant ces trois gars ne viennent pas du delta du Mississipi mais plutôt du Deltawerken en Hollande (CQFD). The Mighty Delta of Time est le nom de leur premier LP qui sort ces jours-ci et bien que peu porté sur la verdure, on s’est dit qu’il fallait choper la douille / le disque au vol.
Stoner certes mais plutôt dans sa branche southern avec des grattes en picking et aux sonorités quasi lap Steel. Bref, ça joue au bottle neck et ça envoie entre deux passes aériennes : “Ride” semble poser le décor de ce que sera cet album.
Ça envoie oui, les chœurs jouent le viril mais toujours mélodieux et je lorgne ici du côté de la piste “Bereft” qui au lieu de faire la poussive est un beau véhicule pour l’auditeur. Ce titre enchaîne avec un autre tout aussi contemplatif, “Riverbed”, et à ce point on se dit qu’il n’en aurait pas fallu plus de peur de l’indigestion. Pourtant c’est bien dans cette veine que continue The Mighty Delta of Time qui, tout de stoner vêtu, est surtout planant.
Les gars tiennent sur la durée non pas par une quelconque extraordinaire beauté des compos (qui néanmoins ne sont jamais dénuées de beaucoup de charme) ; on ira chercher plutôt dans l’atypique de litanies quasi mystiques ou des lourdes cartouches tirées par la basse et la batterie sur “Time” et “Umoya” (les deux morceaux de plus de 10 minutes de l’album)
En résumé, un album qui démarre fort puis, une fois à 20.000 pieds, qui prend un rythme de planeur pour une écoute linéaire avec de beaux moments. Voilà un groupe qui porte bien son nom et rappelle les sensations du hit avant la montée planante des encens prohibés. Ceci fait de The Mighty Delta of Time un album sensible. Sensible mais pas fragile ! OK ?!

Il y a une vingtaine d’années de cela, une poignée de labels se tiraient amicalement la bourre pour faire rayonner le stoner rock sur la planète. Alone Records était de ceux-là, avec une volonté affichée de développer la scène espagnole en particulier. Le label permettait de mettre en visibilité des formations très recommandables comme Viaje a 800, Fooz, El Paramo, Cuzo, Glow, Autoa… Gloire leur soit rendue pour cette noble tâche. Dans ce fringant roster figurait Orthodox, combo de doom assez classique, à la production assez rare, qui faisait un peu figure de précieux OVNI (à l’époque les groupes de doom venaient plutôt des contrées sombres, humides et froides, et les sévillans détonnaient un peu). Pour autant, leurs disques tenaient la dragée haute aux fers de lance du genre, mais leur discrétion (peu ou pas de concerts, sorties d’albums sporadiques…) ne leur permit jamais de réellement occuper la place méritée en termes de notoriété. Pour autant, nos trois ibères ont tracé leur chemin depuis bientôt deux décennies, sous l’indéfectible support de Alone Records (très peu actif depuis plusieurs années), et reposant sur les inamovibles mêmes trois amis. Leur musique a toutefois muté avec les années, et il est intéressant d’en faire le constat à l’écoute de ce Proceed.
Du doom old school classique, Orthodox a gardé les bases d’influence : leur musique s’appuie sur ce socle de rythmiques lentes, de frappe lourde et d’accordages graves. Mais leur soif d’exploration a pris un tournant assez radical il y a un peu plus de dix ans (rendant les allusions au groupe rares dans nos pages), tandis que le groupe s’est resserré en un simple duo (Marco et Borja, bassiste et batteur), injectant à tours de bras des influences débridées, produisant des albums intéressants mais assez barrés. Cette démarche exploratoire trouve une sorte de point culminant sur Proceed, tout en proposant une approche plus cohérente, probablement liée au retour de Ricardo, leur guitariste, au bercail, après une absence de plus d’une décennie. Pour donner plus de lustre encore à ces retrouvailles et à cette ambition retrouvée, comme un coup de poker, le trio fait appel à Billy Anderson (Sleep, Melvin, Neurosis, High on Fire, Eyehategod, Acid King…) à la production, pour superviser l’enregistrement et en effectuer le mix. Ce dernier fait exactement ce qu’on attend de lui : il apporte une cohérence sonore à l’ensemble, propose un rendu parfaitement sale (ni trop, ni trop peu) et donne la puissance sonore où elle s’impose (une batterie terrifiante, une basse oppressante, des riffs subtilement prépondérants et des leads parfaitement dérangeants).
Pour autant, l’écoute de Proceed n’est pas vraiment un long fleuve tranquille, loin s’en faut, et l’objet reste difficile à avaler, en particulier pour l’amateur de plaisirs simples et de dégustations rapides : Proceed est lourd, compliqué et riche, il explore beaucoup et propose beaucoup de choses. Il illustre très bien le riche spectre de genres musicaux pratiqué par le duo/trio : d’un socle évidemment doom, le groupe va se frotter à des plans presque post rock, dérivant sur des terrains déjà déminés par les brillants Eagle Twin (« Abendrot »), indus (on croirait entendre des plans de Ufomammut sur « Starve », avec sa frappe de mule et sa basse claquante), drone (« Starve » encore), et même des passages de doom presque jazzy (la conclusion de « The Long Defeat »). Et que dire du perturbant « The Son, The Sword, The Bread », qui fait tourner l’auditeur en bourrique sur presque dix minutes de plans bruitistes aux lignes instrumentales dissonantes, que l’on croirait même pas synchronisées. Rythmiques inconfortables, riffs malaisants et breaks imprévisibles viennent agrémenter chaque titre ou presque, annihilant toute éventualité de confort auditif ou même mental.
L’ensemble est rude, âpre à l’oreille, mais addictif : on aime à redécouvrir ce disque sur la longueur, se laisser capter par l’ambiance d’un passage, la force de tel autre, écraser par la frappe martiale de Borja, étourdir par les lignes de chant toutes cachées derrière le mur d’instruments… Difficile en revanche de qualifier la qualité du disque à l’aune d’un flux de productions plus conventionnel – on se gardera donc de le doter d’une quelconque notation, mais on le recommandera aux aventuriers du son pour lesquels le doom peut s’incarner dans un prisme musical plus large.

J’ai reçu ce matin une missive de la part de Red Sun Atacama, trio parisien qui fait le stoner avec beaucoup de passion et de tripes depuis 2015 et vient de signer chez Mrs Red Sound. Je vous partage ce qu’ils m’écrivent : “Cabron, sabemos donde vives !!”. Ah les chaleureux remerciements des groupes qui nous écrivent sans cesse. Dommage que je ne parle pas espagnol, mais avec l’habitude on sait à quoi s’en tenir! Et dire que je les avais traités de menteurs lors de ma précédente chronique.
La plaque, Darwin, est un rien plus longue que la précédente mais ce n’est pas pour autant qu’elle passe moins vite. Le rythme est sans doute la qualité majeure de RSA (l’acronyme du groupe, je ne donne aucune aide financière). De bout en bout Darwin nous fait frôler l’arrêt cardiaque en explosant le métronome. Avec cette même particularité, “Furies” s’inscrit dans la droite lignée des compos de Licancabur et lorsque le tempo se calme comme avec l’intro et le pont d’ “Antares” ou le pont de “Ribbons”, c’est toujours pour mieux reprendre son souffle et remettre le pied dedans ensuite, kicks de batterie à toute blinde.
Darwin est un album majoritairement instrumental, Clém réservant sa voix acide pour les meilleurs moments comme pour “Echoes” où non content de placer ses lyrics au bon endroit il livre un parfait solo de basse accompagné de percus, juste après le solo de gratte. Cette structure démontre la cohésion entre les musiciens. Celle-ci est présente sur tous les titres. Les trois gars s’emboitent le pas à merveille et se regroupent pile quand il faut c’est un bonheur de les entendre monter en ligne pour semer la bagarre tout au long de cette galette.
Le groupe ne reste pas sur ses acquis et insère ici et là, quelques moment plus calmes. Se faisant notre trio tente une incursion vers le psychédélisme et enrichissent ainsi leur fonds de commerce. Derrière ce travail de composition on se renferme assez peu sur soi pour laisser monter l’émotion. Tout ici part du ventre (si l’on excepte le morceau d’intro à la guitare flamenco). De la rage et de la force, quelques respirations certes mais pas d’envolée extatique ou introspective. Cela n’empêche pas pour autant Red Sun Atacama de placer ici et là quelques hameçons biens malins qui viennent choper l’auditeur par la manche (notamment la moitié de “Ribbons” qui en regorge et la conclusion pachydermique de “Revvelator” ).
Red Sun Atacama ne ment pas, c’est un pur groupe de stoner qui joue vrai et ils réchauffent les os au soleil brûlant de leur musique. Ils livrent à nouveau avec Darwin un album puissant et efficace qu’il faudra aller recevoir en live avec un protège dents. Un album qui a tenu ses promesses et ravira tous les amateurs du genre. (Sigan predicando la verdad del stoner, chicos)

Est-il encore nécessaire de présenter Valley of The Sun, le quartette de Cincinnati passé sous pavillon Ripple Music Records? On n’avait plus rien entendu depuis leur excellent Old Gods et le revoici avec l’étiquette de nouvelle génération du heavy et du stoner. A user les planches du vaste monde ils sont probablement montés en grade, voyons cela avec l’écoute de leur dernier né, The Chariot.
Valley of the Sun revient avec un album résolument Stoner. Rien d’étonnant. Le groupe creuse son sillon dans le genre depuis 2010, les gars ont eu le temps de se faire les dents et s’installent dans un créneau dont rien ne semble pouvoir les déloger.
La production léchée de la plaque résonne aussi propre et forte que pour le précédent album. On y croise des Chants entêtants comme sur “headlight” et de bout en bout les cordes ne faiblissent qu’en de très rares occasions comme pour “the chariot” afin d’accompagner le suave de la voix de Ryan Ferrier ou encore les chœurs de “Colosseum.”
Les appuis bluesys de “As Decay” qui coulent comme une évidence sont aussi perceptibles aux détours de morceaux gonflés à la testostérone. Car les morceaux savent montrer les muscles à la façon de “Sunblind”, blues rock sur vitaminé sans pour autant que l’enrobage sucré ne fonde totalement, en particulier avec l’à propos d’un passage à l’orgue bien senti.
Valley of The Sun confirme sa place et son identité. Pile là où on l’attendait The Chariot est plus qu’un véhicule lancé pleine balle, il s’agit d’un bonbon aussi doux qu’acidulé pour lequel on remet la main dans le paquet sans aucune culpabilité.

Les anglais de Desert Clouds sont de ces groupes qui portent très bien leur nom avec leur mélange de stoner rock à l’influence grunge très marqué et des sonorités psychédéliques appelant à l’évasion. Un brin taquin, ces hippies du grunge vont plus loin que le Brexit en nous proposant un très tentant Planexit.
Presque comme un cliché, le morceau éponyme ouvrant l’album rassemble toutes les qualités du groupe. Riff bien efficace basse grassouillette, chant écorché, on n’a à peine le temps de se chauffer la nuque que le morceau décolle pour filer vers des étoiles lointaines et stationner autour d’une flûte enchantée. On retrouve ce schéma grunge/psyché sur des morceaux comme “Staring the Sun at Midnight”, “Deceiver” ou “Speed of Shadow” mais avec des constructions plus ou moins différente. Les deux premiers morceaux jouant sur la répétition d’un riff avec une intensité crescendo alors que “Speed of Shadow” donne une plus grande place aux ambiances psychédéliques et sonne comme si les Doors étaient nés à Seattle.
Le groupe pousse cette atmosphère aérienne sur “Wheelchair” ou “Pearl Marmalade” mais conscient de ne pas endormir son auditeur, l’album est aussi parsemé de titres au son grunge plus énervés et rythmés comme “Mamarse”, “Willow” et “Revoltionnary Lies” qui viennent à chaque fois contrebalancer un des morceaux cités plus haut.
Dès la première écoute, on identifie le chant comme atout principal de ce “Planexit”. Forcément influencé par un Chris Cornell des premiers Soundgarden, il évolue aisément pour coller au timbre d’un Eddie Vedder sur “Pearl Marmalade” et “Deceiver” (en plus heavy sur ce dernier) ou de Jim Morrison sur l’errance 60’s de “Speed of Shadow” et intensifier le voyage musical. Car même si musicalement tout est carré et efficace, il manque à certains riffs ce côté entêtant qui permettrait à un titre comme “Staring at the Sun at Midnight” de passer dans une dimension plus épique. On sent cependant que Desert Cloud préfère travailler ses ambiances notamment avec une basse assez présente dans le mix (sur “Staring at the Sun at Midnight” encore lui comme par hasard mais aussi sur “Willow”) et pas mal de passage qui ont dû boucler pendant les répétitions (“Wheelchair”, “Pearl Marmalade”, “Planexit”).
Sans rénover son monde, Planexit est un album sérieux et intelligent dans sa tracklist qui prouve à nouveau que le mariage entre psyché et grunge est possible. Après tout, les hippies et les gosses des années 90 aimaient bien s’habiller de manière douteuse.
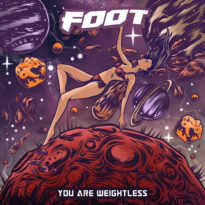
Nous avons jusqu’ici toujours été séduits par les productions de ce groupe australien au patronyme peu enthousiasmant. Derrière son frontman Paul Holden, les musiciens vont et viennent entre chaque sortie, sans que l’on n’ait senti de vraie fluctuation dans l’inspiration du groupe (ce qui laisse supposer le poids de son influence…). En progression constante, on espérait donc encore une bonne surprise après le déjà excellent The Balance of Nature Shifted sorti il y a deux ans.
Quelques écoutes suffisent à constater que le groupe ne s’est pas perdu en route, solide sur ses fondamentaux. Le premier de ces fondamentaux concerne sa production : sans jamais se départir de son son (un mix basse-batterie très classique mais solide, et une surcouche mélodique à renforts de guitares essentiellement) le groupe injecte une vraie réflexion dans ses choix de prod, sons de guitare, rares mais bienvenues nappes de clavier (pour des plans plus atmosphériques comme sur « Caged Animal » ou old school type orgue 70’s comme en fond sur « Scared »), chœurs parfois… avec l’efficacité comme leitmotiv. Sur ce socle de stoner mélodique nerveux gentiment fuzzé vient se greffer le chant de Holden : mixé bien en avant, il est décisif, sans pour autant se reposer sur une technicité ou originalité hors du commun – au service des compos uniquement. Bref, un savant équilibre, ajusté chanson par chanson, rarement mis à défaut.
Le dernier élément différenciant qui positionne ce You are Weightless dans le haut du panier est cette qualité d’écriture, en tout point remarquable : au bout d’une dizaine d’écoutes l’album devient addictif, et les écoutes suivantes viennent finir l’engrammation des chansons, que l’on se prend à fredonner inconsciemment à tous moments de la journée ensuite. Le phénomène est d’autant plus impressionnant avec le recul qu’il s’applique à 80% de l’album (il faut dire qu’avec 7 titres et 40 minutes de musique, Foot n’a pas pris le loisir de faire du gras, tout va à l’essentiel). Votre serviteur goûte un peu moins les mid-tempo (pourtant très catchy) que sont « Fire Dance » et « Caged Animal », mais difficile de critiquer le très malin « Gold Lion », « I’ll be just fine » (un riff impeccable, illuminé par un arrangement presque power pop brillant et un final de toute beauté avec une section de cordes en fond), ou encore le très heavy « Impossible ». Et que dire de ce prodigieux « Bitter », petite perle de robot rock groovy imparable, dont le lick de guitare (qui rappellera les meilleures inspirations de Josh Homme du début du siècle ou encore les illuminations plus récentes de Patròn) aura bien du mal à vous sortir de la tête.
Ce nouveau Foot, probablement leur meilleure galette à ce jour, est non seulement un excellent point d’entrée pour redécouvrir le quatuor de Melbourne, mais surtout un très bon album tout court. Il a de quoi séduire tout amateur d’un stoner rock travaillé, mélodique et efficace.

Si vous réécoutez le premier album de Electric Mountain sorti en 2017, vous vous dites immédiatement que ces trois mexicains ont dû écouter en boucle les albums de Dozer, Nebula et autres (early) Fu Manchu. Ou même plus encore Solarized ou Solace. Bref, ça leur a donné envie de s’y mettre et ils ont eu fichtrement raison. Donc déjà, allez écouter le premier album avant de découvrir celui-ci, c’est une belle pépite de stoner 100% pur jus. L’effet de surprise n’étant pas dans l’originalité des compos mais dans l’énergie et l’authenticité de la démarche.
Nous voici quelques années plus tard et le groupe nous balance Valley Giant. Electric Mountain pour le nom du groupe, Valley Giant pour l’album (et Electric Valley Records pour le label), on ne se démarque toujours pas et s’il n’y avait pas le chroniqueur enthousiaste que je suis pour vous pousser à aller découvrir, ce nom passerait peut-être sous vos radars de dénicheurs.euses avides de nouveautés.
Bref, pas besoin d’en écrire des tonnes, le groupe compense son manque d’originalité par une énergie et un souci évident du travail authentique et bien fait. Un peu comme un artisan qui ne fait rien de nouveau mais qui vous fait des choses de qualité à l’ancienne, Electric Mountain enchaîne les riffs à un rythme dingue et fuzz de partout sans complexe. Le groupe se permet aussi à l’image de “Morning Grace” un tempo plus lent au début, un beau changement de rythme et une écriture plus riche agrémentée de bons petits solos à la limite de l’impro. A partir des graines semées il y a quelques temps commence à germer une identité propre au groupe qui doit absolument continuer dans ce sens. Trouver son propre son, bien développer ses idées et surtout toujours garder cette pertinence dans l’esprit stoner qui les caractérise. “A Thousand Miles High”, instrumental qui conclut l’album est très prometteur. Intro soignée, les idées se développent en prenant leur temps (presque 9 minutes pour le morceau) et le groupe y fait preuve d’une belle richesse d’idées bien mises en œuvre. Du tout bon pour la suite que j’attends déjà avec impatience.
Après toutes ces années à écouter des disques par dizaines, je prends encore énormément de plaisir à revenir aux fondamentaux avec des groupes comme Electric Mountain qui ne cherchent pas à épater la galerie avec autres choses que du bon gros son et l’art du travail bien fait. Réapprenez les bases avec ce trio, c’est impossible de s’ennuyer.

Pour celles et ceux d’entre vous qui ne connaissent pas, petit retour sur Besvärjelsen. Groupe suédois, chant principalement féminin, doom metal mélangé à d’autres styles, des membres ayant déjà roulé leur bosse dans d’autres groupes plus ou moins connus.
Et là vous me direz à raison, qu’est ce qui va distinguer ce groupe de tout un tas d’autres ? Déjà il y a ce qu’en disent les autres. On ne va pas se mentir, leur deux premiers EP (Villfarelser en 2015 et Exil en 2016) n’ont pas vraiment dépassé les frontières suédoises et les collections de die hard fans écoutant tout ce qui passe. Mais les échos étaient déjà assez positifs. Ce n’est qu’avec la sortie du très recommandable premier album Vallmo en 2018 que le groupe va véritablement se faire connaître des amateurs du genre. Quelques défauts, pas mal de qualités. Bref, on se note le nom du groupe dans la rubrique « à surveiller ».
Quelques mois plus tard le groupe se prête au projet lancé par Blues Funeral Recording pour un EP (Frost) dans la continuité du premier album. Pas de réelle avancée (une production tout de même un poil meilleure). A titre personnel, j’ai tout de même plus accroché sur cet EP que sur les productions précédentes. Mais on reste donc sur quelque chose de comparable, c’est déjà ça. Les voici de retour presque 3 ans plus tard avec un deuxième album sobrement intitulé Atlas.
Premier constat, mis à part la clôture de l’album, on ne dépasse pas les 6 minutes par titre étant même majoritairement en dessous des 5. On sent donc avant même la première écoute l’étiquette doom se polir quelque peu. Deuxième constat et ce dès les premières notes, la production est largement meilleure. Le budget enregistrement a dû être plus confortable et ça s’entend immédiatement. Troisième remarque tout aussi instantanée, si l’album est à l’image de ce premier titre très accrocheur et dynamique, l’étiquette Doom aura vraiment du mal à rester collée.
“The Cardinal Ride” d’ailleurs choisi comme extrait pour la promotion de la sortie, est clairement orienté dans une direction différente des précédentes sorties. Celles et ceux qui connaissent le groupe seront surpris.es à n’en pas douter. Cependant, ça sonne bien. C’est très accrocheur, c’est bien écrit, assez court et efficace. “Acheron” enchaine avec la même constatation. Des riffs plus courts mais soignés, un tempo plus soutenu et un son plus massif, moins dépouillé. Les arrangements et autres ajouts ont été peaufinés, c’est moins brut mais très agréable à l’oreille. Et le solo de guitare qui ne s’encombre pas de technicité est juste là pour une transition avant le retour du refrain. J’ai parfois l’impression d’écouter un autre groupe, clairement. Pas habituel. Premiers titres à l’opposé de ce qu’on attendait. Déception ou pas ? Et bien pas du tout. Certes la direction musicale semble avoir changé mais c’est peut-être un mal pour un bien. Le groupe parait plus à l’aise. Lea Amling Alazam semble par exemple plus épanouie vocalement. Consciemment ou pas, l’album proposé est clairement plus abordable pour un public réfractaire à l’étiquette Doom. Un peu comme Alunah dont l’étiquette Doom m’a toujours rendu perplexe, Besvärjelsen vise clairement un autre public. “Hourse of the Burning Light” est carrément à deux doigts du stoner FM avec son refrain hyper évident et son riff de base d’une simplicité assumée. Changement de direction certes, mais on ne renie pas son passé et le titre suivant “Paradise” ralentit clairement son rythme pour nous donner une compo assez classique et pause bienvenue dans ce milieu d’album. Car “Digerliden” reprend la route en ligne droite plein gaz juste après.
Bourré de qualités, cet album n’évite cependant pas quelques facilités. “Descent” est un titre bien trop simpliste dans son écriture prévisible et l’instrumental dépassant à peine les deux minutes est parfaitement dispensable ou aurait dû clairement être intégré comme intro au titre suivant “Obscured by Darkness” qui fait le job côté Doom like.
L’album se termine avec “Divided Ends”. On y retrouve quelques riffs plus longs, des changements de rythme et autres variations qui en font certainement le morceau le plus riche.
Je vous conseille fortement de découvrir cet album comme si c’était un nouveau groupe et de ne surtout pas attendre une suite directe de Vallmo. Car sinon vous risquez d’être déçu.e mais surtout de passer à côté d’un album très agréable à l’écoute et qui devrait permettre à Besvärjelsen d’être plus remarqué et de voir son nombres de fans largement progresser.

Un nouvel album de Sasquatch c’est toujours un petit événement en soi. Né au tout début du siècle, le trio californien (enfin plus complètement depuis que Craig Riggs est derrière les fûts) est à rapprocher de la première vague de vrais groupes de stoner… et cette espèce est en voie d’extinction ! Or bon an mal an, le groupe se rappelle régulièrement à nos souvenirs, trop rarement néanmoins, mais sans jamais donner de signe de fatigue. Ils nous proposent généralement une nouvelle galette tous les 3 ou 4 ans, sans jusqu’ici faire de faux pas qualitatif. Même si on a attendu celle-ci un peu plus longtemps (Maneuvers, son prédécesseur, date de 2017), l’album est en réalité enregistré depuis plus de deux ans (!!), mais les bandes ont attendu dans les cartons que le paysage s’éclaircisse (Covid, concerts, etc…) pour permettre au groupe de le défendre notamment sur scène.
Maneuvers (on vous en parlait ici) répondait parfaitement au clichesque concept « d’album de la maturité », sur lequel le groupe confirmait son talent dans son style de prédilection, mais se permettait en sus quelques expérimentations audacieuses, gonflant son son et élargissant son spectre sonore à partir d’influences plus vastes. Fever Fantasy est exactement dans la même tendance en proposant, tout simplement, un nouvel album de référence dans la discographie sans accroc du groupe. On y retrouve cette fois encore une belle série de titres de stoner nerveux et puissant (“Save the Day, Ruin the Night”, « Live Snakes », « Voyager »…) et une poignée de mid-tempo catchy et heavy (« Part of not knowing », « It lies beyond the Bay »…), qui déjà à eux seuls justifient l’acquisition de cette galette. On trouvera quelques pièces moins classiques aussi, à l’image de « Witch » ou de ce (un peu trop) long « Ivy », où le groupe développe des ambiances plus calmes et lentes. A noter l’apport par exemple sur ce dernier de claviers bien plus assumés que sur Maneuvers, qui apportent des nappes très intéressantes en fond des superbes soli de Gibbs.
Si vous ne connaissez pas encore Sasquatch, on est sur du stoner rock de référence, tout simplement, avec toujours ce son de gratte énorme et lourdement fuzzé dans les coins, cette basse ronde et groovy tissant une base mélodique omniprésente, cette rythmique plombée (quelle frappe de Riggs !)… L’ensemble est servi sur un lit de riffs incroyablement efficaces, qui finiront de tapisser le fond de vos conduits auditifs (le super heavy “Live Snakes”, le catchy “Voyager” couplé à un impeccable arrangement de claviers, “Cyclops”, le punchy “Save the Day, Ruin the Night”…) . Rajoutez à ça le brin de voix chaud et subtilement rocailleux de Keith Gibbs tout à fait emblématique (toutes proportions gardées, le gaillard fait souvent penser à Chris Cornell), et vous retrouvez tous les ingrédients de la recette qui fait depuis plus de deux décennies de Sasquatch l’un des référents incontestés de la scène stoner.
Fever Fantasy s’avère donc être rien moins que l’un des meilleurs disques de Sasquatch (d’aucuns oseront dire qu’il s’agit de l’un des cinq meilleurs – soyons fous), présentant un groupe solide, toujours inspiré malgré les années, fidèle à ses racines tout comme à ses fans. Ce nouveau disque propose non seulement une vraie tranche de jouissance auditive, mais surtout le potentiel d’une grosse poignée de nouveaux brulots propices à alimenter les prochaines set lists live du groupe. Le meilleur des deux mondes.

Le Nouveau Mexique n’a jamais vraiment été (re)connu comme une plateforme du stoner rock américain, loin s’en faut. On pourra néanmoins se rappeler qu’un ambitieux jeune groupe, Spiritu, avait sorti autour du changement de millénaire un excellent disque (hey, devinez quoi : on était déjà là et on vous en parlait) qui en appelait d’autres, mais a fini par disparaître discrètement par la petite porte. Son chanteur Jadd Shickler n’est toutefois pas resté inactif tout ce temps, œuvrant en coulisses pour d’innombrables groupes du genre, à travers labels et boîtes de promotion notamment. Vingt ans plus tard environ, ils décident, avec Mike Chavez, le guitariste de Spiritu, de monter un nouveau groupe sur les cendres bien refroidies de leur ancien combo. Leur récent EP nous avait titillé, et on ne s’est donc pas fait prier pour se plonger dans leur premier LP.
Blue Heron (le Héron Bleu, étrange sobriquet convenons-en) propose probablement un extrait de ce qui peut être fait de mieux dans un genre très balisé : celui du stoner « à l’américaine », un stoner rock moderne, heavy, structuré, qui ne se perd pas en jams sans fin ou tergiversations de toute autre nature. Un style où le songwriting est primordial, et très fortement « riff-dépendant », trahissant une approche de la musique heavy bien charpentée, respectueuse de quelques basiques. Une sorte d’hybridation entre les groupes de pur desert rock (Slo Burn et compagnie) et les combos plus “carrés” du Nord-Est des USA (Lo-Pan, Gozu, etc…). Par ailleurs, toujours dans cette veine musicale, une importance significative est apportée au chant, placé bien en avant, avec un vrai chanteur (si si) au style varié, à la voix puissante et accrocheuse. L’effet est toutefois un peu à double tranchant ici : Shickler est présent sur tous les plans, du chant clair limite suave (“Push the Sky”, “Salvage”) aux passages puissants et énervés (“Salvage” encore, “Black Blood of the Earth”), en occupant tout le spectre stylistique intermédiaire (“Futurola”, etc…). “Double tranchant” car tout en servant habilement chaque compo par un réel effort d’adaptation, cette diversité n’aide pas à mettre en lumière la ligne directrice musicale du groupe.
Côté songwriting, le “jeune” groupe est au rendez-vous de ses ambitions, usant adroitement qui de riffs punchy, qui de leads percutantes et travaillées, qui de mélodies accrocheuses. Le tout est (bien) servi (évidemment) par une bonne prod bien costaude – « à l’américaine », quoi, où rien n’est laissé au hasard. Le mid-tempo énervé est à la fête, bien servi par un son de guitare gras et puissant, adroitement fuzzé, à l’image de “Futurola” ou “Push the Sky”. Le groupe explore aussi des voies moins balisées, avec des morceaux plus complexes, comme “Black Blood of the Earth” (début bourrin avec chant guttural caverneux et blast beat, ouvrant sur la deuxième moitié du titre des plages aériennes de plus pur stoner désertique) ou ce “Sayonara” à l’ambition un peu démesurée (13 minutes, c’est trop, même si la séquence mélodique est porteuse et pas mal pilotée sur la longueur). Au final, 6 chansons (8 avec les deux courts instrus, pas inintéressants pour autant) ça reste quand même peu pour se faire un avis définitif, même si le groupe a le bon goût de ne jamais se répéter entre chaque titre.
Ce premier véritable album de Blue Heron s’avère donc séduisant et prometteur. Il a les (petits défauts) de sa jeunesse : il montre beaucoup de choses, et il est donc un peu ardu d’en faire émerger une identité claire. Mais il y a de l’envie et du (bon) travail, et ce disque devrait contenter les amateurs de desert rock old school et de gros stoner US nerveux.

Depuis treize ans, Geezer inonde la scène stoner de ses compositions cool et bluesy. Une fois encore le trio de New-York vient poser sur galette son groove souple comme un gant de peau et fun comme un spliff trop chargé. Cette fois la plaque s’intitule Stoned Blues Machine et la très belle pochette toute en gouache rouge et noire fait planer sur l’ouvrage la promesse de nous ancrer les pieds dans le sol tout en nous envoyant la tête dans les étoiles, du pur Geezer non?
Le son classieux de Geezer glisse comme le velours sur l’oreille de l’auditeur conquis qui attend toujours qu’un nouvel opus pointe le bout de son nez. Plutôt qu’une description de ce que vous trouverez dans ce Stoned Blues Machine, il faudrait voir cela comme une définition de ce qu’est Geezer. Car oui Geezer c’est quoi?
Geezer c’est le mid tempo d’abord, marque de fabrique indéniable du trio qui emmène sa musique un cran au-dessus du blues rock. La rythmique est toujours impeccable et sait s’accompagner de ci de là d’une pépite qui retiendra l’attention sans jamais être sur-jouée. Puis il y a la fluidité du jeu des trois instrumentistes qui savent se passer le flambeau toujours avec justesse et délivrer une musique pleine de groove et de vie, un truc qui fait planer autant qu’il donne envie de bouger en rythme.
Cet album est comme tous les autres, on se sent porté par “Logan’s Run” ou “Broken Glass” qui envoient des rythmiques aguicheuses, on se laisse porter sur le presque paisible “Saviour”. Enfin l’éponyme “Stoned Blues Machine” mets ce qu’il faut de fun et d’aguicheur pour articuler la plaque. Le fun c’est sans doute ce qui résume le mieux l’écoute d’une plaque ou rythme avec les mains, cowbell, vibraslap et jouet en caoutchouc sont quelques-uns des marqueurs rythmiques qui enjaillent la plaque faisant fi de l’académisme et prouvant que leur musique n’est faite que de plaisir.
Il n’y a pas de surprise avec Stoned Blues Machine, un pur album de Geezer qui fait vivre le blues au travers du stoner et porte haut les couleurs de la détente psychédélique. Cette plaque comme toutes celles qui viennent avant elle font partie des indispensables d’une discothèque. Indispensable non pas parce que meilleure qu’une autre, mais parce qu’elle fait partie d’un ensemble et qu’au hasard on pourra toujours se la repasser et y prendre autant de plaisir.

Blues Weiser repose sur trois types qui ont posé les bases de leur musique en 2016 avec un premier LP qui n’avait d’autre ambition que d’offrir un peu de musique pour picoler avec les potes. Partant de ce postulat nos trois espagnols voyagent entre les styles pour peu que cela soit un minimum bluesy et surtout bien senti. Attirés en 2021 par Argonauta Records, ils nous offrent cette année Obey The Booze, une plaque de presque 40mn dont voici notre perception passé la superbe pochette de l’album.
Si l’intro “Fortune Teller” marche dans les pas du classique stoner mid tempo c’est un véritable pot-pourri qu’offre Blues Weiser. Il faudra dérouler toute la galette et aller taper sur “Void-cather” pour en retrouver la synthèse entre balade à boire et stoner rocailleux ivre de puissance.
Il y a du funk, à la pelle, de “Loose Lips” qui joue sur la frontière avec le feeling d’un Jimi Hendrix à “Clit Eastwood” qui cherche la folie d’un Red Hot époque Freaky Styley. Les boucles sont maîtrisées, les arguments massifs et comme dans ce dernier cas cela vire même à la sauvagerie orgasmique.
Ne nous méprenons pas pour autant, il n’y a pas de tricherie dans le nom Blues Weiser, ça fleure le blues rock (ou power blues selon les écoles). Aussi sensuel qu’un Popa Chubby sur “The Grass” et glissant vers le proto métal zeppelinesque sur “No Input” dont la structure est indéniablement blues. (Entre la rythmique et l’écho de la gratte qui joue le solo tout en finesse, c’est un rendu impeccable)
Le virage s’opère sur “Echoes of Oblivion” avec un pysch moderne teinté de grunge dans son dernier tiers, le titre se complète agréablement avec “Impact of Aviation” qui permet de rentrer dans le vif du sujet avec des mélodies profondes et puissantes qui ronronnent stoner pych de bon aloi.
Obey The Booze ne fera sans doute pas figure d’indispensable dans votre discothèque mais reconnaissons-lui la qualité d’un album de vieux routards qui roulent leur bosse discrètement et mettent tout leurs cœurs et leurs âmes dans leur ouvrage. Une belle pièce sur laquelle il est plutôt plaisant de tomber. Comme le dit le slogan de Blues Weiser: “Blues for Booze !” Qu’il est bon de ne pas se prendre la tête!

Tandis que Carson existe depuis plus de dix ans maintenant, le groupe est relativement méconnu sous nos latitudes. Il aurait pu en rester longtemps ainsi si l’on n’avait pas été « titillé » un peu par hasard par la première écoute distraite de leur galette… puis la suivante… puis la suivante… En fouillant un peu on s’aperçoit que le groupe est implanté en Suisse, tout en trouvant ses origines en… Nouvelle Zélande ! Un parcours atypique, et toutes les chances de ne pas parvenir à nos oreilles, le groupe étant porté par Sixteentimes Music, un label bâlois peu relayé jusqu’ici.
La principale (heureuse) surprise chez Carson tient à la maturité de leur musique, sous deux axes en particulier : qualité des compositions et pertinence de leur production (au sens large : enregistrement, interprétation, mixage…). Très rapidement, plusieurs titres se détachent pour marquer l’auditeur, proposant des accroches efficaces, des riffs bien ciselés, et une mise en son puissante. On est d’abord immédiatement captés par la lourdeur poisseuse de ce « Dirty Dream Maker » introductif, son riff puissant au fuzz subtil nous amène dans un champs stoner confortable. On note un peu plus loin le couplet malin, super accrocheur de « The last Laugh », puis la qualité du riff d’intro de « Outbound Tile » ou de « No Joy » (et l’évidence de son refrain), l’énergie power pop de « Gimmie » pourtant porté par un lit de grattes heavy fuzzées… Les huit titres proposés, très variés, ont chacun quelque chose à proposer, sont bien ciselés, ne jouent jamais la facilité. Du bien beau travail d’artisan.
Dans l’exécution, la présence de Kieran Mortimer-Jones écrase un peu le reste, le bonhomme étant non seulement à la source de cette montagne de riffs derrière sa six-cordes, mais proposant aussi des lignes vocales assez bluffantes pour un groupe de stoner, dans un style musical où le chant est souvent relégué à l’arrière-plan (que ce soit en termes de production ou de composition…), souvent pris en charge par le moins mauvais vocaliste du groupe, par défaut ou même par dépit. Ici, les lignes vocales sont variées, puissantes, servant admirablement la richesse des compositions. On entend PRESQUE Maynard James Keenan parfois (promis ! écoutez un peu le morceau titre). Un vrai facteur différenciant.
Bref, Carson c’est un peu la découverte de ces dernières semaines : The Wilful Pursuit of Ignorance s’impose comme un album très intéressant, emmené par une qualité d’écriture rare, supportée par une interprétation sans faille. Mettez-moi ces gaillards dans un van, on doit les voir plus souvent sur scène !

Pour les vieux tromblons comme votre serviteur, il y a vingt ans le microcosme du stoner rock mondial avait un vrai barycentre en scandinavie, et en particulier en Suède : Dozer, Lowrider, Sparzanza, Spiritual Beggars… ou encore The Awesome Machine. Le quatuor de Göteborg a produit 2 ou 3 des plus excitantes galettes du tournant du millénaire à l’époque, dans un genre musical largement porté par la scène scandinave de l’époque, basé sur un stoner lourdement testostéroné, dans un mouvement très lié à l’époque aux premiers groupes de garage rock énergiques qui fleurissent alors (Hellacopters, Backyard Babies…).
Peu aidés par un label sympathique mais manquant d’envergure (les géniaux “I Used to Fuck People Like You in Prison Records”), TAM (pour les intimes) a quelque peu manqué le chemin de la notoriété qu’ils méritaient pourtant. Usés, ils se sont d’ailleurs séparés au début des années 2000 et ne se sont jamais reformés. Car non, ce God Damn Rare n’est pas l’album de la reformation. Le disque propose onze titres disparates, souvent inédits ou rares, retrouvés dans les vieux cartons poussiéreux du groupe, issus de vieilles sorties trop discrètes, etc… Une bonne part était supposée figurer dans le dernier album mort-né du groupe (jamais finalisé pour cause de tracas avec leur nouveau label à l’époque, qui a fait faillite, emmenant avec lui les premiers enregistrements effectués), et se retrouvent donc ici sous la forme des démos d’époque, enregistrées en 2005, avant leur split. Le petit label Ozium records, en véritable archiviste de la cause stoner (allez voir leur catalogue de re-sorties !) propose l’opportunité parfaite de donner une nouvelle visibilité à ces titres.
Comme prévisible (au vu du titre du disque) la galette commence par la version démo (très aboutie) d’un des plus efficaces brulots des suédois, « God Damn Evil », imparable. Derrière l’image un peu monolithique que l’on a parfois de la musique de TAM, se cache pourtant une part d’expérimentation non négligeable, que l’on se plaît à (re)découvrir ici, à l’image des très efficaces incartades metal old school de « By No One » ou le hard rock groovy de « Gasoline » et « Shakedown » (tous trois inédits ou semi-inédits). Les intégristes du stoner rock pur jus trouveront aussi de quoi se mettre sous la dent avec « Demon King », les vieux « Digging » ou « Sun Don’t Shine on Me », pas si éloignés de la production de Dozer à l’époque, avec une petite dose de Kyuss pour faire bon effet, encore plus prégnante sur un « Ompa Bompa » d’école. On finit l’écoute sur ce vilain arrière-goût mêlant regret et nostalgie, avec une énième démonstration de « ce qui ne fut jamais », « I Never Knew », encore un autre morceau plein de potentiel composé mais jamais porté sur disque, un inédit lui aussi prometteur, capté en live.
Des sentiments mêlés émergent de l’écoute de ce disque, vous l’aurez compris, très étroitement liés à l’expérience personnelle de l’auditeur. Les fans de The Awesome Machine seront avant tout contents de mettre la main sur du matériel rare ou inédit, proposé sous une forme « présentable » (les titres qui en avaient utilité ont été re-masterisés pour l’occasion), et donc de se replonger via cette petite fenêtre sur la carrière du groupe, en particulier pour les débuts et la fin de leur carrière – tous les enregistrements datent en effet soit de 1998-1999 à l’époque où ils diffusaient des démos sur cassettes ou CDR, soit de 2004-2005, en prévision d’un nouvel album qui n’aura finalement jamais existé).
En revanche, est-ce que ce God Damn Rare est un bon moyen de découvrir le groupe ? Pas vraiment en réalité, car ce n’est pas sa vocation : par sa nature, le matériel proposé est certes qualitatif mais hétérogène. Par ailleurs, il ne s’agit pas non plus d’une compilation. Pour redécouvrir cet excellent combo, on vous conseillera plutôt de mettre la main sur leurs trois LP, à découvrir dans l’ordre de leur production. Ce disque trouvera alors naturellement sa place pour « compléter les trous ».
God Damn Rare est avant tout un excellent dispositif expiatoire, après s’être sentis démunis de l’arrêt discret et forcé du groupe il y a presque vingt ans de ça, une manière honorable de lui dire proprement au revoir. Il n’y a certes pas, a priori, de perspective de voir le groupe se former à nouveau… mais peut-être peut-on espérer d’autres petites pépites de cet acabit ressortir de la poussière pour constituer un volume 2 ? C’est le mieux que l’on puisse espérer.
Long live TAM !
|
|