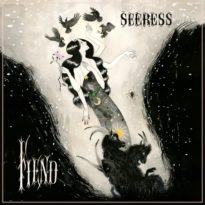|
|

Triste histoire que celle de cet album : le trio californien a vu l’enregistrement de son troisième album, Trough, marqué par une tragédie : le suicide de leur batteur Erik Herzog, atteint de dépression. Difficile d’envisager la suite pour un trio de ce type, encore plus de remonter la pente. Ils l’ont pourtant fait, décidant de poursuivre leur enregistrement en collectant le maximum de prises d’Herzog, et en s’adjoignant les services de rien moins que Brad Davis (oui, le bassiste de Fu Manchu est aussi un batteur très honorable) pour finaliser les pistes manquantes. Seuls maîtres à bord dans le process d’enregistrement, ils ont pris le temps de retrouver leurs marques et ont donc fini ce nouvel opus qui, de fait, rend un fier hommage à leur batteur.
Dire que le décès d’Herzog est tangible sur tout l’album est on ne peut plus faux en revanche : là où, dans une situation comparable, des groupes comme Bell Witch ont pondu un album hommage pénétré par la tristesse et l’absence de l’ami cher, Moab… fait du Moab. Point de séquence outrancièrement dépressive sur Trough, ni plus de mise en son emphatique, de balade sirupeuse ou autre signe extérieur de désespoir. Comme ses prédécesseurs (et en particulier leur premier album Billow) Trough propose un stoner rock teinté de sable californien, lorgnant du côté de la scène de Los Angeles (Fu Manchu, Nebula et consorts…), blindé de plans psyche, doom, et même occasionnellement grunge. Le trio est emmené par Andrew Giacumakis dont les vocaux, que certains ramèneront à Ozzy (RIP), participent surtout à rapprocher Moab du travail de Uncle Acid : il partage en effet avec Kevin Starrs ce type de chant très « nasal » (parfois assorti d’une autre ligne de chant en harmonie, technique aussi courante chez Uncle Acid), mais surtout la musique du groupe trouve souvent des similitudes avec le quatuor anglais, qui à travers des plans de guitare aux mêmes sonorités, qui au détour de plans rythmiques très proches de leurs productions emblématiques (« The Onus » par exemple, ou la seconde moitié de « Skeptics Lament »).
Pourtant Moab développe son style musical sans jamais tomber dans la copie. Ils apportent un disque riche de dix compositions efficaces, parfaitement ficelées, constituant un album riche de variété et de qualité. Mieux, et c’est finalement assez rare pour être mis ici en exergue : pas de remplissage ou de titres médiocres sur ce disque. Chaque morceau fait mouche, pour des raisons différentes, et parfois même déstabilisantes : associer des plans pop (un son de guitare clair auquel on n’est pas franchement habitué) et des plans heavy dans une évidence quasi-absurde ? Check (« The Will is Weak »). Partir sur un instru issu d’une BO de film pour se transformer en bluette sur-fuzzée à l’ambiance mélancolique ? Check (« Turnin’ Slow » ). Développer un riff catchy en intro/couplet qui rappellera les plans les plus malins de… Masters of Reality (le groupe, pas le disque) ? Check (« Fifty Thousand Tons »)… Les plans variés et imaginatifs sont omniprésents, presque roboratifs, et les assemblages étonnants sont toujours bien sentis. En complément, des titres plus « classiques » montrent le savoir-faire du groupe qui reste à l’aise sur ses bases : le nerveux « Medieval Moan » déroule son riff-cavalcade sur un morceau tendu de moins de trois minutes, le très doom « Moss grows Where No One Goes » qui rappellera les grandes heures de Goatsnake, « Fend for Dawn » en clôture qui fait manger le bitume avec son riff metal imparable…
Bref, Trough est encore un album réussi pour Moab, un disque riche, certainement pas de ceux que l’on écoute 2 fois en kiffant et qui finissent gentiment leur vie sur une étagère après la troisième écoute. Un album qui se redécouvre au fil du temps, généreux et modeste à la fois.
Il y a de ces albums associés à une tragédie qui s’en retrouvent transcendés. Est-ce le cas ici ? Le temps le dira, mais plus raisonnablement, on peut penser que Trough restera comme un excellent album de stoner, probablement (malheureusement) resté sous le coup d’une certaine discrétion. De ces petites perles cachées…

Après le feu de Let it burn sortie en février 2017, REZN est revenu cet automne dernier avec un opus intitulé Calm Black Water. Un titre de choix qui pourrait suggérer une invitation au repos, au caractère apaisant de l’eau et à sa douceur maternelle. Toutefois, comme le dit l’adage, il faut se méfier de l’eau qui dort. Car sous cette surface en apparence paisible, se tapit une vraie bête. On salue par conséquent le choix du fanart réalisé par Allyson Medeiros qui, fait assez rare pour être souligné, évoque on ne peut mieux cette dichotomie palpable tout le long de l’album.
En effet, à mesure que l’on progresse dans l’écoute de Calm black Water, on remarque que deux entités se livrent bataille. La première arbore des traits affables, doux, et une certaine sérénité ; son rejeton le plus pertinent restant « Mirrored Mirage », tandis que sa jumelle se révèle prédatrice, sauvage, pleine de violence. D’un côté, les habiles phrasés hypnotiques, les cymbales discrètes, les effets envoûtants au clavier semblables à des bois venus d’ailleurs ; le tout visant à abaisser notre vigilance. De l’autre, la puissance de musculeux riffs et d’une batterie massive. Ainsi, lorsque le monstre déchire la mer pour nous hurler son doom cosmique dans les oreilles, la digue se rompt et nous en frissonnons de plaisir.
« Iceberg » nous ouvre le bal de cette manière. Puis, fendant les eaux tumultueuses pour s’élever vers des cieux inatteignables, la voix du prophète Rob McWilliams survient. Un chant si métallique, si aérien, qu’il semble surgir d’un autre monde. Lorsqu’il se pose sur les riffs dévastateurs de « Quatum Being » ou d’« High Tide », le contraste évoque une créature mystique à la fragile silhouette dorée, juchée sur un cerbère en rage qui crache des flammes noires. Et ce contraste à l’équilibre parfaitement maîtrisé, ce rythme finalement, servira la cause de l’album tout du long.
Nous avions remarqué le gros travail effectué sur l’ambiance dans le premier opus, et il semblerait que celui-ci s’inscrive dans la continuité. Et puisqu’on parle de continuité, mentionnons que les six pistes constituant Calm Black Water s’enchaînent comme un seul et même morceau. Lors d’une écoute distraite, vous ne remarquerez sans doute jamais les transitions et aboutirez à la fin de l’album sans même vous en rendre compte. Une pérennité qui renforce encore un peu plus l’immersion dans cet univers sombre et froid.
Alors que Let It Burn paraissait s’essouffler après quelques pistes, ce nouveau bébé se révèle plus équilibré. Un travail muri donc pour le quatuor de Chicago qui réussit le pari de produire une deuxième galette de qualité encore supérieure. Amateur de gros doom bien membré avec un petit quelque chose d’authentique en plus, ne passez pas à côté de cette pépite.

Lorsque l’air est devenu irrespirable entre Bruce Franklin et Eric Wagner, les deux têtes pensantes de l’hydre Trouble, légende heavy doom de Chicago, le premier a gardé le nom de domaine tandis que le second, en bon chrétien, s’est effacé pour fonder The Skull, prenant tout de même soin d’emporter avec lui Ron Holzner et Jeff Olson, soit ni plus ni moins que la section rythmique de Trouble. Acoquinés avec un ex-Pentagram, cette moitié de Trouble propose avec For Those Which Are Asleep, publié en 2014 chez Tee Pee Records, un excellent disque de doom aux antiques vibrations, reprenant le temps de ce que l’on imaginait comme un coup d’un soir, les qualités ancestrales de ce qui a bati la légende doom US. Voilà que sort alors, quatre ans plus tard et en toute discrétion, The Endless Road Turns Dark, comme une seconde chance pour cette jolie romance.
Toujours chez Tee Pee Records, sans l’ex-Pentagram (Matt Goldsborough), sans Jeff Olson derrière la batterie mais avec le talentueux Rob Wrong (Witch Mountain) à la guitare (son jeu Sabbathien se marie à merveille avec le toucher, plus heavy 80 de Lothar Keller) et rien de moins que Brian Dixon (Cathedral) à la batterie. Solide vous avez dit solide ? Si vous cherchez ici de l’originalité, passez votre chemin, allez du côté de la musique bruitiste, dissertez post rock avec le petit doigt sur l’ourlet et pourquoi pas avilissez-vous jusqu’à suivre la mode synthwave (ce qui vous amènera tragiquement à saluer la prise de risque de Muse sur son dernier disque), mais si votre cœur de doomster bat (au ralenti) pour le vieux heavy, avec refrains poignants et riffs tout en huile de vidange, vous trouverez là votre bonheur. Batti avec les normes usuelles du genre, The Endless Road Turns Dark offre un morceau d’ouverture imparable, puis un single au riff plus complexe qu’il n’y paraît (« Ravenswood », qui rappelle Trouble période Plastic Green Head, le Trouble qui influençait Alice In Chains) avant de se permettre de prendre ses aises, considérant que le contrat est déjà rempli. Ainsi les 5 routiers du mid-tempo se permettent à peu près ce qu’ils veulent, du doom lancinant (« Breathing Underwater ») à l’inévitable ballade (« All That Remains (Is True) ») pour quinquas en mal de « c’était mieux avant » (« Thy Will Be Done » nous sort même le meilleur riff de 2018 qu’on aurait aimé avoir en 1989). Reste que cette apparente routine d’un heavy rock ronronnant est sublimée par la classe folle de ceux qui l’on composée. Avec son patronyme qui le prédestinait à la musique pesante, (Eric) Wagner prêche pour sa paroisse (le refrain de « Longing ») et ses comparses rivalisent de bonnes idées (« From Myself Depart ») tout au long d’un disque aussi ramassé qu’il est efficace. Et puis merde, comment résister à « From Myself Depart », entre feeling bluesy (cette basse) et groove à papa ?!
En se terminant avec « Thy Will Be Done » qui reprend le thème et le refrain de « The Endless Road Turns Dark » en seconde partie de morceau, l’album réalise donc une sorte de boucle et s’impose, par delà sa forme classique et son respect absolu des préceptes Sabbathiens, comme une pépite heavy doom, comme il y en a trop peu en cette fin de siècle tournée vers d’autres préoccupations métalliques. Avons nous affaire ici à une chronique de vieux con (avec plus de parenthèses que dans un roman de Stephen King ?) d’un disque pour vieux con ? Probablement.
Point Vinyle :
205ème publication de Tee Pee Records, The Endless Road Turns Dark n’a été pressé que dans un pas très joli gris avec black splatter en quantité limitée, sans que le chiffre ne soit donné (500 ? 1000 ? 1500 ? Mystère). Pas le plus difficile des albums à trouver.

De l’Heavy truckin’ space fuzz, voilà avec quel bois on se chauffe aux côtés de ce quatuor outre-Manche. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ce titre n’estampille aucun mensonge sur la marchandise. Les gars de Bradford sortent cette année leur premier album intitulé Mojo Rising et signé chez Ripple Music. Une galette aux neuf morceaux sentant fort l’huile moteur et la poussière du désert.
On y découvre un son très sec, aride ; corrélé sans doute à la présence d’une forte fuzz, qu’il s’agisse des guitares ou de la basse de Martyn. La frénésie s’invite souvent à leurs phrasés électriques et nous propulse sur les platebandes d’un Fu Manchu dans sa période Boogie Van. Il n’y a qu’à écouter « Ride », « Juju », ou « Black Dog » pour abonder dans ce sens. Toutefois, et comme nous le prouve « Stone », par exemple, nous sommes loin de la simple imitation. Car si la ferveur californienne reste perceptible tout du long de l’album, elle s’avère en revanche diluée d’éléments doom bien caractéristiques. Lent sans œuvrer dans le pesant, lourd sans s’enfoncer dans les poncifs des musiques incantatoires, Psychlona semble exister à la frontière du style, n’en distillant que la phase la moins dense.
Ce substrat se mêle alors à la fièvre du désert pour donner vie à des pistes très accrocheuses, telles que « Down in the Valley » avec son riff d’intro bien bourrin ; ou encore « Your God » qui, après une minute aux limites du psyché, nous propulse au galop avec la voix presque distante et neutre de Phil en guise de rappel régulier à l’ordre.
Mojo Rising, c’est aussi « Breakfoot ». Un morceau s’étirant sur neuf minutes à la structure évoluant peu à peu vers le jam session débridé. Une pièce sans équivoque taillée pour le live et qui aura certainement pour rôle de boucler les futurs shows du groupe.
Finalement, au carrefour des styles, on trouve forcément de quoi sustenter ses esgourdes. Néanmoins, et pour les mêmes raisons, les plus difficiles pourraient déplorer un je-ne-sais-quoi manquant dont la présence transcenderait le tout. Un ultime ingrédient nécessaire à cette potion pour véritablement devenir explosive. En somme, rien de dramatique pour un premier album, bien au contraire. Laissons donc à ce quatuor prometteur le temps de parachever sa quête du Graal et venir nous rabattre le caquet à sa prochaine sortie !
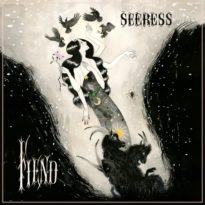
Fiend est l’archétype du groupe qui gagne à être connu. Si si. Dans un monde idéal, il y aurait plus de Fiend et moins de Sabaton, par exemple. Bien sûr il y a d’autres combats plus importants à mener, mais celui de la réhabilitation de ce quatuor d’origines incontrôlées est une mission que Desert-Rock se doit de porter. Pourquoi diable Fiend n’est-il pas (re)connu comme l’un des tout meilleurs groupes de doom en France ? Parce qu’ils le font de manière ancestrale, loin de la surfuzzcherie ambiante et des relents de retro-rock mal plagiés qui semblent être un standard en cette fin de décennie ? Possible. Parce qu’ils ne jouent absolument jamais (une poignée de concerts en presque 15 ans) Probablement. Pourtant le CV des musiciens est loin d’être ridicule : Heitham Al-Sayed est un anglais rompu à la scène fusion anglaise 90’s avec Senser, Nicolas Zivkovich a rejoint DDENT et Michel Bassin, le guitariste, a joué de longues années dans Treponem Pal et prêté main forte parfois à KMFDM et même… Ministry. Même leur premier batteur n’était autre que Simon Doucet, ex Kickback. Bref on est pas loin du pédigrée. Et pourtant. Aglan leur premier album sort en 2009 chez un discret label du sud de la France (Trendkill) et ne remue pas la scène (et pourtant jetez d’urgence une oreille à la chanson « St. Helens »). Leur second effort Onerous, publié en 2013, est même une auto-prod. L’une des auto-prods les mieux produites de l’année (Non mais écoutez moi « Frankenstein, You’re Fired » !). Quelques dates sur Paris (dont un Stoned Gatherings remarqué dans ces pages) et puis silence total. Jusqu’à cette signature chez Deadlight Entertainement, autre label du… Sud de la France, qui semble avoir fait de Seeress, ce troisième album, une priorité. Et tant mieux.
Avec Renaud Lemaître à la batterie, dont la subtilité du jeu sied à ravir au groupe, les quatre garçons toujours pas dans le vent ont mis en boîte un bien bel album. 7 titres, 7 bonnes raisons de s’enthousiasmer. Derrière « Morning Star », tête de gondole évidente du projet, notons « Ancestral Moon » dont les modulations vocales font penser au travail d’Hangman’s Chair ou « Vessels » qui, avec son ambiance post punk et son goût pour l’audace se rapproche des velléités d’Årabrot. Il y a une vraie élégance qui se détache de cet ensemble. Les riffs sont raffinés, les mélodies mémorables, et Al-Sayed arrive toujours, avec sa façon si personnelle de chanter, à faire passer une émotion certaine. Quelques claviers, discrets (« 5th Circuits », le final très expérimental mais néanmoins doom comme c’est pas permis « The Gate ») viennent agrémenter le disque, surtout en sa seconde partie, plus aventureuse.
Espérons donc que Seeress aura enfin une durée de vie digne de ses qualités et que Fiend saura capitaliser sur ses qualités pour enfin se faire connaître des nombreux rompus au genre, qui sauront à coup sûr reconnaître en ce groupe une valeur sûre. C’est en ce sens que le Hellfest 2019, qui a retenu Fiend sur son affiche, prend des allures de tremplin idéal.
Point vinyle :
Deadlight n’a pas décidé de presser de LP pour le moment. Oui c’est frustrant.

Wizard Must Die, c’est un trio (ou duo, ça dépend des jours) de Lyon qui a eu l’excellente idée de se mettre a jouer de la musique et, qui plus est, de la musique dans notre champs d’écoute. Alors bon, il faut bien avouer qu’en off, ces gars-là ont un humour douteux et une passion presque perverse pour les musiques oubliées des années 80-90, mais… mais… mais, sorti de la grosse déconnade, ils ont enfilé quelques titres sur une galette poétiquement intitulée In The Land Of The Dead Turtles qui fait office de premier LP dans leur discographie et c’est de cela dont nous allons parler à présent.
Tout au long de l’album j’ai pu jouir de la subtilité des passages légers parfois aériens. La teneur en est toujours mesurée, la durée toujours correctement jaugée, cette légèreté ne vire jamais chiant, car il faut bien le dire, à vouloir faire trop délicat on risque toujours de sombrer dans le mielleux voire l’inutile, or ici, l’équilibre est toujours respecté in extremis. Le magicien est un funambule qui sait quand il doit passer au choses sérieuses. D’un coup de baguette de batterie magique puis d’une formule de riffs obscurs sort toujours la puissance et l’envolée qui va te faire bouger vivement sans même que tu t’en rendes compte.
En plus d’être équilibré, l’album est rentable, car tel le paquet de lessive magique, un seul album en fait autant que vingt ! Les références se croisent, s’enchaînent sans jamais donner l’impression de copié-collé. On retrouvera du Tool, et son “Forty Six And Two” dans l’intro de “Umibe No Kafuka” (quand on vous dit que les gars ont du goût, références croisées musicale et littéraire et pas n’importe lesquelles) ou encore un peu plus loin un air de je-ne-sais-quoi de Marylin Manson le jeune. La voix de Florent est surprenante, car sur un album de stoner, elle ne pousse jamais dans le growl, le cri ou le rauque. Du mélodique, uniquement du mélodique, voilà aussi sans doute ce qui fait une bonne partie du job. Ladite voix évolue entre esprit pop 80’s de qualité et pousse même jusqu’à une approche à la Bertrand Cantat dans ses passages susurrés sur “Empty Shell”, ce même morceau qui nous aura rappelé sans l’ombre d’une hésitation les dernières frasques de Greenleaf, une fois de plus à cause du chant, mais également à cause de la structure.
Le titre final, “Odyssey” fera ressurgir The Offspring et son “Come Out And Play” grâce à son break oriental et Wizard Must Die ne joue pas un pastiche, non ! Un patchwork de références que l’on soupçonne inconscientes et assumées à la fois. Je ne forcerai pas plus sur les comparaisons, car il y aurait à dire aussi du coté de nos classiques fuzz tel Truckfighters ou stoner tel Red Fang, j’en passe et des meilleurs.
Une chose encore cependant, la marque de fabrique des Dust Lovers est imprimée sur une bonne partie de l’album et à regarder de plus près, rien d’étonnant puisqu’ils ont activement participé à l’enregistrement. Outre le fait que ce dernier ait été enregistré chez Christophe, le batteur de la susdite formation, il se retrouve crédité sur les fûts et Nagui et Clément tiennent respectivement gratte et synthé sur “Empty Shell”.
Cher lecteur je te le redis, les gars ont du talent à revendre et c’est une pièce presque sans accroc que ce In The Land Of The Dead Turtles. Surprenant, souvent à la limite d’une pop grand public, mais ayant eu la sagesse d’en distiller le meilleur. Aérien, mais sans être dans la redite psych’. Péchu sans facilement déborder dans l’excès de violence auditive déconstruite et, à ce sujet, je vous invite d’ailleurs à vous arrêter sur “Logical Math Carnage” qui est LA poutre de l’album. Wizard Must Die fait les choses intelligemment et avec beaucoup de sensibilité.
Avant de conclure, je m’arrête sur l’artwork qui, comme les titres, fourmille de petits raffinements. Un triptyque de visages mystiques, un rien BD 70’s, pléthore de détails comme dans un tableau de Jérôme Bosch. Thèmes sur thèmes, une composition qui ne fait rien comme les autres et qui résume subtilement la perle d’album qu’il contient.
Tu ne savais pas quoi commander au père Noël, voilà de quoi faire, Wizard Must Die, In The Land of The Dead Turtles, un album qui sonne avec originalité et talent dans le flot des sorties parfois trop ternes. Un seul reproche, quelques titres de plus auraient été les bienvenus pour gagner en densité. Mais clairement si c’est le seul reproche à leur faire, je crois que la galette pourra se trouver seule sous le sapin et qu’elle fera autant ton bonheur qu’une débauche de cadeaux.

Peut-être ne le saviez-vous pas mais Earthless et les albums live c’est une longue histoire. Depuis Sonic Prayer Jam en 2005 jusqu’à ce From The West tout juste sorti, la discographie du groupe est parsemée de très régulières sorties enregistrées en public. De sorties très confidentielles sur CDr (OZ Tour volume 1 et 2, 50 exemplaires pour l’un et 96 pour l’autre) à celles uniquement en vinyles (Live At Tym Guitars Brisbane, Australia) en passant par celles disponibles aussi en cassette (Live In Guadalest), les amateurs connaissent surtout le mythique Live At Roadburn sorti en 2008.
La première chose qui frappe lorsque l’on passe ce nouvel album live pour la première fois, c’est le son ! Oubliez justement la production douteuse du Live At Roadburn, le son de ce cru 2018 est parfait. L’équilibre entre les différents instruments et la voix est parfait et on sent qu’ici tout a été mis en œuvre pour que ce disque ne soit pas uniquement réservé aux fans hardcore prêts à écouter du bootleg au son caverneux. Bref, From The West est un vrai bon live, bien produit et extrêmement bien soigné.
Pour le contenu, la setlist est assez similaire à ce que le groupe nous avait offert lors de sa tournée européenne estivale pour la promotion de Black Heaven. On navigue donc sur les deux derniers albums studio plutôt que les deux premiers. Ni “Godspeed”, ni “Sonic Prayer” ne sont présents mais l’hallucinante version de “Uluru Rock” n’a rien à envier à ces deux mythes du passé, c’est une certitude. D’ailleurs, aucun des morceaux présents sur ce live ne vous décevra. Car Earthless tient là son premier vrai disque live en bonne et due forme. Le fond et la forme sont parfaits. C’est tellement bien joué que les plus sceptiques crieront à l’imposture, à la retouche en studio. Mais celles et ceux qui ont assisté à un des concerts de la tournée savent que ce n’est pas le cas. Car oui, le contenu du disque est fidèle à ce que le groupe offre réellement en live. Là encore le chemin parcouru depuis le mythique Live At Roadburn est impressionnant.
Je ne vous vanterai pas ici la qualité des compositions, c’est affaire de gout, mais la qualité de l’interprétation et le rendu en live est indéniablement et objectivement une réussite. Si vous aimez la musique d’Earthless, ce disque est un indispensable. Que des bons titres interprétés à la perfection, magnifiquement enregistrés et parfaitement produits.
Heureux sont ceux qui ont vu Isaiah Mitchell sortir de sa guitare de tels sons avec un tel feeling. Et heureux sont ceux qui pourront éternellement écouter cela dans de bonnes conditions avec ce disque.

Boston s’avère décidément une ville de talent. Loin de se satisfaire des deux usines à génies que sont l’université d’Harvard et le Massachusetts Institute of Technology, ou encore de ses prestigieux clubs sportifs, tels que les Bruins, les Celtics, Red Sox et autres Patriots, tous détenteurs de trophées, il faut encore qu’elle produise de supers groupes de stoner. On pense tout de suite à Elder, et on aurait raison, mais d’autres énergumènes moins bien cotés mériteraient tout autant notre intérêt. C’est sans doute le cas de Sundrifter.
Après un premier album paru en janvier 2016 intitulé Not Coming Back, le trio revient (pourtant) depuis peu avec une deuxième galette éditée chez Small Stone. Et si l’artwork du premier opus représentait un coucher de soleil sur fond de paysage stérile ou post-apocalyptique, le second évoque des horizons nettement plus… lointains. Pourtant Visitations, de son petit nom, ne détonne pas vraiment de son petit frère.
Le vaisseau a peut-être voyagé des années-lumière, mais sa façon d’aborder l’environnement demeure. On y retrouve toujours ce son bien fuzzé et identifiable dès les premiers accords de « Sons of Belial », ou sur « Hammerburn ». La solide charpente rythmique est assurée par Paul Gaughran et Patrick Queenan, respectivement bassiste et batteur, qui à eux deux propulsent l’engin au travers du cosmos. Au milieu de ces deux boxeurs, la guitare peine presque à imposer son empreinte. Ça tombe bien, car la gratte n’est pas le seul atout de Craig Puera. En effet, une fois le climat installé par ses riffs envoûtants, il œuvre surtout niveau vocal.
La voix de Sundrifter donne selon moi toute son identité au groupe. Dépourvue d’aspérité, elle ne franchit jamais les frontières de la clarté pour oser s’aventurer en territoire saturé. Cela ne plaira guère à toutes les oreilles, surtout pour tous les amateurs de poussière et de crasse vocale qui sont pourtant l’apanage des musiques du désert. Toutefois, ce chant détient quelque chose d’étrangement captivant, d’hypnotique. Peut-être est-ce le contraste avec le reste de la musique, ou bien ce côté nonchalant, flottant, presque onirique sur « Targeted », qui retient notre attention. Toujours est-il qu’on ne peut l’ignorer. J’avoue être curieux de découvrir le groupe sur scène, afin de mesurer l’implication des ajouts d’effets dans cette mystérieuse magie vocale.
Quoi qu’il en soit, c’est dans une ambiance d’exploration spatiale et temporelle, mais aussi à la recherche de vie extraterrestre (les thèmes redondants du trio américain) qu’on se retrouve projeté au cours des neuf pistes constituant l’album. Un album qui, s’il n’invente rien ni ne transcende le genre, a au moins le mérite de lui rendre hommage, tout en apportant d’intéressants questionnements.

2014-2016-2018 : avec un album tous les deux ans, on ne pourra pas dire que Witchthroat Serpent se la coule douce. Sur disque en tout cas, car sur scène le trio ne se distingue pas par sa suractivité : quelques dates (bien) choisies ici ou là, mais jamais de grosse tournée. Ce n’est donc pas vraiment sur scène que le groupe s’est avéré décisif jusqu’ici, mais plutôt à travers sa discographie que WS gère son évolution, ses albums étant le principal indicateur de sa vitalité et de sa créativité. Les toulousains ont après leur précédent opus Sang-Dragon quitté leur accueillant label Deadlight pour rejoindre une belle boutique, déjà inaugurée avec leur EP sorti l’an dernier : Svart Records et son roster extensif et stylistiquement diversifié. Rien d’illogique, mais pas forcément une destination que l’on aurait imaginée naturelle pour un tel groupe de doom. Prestigieuse expérience en tout cas, sur un label culte !
Nouvel album donc, sept titres (plus une intro), quarante-cinq minutes : on a beau être dans le doom pur jus, on reste sur du classique, avec des morceaux de 6 ou 7 minutes en moyenne. C’est lent, c’est long et c’est lourd, mais ça ne déborde pas en plans ambiants interminables ou en répétitions stériles. Niveau son, Sang-Dragon était déjà doté d’une excellente prod, et ce Swallow the Venom n’est pas différent. Bon, on cherche un peu trop souvent la basse dans le mix au goût de votre serviteur, et le chant est un peu trop mis en avant, mais ce son doom-garage juste assez sale sied parfaitement à la musique du combo. Si l’on devait décrire le style du groupe… commençons par décaniller l’éléphant dans la salle, comme disent les ingliches. Ceux qui ont suivi le groupe ces dernières années savent qu’ils traînent une réputation pas vraiment infondée d’ersatz d’Electric Wizard. Le son de guitare, le son de basse, le type de compos, le chant (pour le mix, mais aussi les similarités dans la voix), la place de l’occultisme dans les thématiques développées… on y revient fatalement. Ecoutez « The Might of the Unfail » si besoin d’une illustration… Pourtant on ne taxera pas les toulousains d’opportunisme pour autant, ses membres étant issus de formations gravitant dans plusieurs sphères doom / funeral / occult / drone depuis plusieurs années ; simplement, la synthèse du doom « moderne » revient souvent autour de ce qu’a pu produire Electric Wizard au long de sa carrière. Demander au groupe de se forcer à s’en distinguer serait contre-productif, voire castrateur.
Dans ce cadre musical toujours un peu codé, Witchthroat Serpent ne peut s’appuyer que sur la qualité de ses compos pour se distinguer. Heureusement, sur le sujet ils sont bien armés. Toujours solides sur les basiques (à l’image de « Lucifer’s Fire » : excellent riff refrain, excellent riff couplet, petit solo concis et efficace… propre), le groupe explore néanmoins quelques sentiers de traverse sur ce Swallow The Venom. Sur un « Pauper’s Grave » bien chargé en fuzz, ils se lancent dans un break en son clair quasi dissonant, avec chœurs en fond, qui donne un côté WTF assez rafraîchissant au morceau. Sur « Hunt for the Mountebank » on est séduit par un travail rythmique moins linéaire. Et puis ici ou là on trouve des initiatives qui sans être d’une audace formelle énorme relèvent de réels efforts de production pour densifier encore un peu le disque. Enfin, ce type d’initiatives reste assez timide dans sa portée et les occitans restent quand même largement dans leur zone de confort. Mais pas de raison de bouder notre plaisir, Swallow the Venom est un très bon album de doom classique : il regorge de riffs efficaces, de mélodies accrocheuses, et ne tombe jamais dans l’écueil du cliché doom. Pas l’album de la consécration, mais une suite logique dans leur carrière, toujours en progression.

En Norvège, le metal et l’église sont étroitement liés. Par le feu principalement, criminel, de quelques jeunes devenus membres légendaires des groupes de la première vague black metal à l’aube des années 90. Årabrot, en bons musiciens norvégiens, ont quant à eux acheté une église et l’ont transformé en studio. Voilà 15 ans maintenant que le quatuor s’évertue à faire vivre une musique à la croisée du métal, de la noise, du blues, de post punk et du doom, un peu. Pas stoner pour un sou non, mais une vraie volonté de lorgner vers l’art de la transe nébuleuse comme les américains l’ont produite dans les années 90. Dès leur troisième album (The Brother Seed) donc, Kjetil Nernes et les siens ont opté pour Seve Albini à la production avant de confier les deux suivants (Revenge et Solar Anus) à Billy Anderson. Voilà qui pose leurs intentions. La carrière du groupe se lançait alors doucement lorsque Nernes fut terrassé par une forme peu courante de cancer dont il mit un temps fou à se remettre. Conscient alors de la fragilité de l’existence, le garçon met ses questionnements philosophiques et sa rage en musique. Le résultat sort en 2016, se nomme The Gospel et a remporté un Grammy en Norvège. Cet album n’est rien d’autre qu’un essentiel et Who Do You Love lui emboite le pas avec classe.
Si le nom de leur 8ème album se réfère directement à une chanson de Bo Diddley (« Who Do You Love », 1957), la musique, elle, s’imagine toujours comme une réponse froide et métallique aux digressions des Melvins ou de Sonic Youth. Il y a même, plus que jamais, du Killing Joke (« Warning ») au détour de thèmes, d’intonations vocales. « Maldoror’s Love » en ouverture de disque pose l’ambiance. Le personnage habité par Nernes éructe, braille, psalmodie et le disque se pose ainsi en suite logique de son glorieux prédécesseur. Si idée de voyage il y a, c’est d’un voyage long et déprimant, celui d’un tour bus sillonnant le pays, comme le suggère les dissonances anxiogènes de « The Dome ». Le fan de doom verra son attention particulièrement retenue par « Look Daggers » (probablement le meilleur titre de l’album) ou la reprise du standard black popularisé par Nina Simone « Sinnerman » (déjà disponible sur l’EP sorti quelques mois auparavant) mais saura également apprécier l’aération voix/clavier « Pygmalion » ainsi que la lancinante « Sons And Daughters », deux titres mettant à contribution vocale la claviériste Karin Park. Ni trop long (le mal de cette décennie en matière de musique) et jamais ô grand jamais répétitif, Årabrot signe là un nouveau chef d’œuvre. Et si on tenait là le groupe rock le plus inventif de ces dernières années ?
Point vinyle :
Sorti chez Pelagic, l’artwork de Who Do You Love est soigné, rendant hommage au malsain de sa pochette. L’album vient avec un insert (paroles et surtout une jolie histoire du journaliste/essayiste anglais John Doran) et une download card. Vous le trouverez en Brown/beer (250ex), clear (250ex) et en black tout simple. Pour tous les goûts donc.

Domkraft est un trio Suédois qui sort son deuxième LP Flood, chez Magnetic Eye Records. Ils avaient déjà retenu mon attention lors de leur précédente sortie de 2016 The End Of Electricity par leur approche Post-Metal du genre Doom. Voici donc l’album Flood, tournons nous vers la platine et voyons ce que cela donne.
Galette qui sonne Doom, voix plaintive, basse lourde comme une tonne de plomb, guitare appuyée aux riffs lents et frappes de batterie qui tombent de très haut. “Landslide”englobe la marque de fabrique d’un Doom à la Black Sabbath mais ne fuyez pas trop vite de peur d’être lassés, il y a aussi des choses bien à eux dans tout ca. On se prend à hocher la tête avec une petite sensation de contentement. Pédale fuzz, chant proche dans l’esprit de celui de Windhand effectivement il y a de quoi se laisser porter.
On retrouve chez Domkraft une direction prise dans nos genres de prédilection ces derniers temps, à savoir un attrait pour le post Rock. peut être n’est ce que l’effet du chant hurlé en sourdine mais on se prend tout de même à penser que l’on rentre là dans un courant que pas mal de leurs confrères du Doom empruntent (Devrais je parler de post-doom comme certains parlent de post-Monolord?)
La filiation avec Monolord n’échappera d’ailleurs à personne sur “The Watchers” , crochet guitare/basse qui prend l’auditeur et laisse planer le chant qui néanmoins sonne un rien terne, à la limite du manque de coffre.
En fait ce manque de puissance vocale pousse un peu à la lassitude, rien de vraiment désagréable mais une sensation de trop peu, surtout lorsque toute la compo tourne en boucle comme sur un titre éponyme qui fout le vertige à force d’effets et de phrases répétées (Nous rappelons que l’utilisation de psychotropes n’est pas encouragée par la rédaction).
“They Appear To Be Alive” joue sur un thème plus léger et hypnotique plus par les sonorités que par la répétition. On retrouve l’esprit du Post-Rock et ce n’est pas un tort. Cependant, une piste de 1’23 minutes c’est un peu léger pour se satisfaire.
“Sandwalker” possède un rythme Funeral Doom qui prends lentement mais sûrement le virage du métronome pour s’accélérer toujours dans cet esprit minimaliste constant. Puis gentiment le rythme redescend puis remonte. J’ai une pensée pour certaines composition de Mother Engine. De fait Domkraft peut aussi séduire les amateurs de riffs psychédéliques obstinés et lourds.
L’album décolle un peu sur “Octopus” et curieusement on se met à en attendre un peu plus du batteur (Effet lié au titre?) et la frappe se fait plus fournie et l’esprit global du titre est un rien plus léger (J’ai bien dit un rien) avec un rythme Mid-Tempo agréable à l’oreille.
La bouffée d’oxygène arrive enfin sur “Dead Eye, Red Sky”, il était temps car il s’agit du dernier morceau de l’album. Sur un rythme plus rapide, les riffs de guitare prennent en consistance et enfin on sent que les doigts de Martin Widholm commencent à s’échauffer, la basse tient toujours sa place de monolithe mais cela sert d’autant mieux le jeu du guitariste et du batteur, ce dernier lâchant un peu plus les chevaux sans nous emporter vers des monts de grâce absolue. Le chant semble également se libérer en particulier sur l’outro plus mélodique avec l’abandon du cri, cette conclusion pour Flood finissant comme à bout de souffle.
Tout au long de l’album on trouve des inflences Stoner qui se glissent dans les compositions. L’utilisation du Fuzz et de la Wawa rendent l’album doucement polymorphe et lui confèrent une certaine richesse. Flood est un album qui demande de l’effort pour rentrer dedans. Il ne révèle pas tout son intérêt à la première écoute, mais au fil des auditions on commence à apprécier sa moelle. Répétition pour répétition, c’est un album à mettre en abyme avec lui même et il y a fort à parier qu’il s’agit d’un vaisseau de transport en Live.

Il y a Pink Floyd et il y a “The Wall” de Pink Floyd ! D’un côté une légende du rock psychédélique (qui a marqué le stoner quoi que certain de mes proches s’autorisent à penser) et de l’autre un concept album issu du cerveau tourmenté de Roger Waters, jadis l’âme de la formation britannique. Il y a à ma gauche des skeuds pour hippies à vestes à franges et à ma droite une démarche résolument nihiliste orchestrée pour être livrée sous la forme d’une véritable performance live genre, genre opéra déglingué, de sa genèse à son apocalypse. Il y a le goret qui vole au-dessus de Battersea Station et il y a l’œuvre cinématographique d’Alan Parker qui a sublimé « The Wall » dont la musique est à jamais associée aux images d’un film qui a fait date. Il y a aussi moi-même qui découvre ce joyau du rock alors que je commence à voir mon faciès se consteller de points noirs et blancs des plus disgracieux. Il y a ce petit suisse qui commence à avoir des émanations malodorantes qui s’échappent d’aisselles se couvrant d’un duvet de poils et qui use jusqu’à la corde la cassette sur laquelle la sœur d’un de mes potes a enregistré ce chef d’œuvre. Il y a ma pomme qui grandit avec cette masterpiece qu’il a acheté dans de multiples déclinaisons et sous toutes ses formes ou presque. Joie fût mienne quand ce double album sortit sur ce nouveau format qu’était alors le CD, ravissement fut mien lorsque des brigands sortirent des captations live que le groupe interpréta alors que je n’étais encore qu’un jeune padawan, mais déception fut aussi mienne lorsque certains audacieux firent leurs les titres de ce mythe. Rage fut mienne quand des artistes de renom (#balancescorpions) se cassèrent les chagnottes en dénaturant, saccageant, voire dégradant de manière outrancière ces joyaux appartenant à notre héritage commun de rocker !
Échaudé par les moult tentatives de réinterprétation de ces ogives, je me suis attaqué à cette énième réinterprétation de ma madeleine qui proute ne sachant si j’allais tenir le choc ou si cette production rejoindrait mes étagères sans même effectuer un deuxième tour sur ma platine avant de se parer de poussière pour l’éternité. Le résultat est bandant, brillant, époustouflant et le génie de l’écriture de cette œuvre à charge conjugué à celui des formations s’étant attelées à réactualiser ces bandes vintage en font une pièce que tout esthète du rock se doit de détenir dans sa discothèque ; il n’y a pas photo, il n’y a pas d’excuse et il y aura sanctions ! « The Wall » est une œuvre majeure du siècle passé et les zicos invités à en donner leur relecture – parfois peu aventureuse en ce qui concerne l’éloignement par rapport à l’original je le concède – font mouche à tous les coups. Comme diraient des Germains : « No Fillers – Just Killers ». Parmi les tueurs il y a du beau monde : The Melvins, Sasquatch, Greenleaf, ASG, Mos Generator, Mars Red Sky (cocoricoooooo), Solace ou le mythique Scott Reeder (et j’en passe). Vous en voulez plus ?
Allez poser vos fabriques à cérumen sur la chavirante version de « Vera » que nous livre Ruby The Hatchet avec une touche féminine qui sied à merveille à ce titre qui transpire le mal de vivre par tous les pores et prolongez la sentence avec « Nobody Home » par Mark Lanegan tout seul avec une ligne acoustique laissant tout le champ à son timbre dépressif : une déclinaison sur laquelle Nick Cave n’aurait pas craché. Allez vous plonger dans l’envoûtante relecture que Summoner fait de l’hymne « Hey You » en faisant sienne la suite d’accords plaqués jadis avec maestria par les Anglais pour la délurer à grands renforts de rythmique bien stoner avec des saturations bienvenues. Faites vous du bien avec « When the Tigers Broke Free », titre essentiel de cet opéra rock relégué sur l’album The Final Cut, mais présent sur cette plaque par l’entremise de Year Of The Cobra qui lui ajoute vociférations et en prime une ligne de basse tueuse en première ligne. Prenez-vous en à vous-même avec « Empty Spaces » transposé par Domkraft qui incarne merveilleusement bien le propos de ce titre en lui donnant les atours psychotiques qu’il mérite. Rejoignez la frénésie avec « Run Like Hell » déployé de manière véloce, mais pas dénaturé pour autant, par Pallbearer.
Bordel ! Courrez chez votre disquaire procéder à l’acquisition de cette réussite qui aligne la fine fleur du stoner pour l’allier à la créativité du génie torturé et vindicatif de Roger Waters qui commit encore le prolongement de « The Wall » avec « The Final Cut » (vous savez l’album où nous retrouvons des titres de ce chef d’œuvre qui figurent au générique d’un film pour lequel Alan Parker n’a pas reçu une Palme d’Or pourtant méritée) avant de tourner le dos à Pink Floyd, mais pas à « The Wall » qu’il trimbale encore par-delà le vaste monde histoire d’alimenter son plan retraite. Pendant que vous y êtes écoutez aussi l’original : il est très bon et matez le film qui retranscrit avec brio le désespoir d’une génération entière de Britanniques, repensez à sa réinterprétation avec des guests (dont certains approximatifs dans leur approche de morceaux légendaires ; que faisait la police du rock ?) à Berlin lorsqu’il incarna la chute du mur séparant deux mondes et des milliers de familles ; considérez ensuite les murs en construction en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient… bref découvrez, écoutez, redécouvrez et réécoutez cette chose auréolée qui le vaut bien !

“Olaf, t’as mis les fusils dans le Pick-up avec les Bières?
– Ouais, let’s Go!”
Ce sont les dernières paroles dont je me souvienne, je me revois mettre la clé USB dans la prise et démarrer le camion, c’est tout. Nous devions passer le weekend à la chasse et on s’est réveillé au bout de la rue encastrés dans un réverbère… Pour essayer de savoir ce qui est arrivé, repassons nous ces premiers instants. On remonte donc dans le Pick-up avec l’ami Olaf, je branche la clé et là, l’autoradio affiche Greenleaf – Hear The River. Mais c’est bien sur! le 7e album des Suédois nous a fait disjoncter! Une prod Napalm enregistrée par Karl Daniel Lidén ex-Dozer, ex…Greenleaf… Il n’en fallait pas plus!
Il ne faut pas longtemps pour que la profondeur de son et le mix mêlant lourdeur instrumentale à mélodie du chant de Arvid Hällagård nous propulse sur la route à plus de 150km/h. “Let It out!” est une entrée en matière qui porte merveilleusement son nom, solo aux riffs sabbathesques, profondeur amplifiée par une reverb constante ont le chic pour nous projeter dans l’album à toute blinde. On ne change pas fondamentalement de registre vis à vis des deux dernières productions mais on retrouve des pistes avec quelques tours bien malins. J’en appelle à “Sweet Is The Sound” au refrain en Negro Spiritual, surprise rafraîchissante sur une piste faite de Stoner. “Good Ol’ Goat” nous envoie un coup de pied au cul Rythm’n’Blues des bords du bayou, résurrection d’un blues organique dans un emballage maîtrisé et pro. Ce dernier morceau est d’ailleurs un agréable changement d’ambiance sur l’enregistrement des voix qui deviennent plus granuleuses pour un chant en chœur et une rythmique entêtants . Enfin on passe à deux doigts d’une rythmique Rockabilly épileptique sur “High Fever”. Ces compléments épicés sur un album qui aurait pu être attendu en rehausse la qualité.
On comprend bien qu’après un changement régulier de Line-up, Greenleaf s’engage dans un voie qu’il a lui même formé sur la base de ses influences et anciens participants. “A Point Of Secret” navigue entre la patte d’un Clutch et l’esprit fantôme de Truckfighters mais reste cependant du Greenleaf pur jus, alternance de pains dans la gueule et d’émotions bien plus douces. Cette dichotomie c’est d’ailleurs sans doute ce qui qualifie le mieux la formation actuelle du groupe avec en prime les passages de chant tout en légèreté mélodieuse qui impriment une identité forte à la formation. Dans le même registre “The Rumble and The Weight” et “We are The Pawns” sont dans la droite lignée de ce qui avait déjà été fait auparavant.
En définitive, ce Hear The Rivers ne fera peut être pas l’album de l’année compte tenu des sorties qui ont pu se distinguer depuis janvier, cependant il me conforte dans l’idée que désormais il faut attendre Greenleaf dans un créneau bien marqué. La qualité d’exécution autant que la maîtrise de la voie empruntée font de nos Suédois un groupe qui restera parmi les classiques du genre. Petit regret, le peu de renouveau dans l’artwork du disque qui ne le distingue pas vraiment du précédent. Finalement il s’agit peut être d’un choix artistique total que cette continuité, la volonté d’imposer son style tant sur le contenant que sur le contenu.

Après s’être fait remarquer en 2017 avec leur première sortie (un album live c’est assez rare), le groupe suédois sort son premier album studio simplement titré Hazemaze.
Officiant dans un style stoner/doom assez propre, la musique du groupe peut faire penser à Saint Vitus sur quelques aspects. Mais la comparaison s’arrête là.
On a souvent évoqué le problème de certains groupes à sortir du lot en particulier avec cette mode du revival seventies. Certains y arrivent avec brio, d’autres non. Hazemaze est à mi-chemin entre les deux. Pas assez lourd pour porter haut l’étiquette doom le groupe sort ici un album trop académique. Des recettes cent fois appliquées le sont ici sérieusement, mais trop sérieusement justement. Il manque une touche personnelle, il manque ce petit quelque chose qui pourrait faire la différence. Hazemaze est, j’en reviens à ce terme, trop propre. C’est bien fait mais ça sonne un peu creux. Les plans de basse par exemple sont cool certes mais cela manque d’audace. La batterie accompagne et c’est tout. Pas de véritable envolée, de mise en avant, le batteur fait le job sans plus. La guitare quant à elle ne dénote pas particulièrement. Peu de solo, manque d’autorité sur les chansons, le guitariste se permet quelques petites choses mais cela reste sur du sans risque, du terrain déjà exploré mille fois. L’homogénéité est parfois un atout, ici cela dessert l’ensemble.
Ne me faites pas dire que c’est mauvais, au contraire, c’est agréable à écouter. Mais si vous cherchez de l’originalité, un truc qui vous prends aux tripes à la première écoute, passez votre chemin.
Difficile de dire si Hazemaze a un fort potentiel et si ce groupe est à surveiller de près. J’en doute.
Point vinyle :
Le vinyle est pressé en vinyles noir ainsi qu’en marbrés rouge/blanc/noir. La version black est pressée à 100 exemplaire tandis que la marble à 200 exemplaires. Cette dernière voit ses 111 premiers exemplaires numérotés.

Formé en 2004 en Suède, Deville sort son sixième album studio intitulé Pigs with Gods chez Fuzzorama Records (Truckfighters, Valley of The Sun).
Il faut le dire, la qualité sonore de la production est au rendez-vous : son gras, lourd et bien dosé. Vous avez notamment un équilibre basse batterie clairement mis en avant et des guitares qui enveloppent le squelette des morceaux. L’utilisation des effets reste simple et efficace afin de laisser beaucoup plus la place à la grosse distorsion, plus proche des productions Métal que du Stoner. « Gold Sealed Tomb » résume bien cette tendance à un Rock plus Sludge qu’avant. Côté chant, il faut l’avouer, la prestation vocale rocailleuse et bien grasse d’Andreas Bengtsson est légèrement noyée dans le mix, mais ça fonctionne très bien.
Si on entre un peu plus dans l’album, on constate rapidement que les Suèdois se sont concentrés avec beaucoup de brio sur la composition et l’arrangement de nombreux titres. « Cut it Loose », qui par ailleurs rend un charmant hommage au chef d’œuvre cinématographique d’Ingmar Bergman et son Septième Sceau par le biais d’un clip vidéo, le prouve avec un dosage instrumental riche et varié. C’est en effet, le métissage mélodique et gras qui sont à l’honneur avec par exemple l’excellent « Lightbringer » : lourd, sensible, lent et progressif à souhait. Les refrains planants et entêtants comme sur la très bonne « Hell in The Water » rappellent entre autres des groupes comme Alice In Chains ou Soundgarden.
Et on a même le droit à des chansons très progressives (« Acid Meadows » ou encore la charmante conclusion « In Reverse »), voire instrumentales (« Dead Goon »). C’est pour ainsi dire, un album riche en ambiances qui nous fait très vite oublier les quelques essoufflements d’originalité en début et milieu d’album comme avec les deux premiers titres « Lost Grounds » et « Pigs with Gods » : largement en dessous et plus académiques que le reste des compositions.
Pigs with Gods est donc à la fois un album qui surprend grâce à un son terrible, à des titres très efficaces et originaux, mais qui souffre aussi de quelques longueurs. Il n’empêche que Deville commence à trouver son style en s’éloignant d’un Stoner traditionnel pour offrir un univers riche en nuances Grunge et Rock Alternatif. On ne peut qu’espérer de bonnes choses pour la suite.
|
|