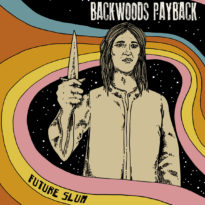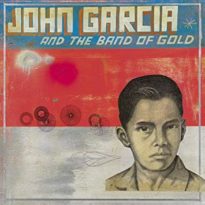|
|

Le moins qu’on puisse dire c’est que le Stoner grec a le vent en poupe ces dernières années. Montée en puissance de 1000mods, émergence de Naxatras, retour sur scène de Planet of Zeus, présence fantomatique de Nightstalker…. Les sujets d’illustration ne manquent pas y compris avec le reportage “Greek Scene Révolution” à sortir en mars. Alors tout ça pourquoi ? peut-être pour faire notre mea-culpa quant au fait que nous avons failli ne rien dire sur la sortie de Coming of Age seconde plaque du quatuor grec Godsleep en novembre dernier. Qu’à cela ne tienne on va rattraper ça fissa.
Intro sur un air de 1000 Mods pour “Ex-nowhere Man” Godsleep ouvre sous de très bons auspices. La voix d’Amie Makris offre un terreau fertile à la sensualité autant qu’au déchaînement grunge, le tout supporté par un son saturé de Fuzz de la gratte de John Tsoumas. Ce dernier a le talent de ne pas se perdre sur un seul registre et pousse des réglages à la Midnight Ghost Train sans pour autant perdre son identité fuzzée, rendant l’enchaînement jouissif sur “Celestial”
A ce point de l’album il faut admettre cependant une légère lassitude du point de vue vocal. Les modulations sont presque toujours les mêmes et fissurent un peu l’identité de chaque morceau pour les fondre dans un creuset commun. Je n’irai pas dire que ce n’est pas bon, c’est juste qu’au cours de l’écoute on perd un peu de l’entrain de l’introduction. Ce constat passé un regain d’originalité quasi Indie Rock se fait jour sur “Karma is a Kid” où les modulations à la limite de la rupture donnent un nouveau tour à l’album. La guitare et la basse s’en donnent à cœur joie pour une montée en puissance sur un pont qui gifle l’auditeur avec juste ce qu’il faut de ménagement.
Décidément l’influence 1000mods est présente presque d’un bout à l’autre, peut-être une impression due à George Leodis producteur du présent album et des sus cités 1000mods ? Le riff de basse de la piste finale “Ded Space” roule comme un camion sur une ligne droite sans fin et vient nous rappeler que l’instrument a été un gros moteur tout du long du trajet au travers de ces contrées grecques.
Coming of Age est une suite plutôt positive pour Godsleep et laisse présager de bons moments enivrants en Live. Un album assez construit que pour être bon même si pari est pris qu’il ne s’inscrira pas dans les mémoires outre mesure. Finalement, une galette qu’il va falloir vivre et faire vibrer une bière à la main et la sueur au front.
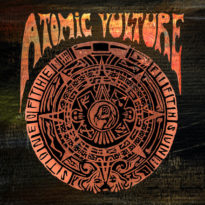
Il nous arrive parfois, au hasard de nos pérégrinations nocturnes, d’entrer dans le sous-sol d’un bar et de tomber sur un groupe inconnu. Souvent la première partie d’un nom populaire, ou bien une équipe locale. Nous pouvons de la même façon apprécier ce groupe au point de s’agiter dans la fosse et de visiter le merch en fin de show. Puis le lendemain, l’alcool et la joie de retrouver les copains ne pesant plus dans la balance, il arrive que l’écoute à tête reposée de la récente acquisition ne nous séduise pas davantage que la gueule de bois qui nous accompagne depuis le levé. Et bien avec Atomic Vulture, ce n’est pas du tout le cas.
Autant le trio originaire de Bruges sait casser des bouches sur scène, autant il sait insuffler une énergie similaire dans ses albums. Et notamment le premier intitulé Into Orbit et paru en octobre 2014. On y découvre un stoner instrumental tantôt posé, nous invitant au voyage et à l’introspection avec des pistes comme « Winter Blues », tantôt une machine chargée d’explosifs nous balançant un stoner percutant aux riffs très accrocheurs. « Tequila », « Spider », autant d’intitulés évocateurs pour ces deux morceaux qui déménagent dès les premières secondes. Et que dire de « Mos Eisley Spaceport » ; la piste finale et sans doute maîtresse de ce premier album. Une atmosphère de puissance sinistre se dégage de ce titre. Il s’articule autour de la basse grassouillette de Jelle et de la grosse caisse de Jens pour installer une rythmique propice à déployer tout un arsenal de riffs et de sombre mélodies. Ce que s’empressera de faire le guitariste Pascal David.
Toutefois, là où la monotonie des riffs de Karma To Burn peut en lasser certains, la richesse de composition d’Atomic Vulture tient en éveil. Une certitude acquise lors de l’écoute du récent EP sorti il y a quelques mois et nommé Stone oh the Fifth Sun. Premier constat, la quatre cordes change de propriétaire et tombe désormais entre les mains non moins talentueuses de Kris Hoornaert. Deuxième surprise, la présence d’une voix sur « Rain ». Non qu’il s’agisse ici d’une double casquette artistique de la part d’un des membres du trio mais bien d’une participation extérieure ; celle d’Henk Vanhee, chanteur de Cowboys & Aliens.
Au-delà de ces changements, le groupe conserve sa substance. Bien qu’il semble évoluer davantage vers le space rock et le psyché plutôt que de s’enfermer dans les carcans confortables des riffs accrocheurs ; sauf peut-être pour « Earthquake » qui se rapproche des premiers amours dévastateurs du groupe. Et encore. « Water » de son côté évoque du Somali Yacht Club dans son écriture comme dans son style subtil, tandis que « Wind » concilie à merveille les hauteurs astrales du psyché avec des abysses sans fonds de lourdeur comme pourrait le faire REZN.
Encore une étape de transition donc pour le groupe, qui s’essaie à la nouveauté afin d’en saisir et de s’en approprier le meilleur. Nul doute qu’à l’issue de leurs tournées, lorsque les trois gaillards retourneront bûcher en studio, il en résultera un album liant toutes les qualités passées avec les apprentissages acquis sur le chemin. En attendant, ne manquez pas de découvrir ce qu’Atomic Vulture qualifient eux-mêmes, et à juste titre, d’« Instrumental psychedelic kick-ass stoner band ».

Parler de « classic rock » pour décrire le nouvel opus de Rival Sons semble la meilleure manière d’aborder cette toute récente livraison. Quand bien même il s’agirait là de la moins proche de notre ligne esthétique. Néanmoins les gonzes font référence pour nombre d’entre nous et il serait dommage de passer à côté de ce « Feral Roots » emprunt de classe et de classicisme.
Et de partir sur cette guitare si singulière, cette amoureuse de l’octaver à la limite du synthétique, posant jalons et riffs comme autant de marqueurs nécessaires. Il faut l’avouer les premiers morceaux ne soulèvent pas un excessif enthousiasme tant on navigue en territoire connu et labouré par le combo. Classique donc, exécuté avec classe et une technique au-delà de la masse certes mais sans surprises.
Il faut attendre « Look away » et son intro acoustique pour sentir un propos plus mature, une envie d’aller plus loin dans la recherche de l’essence même de Rival Sons. Et la maîtrise de ces instants mélancoliques accentue les breaks plus sauvages, amusante ironie que de clamer son envie de regarder ailleurs tout en puisant dans l’americana la plus intime. Mais d’une évidence sans faille. C’est nos racines qui donnent une assise pour mieux avancer et le combo d’insérer le titre éponyme « Feral Roots » juste après. Logique.
Alors oui, s’il ne soulève pas les envies les plus sauvages, l’album des américains interpelle par son intelligence de mise en place, ses propos comme autant de frappes de caisse claire juste, à la précision cristalline. Et il n’est jamais aussi intéressant que quand il se fait mélancolique. On traverse donc certaines compos de l’album avec indifférence, des titres pas mauvais mais mille fois entendus. Un « Stood by me » par exemple refait tomber la pression et creuse cette bipolarité d’un album tantôt lumineux tantôt banal. Alors attention, nous sommes en présence de musiciens extrêmement talentueux, avec, peut-être la plus belle voix du rock actuellement mais c’est justement parce que le niveau est élevé que notre exigence se veut majeure.
Rival Sons souffle le chaud et le froid avec sa nouvelle livraison ce qui empêchera sûrement l’album de prétendre à une belle place dans leur discographie. Il serait néanmoins dommage de passer à côté de l’exercice tant le groupe excelle sur certains points et devient immense quand il est soucieux et angoissé. « Roots » assurément, mais tout de même loin d’être « Feral ». On a connu les mecs plus énervés mais la maturité, une fois assimilée, pourra être un sacré terreau pour les albums à venir.
« Feral Roots » s’entrevoit plus comme un opus de transition et on sera toujours curieux de poser une oreille sur les compositions de ce groupe à la classe indéniable.
 Le Maryland, son fameux Doom Fest, sa ville la plus peuplée : Baltimore et sa criminalité impressionnante, sa tradition artistique avec des formations de lourdingues : The Obsessed et ses démêlées avec les douanes européennes ou Earthride, ses stars du stoner qui se paient le luxe de se produire en Mainstage au Hellfest : Clutch et maintenant son trio de gros bourrins : Yatra. Le Maryland, son fameux Doom Fest, sa ville la plus peuplée : Baltimore et sa criminalité impressionnante, sa tradition artistique avec des formations de lourdingues : The Obsessed et ses démêlées avec les douanes européennes ou Earthride, ses stars du stoner qui se paient le luxe de se produire en Mainstage au Hellfest : Clutch et maintenant son trio de gros bourrins : Yatra.
N’allez pas chercher dans ce « Death Ritual » la sagesse du pèlerinage hindouiste dont ces Étasuniens ont tiré leur blaze ni même une référence à l’album presqu’homonyme de Six Feet Under qui pourrait passer pour un recueil de comptines enfantines à côté du déchaînement doom pratiqué sur ces huit pistes où règne une noirceur d’une ténacité incroyable.
Une fois que l’auditeur s’est plongé dans le sinistre bordel fomenté par la formation mixte, il lui est impossible de s’en désolidariser : le magma sonore adhère carrément et devient, au fil du temps, addictif. Lentes, lugubres et pachydermiques, les ambiances déployées sur ce premier effort sont le fruit d’itérations étalées dans le temps et mises en boîte en plein mois d’août 2018 dans des conditions allant droit à l’essentiel et faisant fi de bricolages sonores ou de délires de producteurs. L’essentiel consistant, pour ces Étasuniens, en un mur de guitares saturées sans une once de finesse, une rythmique pugnace dans le bas de l’échelle des BPM et des hurlements pathologiques. Si ça ne vous parle pas : il y a des nouveautés intéressantes au rayon hippie en ce début d’année ; vous avez de quoi vous faire plaisir et laisser les moins finaux s’astiquer en considérant les lambeaux de leurs cerveaux qui se répandent sur le sol sous les assauts dégénérés de Yatra.
Bien qu’étalant certaines plages au-delà des 5 minutes réglementaires, le trio du Maryland renoue avec une certaine urgence du genre punk qui sied si bien à des formations comme Eyehategod dont les fans feraient bien d’écouter le brulot « Sacred Flower » qui est un bel exemple du bâtard engendré par le télescopage de la mouvance stoner catégorie poids-lourds et du crust-punk déglingué orienté metal.
Quand la triplette exécute ses longues compos, il parvient à insérer un riff de base dans la boîte crânienne de son auditoire ; « Smoke is Rising » incarne ce type d’exercice avec quasi sept minutes burnées au compteur qui s’achèvent sans artifice de manière abrupte en laissant le fameux auditoire déboussolé. Yatra a habilement placé « Mighty Arrows » en avant-dernière position de ce premier effort. Ce titre, un tantinet pugnace (pour le genre pratiqué), nous percute comme un redoutable uppercut balancé au ralenti à grands renforts de hurlements de forcenés ; on ramasse ses dents après plus de cinq minutes bestiales durant lesquelles on croisera même du solo à la gratte (c’est vous dire l’ouverture d’esprit) : diabolique et jubilatoire…à l’image de cette production !

L’office de tourisme de Louisiane vient d’appeler, ils souhaitent récupérer ce noir dossier échappé de leurs archives secrètes. À l’intérieur, une fois retirés les cadavres d’insectes écrasés entre les pages, on y découvre une œuvre macabre. Un projet initié par le guitariste et chanteur Joey Carbo, John Robinson aux basses ainsi qu’Aaron Polk à la batterie. On y trouve également une date : le 18 janvier 2019, jour de la sortie de cet album arborant tout l’apanage du doom/sludge versé dans un post metal à nuance punk.
Il faut avouer que l’estampille Sudgelord Record donnait déjà un bel indice. Et durant l’intro de deux minutes qu’incarne « Corpse Corps », où l’on vogue entre chant liturgique et psychédélisme post apocalyptique, le doute reste encore permis. Toutefois, le passage au second titre « Find a Meal Find a Bed Find a God » éradique tout vestige de malentendu. Le lourd sludge du trio survient au moment où on l’attend le plus. Lancinant, puissant et gras à souhait. Puis presque deux minutes plus tard, la voix caverneuse du frontman vient couvrir le marécage d’une chape lugubre et hypnotique.
Qu’il s’agisse du chant perturbé ou des effets sonores dissonants, il émane de Slake un malaise permanent ; une volonté de sortir des carcans confortables de l’écoute passive, de révéler la noirceur des hommes et de la leur projeter en plein visage. Ce phénomène s’intensifie grâce à des pistes comme « Veni Vidi Fucki » ou « Our Lady of perpetually Shitfaced » qui, paradoxalement, offrent moins de contenu musical que leurs voisines. Durant l’écoute de cette dernière, on assiste au discours d’un homme à l’éloquence abîmée. Par moments, il s’avère même difficile de le comprendre tant il semble englué dans sa propre langueur. Puis en toile de fond, des riffs sont parfois lâchés comme des boules de démolition percutant les attentes musicales que l’on pourrait conserver. Et comme si de rien n’était, « Racist Kevin » survient et balaye notre frustration pour 1 minute 18 d’un noise punk tout ce qui existe de plus efficace.
Avec Slake, Woorms évolue sans arrêt entre ces deux tableaux, constellant ses morceaux de sample vocaux comme un vêtement de travail marqué de multiples traces de boue. Ou de manière plus métaphysique, comme l’âme d’un homme tachée par ses ténèbres intérieures ; ses remords, ses contradictions perpétuelles, ses démons en somme. Au-delà de cette analyse, la composition y est maîtrisée et plaira aux amateurs d’Eyehategod, des Melvins ou à tous les friands de graisseux sludge perturbé.

Aver est un quartet Space Rock de Sydney. J’étais donc obligé de me pencher sur ce groupe aux origines curieusement parlantes pour moi (Non, je ne suis pas australien, je ne vois pas le rapport). Sort donc ce mois-ci Orbis Majora chez Ripple Music, seconde production de Aver qui n’avait rien sorti depuis 2015.
La première piste “Feeding The Sun” déroule un Stoner orientalisant qui capitalise sur d’inhabituelles sonorités de violon que l’on retrouvera par la suite. Dans un univers en orbite où planent les riffs les plus Krautrock, les plans plus agressifs sont comme les impacts dus à une pluie d’astéroïdes.
Ce que Aver réussi très bien c’est le mélange de styles, la couche constante de Psychédélisme sauce Space Rock est rehaussé ponctuellement des touches Grunges de la voix de Burdt qui s’emballe et monte en puissance. Le tout est servi sur une soucoupe Stoner qui voyage à mille à l’heure quand c’est nécessaire et démontre aussi par-là que les quatre comparses savent y faire ensemble sans laisser un seul instrument sur le bord de la route et là il faut jeter une oreille en particulier sur “Desorder”
Les amateurs de Mother Engine devraient trouver sujet à contemplation en particulier sur “The Last Goat Out of Pompeï” où tant la rythmique que les sonorités en sont les jumelles. Toms lents et profonds sur guitare spatiale et basse hypnotique que l’on retrouvera sur la conclusion du morceau suivant.
“Unanswered Prayers” émerge d’une brume interstellaire et se propulse au groove. Un voyage qui berce l’auditeur pour l’emmener danser plus loin en toute confiance. Pourtant ce voyage de 13 minutes ne se fait pas réellement sans turbulence. Les thèmes s’enchaînent dans ce titre avec un léger sentiment d’incohérence. Un peu comme si l’on assistait à la concaténation de deux morceaux si ce n’est trois. Dommage, l’exercice aurait pu se contenter de voir la piste splittée en deux et ainsi chasser toute gêne. Parfois une escale est nécessaire même pour les voyages intersidéraux. Je ne jetterai pas le bébé avec l’eau du bain, quelques passages avec une basse et une batterie en contrepoint très jazzy font revenir sur le morceau avec plaisir et cet esprit Jazz va s’affirmer sur l’intro de “Hemp Fandango”.
Curieuse conclusion que ce “Hemp Fandango” d’ailleurs. C’est le plus dansant des titres, un morceau qui ressemble à une sorte d’astéroïde esseulé au milieu du reste de l’album. Il est peuplé de créatures dansantes et bienveillantes (La bienveillance, c’est sans doute ce qui qualifie tout l’album d’ailleurs). Tantôt ça joue groove, tantôt ça joue aride, tantôt ça joue comme une Jam Session pleine de vie. Pourtant on en vient sur le dernier tiers de la piste au même constat que pour le précédent titre. Celui-ci aurait peut-être gagné à se voir scindé en deux morceaux pour plus d’équilibre avec sa conclusion qui donne le sentiment d’être plus écrite que le reste.
Ripple Music ouvre cette année 2019 avec un morceau d’originalité qui devrait en ravir plus d’un et place ainsi déjà la barre haute en terme de qualité. De plus il faudra souligner que l’album pèse près de 50 minutes et met donc à portée de l’auditeur une durée que beaucoup peinent à atteindre et à maintenir dans la qualité. Donc un album qu’il est bon de découvrir et de réécouter surtout sur sa seconde moitié, malgré quelques légers couacs qui ne gâtent en rien la qualité intrinsèque de cette galette.
En écoute intégrale en cliquant juste là.

Dans un genre musical il est vrai bien garni (proche de la saturation ?) les discrets finlandais de Boar tracent leur petit bonhomme de chemin, et proposent avec ce délicat Poseidon leur 3ème LP en moins de dix ans d’existence. Avec encore le soutien du label français Lost Pilgrims Records, comme pour leur prédécesseur Veneficae, le groupe scandinave délivre une nouvelle torgnole sludge-doom énervée, massive et ramassée (6 titres, moins de 45 min).
Comme il va de soit avec les galettes de cet acabit, les premières écoutes sont laborieuses, tant il est difficile de se frayer un chemin auditif dans ce disque poisseux, où l’hyperviolence du chant se conjugue à la densité du mur de grattes. Armés d’une belle prod, nos gaillards n’ont aucune intention de verser dans l’easy-listening. Pour autant, la musique de Boar n’est pas aussi monolithique que son subtil sobriquet (« sanglier ») ne pourrait le laisser présumer : les rythmiques sont variées, le travail du riff est efficace (« Dark Skies », « Shahar’s Son »…) et aucune structure de morceau ne se ressemble. Piocher occasionnellement dans le mid-tempo mélodique ne leur fait pas peur (le très intéressant « 12 »), voire dans le hardcore metal (voir le très Pro-Pain « Featherless ») ou encore le doom (« Dark Skies »).
Largement basée sur une belle dualité de guitares (et un son de basse saturé emblématique du genre), le son du groupe s’appuie aussi sur un growl virulent, ce qui n’est pas la seule caractéristique vocale de Boar : le duo Henell / Saarela donne aussi occasionnellement de la voix, jouant parfaitement de la complémentarité du binôme pour occuper le terrain sonore (voir le morceau-titre « Poseidon »).
En guise de morceau-synthèse, le virulent « Totally Out of This World » qui clôture la galette est probablement aussi son titre le plus intéressant, proposant une montée en puissance redoutable d’efficacité, en s’appuyant sur un véritable maelstrom de guitares et de beuglements entêtants. Impeccablement construit, l’album laisse donc l’auditeur exsangue, en attente d’une autre écoute.
Bref, sans prétention particulière, Boar propose avec ce Poseidon un bel album sludge, riche en nuances, mais jamais opportuniste. Le groupe mérite qu’on se penche dessus, ce qui pourrait l’inciter à venir défendre ces titres plus régulièrement en direction de nos salles de concert…
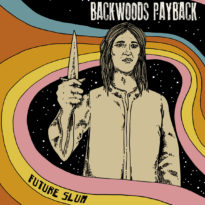
Le groupe de Mike Cummings est parvenu à mettre de son côté tous les atouts pour maintenir son statut de groupe méconnu, en particulier de ce côté-ci de l’Atlantique : implantés près de Philadelphie (avec un batteur à quelques centaines de km pour faciliter les choses), le groupe enquille les albums autoproduits (tous sold out en physique), sans distribution solide, et ne joue quasiment que dans ses contrées. Son passage remarquable et remarqué chez Small Stone (avec l’album Momantha, chroniqué dans nos pages) lui a permis de sortir temporairement la tête du nuage de fumée, mais c’était pour mieux s’y réfugier à nouveau dès l’album suivant et y rester encore aujourd’hui. Un fait notable toutefois : depuis son album précédent Fire Not Reason (2016) le trio compte dans ses rangs rien moins qu’Erik Larson à la batterie, le très inspiré guitariste (!) des légendaires Alabama Thunderpussy (aussi auteur d’une poignée d’albums solo remarquables dont certains chroniqués dans nos pages). Le constat est sans appel : le bonhomme est un aussi puissant batteur que six-cordiste ! C’est donc avec une envie légèrement teintée d’anxiété qu’on récupère cette galette pour voir ce qu’elle propose.
Dire qu’on est pris à froid est en dessous de la vérité : Cummings attaque direct à la carotide dès la première seconde de « Pirate Smile », un glaviot heavy bien fiévreux qui attaque direct sur le couplet/riff , sans intro. On sent que ça va pas tortiller des fesses, cette affaire… Enfin, comme rien n’a jamais été complètement simple avec le trio US, la suite est plus nuancée, et plus riche surtout. Pour tout dire, il suffit d’attendre le titre suivant pour en être convaincu, avec ce « Lines » tout en mid tempo dont le couplet rappellera les années 90 et l’émergence grunge… pour mieux se transfigurer à la moitié du titre en morceau heavy franc du collier, pour une séquence faisant la part belle à une section rythmique impeccablement en place.
Plus loin, le groupe offre sur un plateau le somptueux « Whatever » à Mlny Parsonz, la puissante vocaliste de Royal Thunder, qui partage le chant de ce superbe mid-tempo avec Cummings. Loin du featuring-prétexte, ce titre prend une toute autre dimension à travers ses plans en harmonie ou alternés, en particulier sur le refrain qui emmène le morceau vers un final entêtant.
La suite est aussi riche et enthousiasmante, les compos s’enchaînant, toutes inspirées et puissantes. On pense à ce « Threes » au refrain classique mais imparable, ce « Generals » qui convoque les vieux standards du metal hardcore, ce « Cinderella » tout en lascivité, léger et grave à la fois… Et que dire de ce superbe « Alone », titre doom aux relents grunge dont l’intro/couplet poisseuse, trésor de simplicité, installe une ambiance à couper au couteau. Seul regret : ce « Lucky » qui s’emballe à un moment en un morceau épique, et qui aurait pu se finir en apothéose plutôt que sur cette section un peu foutraque à la fin. Sortie d’album un peu ratée. Mais c’est tellement anecdotique…
Attention toutefois : les premières écoutes peuvent apparaître un peu arides, notre oreille ayant été plutôt habitée ces dernières années à des genres musicaux et des sonorités plus éloignées probablement. Mais petit à petit la coquille se brise et la richesse des compos apparaît plus évidemment. Il faut donc, plus qu’à l’habitude peut-être, laisser sa chance au produit. Il devient ensuite plus difficile de s’en détacher…
Un très bon album, par un décidément très bon groupe, qui nous montre plus que toute autre chose qu’il se passe des choses remarquables hors des sentiers battus (gros labels, gros tourneurs, gros médias…).

Un souhait de roadtrip improvisé dans les 70’, un désir commun de planer et de transpirer sur des sons psychédéliques. Il n’en faudra pas plus aux quatre énergumènes de Fuzzy Grass pour se rassembler en 2015 et former ce groupe d’heavy blues bien nerveux. Après un bref enregistrement de pistes en novembre 2017 sobrement intitulé Recording Live, l’équipe toulouso-parisienne parvient à transformer l’essai avant cette fin d’année 2018 et sort son premier album : 1971. Un album qui, comme ses couleurs pastel et son titre le suggèrent, ouvre le vortex sur la sacrosainte époque des pantalons patte d’éph et des chemises à fleurs.
1971 donc, une année qui, si elle déplore le départ de patrons tels que Jim Morrison, Louis Armstrong ou encore Igor Stravinsky, reste pour la musique une période d’apogée. On est à peine deux ans après Woodstock, cette merveille de Led Zeppelin IV débute sa conquête du monde, bref, tout roule au pays du rock’r’roll.
Avec Fuzzy Grass, nous retournons dans l’insouciance de ces belles années. Là où groove lancinant et mélodies fuzzées se mêlent à une énergie fiévreuse et un chant haut en couleur. Le bal s’ouvre avec « Electric Ayahuasca », un morceau au nom de la reine mère des psychotropes et ne servant qu’à propulser l’auditeur dans l’univers psychédélique de « The Alone Boy Song ». De là, les soli ardents de Laura se succèdent pendant que les frappes de Clément pilonnent ses cymbales avec la force d’un John Bonham et la frénésie d’un Mitch Mitchell. Cerise sur le gâteau, la voix d’Audric haute et très juste ; qui comme le démontre « Healed by the fire » n’éprouve guère le besoin de se dissimuler derrière un mur d’effets pour toucher sa cible.
Dans l’ensemble, cet album croise à merveille les phrasés hypnotiques de Colour Haze ou de Naxatras, comme l’illustre « The Winter Haze », avec le heavy blues endiablé de Radio Moscow. « Shake your Mind », « The Upside Down » ou encore « The faceless man » et son groove dévastateur sauront vous convaincre davantage que ces quelques mots.
1971 c’est aussi le témoin d’un énorme potentiel sur scène. Et pour avoir déjà assisté au bazar l’an passé, je peux attester de la puissance libérée en live. Tout le matériel pour agiter et faire transpirer les foules se trouve inscrit sur ces sept pistes dont je ne saurai vous recommander d’avantage l’écoute. Que l’on soit fanatique des ondes 70’ ou aficionado de modernité plus fuzzée, on y trouve forcément son compte.
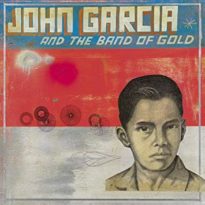
On avait quitté le sieur Garcia en 2017 avec « The Coyote Who Spoke In Tongues », album acoustique reprenant principalement les standards de Kyuss. Les fans inconditionnels de tout ce que touche le prince du desert rock avaient grandement apprécié mais pour d’autres, le manque de gros son faisait quelque peu défaut. Toujours est-il que John Garcia était attendu au tournant avec l’annonce de la sortie de cet album éponyme de John Garcia And The Band Of Gold. On ne fera pas durer le suspens plus longtemps pour les impatients : cet opus aurait pu naître sous la bannière Hermano, Unida ou autre, la plupart n’y auraient vu que du feu. Mais ce n’est finalement pas le plus important; John Garcia nous livre un superbe album, bien équilibré et surtout très prometteur pour les futurs lives. Garcia réalise ici ce qu’il sait faire de mieux et ce qu’il a toujours su faire: du Garcia. On n’en demandait pas plus.
Et pourtant, il y avait de quoi être sceptique au départ. Il suffit d’avoir déjà assisté à un concert de Vista Chino, Kyuss Lives, Unida, Hermano… pour prendre conscience que John Garcia aura toujours cette étiquette Kyuss placardée sur son front. Mais du haut de ses 48 ans, le chanteur démontre qu’il a plus d’un tour dans son sac. L’album commence fort avec « Space Vato », chanson instrumentale, très spatiale comme son nom l’indique. Une belle occasion pour Garcia de se faire désirer et surtout de présenter ses nouveaux acolytes.
John Garcia daigne enfin s’approcher du micro pour nous abreuver de son « Chicken Delight ». Du pur Garcia où l’Américain nous rappelle la puissance de sa voix. Les fans de Kyuss vont adorer. Les instruments font le boulot et de belle manière. La section rythmique assure le job sans en faire des caisses, laissant toute la place nécessaire à la guitare pour répondre aux vocalises du chanteur. Même constat élogieux avec « Kentucky II » et « My Everything » avec tout de même un bémol : on sent que les zicos auraient pu avoir un peu plus de place à certains moments. Un solo basse/batterie par-ci, une envolée du gratteux par-là… mais n’oublions pas que c’est bien le nom de John Garcia qui figure sur la pochette…
On change un peu de registre par la suite avec « Lillianna » qui nous renvoie plus vers l’époque Hermano. Plus de chœurs (toujours assurés par Garcia évidemment) et « Popcorn », qui reste simple mais bougrement efficace. Dans sa globalité, l’album est plutôt bien équilibré et laisse présager de très bonnes choses pour la tournée de John Garcia And The Band Of Gold.
La galette se termine avec « Softer Side », une ballade psyché où John Garcia prouve une nouvelle fois toute sa force et sa puissance vocale sur des rythmes lancinants, digne des meilleurs riffs de stoner rock.
Sans surprise, « John Garcia And The Band Of Gold » ne révolutionne pas le genre mais livre un très bon album, aussi bien musicalement que vocalement. Dès la première écoute, on sent que John Garcia a pris plaisir à enregistrer ces 11 titres et pour un mec de cette trempe et avec un tel passé, le match n’était pas gagné d’avance.

Red Stone Souls Quartet de Detroit ne fait pas office de petit nouveau de la scène Stoner puisque formé en 2012. Pourtant on ne pourra pas dire que ces gars-là ont profité de feux de la rampe en matière de promo. Leur Album Mother Sky est sorti en décembre 2017 dans un murmure et si l’on n’avait pas tendu l’oreille un petit peu, fort est à parier que nous aussi nous serions passés à côté de ce petit poucet qui a enfilé les bottes de sept lieues pour mieux venir nous botter le cul.
Avec son Stoner qui fleure bon le rock 70’s Red Stone Souls attaque fort sa dernière galette avec un “Nights Watchful Eye” qui navigue entre rythmique sabbathéenne et lourdeur rocailleuse d’un Sasquatch, on y retrouve même des riffs qui feraient penser à un “Moby Dick”” de Led Zep’ autant dire que l’on risque de ne pas bouder notre plaisir avec cette galette. Il faut s’arrêter sur “Trucker”. Ce morceau bien balancé au relents de Thin Lizzy ou même de Creedence Clearwater, envoie ce qu’il faut. Les enchaînements au poil et la monté qui précède l’outro démontrent une excellente maîtrise de la composition et du timing. L’album est résolument Rock, il intègre les codes des grands du genre et fait appel aux Deep purple et consorts tout en proposant une musique jeune et pleine de puissance.
Red Stone Souls pourrait se contenter de cela et user les gammes dans un genre unique mais dès “Before the Devil Knows You’re Dead” les notes sonnent Space Rock avant de virer dans les envolées Heavy Blues et des passages plus posés. Pas de genre unique pour cette galette, le morceau en est la parfaite démonstration faisant défiler 8 minutes d’un voyage au cœur des genres Stoner et Garage. On est pleinement nourri avec cette écoute qui remplit de contentement Alors même si Red Stone Souls ne réinvente pas le genre pour moi ce qui compte c’est l’âme. Et de l’âme il y en a à revendre, ça sent l’investissement et le jeu en connivence. Il y a même à parier qu’un live de ces quatre-là doit laisser vidé de toute énergie et pleinement satisfait.
Si je devais faire un reproche malgré tout à l’album Mother Sky, cela porterait sur les outros pas toujours bien ficelées et qui chutent abruptement un peu trop souvent. Mais au fond si ce reproche leur est fait c’est presque un lieu commun tant cet exercice semble difficile. L’attaque de “Murder Thrill” est un must de Heavy du début des années 70. La basse ronfle comme un gros diesel qui dégorge l’huile et l’attaque de chant surprend car on ne s’attendrait pas à quelque chose d’aussi mélodieux après une telle ouverture. Il surprend mais ce contrepied fait plaisir à entendre car une fois de plus la facilité est évitée. L’enchaînement instrumental du dernier tiers de la piste fait surgir de nouveau Black Sabbath et on se délecte de cette référence comme bien souvent lorsqu’elle se présente chez les pairs de Red Stone Souls.
Il n’y a au final pas grand-chose à reprocher à Red Stone Souls sur ce Mother Sky, un bon album bien ficelé, droit dans ses références et qui délivre là où il faut intensité et maîtrise. Je ne saurais donc que trop vous recommander de jeter une oreille sur cet album sous peine de passer à côté de près de 35 minutes de bonheur sans prise de tête, ça se passe par là:
https://redstonesouls.bandcamp.com/album/mother-sky-official-cd

Le quatuor étasunien n’en est pas à son coup d’essai avec « Awaken To Destroy » qui fait suite à une première démo sortie en 2014 et un premier vrai album (« The World Unseen » déjà sur sorti sur Ripple Music) ayant laissé mitigé mon camarade qui l’avait chroniqué alors. Lorsque Chuck m’avait donné leur première démo à Berlin quelques années plus tôt, la moitié des acteurs de cette plaque officiaient dans le mythe ressuscité Sixty Watt Shaman. Comme personne ne peut l’ignorer vu que les différents partis (en fait 1 contre 3) se sont abondamment épanchés sur les réseaux sociaux : Sixty Watt Shaman n’est pas prêt à refoutre la compresse en tant que groupe ; ses acteurs ont donc pu dégager du temps pour se consacrer à d’autres projets musicaux notamment Foghound.
Tout ça tournait à peu près rond dans un contexte tendu jusqu’à ce maudit 18 décembre 2017 : jour où notre ami James Robert Forrester dit « Reverrend Jim » s’est fait abattre devant le shop de tattoo où il bossait à Baltimore. Il est impossible pour moi de ne pas penser à lui alors que j’écoute les lignes de basse qu’il a imprimé sur cette production (« The Buzzard » en est une belle illustration) et mon avis sera donc partial ! Tant pis ! Et carrément tant mieux de savoir qu’Adam Heinzmann a rejoint cette fine équipe par la suite afin qu’un meurtre n’ait pas raison de cette aventure rock’n’roll qui envoie de belles buches ! Je signale que la vague de solidarité au sein du microcosme stoner du nord des USA a été exemplaire.
Je signale aussi que musicalement cette pièce envoie sérieusement le bois et que passée outre la dimension émotionnelle, « Awaken to Destroy » mérite sa place dans toutes les discothèques heavy rock qui se respectent (elle a par ailleurs le potentiel de toucher au-delà vu l’intérêt déclaré grandissant pour Motörhead auprès des tribus rock).
Le mid-tempo est à l’honneur de certaines plages dont le titre éponyme ou « Keep On Shoveling » qui font aussi montre d’une rare sauvagerie assénée à grands renforts de riffs saturés quand c’est nécessaire. Quand l’équipée mixte décide de passer la vitesse supérieure (« Known Wolves » qui a fait l’objet d’une vidéo visible sur les plateformes vidéo en ligne), on tape dans une débauche plus saignante bourrinant sa maman avec brio dans un registre entre punk’n’roll véloce et stoner pour mâles en direct de chez les Rednecks ! Les chants façon Riot Grrrl amènent un petit plus qui tonifie une production qui, sans s’inscrire dans la révolution musicale, bouscule les codes avec Dee, un Lemmy au féminin, aux commandes.
Jouant sur toute la largeur du spectre de l’héritage stoner, le quatuor du Maryland commet le grand écart sur « Awaken To Destroy ». D’un côté ils concluent l’album sur quatre minutes apaisées entre ambiance enfumée/enivrée et suave sans jamais se lancer dans un passage où ils excellent pourtant : l’invitation à danser de la nuque et ils le font avec brio. D’un autre côté ils envoient un brulot impeccable de deux minutes trente qui transpire le punk US des eighties par tous les pores et fait bien saigner les oreilles : un pur régal pour amateurs d’ambiances plus trépidantes.
Le curseur est habilement placé entre les deux extrêmes sur « Gone Up in Smoke » : cette réussite du genre est habilement amenée par une rythmique lourde, dirigée par Chuck à la batterie, qui monte en intensité parallèlement à un alignement de gros plans de guitares overdrivées. Les Étasuniens s’affranchissent des conventions en dérapant dans les soli dès la première minute de jeu et y reviennent dans un registre plus barré en fin de partie lors d’un final énorme qui cartonne au rayon des bûches.
Inconditionnel du heavy rock US des années deux-mille : si à l’époque tu as kiffé The Glasspack, Halfway To Gone voire même Sixty Watt Shaman, ce disque manque cruellement à ta collection en cd, en téléchargement voire même en vinyle !

On s’est construit une relation étrange avec Riding Easy depuis quelques mois. Après une série de premières sorties détonantes, marquées par des découvertes / révélations fulgurantes et solides (Monolord, The Well, R.I.P., The PictureBooks, Holy Serpent…), le label a depuis parfois dilué son aura dans quelques sorties plus faibles, qui avaient du mal à se distinguer. Mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain : Daniel Hall reste un grand dénicheur de talent, et on aurait pu passer à côté de ce disque si on ne s’en était pas rappelé…
Alastor, donc, quatuor suédois tout jeune par sa structure (naissance en 2016, quelques titres sortis ici ou là…) mais pas si jeune musicalement : les gaillards trouvent leurs racines dans les meilleures productions qui ont baigné la fin des années 70 / début des années 80. Vous me direz : c’est le cas de bon nombre de sorties des derniers mois / années, et pas toujours la garantie d’une grande réussite musicale en soi. Certes, sauf que là, le résultat est d’une qualité remarquable, fruit d’une synthèse si réussie que l’on croirait nos jeunes loups en provenance directe du siècle précédent.
Le groupe tape dans tous les sens et fait mouche à chaque fois. Insolent. Le doom séminal de “Your Lives are Worthless” traîne sa froide langueur sur presque 10 minutes gorgées en riffs pachydermiques 100% AOC. “N.W 588” convoque les meilleures références du heavy metal des années 80 et y rajoute quelques rasades de fuzz croustillant pour faire bonne mesure. Le morceau titre “Slave to the Grave” rappellera les grandes heures de Pentagram sur une première moitié très doom old school, tandis que sa seconde moitié livre une déclinaison entêtante du master-riff, propice pendant 4 bonnes minutes à un déluge de leads roboratives en enivrantes qui emmène le titre aux portes du space rock le plus trippant. Mais le morceau-maître de cette galette réside sans discussion dans les 17 minutes du délicieux “Spider of my Love”, un pur joyau de vieux doom classique, où les vocaux légèrement nasillards de Dharma Gheddon (!) viennent se caler sur un riff monolithique joué avec une lenteur extrême mais évidente dans le contexte. Le morceau, emmené sur sa longueur par un clavier qui trouve impeccablement sa place, se conclue pendant plusieurs minutes sur une orgie de soli jouissifs. Bon, les 8 min de “Gone”, bluette électro-acoustique terminant sur une section “on tape des mains en rythme au coin du feu”, s’avèrent être le passage facultatif du disque, clairement. Mais sur presque une heure de musique, on ne va pas chipoter non plus !
Le plaisir est au rendez-vous dès les premières écoutes, et les suivantes s’enchaînent sans jamais l’ombre d’un déplaisir. Quel excellent premier album ! On sort de ce disque repu, souriant, avec le sentiment qu’on en a eu largement pour notre argent. Et on n’a qu’une envie désormais : voir le groupe en live.

J’ai mis du temps avant de l’écrire cette chronique là, mais que voulez-vous, les histoires d’amour finissent mal en général, tout du moins les histoires contrariées étouffent quelque peu la flamme. Contrariant oui. C’est l’effet que procure ce nouvel opus de All Them Witches intitulé simplement « ATW ». Effet d’épure ou imagination en berne, la suite nous prouvera que les deux choix parcourent la galette.
Épure en effet, car le combo décide de réduire ses expérimentations pour revenir à un blues plus direct où l’overdrive des guitares sera plus mis en avant que le signal des claviers, où la voix raconte plus qu’elle ne chante, où les mélodies se font plus rêches. Le groupe tente peut-être de recentrer le débat en revenant à ses premiers amours mais, soyons francs, n’y parvient guère. Il suffit des quelques minutes du morceau d’introduction «Fishbelly 86 Onions» pour comprendre que quelque chose sonne creux au royaume de Nashville. Malgré la virtuosité des gonzes le riff est vide, les envies faussement garages et le chant d’habitude si habité se trompe de direction. C’est une immense déception que cette ouverture et la suite est malheureusement du même acabit.
J’ai écouté « ATW » des dizaines et des dizaines de fois parce que, voyez-vous, j’aime ce groupe passionnément. J’ai chroniqué beaucoup de leurs albums, dévoré leurs lives de manière déraisonnable, je les ai sûrement défendu ardemment en me voilant la face par moment mais voilà, le constat est terrible et difficile à accepter. Je me suis emmerdé à chaque écoute de ce dernier opus. J’y revenais sans cesse en me disant « Non, non, je refuse qu’il en soit ainsi… », mais la sentence fut la même à chaque fin de respiration. Ennui total.
Je ferai tout de même exception du titre « Diamond » qui retrouve l’inspiration, la force créatrice et l’acidité du All Them Witches que j’aime et qui nous berce de son obsédante langueur.
Immense déception que ce dernier album de All Them Witches. La vérité est que peut-être le combo devrait se reposer un peu. S’imposer une période de calme en réduisant la voilure, cesser ce rythme infernal en alternant tournées conséquentes et album tous les ans. Si toutefois le groupe décide de maintenir ce cap esthétique il sera temps pour moi de leur dire au-revoir, le cœur serré. Et de les remercier pour toute cette incroyable musique qu’ils nous ont donné alors.

C’est déjà la fin de l’année et plus que quelques jours pour rattraper les manquements à nos devoirs de couverture des sorties de l’année. King Buffalo a mis au jour mi-octobre son second LP sur le label Stickman Records et au vu de ce que le premier album avait suscité comme engouement du public il eut été dommage de ne pas se laisser tenter par l’écoute de Longing to Be the Mountain. Du coup j’ai cliqué sur play pour me faire une petite idée de ce que pouvait donner le trio lors de l’exercice de production d’une seconde galette plein format.
A la première écoute l’album paraît dense et l’approche pas si évidente que cela. Pourtant à la réécoute on comprend bien que King Buffalo sort des sentiers Psychs creusés par les semelles de ses prédécesseurs. L’album ne s’attarde jamais trop sur la répétition de ce qui a déjà été fait. Les références se glissent par touches et c’est un réel plaisir que de les retrouver au fil des auditions successives. Bien entendu l’esprit d’un Elder est présent sur cette plaque tant dans les riffs que dans la structure même de l’album, quoi de plus naturel après que les deux formations aient tourné ensemble et qu’elles aient partagé le créateur de l’artwork. Il est indéniable également que l’âme de Pink Floyd, déjà présente sur Orion, hante les riffs de guitare et s’affirme ici plus nettement (rien que l’intro de “Morning Song” devrait vous rappeler quelque chose avec ses samples de cris d’oiseaux et les premières notes arpégées dignes de “Shine On You Crazy Diamond”). Cependant passé cela, King Buffalo montre une prise d’assurance dans ses compositions et l’affirmation de ses origines Prog.
Il est appréciable de trouver dans cet album d’entrée l’apaisement avec une guitare électro-acoustique gratifiant la piste “Morning Song” d’un univers tout en douceur et en lenteur, pour rappeler une ballade bluesy servie par le producteur et guitariste de All Them Witches, Ben McLeod. Progressivement l’intensité vient, chaque piste monte d’un cran, les effets de pédales Fuzz, les Loop et autres Delay sont autant d’ingrédients ajoutés aux plats successifs apportant à chaque fois une touche rehaussée de saveurs. La rondeur des lignes de basse Heavy-Blues de Dan Reynolds emporte l’auditeur de “Cosmonaut” à “Eye of the storm” et les boucles possessives de ce dernier titre entraînent l’auditeur dans une transe totale lorsque la guitare s’en mêle. Le chant de Sean McVay marque l’esprit par une approche mélodique peu courante et difficilement descriptible mais certainement fort habile.
Au registre des morceaux notables “Quickening” prend son temps, commence à saturer les guitares doucement mais surement pour exploser dans son dernier tiers et tout emporter sur son passage afin de mieux laisser le calme de “Longing to Be the Mountain” s’installer. Mais ce n’est pas parce que le tout est abordé sereinement qu’il n’y a pas grand-chose à ressentir. La piste est lumineuse et addictive, pleine d’une profondeur où les notes se matérialisent quasiment. Une fois de plus Sean McVay troque sa guitare pour le synthé et offre un univers aux touches de Samsara Blues Experiment loin d’être déplaisantes d’autant qu’elles se complètent à merveille d’une frappe magistrale du batteur Scott Donaldson. La galette se termine abruptement après “Eye The Storm” dont on salue les modulations d’intensité. Je souligne volontairement ici une fois de plus le travail fait sur ce titre car les trois acolytes qui jouent les uns pour les autres, se servent mutuellement en produisant, à mon sens, le meilleur titre de l’album.
En conclusion on peut dire qu’il aurait été dommage en effet de manquer Longing to Be the Mountain malgré sa sortie discrète. Avec une moitié d’album où les pistes ne dépassant que de peu les quatre minutes et l’impression qu’il manque une poignée de titres pour se trouver véritablement rassasié, il faut bien admettre que l’album est plutôt réussi puisque autant le dire, on en redemande! Longing to Be the Mountain intègre donc le cortège des sorties de qualité de l’année 2018 et on ne saurait que trop saluer tant sa maîtrise instrumentale que sa qualité structurelle. Un bien bel objet et un King Buffalo à suivre de près lors de ses prochaines sorties.
|
|



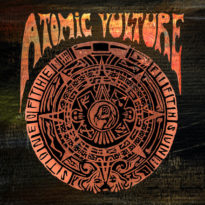

 Le Maryland, son fameux Doom Fest, sa ville la plus peuplée : Baltimore et sa criminalité impressionnante, sa tradition artistique avec des formations de lourdingues : The Obsessed et ses démêlées avec les douanes européennes ou Earthride, ses stars du stoner qui se paient le luxe de se produire en Mainstage au Hellfest : Clutch et maintenant son trio de gros bourrins : Yatra.
Le Maryland, son fameux Doom Fest, sa ville la plus peuplée : Baltimore et sa criminalité impressionnante, sa tradition artistique avec des formations de lourdingues : The Obsessed et ses démêlées avec les douanes européennes ou Earthride, ses stars du stoner qui se paient le luxe de se produire en Mainstage au Hellfest : Clutch et maintenant son trio de gros bourrins : Yatra.