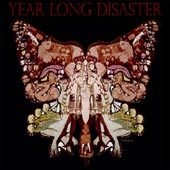|
|
 Ouch ! Voilà l’effet que fait le dernier Cathedral sur le pauvre auditeur non-averti : l’effet d’un coup de massue derrière la tête ! Le ton est d’ailleurs donné dès ce ‘Cathedral Flames’ en intro, dont le rythme effréné (??) doit atteindre les 3 bpm au moins, avec une gratte (ou plutôt une armée de grattes) accordée une douzaine de tons plus grave que la normale. S’ensuit un ‘Melancholy Emperor’ bien plus proche du Cathedral qu’on connaît et qu’on apprécie, avec un gros riff qui castagne et des bons breaks lents et lourds, qui vous donnent l’impression de vous faire écraser par le son de basse ! Et oui, en deux titres, le ton est donné : les anglais de Cathedral, emmenés par un Lee Dorrian pétant le feu, reviennent au top de leur forme. Instigateurs du Doom tel qu’il est connu aujourd’hui , appelons-le ‘Doom moderne’. Cathedral s’est néanmoins, de l’avis des puristes, fait voler la tête de file par leurs compatriotes de Electric Wizard. Mais la bonne nouvelle est qu’ils s’en foutent et continuent leur chemin, à coups de morceaux bien accrocheurs, du genre à vous laminer la boîte crânienne pendant une heure non-stop. Vous aurez du mal à ressortir en un seul morceau des super-heavy ‘Whores to Oblivion’, ‘Ultra Earth’, ou un ‘Templars arise’ à rallonge pour clore le tout dans la joie et la bonne humeur. Bref, on se pose pas de questions, le nouveau Cathedral est sorti, alors on fonce gentiment chez son disquaire et on aligne les biftons !
Voici un disque qui pourrait bien être l’album stoner rock de l’année. Cette production du quatuor de Goteborg concentre tout au long de ses onze plages tous les éléments qui font un énorme album de heavy rock : l’énergie sauvage du rock originel ‘Black City’, l’émotion ‘Love Song’, les riffs ultra lourds ‘Ratsafari’ et le côté halluciné des seventies ‘6 :36’. A consommer sans modération, cette production disponible en cd et vinyle vert, a tendance à rendre accro très rapidement ses auditeurs. Si vous avez loupé les deux premiers épisodes de la saga de ces Suédois c’est le moment de vous rattraper en sautant sur la pochette verte flashy de cette œuvre ; le serpent qui l’illustre ne vous mordra pas mais le venin que contient ses compos vous guidera chez votre disquaire pour obtenir les deux premiers opus du groupe.
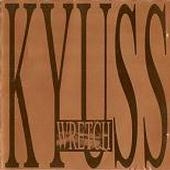 ‘Beginning Of What’s About To Happen’, en voilà un titre bien prémonitoire (quant à l’impact du groupe) pour cet instrumental d’une minute et demie qui ouvre le premier véritable album de Kyuss (après un disque sous le nom de Sons of Kyuss sorti un an plus tôt sur un label indépendant US et tiré à seulement 1000 exemplaires).
Car c’est bien à partir de ce Wretch que Kyuss va poser les jalons de son succès (d’estime) futur. Certes, le disque, dans l’ensemble, n’a rien d’exceptionnel. Cependant, il laisse présager un avenir rempli de bonnes choses pour ces 4 garçons ayant grandi dans les environs de Palm Desert. Pourquoi me direz-vous ?
Tout d’abord, une voix hypnotique, celle d’un John Garcia, si jeune, et déjà si mature dans ses interprétations.
Ensuite, l’indéniable talent de Homme à la guitare et de Brant Bjork à la batterie. Il ne faut pas oublier que nos lascars ne sont encore que des ados à l’époque (Josh n’a pas encore 18 ans lorsque les titres ont été composés).
Enfin, il y a cet « art », pas encore tout à fait maîtrisé, d’écrire des chansons et des riffs qui font mouche. L’excellent ‘Son of a Bitch’, fruit de la collaboration entre Homme, Oliveri et Garcia, ainsi que le déjanté ‘I’m Not’ en sont l’illustration parfaite.
Pour ce qui est du contenu de l’album, ça part dans tous les sens, ce qui laisse parfois l’auditeur assez dubitatif. Des titres agressifs (‘Katzenjammer’ ou ‘(Beginning of What’s About to Happen) HWY 74’) plutôt bien inspirés, côtoient certains morceaux qui s’avèrent au final assez fades (‘Love Has Passed me By’, ‘Big Bikes’).
Pas encore totalement stoner, parfois à la limite du punk sans être vraiment tout à fait Thrash, ce disque est passé inaperçu lors de sa sortie (et reste encore aujourd’hui assez confidentiel). Pourquoi ? Car le monde n’était visiblement pas préparé à ‘What’s about to Happen’. En tout cas, jetez une oreille à ce disque, juste par simple curiosité, car cela reste quand même un disque des mighty Kyuss.
 La formation suédoise se paie le luxe de sortir un ep composé de quatre titres quelques mois après l’arrivée de leur nouveau batteur Draken et dans le sillage de leur nouvel album, Vol II ‘Words Unspoken’ qui atterri aussi ces temps dans les bacs de votre épicier favori. La spontanéité est palpable sur cette production mise en boîte dans un esprit détendu au Studio Deadline avec des featuring qui en jettent bien au-delà des frontières de la galaxie stoner et de ses satellites.
Totalement inédit de par sa composition puisque aucune de ces plages ne se retrouve sur le nouvel opus du quatuor nordique, ce court format démarre en trombe avec l’incisif ‘Bring The Storm’ et le couillu ‘Unicorn’ qui sont les deux seules compositions à mettre au crédit du groupe. Plutôt rapides et bien foutus, ces titres sont dans le registre habituel du combo et ils enchanteront donc ses fans.
Le premier cover c’est ‘I Want You’ de Kiss. Le morceau de Paul Stanley, dont je suis loin d’être un inconditionnel, sur lequel Mattias ‘Ia’ Eklundh de Freak Kitchen vient prêter main-forte au quatuor est une excellente surprise au final. Les membres de la Kiss Army l’ont par ailleurs très bien accueilli et le solo de guitare livré par le guest est monstre cool même si ce type d’exercice de style semble regarder son avenir dans un rétroviseur, tant pis pour les médisants. Moi j’ai été bien emballé par la chose !
La seconde reprise tient un peu de l’ovni si cher à Scully et Mulder puisque nos lascars ont convié Zak Tell de Clawfinger a poussé la chansonnette avec Peter sur une reprise de ‘Heartbreaker’ de Led Zeppelin. Et là mes cadets c’est du délire total : le phrasé du metalleux, les attaques de riff orientées griffe, la maîtrise de ces types et le génie de Boham, Jones, Page et Plant font excellent ménage pour une énorme tuerie au très très gros son.
Une petite gâterie que nous offre ce groupe et vous auriez tort de vous en passer.
Rien que du bon ! Cet album d’Elephantum est vraiment d’une rare qualité. Bien sûr il serait aisé de lui reprocher sa durée qui demeure fort modeste. Mais franchement en même pas vingt minutes, ce quartet hollandais nous livre cinq perles stoner et puis merde ! La qualité de l’objet est suffisamment bonne pour que l’aspect quantitatif n’entre pas en ligne de compte. Tout commence pour ce ‘Sedimentation’ par un petit air de guitare léger, très inspiré par celui de ‘Wasted Years’ d’Iron Maiden, qui perdure fort agréablement tout le long du morceau ‘Anthem to The Fall And Awakening Of The Tiny Yellow Flower’. La suite est composée de deux énormes composition stoner pop très planantes (‘Black Butterfly’ et ‘Light Up Your Summer’), d’un instrumental assez court dans le style ‘feu de camp baba’ et de ‘Low Phil’, titre envoûtant à sa genèse qui se termine d’un style dans le veine de Kyuss. Un album de stoner tout en finesse mais loin d’être mou.
Avec un nom comme Mothertrucker, on s’attend à ce que ça dépote, qu’un trio de baroudeurs poussiéreux, la clope au bec, humant bon la sueur et la binouse tiédasse, débarque dans le studio, qu’un gratteux remonte son froc usé, renifle, branche son jack, tourne le potard de volume à fond, et commence à éructer derrière son micro en faisant des moulinets avec sa gratte ! Et ben non… Mothertrucker est plus dans une mouvance instrumentale froide, type “post stoner”, tendance Neurosis sans la voix.
Sur cette base, les anglais ne déçoivent pas : ce qu’ils font, ils le font bien. A 3 seulement, ils balancent un mur sonique compact et raide, sailli de riffs secs comme des coups de trique. Ici ou là, des leads de guitare peuvent nous rappeler les passages les plus “psychédéliques” de Kyuss, par exemple. Un peu plus loin, les lointains et lancinants licks de guitare légèrement dissonants font inévitablement penser à Yawning Man. Vous l’aurez compris, quelques relents purement stoneriens bassement organiques satisferont les plus rudes d’oreilles d’entre vous.
En revanche, si vous aimez votre stoner “pied au plancher”, in your face, Mothertrucker n’est pas fait pour vous : compos alambiquées fleurtant allègremant autour de la dizaine de minutes chaque, le trio grand-breton est plus dans un trip ambiant-planant-labourant… Et ils pratiquent l’exercice remarquablement.
Curieusement, autant il ne m’avait fallu que quelques écoutes (3) dès sa sortie pour déclarer que ‘Variations on a Theme’ était un classique, autant je ne sais toujours pas quoi penser de celui-ci. Bien sûr, je suis fan, il m’a emballé dès la première écoute, mais il faut être sourd pour ne pas se rendre compte qu’il est bien plus inégal, tout en lui ressemblant presque comme deux gouttes d’eau, que son prédécesseur.
Un soupçon d’honnêteté me pousse à me demander si on aurait fait tout ce charivari autour d”At Giza’ si c’était un autre groupe de stoner à la moindre envergure qui l’avait composé. Car tout comme le morceau de l’avant dernier EP de 5ive, ‘At Giza’ rappelle fortement ‘Set the controls for the heart of the sun’ du Floyd. Mais voilà (la subjectivité reprenant rapidement le dessus, faut pas déconner, je suis une groupie), ce sont 2 mecs qui ont quasiment formé cette scène stoner/doom qui sortent ce morceau et comme avec toutes leurs précédentes réalisations (sauf The Sabians mais j’y reviendrais), ils font ça avec la classe et le talent.
Un morceau à la durée moyenne convenable de 15 minutes, à la progression épique, on plane plus que jamais au son de cette répétitivité portée par une basse sans saturation, un chant apaisé quasi-mécanique, évoquant lointainement des mantras et les percussions venant s’ajouter la création de ce rythme tribal d’un batteur rodé à l’exercice depuis l’épreuve de force que fut Dopesmoker. Planant, céleste, les qualificatifs d’évasions ne manquent pas de jaillir à l’écoute (qui peut se répéter indéfiniment) de ce morceau qui, finalement, n’est qu’une énième resucée des expérimentations psychédéliques et free jazz des 60/70’s, mais jouée avec la classe de deux mecs passionnés et intègres.
Je parlais d’inégalité tout à l’heure, elle s’impose sur la durée quand vient le tour de ‘Flight of the Eagle’ de débuter. Second morceau le plus long du duo, mais aussi le moins excitant (ça ne me coûte pas tant que ça de le dire finalement), son principal défaut est de suivre ‘At Giza’. Les fans ne seront pas dépaysés mais n’auront même pas la pointe de surprise ou de délectation que l’on éprouve à l’écoute d’un nouvel album tant attendu d’un artiste qu’on adore, lorsque l’on reconnaît sa patte tout en entendant de nouvelles créations dont on ne sait pas quoi encore penser. Non, là, ils auront juste l’impression d’entendre le disque précédent, avec une meilleure production, un poil plus limpide mais un poil plus délayée aussi.
Alors, oui, c’est toujours un bon morceau, mais devant l’originalité’ du titre d’ouverture, n’aurait-il pas été plus intéressant de continuer à surprendre, plutôt que retomber immédiatement dans ses travers ?
Om est un groupe à fans, ceux qui comme moi se délecteront de leur répétitivité sonique poussée d’un album à sa discographie complète, mais les autres tireront-ils le même plaisir à écouter sans cesse le même disque ?
 Attention, énorme album ! Le stoner rock incarné dans un quatuor en provenance de, allez, devinez. Ben oui, de Suède, l’autre pays de la guitare. Et tant qu’on parle de guitare, rentrons dans le vif du sujet, c’est bien la gratte que vous remarquerez en premier : jamais, je dis bien jamais, je n’ai entendu une gratte de cette trempe, avec un son aussi gros et graisseux, une 6-cordes si saturée et baignée de fuzz, le tout servi par une paire de guitaristes qui n’a pas oublié d’écouter le grand Sab, Sleep, Kyuss, Fu Manchu ou même Motörhead. Donc déjà, il y a ce son rêche, de ces sons qui vous caressent à l’opposé du sens du poil mais qui provoquent quand même des frissons de bonheur, mais ce n’est pas tout : les scandinaves s’appuient aussi sur une belle poignée de compos torchées de mains de tailleurs de pierre pour satisfaire les plus bas instincts d’un public qui n’attend que la nouvelle révélation du stoner rock pour donner un nouveau coup de pied dans le couffin douillet dans lequel le genre peut parfois sembler se confiner (ce n’est heureusement qu’une impression). Ce groupe est peut-être bien Astroqueen, finalement : même s’ils sont loin de révolutionner le genre, même s’ils n’inventent rien, ils fusionnent leurs influences avec un entrain qui fait plaisir à voir, bien servis par une production de Andy La Rocque (oui, de King Diamond !). Si vous hésitez, écoutez simplement les trente premières secondes de l’album, le début de ‘Landslide’, vous comprendrez.
 Comme une bouffée d’air frais, le quintette italien a débarqué dans ma platine avec ses huit nouveaux morceaux qui se succèdent rapidement sans me laisser le temps d’encaisser le coup. Fortement influencés par le rock indépendant qui suivit la déferlante de Seattle et le fuzz bien carré, ces types-là pratique un rock bien pêchu chanté dans leur langue nationale.
Si ‘Sempre Lo Stesso’ qui ouvre les hostilités a plus à voir avec Sonic Youth qu’avec le stoner à l’exception de son terme, il n’en va pas de même pour tous les titres figurant au sommaire de cette production. ‘La Cagna’, le second titre, martelé régulièrement de bout en bout est dans un registre pas tant que ça éloigné de Queens Of The Stone Age et de Monster Magnet avec son tempo rapide ainsi que ses guitares légères. ‘L’Animale’ est encore plus véloce et me fait penser à Winnebago Deal pour l’allure générale.
Le reste des morceaux s’inscrit dans un créneau hérité de Kyuss avec de gros vrombissements de basse et des riffs très saturés mis bien en avant par le sonorisateur de cette galette. ‘Lettere Dal Profondo demeure, à mon sens, la meilleure plage proposée sur ce cd avec son son stoner très traditionnel et la spécificité linguistique en plus.
 A la première écoute de ce second méfait de Hainloose (dont j’avais complètement zappé la première sortie), on se dit qu’on a affaire à un petit album de stoner classique, très bien produit, pas très innovant mais bien foutu qui ne se distingue pas particulièrement de la pléthore de sortie qu’on nous balance à longueur d’année.
A la deuxième écoute, un peu plus attentive, on se dit que si ce trio avait été américain et non pas allemand, il aurait facilement trouvé sa place sur le catalogue de Small Stone grâce aux accents southern-rock qui parcourent l’album. C’est surtout marquant sur les trois premier titres et en particulier sur « Proud of My Doom » où Haris Turkanovic, dont le timbre de voix évoque celui de Pepper Keenan, se la joue redneck patenté sur une intro non dénuée d’humour.
A la troisième écoute, on se dit que ce qui distingue Hainloose de ses modèles américains, c’est la volonté de développer leurs morceaux en creusant un peu l’idée de base tout en parvenant à rester concis (la majorité des titres tournent autour des quatre minutes). Cela nous vaut quelques breaks et solos du plus bel effet offrant l’opportunité à nos lascars de faire la démonstration de leur maîtrise technique.
Alerté par l’écoute précédente, on se repasse immédiatement les dix titres pour se rendre compte que derrière l’aspect basique des compos un brin bourrin se cachent trois musicos de haute volée qui à l’instar de Clutch (à qui on songe plus d’une fois) parviennent à sonner simple et efficace tout en jouant des parties complexes. Difficile de sortir un morceau du lot tant ils présentent tous les mêmes qualités bien que j’aie une légère préférence pour l’instrumental « Chernobilly », sans vraiment pouvoir en expliquer la raison.
Au final, alors qu’on pensait que ce disque ne sortirait de son boîtier qu’à de rares occasions, « Burden State » trône toujours sur le haut de la pile depuis plusieurs semaines. Preuve en est qu’il ne faut jamais trop se fier à une première écoute.
Que dire de ce skeud? A lui seul, on pourrait lui dédier des études entières, voire des mémoires de musicologie. Si nous avons souvent cité le Blues For The Red Sun de Kyuss comme étant un excellent album pour aborder l’écoute du stoner (et c’est vrai!), il convient d’ajouter que cette plaque est au stoner et à ses dérivés ce que E = MC² est à la physique. Parce que comprendre le présent, c’est tenir compte du passé, essayons de nous plonger succinctement dans cette bombe digne de 1000 éruptions pliniennes. Il va sans dire que les 2 albums précédents sont indispensables à la compréhension de cette pièce légendaire. Ajoutez le 4e et le 5e albums et vous aurez fait le tour de la première phase édifiante du Sab.
Nous sommes en 1971 et le groupe en est à son 3e album. Ce dernier devant confirmé la position dominante du groupe sur cette scène encore méconnue aurait dû faire l’objet d’une composition longue et réfléchie ainsi que d’un mix 5 étoiles revu et corrigé par les plus grands maîtres des studios. Il n’en est rien. Le groupe compose cet opus en 3 mois, quasiment sur la route de la tournée Paranoid. Les morceaux sont balancés spontanément avec une patate et un sans-gène déstabilisants. A peine achevé le sample d’une quinte de toux simulant un disque rayé qu’un un riff aux relents sludgy surgit pour balayer le silence et envoyer l’auditeur directement dans les cordes.
Le sample aux relents de phaser en guise d’intro de la 2e plage fait place à un riff époustouflant constitué d’une série d’étouffés et de 2 contre-temps vertement ponctués qui, 36 ans plus tard, me scotchent encore au mur. Les musicos se rendaient-ils seulement compte de l’impact et de l’influence qu’ils allaient avoir?!
Butler et Ward pilonnent grave et nous bétonnent une section rythmique de 1er ordre alors que le maître ès riffs qui tuent alias Tommy Iommi fait parler avec brio son accordage en mi bémol et Ozzy, jeune premier à l’époque, bourré de trucs illicites mais loin de toutes ses idioties télévisées de maintenant, chante très juste sur des paroles souvent écrites par le bassiste Geezer Butler. Les soli sont parfois dédoublés dans des moutures différentes, une technique qui sera maintes fois copiées par la suite, afin d’améliorer le décorum sans mettre dans l’ombre les bases rythmiques fondatrices de ces ogives nucléaires.
La suite donne lieu à des passages calmes comme cette séquence de guitare aux réminiscences médiévales ou cette intro hispanisante à la gratte sèche. Cette plaque est certes moins variée que Paranoid (2e album) mais révèle néanmoins la phase la plus noire et la plus influentielle du Sab. Comme une prophétie ou des tables de loi gravée dans le marbre… Mais cet album ne vous fera probablement pas péter un câble dès la 1ère écoute. Il faut faire un effort pour accéder à la perception de cette perle intemporelle.
Ne vous croyez pas sorti d’affaire pour autant: Black Sab pousse le vice jusqu’à inviter l’auditeur à faire l’ultime effort de conquérir Into the Void, un morceau long de près de 7 minutes qui navigue dans les eaux troubles d’un style qui se voudra progressif.
Pour la petite histoire, l’intro sous la forme d’une quinte, c’est Iommi toussant après avoir tiré sur un buzz. Et sur Solitude, c’est bien Ozzy qui chante sans effets. Si un vieil oncle ou une autre connaissance souhaite se défaire de ces vinyles, accueillez cette proposition avec enthousiasme: peut-être y-a-t-il une ou plusieurs perles du genre dans le tas…
Ahhh, ça faisait longtemps qu’on attendait ce nouvel album de l’une des “locomotives” du stoner : vous voyez de qui on veut parler, ces groupes qui se maintiennent facilement dans le peloton de tête du genre, pas toujours par l’intégrité et la qualité de leur musique (généralement c’est le cas, quand même !), mais en tout cas par le succès qu’ils ont acquis, et le simple fait qu’ils sont parvenus à dépasser le statut de modeste groupe “underground”. Un groupe qui fait du bien au genre, donc, permettant à plus de monde de découvrir les influences qui ont “enfanté” ce terrible rejeton…
Assez de digression, il est temps d’enfourner cette galette dans le lecteur CD. Après une intro frisant le cérémonial, l’album commence par “Throwing your life away” et on retrouve Spiritual Beggars, finalement là où on l’avait laissé : un groupe qui se fait plaisir, à l’aise dans ses baskets, évoluant dans un hard rock très inspiré seventies, avec une aisance et une assurance confondantes. Sûrs d’eux, ils avancent toujours dans la même direction.
Et puis les titres avancent, et le groove est toujours là (“Salt in your wounds”, “Dying every day”), mais aussi une bonne dose “d’agression”. Et là, le bât blesse un chouilla… Parce qu’au final, Spiritual commence quand même à ressembler à un groupe de metal. Ce n’est pas péjoratif, mais ils s’éloignent quand même de ce pourquoi on les aime tant… Certains titres ont très peu de lien avec le bon vieux hard psychédélique un peu suranné que le groupe maîtrisait si bien. Bon, on va un peu facilement reprocher à Amott de rapprocher son second groupe de son autre bébé, Arch Enemy, surtout suite au succès récent de ce dernier ; ce serait probablement une erreur, toutefois : vu le carton, justement, de Arch Enemy, on peut imaginer que si le bonhomme revient faire un skeud (forcément confidentiel, en comparaison) avec ses potes de Spiritual Beggars, c’est avant tout par passion !
Ne boudons pas notre joie donc. On retrouve quand même des morceaux Beggaresques comme on les aime, et auxquels le groupe nous a habitués (“One man army”, “Treading water”), et même quelques joyaux (l’épique “Elusive” et ses montées en puissance jouissives, servies par un chant et une gratte solo en états de grâce). Le groupe se laisse même aller à des titres plus lents, où la guitare prend un tour vicieux, malsain parfois (“No one heard”, très énervant car immédiatement entêtant, ou “Through the halls” et son final en forme de déferlante guitaristique + claviers). Le tout baigne dans une indécente quantité de riffs tout simplement remarquables (putain de Mike Amott…), et la maîtrise instrumentale est vraiment sans faille, totalement bluffante : la basse groove, la batterie est agressive, les claviers se font discrets mais bien efficaces lorsqu’ils sont sollicités, et les guitares, complémentaires, finissent d’assoir un groupe qui désormais repose derrière le talent vocal de JB. Inutile de griller le suspense, c’est lui la star incontestable de cet album. J’adorais pourtant ce bon vieux Spice, mais là, faut se rendre à l’évidence : le coffre de l’animal est affolant, son potentiel vous scotche au détour de chaque refrain. On a vraiment l’impression que sur tous ces titres, il ne fait que chantonner, sans pousser vraiment sa voix dans ses derniers retranchements, avec une aisance et un “charisme vocal” étonnants… Honnêtement, ça calme.
Alors voilà, ce n’est pas le meilleur album des Beggars, mais il reste un album de très grande qualité, qui mérite que l’on s’y attarde : une sorte de garantie sans risque, du Spiritual pur jus, avec tout ce qu’on aime. Mais c’est quand même encore un pas vers “autre chose”, un de plus…
Note : il paraît que l’album est sorti dans le commerce avec un DVD live, ou quelque chose d’approchant. Autant vous dire que cet argument devrait finir de vous persuader, surtout si le prix est raisonnable !
Petit dernier de l’écurie Buzzville, Sideburn n’est pas un groupe de débutants pour autant. Loin de là. Le quatuor suédois existe depuis 10 maintenant et a bourlingué vaille que vaille pour sortir sa première plaque Trying to Burn the Sun (on aime le soleil en Suède, ça se comprend) en 2002. Après un changement de batteur, une flopée de dates et de belles gueules de bois, Sideburn se stabilise et compose son 2e skeud. Nous sommes en 2006. Mais là, la question du label se pose. Et c’est les dynamiques gaillards de Buzzville qui vont signer nos hommes venus du froid. Voici donc la chro du dernier album tant attendu de Sideburn.
D’entrée de jeu, on perçoit qu’on a affaire à un groupe qui revendique haut et fort son appartenance aux late 60′ et 70’s. Entre quelque hommage aux Doors (3e plage Top of the World), à Deep Purple (10e plage riding the Rainbow => sans doute un jeu de mots caché…), Black Sab (plage 6 Soulville => encore un clin d’oeil mais contemporain cette fois), Led Zep (plage 4 When the Day Dies) et aux Allman Brothers (2e plage Sweet Wine), les mecs nous envoient des morceaux parfaitement équilibrés. Il y a d’autres références qui viennent à l’esprit mais on ne va pas se casser la tête à les énumérer, le décor étant planté. Attention! Je dis bien que ces groupes cités plus haut sont des références. En rien le groupe ne plagie ses monstres de la zique qu’on aime! Les compos restent personnelles, de très bon goût et de très bonne facture.
A propos de mix, celui-ci se révèle de première qualité et très actuel. C’est particulièrement agréable: on sent que Sideburn puise ses racines dans les profondeurs des late 60’s et 70’s mais retient un mix résolument contemporain. On a d’ailleurs droit aux fréquences reconnaissables entre mille d’un orgue vintage traversant le spectre sonore de temps à autre. Le due basse/batterie offre un soutien indéfectible et les fûts sonnent bien profonds tout en conservant de la dynamique. Le guitariste, qui est une grosse bête, est me rappelle que je ferais bien de bosser mes gammes et le chanteur est beaucoup plus affirmé et présent que sur le précédent opus. Bref, il y a eu de l’évolution chez Sideburn et c’est très positif!
Inutile de vous dire que les compos sont extrêmement bien jouées. Ce groupe doit assurer grave sur scène dans des délires d’impro jouissifs au vu de la longueur des plages qui, sur la fin, tendent légèrement vers le rock progressif. Ca sent bon l’encens, la bière et les trucs pas très légaux. C’est surtout une folle énergie rock complètement débridée qui émane de cette plaque. Ces mecs croient en ce qu’ils jouent et doivent prendre un pied d’enfer.
En résumé, si la première plaque du groupe nous avait laissé sur notre faim, celle-ci me laisse repu à l’excès. Aujourd’hui, je sors mes pattes d’eph, je ne taille pas mes fav (sideburn signifie favori en anglais) et je me la joue hyper relax. Cet album est splendide et mérite moultes écoutes pour en cerner tous les contours. Vous en reprendrez bien un peu…
Pour rappel : Year Long Disaster a été formé par le binôme Rich Mullins, quelques années après la fin des mythiques Karma To Burn (dont il était le bassiste), et Daniel Davies (guitare & chant, fils d’un membre des Kinks). Se greffa au binôme Brad Hargreaves, batteur des immensément populaires (aux USA) Third Eye Blind. Le trio ainsi né, ils se sont mis à jammer, composer et enregistrer rapidement quelques morceaux. Ces morceaux ont rapidement généré autour du groupe un “buzz” grandissant, qui voit son apogée avec la sortie de ce premier album tant attendu.
Pour l’anecdote, cette galette est en fait une resucée d’un album sorti en vinyl quelques semaines plus tôt, avec des titres partiellement identiques, mais dotés d’un mix différent. Par ailleurs, ce vinyl renfermait lui-même une version CD, proposant encore un track listing différent. Faut suivre !
YLD évolue donc sous la forme d’un power trio, et pousse le concept dans ses derniers retranchements : tandis que le duo basse-batterie groove à la perfection, les parties de gratte rythmique sur lesquelles surnagent les vocaux aériens et rocailleux (!!) de Davies se retrouvent magnifiquement complétées de leads et soli divers, parfaitement enlevés. A noter que le jeu de basse permet d’appuyer et renforcer chaque riff, et, lorsque nécessaire, de suppléer à la gratte, trop occupée à s’envoyer en l’air en solo. Magnifique combinaison instrumentale, donc.
Musicalement, les influences de YLD sont diverses mais jouissives. On pourrait qualifier le groupe de croisement bâtard entre Led Zeppelin (pour la guitare maîtresse et les influs rock 70’s) et ZZ Top (ce groove sudiste omniprésent !!!!!), bercé trop près de Karma To Burn (pour les plans instru et la force du riff), ou de Jeff Buckley (pour la subtilité de quelques compos, et le chant élevé au rang de “marque de fabrique”).
L’entâme de l’album se fait par le single de l’album, “Per qualche dollaro di piu”, un brûlot mid-tempo baigné par un riff impeccable. L’un des grands moments de l’album intervient dès la seconde plage avec le délectable “Leda Atomica” : la rythmique sèche et saccadée qui encadre le riff “moteur” ne trompera personne, ce titre aurait pu être composé par le ZZ Top de la grande époque. Le refrain “à tiroirs”, totalement atypique, montre une facette “fil rouge” du groupe : ce sentiment qu’ils ne font rien comme personne. S’enchaînent ensuite, comme si de fait exprès, des titres aux tempi et structures bien différents les uns des autres, de la “presque balade” au sautillant “The fool and you” (mmmmh, ce bottleneck), en passant par le lancinant et groovy “Ain’t it luck”. Les morceaux sont entêtants, s’engramment dans le cervelet à force de riffs vicieux et malins. A noter la prod impeccable de James J. Waters, sommaire et brute lorsque les morceaux se reposent sur les instruments seuls, et chiadée lorsque des arrangements peuvent servir le propos (voir les arrangements de violons/violoncelles qui amènent “Swan on black lake” vers son riff-éléphant).
Au final, cet album devient rapidement prédestiné pour ceux qui aiment la “jouissance musicale” (voir le pont instrumental jouissif de “Galea Aponeurotica”) : écouter un groupe en sentant que ces mecs se font plaisir avec leur instrument, et le maîtrisent assez pour flatter l’ouïe en même temps. Enfin, il ne trompera personne que cette galette, aussi somptueuse et délectable soit-elle, est par nature un prétexte à aller écouter ces riffs en live, tandis que la formule power trio se déchaîne, à force de soli et impros borderline. A mon sens un candidat très sérieux au titre de meilleur album de l’année.
 Les groupes australiens ne courent pas les rues, et encore moins les bons groupes australiens. Fraîchement débarqué sur un label français (vous ne rêvez pas), Rollerball fait partie de cette dernière catégorie. Clairement, le groupe évolue à mi-chemin entre un franc stoner rock (des morceaux aux riffs plombés) et un gros heavy rock (des chansons très structurées, accrocheuses, où l’on va droit à l’essentiel). Foncièrement original, il aligne sur sa dernière galette pas moins de quatorze perles, toutes différentes, mais sans jamais se dépareiller d’un son heavy en diable, crasseux parfois, plus fin d’autres fois, mais chaleureux tout le temps. Le point fort de l’album réside clairement à ce niveau, dans cette production et ces arrangements qui font que même après des dizaines d’écoutes on ne regrette en aucun cas l’achat de l’album (au contraire, il s’apprécie encore plus avec le temps). On retrouve donc des effets originaux sur le chant, sur les grattes bien sûr, mais aussi des percus (‘Knocking The Top Of’), sans jamais perdre de vue l’essentiel : des compos heavy, rythmées, et qui groovent. On notera quelques chansons qui sortent du lot, des chansons comme ’24 Hours’ ou le boogie-rock de ‘Reflections’, catchy au possible, le splendide et épique instrumental ‘Theme From Odissey’, mais surtout un vrai petit chef-d’œuvre de subtilité électro-acoustique, l’enjouée ‘Believe In The Breeze’, garantie pour vous donner le sourire rien que par l’émotion positive qu’elle dégage. Sachez aussi que la version définitive de l’album proposera pas moins de deux vidéos multimédia de Rollerball. Tout ceci justifie plus que raisonnablement un investissement immédiat.
|
|




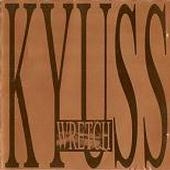







.jpg)