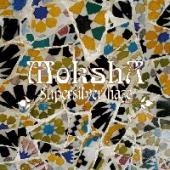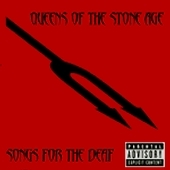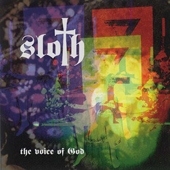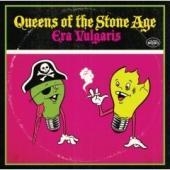|
|
The Bottle Doom Lazy Band, on commence à les connaître, le sujet faisant attrait à leur groupe ayant fleuri sur la plupart des forums doom de France et de Navarre. Et pourtant, j’avais zappé, honte sur moi. Heureusement les musiciens ont été assez sympas pour me proposer de rattraper mon retard en chroniquant leur album, sorti cet été. Et voilà que déjà pointe notre amie la subjectivité. Eh bien oui, quand les musiciens sont cools, difficile en faire abstraction, tant cela fait plaisir d’avoir un bon contact. Cela dit, cela ne m’empêchera d’évoquer quelques défauts.
Le quatuor a bien fait les choses pour sa première sortie. Objet pro, pochette réalisée par un artiste touchant sa bille qui leur offrira aussi ses talents pour la prochaine, bref, ça s’annonce bien. Puis vient le moment fatidique d’enfourner la bête, promis à une mort certaine donc, dans l’antre de sa chaîne. Premières secondes, première déflagration, un son énorme, doom, funeral, tout le répertoire y passe, ce sera lourd et sans compromis. Il en sera ainsi durant les quasi 40 minutes de cet album, qui en dureront 10 pour les fanas de St Vitus Pentagram The Obsessed, voir de drone tant je trouve que le son est massif, d’une densité extrême, soit sera d’une éternelle langueur pour ceux qui n’accrocheront pas. Je me place entre deux eaux.
Leur son est sans doute ce qui emporte d’emblée mon adhésion, leurs riffs lancinant, le groove qui pointe son nez par à-coups, cette batterie inébranlable au rythme subjuguant, de nombreux éléments bénéfiques pour entrer dans une transe proche de celle que l’on ressent à l’écoute de Dopesmoker.
Malheureusement, car il y a un mais, le point faible, la voix. Très lyrique, généreuse, massive et imposante, son timbre rauque et sa diction font tiquer car à 1000 lieues de ce qu’elle survole. Hormis sur l’interlude de 3 minutes où son timbre désabusé colle parfaitement à l’ambiance glauque et tragique du morceau, je persiste à penser qu’un choix pour un chant plus éthéré aurait mieux collé au pavé de cette musique qui oscille entre bon doom trad des familles et psychédélisme métallique.
J’espère que ce défaut pourra être corrigé sur la prochaine livraison, tant ce groupe fourmille d’un enthousiasme communicatif et d’idées terribles, comme cette cornemuse sur le dernier titre ou comment réussir à introduire de façon intelligente dans le doom cet instrument qui n’avait jusqu’alors trouvé sa place que sur le fameux Times of Grace de Neurosis.
Un excellent effort de la part de passionnés français et dont j’espère une suite, tant le résultat mérite d’être souligné. Doom on !
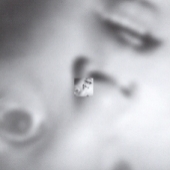 Les choses se compliquent lorsque nous arrivons dans le laboratoire secret de l’abominable Docteur Infidel ? / Castro !. Articulé autour des esprits torturés et tortueux que sont Colin Marston (Dysrhythmia et Behold The Arctopus) et George Korejn le style de cette formation us évolue dans un registre que le label nous qualifie d’indéfinissable et incatégorisable. Après avoir pouffé quelques minutes sur mon fauteuil, mon sourire s’est crispé sur mon visage quand je me suis demandé ce que ces types cherchent à transmettre comme émotion.
Qu’elle soit vecteur d’idée ou moyen de s’évader je n’ai aucun préjugé en ce qui concerne la musique de la grande famille du rock, mais de là à adhérer au trip bruitiste, électro, grunge et drone (mais pas drôle) du duo il y a un pas à franchir que je ne saurai franchir. En me plongeant dans cet univers créé par des types qui doivent avoir financer la baraque en bord de mer, la piscine, la limousine ainsi que le yacht de leurs psys respectifs à force de les consulter, je me suis un peu imaginé dans ces expos d’arts conceptuels où un artiste un peu frappé présente des œuvres qui me rappellent des fèces étalées sur de la toile et où il y a toujours un (en fait c’est souvent une, mais je ne vais pas jouer les misogynes) énergumène pour s’écrier : ‘Mon Dieu ! C’est fantastique !’. Et bien pour ce double cd, le premier intitulé ‘Cancer’ et le second ‘Cancer Decay’, qui regroupe 14 plages oscillant entre 1:04 pour la plus courte et 12:19 pour la plus longue, il doit bien y avoir des bipèdes complément dans le jus qui s’écrient : ‘Mon Dieu ! C’est fantastique !’.
J’en suis pas, loin s’en faut, peut-être le fait que je ne sois pas atteint de troubles psychologiques aigus ou que je ne consomme aucune substance modifiant la perception de la réalité n’y sont sans doute pas étrangers.
Aussi je vous invite à vous plonger dans cette œuvre en gardant à l’esprit que vous pouvez apprécier un morceau qui zappe entre délires électroniques, manipulation d’un tuner entre plusieurs sources de réception, rythmiques hardcore news school et guitares drone sinon passez votre chemin !
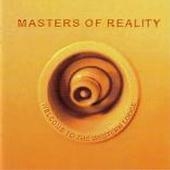 Ne vous fiez surtout pas au titre du morceau d’ouverture (‘It’s Shit’) : cet opus de Masters Of Reality est loin d’être une daube, bien au contraire. Encore une fois, Chris Goss bluffe tout son monde en nous offrant une galette séduisante, variée et très en avance sur son époque. Car l’homme est un visionnaire, et c’est ce qui fait la force de sa musique.Qu’ils soient empreints d’une certaine folie musicale (‘Moriah’) ou plus rentre-dedans (‘Time To Burn’), tous les titres de ce Welcome To The Western Lodge font mouche et donnent le tournis à l’auditeur.Outre le tubesque ‘Why The Fly’, on retiendra parmi ces 13 perles ‘Annihilation Of The Spirit’ et son tempo très ralenti, les calmes et sensuels ‘Calling Dr. Carrion’ et ‘Baby Mae’ ou encore le fameux ‘Boy Milk Waltz’ dont la mélodie si particulière et jubilatoire nous rappelle immanquablement Faith No More. Mention spéciale au magnifique ‘Lover’s Sky’ sur lequel les guitares semblent pleurer (Je vous jure, j’ai rien fumé avant d’écrire cette chronique !).Bref, MOR nous prouve une fois de plus son talent immense. C’est très bien écrit, magnifiquement interprété et admirablement produit. Un disque à écouter de toute urgence.
“Roll out the rock” regroupe vingt titres disséminés sur des 45, splits et autres compilations à travers le monde. Excellente initiative puisqu’elle permet d’entendre le traitement qu’inflige Ironboss à des titres de groupes tels que Cactus (« Rumblin’ man », très heavy), AC/DC («Whole lotta rosie », dans une version proprement géniale : intro au banjo, chant a cappella, puis déflagration, re-banjo pendant le riff qui tue, TERRIBLE !), Saxon (« Motocycle man », version studio supérieure à la version live) ou encore Van Halen (Everybody wants some », ils doivent se foutre de la gueule d’Eddie). On y entend également quelques titres inédits d’excellente facture, des morceaux truffés de gros mots, blasphèmes et autres cris d’animaux, des blues à l’ancienne comme le superbe « Dirty rotten stinkin’ fuck », des punkeries comme « Ironboss ». Bref, que du très bon.
 Pas évident de rester objectif face à un tel album. Scott Reeder, outre le fait qu’il déborde de talent et présente un CV à faire pâlir d’envie n’importe quel bassiste, bénéficie également d’un énorme capital sympathie chez ceux qui connaissent un tant soit peu le personnage.
C’est néanmoins la surprise, voire la déception, qui s’empare de l’auditeur une fois ce CD enfourné. Reeder prend tout le monde à contre-pied en proposant treize titres essentiellement électro-acoustiques à mille lieues de ce qu’il a pu faire avec The Obsessed, Kyuss ou Goatsnake, groupes pour lesquels il n’a néanmoins jamais été qu’un musicien de passage et pas un membre fondateur. Ce qui ne l’a pas empêché de contribuer occasionnellement à l’écriture de certains morceaux, fait d’autant plus remarquables lorsque les leaders s’appelaient Wino ou Josh Homme.
On pourrait trouver mille influences et autant de comparaisons, mais comment un album composé et enregistré sur une période de 18 ans peut-il souffrir ce genre de procédés ? On imagine que sur un tel laps de temps, Scott a du emmagasiner assez de titres pour sortir trois albums, dont un aurait pu être farouchement heavy. Lui a préféré sortir les chansons qui lui tenaient le plus à cœur et on ne peut que respecter ce choix. Par contre, le traitement donné à ces compos est beaucoup plus discutable. On sait que Scott vit depuis quelques années reclus dans sa ferme, consacrant son temps à l’élevage de toute une ménagerie. Ce cadre champêtre aurait pu influencer le son de cet album, lui donner un côté très organique, très dépouillé. Au lieu de cela, on se trouve face à des morceaux parfois surchargés d’effets, la guitare semble horriblement synthétique à quelques exceptions près (« When ») et on regrette souvent l’utilisation abusive de Pro Tool. Quand Scott troque la batterie pour une boîte à rythme et un séquenceur (« For Renee », « Fuck You All »), on se dit que si le mix mettait moins la voix et la guitare en avant, on se retrouverait avec un morceau de Trip-Hop quelconque. Et que dire de « Away » qui sonne comme du Tangerine Dream dans sa période la plus pénible ? On en oublie même qu’on a ici affaire à un dieu de la basse, fort discrète excepté sur « Queen of Greed » pour lequel Scott ne recourt qu’à son instrument fétiche. Au milieu de tous ces titres légers et aériens empreints de mélancolie, seuls « Diamond » et « Day of Neverending » pourraient séduire les inconditionnels de rythmiques qui roulent et de riffs acérés, dont il donne une version très personnelle, alors que le break très court de « The Fourth » constitue le seul passage vraiment heavy de l’album.
Malgré des choix de production pas toujours opportuns, « Tunnelvision Brilliance » comporte son lot de compositions de qualité portées par la voix très agréable de Scott Reeder et exécutées de façon honnête mais sans grande originalité. Certains seront séduits, d’autres crieront à l’hérésie mais personne ne restera indifférent face à ce disque très (trop ?) attendu.
C’est du made in Japan mais ça sonne vrai, Eternal Elysium est un trio venant du pays du soleil levant qui se distingue par un son et des riffs façon 70’s heavy rock tels que Led Zep, Grand Funk Railroad ou encore Black Sab.
Même si le groupe vient juste de signer sur ce nouveau labl belge, il n’en pas à ses débuts, loin de là! Ces mecs ont sorti leur premier album full length en 1995, ainsi que 3 autres en 2000, 2002 et 2005 sur des labels différents. On comptera aussi 1 DVD compile (avec Boris, Church of Misery…) et 2 apparitions sur des compiles en 2000 et 2001. Enfin, le groupe a déjà aussi opté pour la formule split CD, l’un avec Of The Spacistor en 2003 et l’autre avec Black Cobra en 2007. Au fait, c’est justement des morceaux de ce split avec Black Cobra dont il s’agit ici, augmenté d’une plage aux relents doom psyché.
Alors, ça se présente comment, docteur? Et bien, nous avons ici 4 morceaux aux tempos engagés qui me laissent penser que le groupe est plus psyché 70’s que réellement doom. Les attaques de la batterie et les grooves allumés qui en ressortent me aussi confirment cela, le tout tapissé par des couches de solo plutôt longuettes mais ma foi très bien agencées. On sent très bien que les musiciens se connaissent parfaitement que le moindre changement peut s’opérer sur un battement de cil, le tout sur une tonalité et dans une harmonies parfaites.
Le gratteux s’en donne à cœur joie avec son vieux phaser et sa wah-wah et les titres gagnent en profondeur. Si la voix est correcte, elle n’est néanmoins pas typée et peut être citée comme l’élément plutôt faiblard du trio. rien à redire du côté du couple basse/batterie. L’ensemble sonore flaire le vintage et on devine aisément la poussières sur les vieux stacks d’ampli à tubes.
Bref, on a ici des orfèvres du son à l’ancienne dans des morceaux fouillés aux durées fidèles à l’époque (comptez 6 à 8 minutes par plage). Le groupe gagnerait néanmoins en plénitude avec un chant plus puissant et plus affirmé.
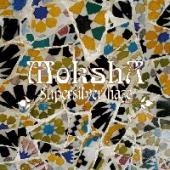 Voilà un album sans aucune concession, ce genre d’album que l’on déteste ou qu’on adore.Ce quatrième album du groupe est assez différent des précédents car plus influencé Doom. On n’y retrouve pas forcement les longueurs pesantes de ce style si particulier puisque avec les neuf titres cumulés on arrive à la demi heure, mais les lourdeurs, n’y voyez pas là un gros mot, sont omni présentes et bien pesantes. On a donc ici un pur concentré d’énergie et de brutalité le tout dans un dosage savamment orchestré.N’étant pas un véritable fan du genre, je dois tout de même bien avouer que je me suis surpris quelques fois à secouer la tête face à cette machine à riff. Bien entendu, il vous faudra passer le cap du chant qui comme dans beaucoup d’album de ce genre est typique. Mais les morceaux que sont « Down The Sun », « Neurons » ou encore « Voices Of The Street » pourraient bien vous aider à appréhender le genre avec une oreille plus attentive. Et que dire de la surprenante reprise de Janis Joplin (Move Over).Bref, ça cogne fort, ça change de rythme à tout va et ça ne vous laissera certainement pas indifférent même si je vous l’accorde, ce n’est pas exactement le style que je préfère.Un petit mot, même si ce n’est pas le plus important, sur un artwork particulièrement réussi et réellement surprenant pour ce style de musique.A noter que Moksha est un groupe assez prolifique puisqu’il s’agit tout de même là du quatrième album en quatre ans !On peut donc s’attendre à un nouvel opus d’ici peu de temps et qui, une fois de plus, sera peut être totalement différent de celui-ci !
La quantité et la qualité de sa production ces dernières années font de Small Stone l’un des labels les plus excitants pour tout amateur de stoner. Avec un roster contenant certains des plus grands groupes de stoner du moment, le label de Detroit est aussi le havre de quelques groupes plus éloignés du genre, mais qui fricotent régulièrement avec leurs copains d’écurie (tournées en commun, compilations, splits…). Le point commun de ces groupes tient à leur état d’esprit, leur authenticité, leur attitude “100% Small Stone approved”… et (souvent) leur talent ! The Brought Low est de ces groupes.
The Brought Low représente probablement l’un des meilleurs groupes de classic rock / rock sudiste “modernes”. Assez éloignés de la tendance plus “folk”/country dans laquelle peuvent parfois verser ce type de groupes, TBL trouve ses racines directement chez les meilleurs : Lynyrd Skynyrd d’abord (le chant, les choeurs, les guitares…), puis les Allmann Brothers of course (les instrus frénétiques, les “presque jams” sur disques qui, probablement, donnent de “vrais” jams sur scène…). Mais le groupe, à l’instar d’un Big Chief ou d’un Raging Slab, a su piocher dans le hard rock le plus pêchu pour développer le genre (voir “Everybody loves a whore”). On entendra même des passages rappelant le ZZ Top de la fin des années 70 (“My favorite waste of time”), ni totalement bluesy, ni totalement hard rock, mais furieusement boogie.
Cet album au sobriquet ridicule propose donc 9 titres fort agréables, et très variés, sans jamais perdre le fil rouge southern rock. Entamant très fort par un imparable “Old Century”, le groupe aligne une splendide triplette très “skynyrdienne”, plutôt rapide et rock. L’acoustique “A thousand miles away”, mid tempo très bien fichu, annonce une sorte de “ventre mou” de l’album, avec quelques titres plus lents… mais aussi les plus “traditionnellement” sudistes. Du coup on ne s’ennuie pas, jusqu’à ce très bon instrumental de clôture, “Slow your roll” (qui porte mal son nom).
Au final, cet album en touchera une sans bouger l’autre au fan hardcore et exclusif de stoner, mais il devrait faire baver tout amateur de classic rock et de rock sudiste qui se respecte. Si vous êtes entre les deux, cet album reste une acquisition intéressante.
Non, vous ne rêvez pas, sont bien crédités pour ce premier titre les musiciens de Pink Floyd et non le géant Moss. Normal pour un expérimentateur comme lui de reprendre un groupe qui fut lui aussi à la pointe de l’innovation. En fait, Moss annonce la couleur en gros sur la pochette parodiant celles des sorties classiques ou jazz, cet album qui n’en est pas un (catalogué ep ou lp, cela dépend selon les sources), sera la synthèse de mois d’expérimentations sonores centrées sur un effet propre à l’amplification électrique, le feedback ou boucle sonore expansive.
Ce premier titre, donc, vous cueille d’emblée par ses 12 minutes et illustre parfaitement ce terme de synthèse, puisqu’il est en fait composé de 4 ré-interprétations du titre de la bande de Waters. Ce ne sera pas le seul morceau maltraité, puisque Lemmy en fait aussi les frais via 3 versions de son titre ‘Sister’.
Moss montre également qu’il n’est pas un simple musicien mais aussi un compositeur et nous assène entre 3 titres, disséminés ici et là, de pur feedback (totalement déjantés et excellents mais sans aucune aspérité mélodique à laquelle se raccrocher, vous voilà prévenus), de graves morceaux plombés de stoner/doom, à la production sans doute moins puissante et massive que son successeur, mais tout aussi appréciables.
La lecture du livret s’avère très enrichissante tant les premières écoutes de ce disque nous laissent perplexe devant un tel mur de saturation poisseuse ( la voix lymphatique d’ours mal léché de Moss renforçant ce sentiment de malaise). On y apprend que forcé à un mutisme total suite à une opération des cordes vocales (nodule formé suite à des années d’excès, si ça peut en avertir certains), Moss et son compère de studio Goldring durent communiquer par signes puis s’inventèrent carrément des dialogues soniques (comme le démontre la conversation de guitares de ‘Feedback IV’).
Cet exemple vous aura fait comprendre, j’espère, que ce disque est bien moins terre à terre (ou plutôt cieux à cieux dans ce milieu) que la plupart des productions habituelles du style. Moss explore la saturation comme d’autres la biologie moléculaire et même si l’on n’a pas besoin de doctorat pour l’écouter, cet album nécessite bien plus d’attention et de concentration que la cacophonie des premiers passages sur la platine ne le laissait penser.
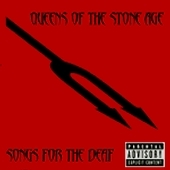 Pourquoi tergiverser : ce que vous avez entendu ou lu ici et là est vrai, totalement vrai : cet album est effectivement l’album de l’année. Tous genres confondus. C’est d’ailleurs bien là que se situe la plus grande prouesse du groupe : être aussi bon dans tous les genres, à tous les niveaux. Les compositions sont imparables, il s’agit bien là d’un album de chansons – pas forcément homogène de par les genres musicaux, mais bel et bien homogène dans la qualité, constante du premier au dernier titre. Des chansons que l’on ne se lasse pas après plusieurs mois de redécouvrir, tels le single ‘No One Knows’ (d’abord déstabilisant, il est vrai), le catchy ‘First It Giveth’, les expéditifs ‘Six Shooter’ et ‘You Think I Ain’t Worth A Dollar But I Feel Like A Millionaire’ (que l’on trouvait déjà, comme ‘Hangin’ Tree’, sur les mythiques ‘Desert Sessions’ du sieur Josh Homme), le somptueux ‘Go With The Flow’, le jovial ‘Another Love Song’, etc. Difficile en réalité de ne pas citer l’un des titres, cet album ne souffrant d’aucun point faible, aucune baisse de régime. Les musiciens, on le savait déjà, sont impeccables, Josh Homme en tête (formidable vocaliste désormais) secondé par Nick Oliveri, mais aussi le furieux Dave Grohl derrière les fûts, excellant sur toutes les chansons, sans parler des dizaines d’invités qui apportent tous une touche spéciale aux chansons. Quel que soit votre genre de prédilection, il y a quelque chose à boire ou à manger pour vous sur cet album (Ok, assez peu de black metal ou de death tout de même), et vous en redemanderez !
 Il est plus que temps d’arrêter de chialer sur les cendres de Kyuss, surtout lorsque le géniteur ultime du genre stoner tout entier accouche d’autant de géniales entités, Unida et Queens Of The Stone Age en tête. QOTSA, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, proposait il y a moins de deux ans l’un des albums les plus originaux et excitants de la décennie. Brassant des dizaines d’influences musicales différentes, le trio/quatuor (selon les périodes) s’affirmait déjà comme un groupe hors norme bourré de talent (on hésite toujours à parler de génie), alignant les performances scéniques de grande qualité. Manquait toutefois au groupe une confirmation discographique de ce talent, et il n’a pas fallu attendre longtemps pour cela, car voici déjà leur second méfait. Piétinant méchamment l’étiquette stoner, Josh Homme et ses acolytes se servent de leurs influences passées pour pondre un album rempli jusqu’à la gueule de chansons mémorables, de mélodies catchy cachées sous des riffs énormes, de paroles et de thèmes drôles et cyniques à souhait (il faut oser le “C-c-c-c-cocaïne” du refrain de ‘Feel Good Hit of the summer’, le morceau étant en fait un inventaire de toutes les drogues existantes en ce bas monde!). 11 chansons originales et différentes, qui s’agencent ensemble comme par magie pour former un album aussi énorme qu’indéfinissable. Car traiter du genre musical abordé est vain, chaque chanson apportant une tonalité différente à l’ensemble, tout en gardant le même son de guitare, de basse, etc… Ne parlons pas des invités musicaux, de Rob Halford aux Screaming Trees, leur apport est si naturel qu’on les remarque à peine. Si vous êtes scotchés sur un genre musical (quel qu’il soit), passez votre chemin, par contre, si vous pensez avoir l’esprit ouvert musicalement, vous ne pouvez décemment pas être déçu par cet album. Ne vous fiez pas au ‘Restricted to everyone, everywhere, all the time’ de la pochette, cet album est à écouter par tout le monde, partout, et tout le temps.
 Un nouveau Bongzilla, c’est toujours un petit événement dans la sphère “secondaire” du stoner au sens large, l’un des groupes qui traînent dans l’orbite plus ou moins rapprochée de notre genre de prédilection. Néanmoins, Bongzilla a toujours ce lien ferme, assuré, sans ambiguïté, qui le lie au stoner-rock “traditionnel”. Historiquement, serait-on tenté de dire, Bongzilla, qui restera toujours affilié dans nos esprits aux définitifs Weedeater, reste le chantre, le héraut d’une certaine idée du stoner (qui leur est propre, c’est ça le plus fort !) qui met tout le monde d’accord. Respect. Et ce n’est pas uniquement dû à leur goût immodéré (et un petit peu monomaniaque, quand même !) pour l’herbe qui fait rire. Musicalement, ensuite, les riffs sont lourds, pachydermiques, répétitifs et lancinants (ils tournent en boucle sans fin, selon le célèbre adage : “pourquoi arrêter de jouer un riff si tout le monde ne le connaît pas encore par cœur”), on est en terrain ultra connu. Ultra jouissif aussi, ne nous y trompons pas, on se laisse baigner par ces rythmiques roboratives avec un plaisir évident, sans arrêt sur le qui-vive, entre nonchalance et réveil brutal.Après, y’a ce chant. J’avoue, c’est pas ce que je préfère chez Bongzilla, mais ça ne change pas : ça éructe, c’est hurlant, nasillard, on dirait Mortiis mélangé à Matt Pike ! Ces vocaux glaireux au possible participent largement aux tonalités sludgesques de Bongzilla : la musique du combo suinte littéralement la sueur, les lignes de basse sont la seule part “rigide” de cet édifice craspec et visqueux, érigé à la gloire du fuzz le plus crade. Du bonheur en rondelle, donc.Au final, vous l’aurez deviné, ça reste une valeur sûre : 7 titres longs, sinueux, composés pour être parfaitement et spécifiquement propices au fumage de joints, mais que l’on peut apprécier (ce fut mon cas) sans même s’adonner au loisir préféré de nos gaillards.
Facile de résumer de disque, il se compose de tous les éléments assurant un bon disque de stoner/doom. Il représente à tel point la quintessence du genre qu’il fait partie de mon top 10 personnel depuis déjà moult années sans avoir perdu la moindre place, si cela peut servir de gage de qualité.
A ne pas confondre avec ses deux homologues américains, dont celui officiant dans un registre sludge à l’humour décalé façon Anal Cunt et responsable d’innombrables morceaux sur une montagne de supports divers et variés, ce Sloth anglais n’a sorti que cet unique album. Pour la petite histoire, il compte dans ses rangs le bassiste Will Palmer, co-gérant du label de Lee Dorrian (Cathedral), celui qui met les disques dans les colis que vous commandez chez eux. Il fit courir autrefois ses doigts boudinés sur son manche (de basse, voyons) pour le compte d’un obscur groupe doom du nom de Mourn.
Je parlais il y a un instant des qualités de The Voice Of God. Elles sont simples :
Ce groupe joue d’une façon ultra lourde. La production est dantesque, plombée et bourrée d’effets cosmiques totalement planants. Ces mecs jouent comme s’ils étaient le Sabb’. Ca riffouille comme aux grandes heures de Iommi et sa bande, entre gros morceaux avec une de ces patates, moments plus bluesy, voir carrément lysergiques, intervenant même un interlude instrumental où on frôle le génie en quelques misérables notes. La basse est caverneuse, la batterie survoltée et totalement claquante, les guitares plombent l’atmosphère avant de partir en grosses volutes fuzz, et la voix, qui va plutôt chercher ses influences du côté de l’école américaine( Trouble, St Vitus) que de celui d’Ozzy, colle parfaitement à l’ensemble. Une fois dans l’album, on n’a plus qu’une seule envie, se balancer en rythme.
Gros morceau que ce disque. On regrette une chose, une suite qui ne cesse d’être évoquée puis repoussée. En espérant qu’ils ont gardé la même verve musicale en 6 ans de silence discographique.
 Dixie Witch est sans doute le power trio le plus excitant du Sud des USA, du Texas pour être précis. En purs texans, ils ont cette fibre bluesy, ce groove indéfinissable (que l’on retrouve aussi chez l’autre grand trio texan, ZZTop, excusez du peu), ce à quoi ils ajoutent leur marque de fabrique : des passages heavy, des soli limpides et percutants, des riffs efficaces, une batterie presque jazzy parfois, et une ambiance 70s très appuyée. Que du bonheur ! On passe de morceaux heavy, endiablés (“Get Busy”, “More Of A Woman”), à d’autres plus calmes (“The Wheel” ou “Makes Me Crazy”, très Lynyrd Skynyrd, ou “On My Way” que l’on croirait issue du répertoire de Gov’t Mule), sans jamais se défaire d’un sens de la mélodie tenace, le tout bercé par des instrumentaux toujours bienvenus, aidés par des plages solo jamais “masturbatoires”, toujours empreintes d’un feeling chaleureux “Feeling”, c’est bien le mot clé de cet album, des sensations à la pelle, une ambiance, et de la bonne musique. Que demander de plus ?
Qu’est ce qui peut encore nous pousser à chroniquer les albums de Queens Of The Stone Age sur desert-rock.com ? La question se pose déjà depuis plusieurs albums car mise à part l’album éponyme du groupe qui avait un vague arrière goût stoner, force est de constater que nous en sommes maintenant éloignés de très loin. Mais le passé du leader de ce groupe est tel que nous ne pouvons décemment pas ignorer non plus cette sortie. Bref, vous l’aurez compris, point de stoner rock ici, que ce soit de près ou de loin.
La sortie d’un album de Qotsa, que l’on soit fan ou pas, reste un événement que certains attendent avec impatience. Voilà comment j’aborde les premières écoutes de ce nouvel opus qui répond au doux nom de Era Vulgaris.
Turning On The Screw entame le bal. Voilà que commence le long défilé des déceptions que va m’apporter ce disque qui, disons le tout de suite, n’est pas pour moi une réussite, bien au contraire. L’équilibre bancal de ce titre me laisse perplexe. On ne sait pas sur quel pied danser et les quelques trouvailles qu’apporte ce titre sont noyées dans un marasme consternant.
Sick, Sick, Sick nous envoie enfin la sauce avec une intro directe et un chant rapide dès plus agréable. On enchaîne rondement les couplets, refrains et parties musicales avec la plus grande efficacité. Un titre somme toute réussi et très rock’n’roll.
I’m a Designer fait un peu retomber la sauce avec son rythme qui ne tiendra pas la durée et les écoutes multiples, surtout son changement de rythme raté suivi d’un solo noisy pas franchement bien placé. Un titre qui pourra surprendre à la première écoute mais qui risque fort d’en faire appuyer plus d’un sur la touche « skip » de votre lecteur cd si vous voyez ce que je veux dire. D’autant que le titre, un petit peu trop long aurait certainement gagné à être légèrement raccourci.
Les fans connaissaient déjà le titre Into The Hollow qui fut joué en concert avec Chris Goss bien avant sa sortie sur cet album. Une belle chanson comme ce groupe sait (savait dirons certains) en faire, calme et agréable, agrémentée de jolis effets de guitares. Si vous faites abstraction de la tentative lyrique de Josh Homme au niveau de la voix, vous trouverez certainement ce titre réussi tout comme moi.
L’intro de Misfit Love est excellente avec un son assez lourd, assez pesant. Des effets de guitares multiples, certains répétitifs et d’autres pas apportant un variété bien sentie. Le chant (parfois un peu trop forcé) se calque à ce rythme de façon particulièrement réussie et font de ce titre l’un de sommet de cet album. Dommage que le reste ne soit pas de ce niveau.
Désagréable, voilà bien un terme qui me vient rarement en tête lorsque j’écoute pour la première fois un titre. C’est pourtant le cas ici avec Battery Acid. Le faux rythme lassant et saccadé, base de ce titre, n’en fait pas une réussite. Un titre qui lassera sûrement très vite, pour ne pas dire immédiatement. Un peu trop lent, je pense que ce titre aurait davantage gagné à être joué sur un tempo légèrement plus rapide.
La tradition qui veut qu’un titre extrait des dessert sessions finisse inévitablement sur un album de Qotsa est ici confirmée avec Make It With Chu (Desert Sessions volume 9). Ce principe ne m’a jamais dérangé outre mesure, mais pour le coup, Josh aurait pu s’en passer. Pas tant que le titre soit mauvais mais plutôt qu’il a déjà été exploité sur l’album live du groupe. De là à dire que y’avait pas grand-chose d’autre à prendre sur les derniers volumes des Desert Sessions, il n’y a qu’un pas.
Le hit single censé promouvoir la sortie de l’album nous arrive (qui a dit « enfin »). 3’s & 7’s est très calibré radio. La longueur, la construction, le rythme, le solo, tout ici fait penser à un titre de commande. « Il nous faut un titre qui puisse passer sur MTV avant 22h », voilà ce que ce titre crie haut et fort. Attention, je ne dis pas que le titre soit mauvais, si vous avez aimé Little Sister, vous aimerez celui là, la comparaison parle d’elle-même.
La ligne de basse trop basique pour être mise en avant comme cela et un changement de rythme moyennement réussi en fin de morceau, voilà qui n’est pas très engageant pour le titre trop simpliste qu’est Suture Up Your Future. Dans la lignée des morceaux « calmes » du groupe, celui-ci n’en a pourtant pas le niveau. De bonnes idées moyennement bien exploitées.
L’intro de River In The Road est ignoble. Je pensais que ma femme avait encore mis une de ces compil’ des années 80. Le reste du titre est une masse informe qui se termine de piteuse façon. Je me demande pourquoi ce titre n’a pas été écarté.
Run Pig Run clôt le défilé. Va-t-il remonté le niveau in extremis ?Même pas. On peut même dire que l’on touche le fond avec le changement de rythme absolument ridicule de ce titre. N’en jetez plus, la coupe est pleine.
C’est dingue parfois comme on peut être déçu par l’un de ces groupes favoris. C’est le cas aujourd’hui.J’ai appris à apprécier certains titres du groupe avec le temps, certaines chansons qui ne m’inspiraient pas au départ sont devenues des classiques. Pour le coup, j’ai des doutes, d’énormes doutes que le temps fasse son œuvre et me fasse découvrir en Era Vulgaris un album finalement bon.
|
|