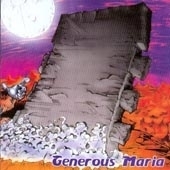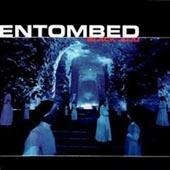|
|
Y a pas de doute, ces suédois connaissent leur Kyuss sur le bout des doigts. Ils nous annoncent d’entrée que le groupe de Palm Springs constitue un élément actif de leur appareil respiratoire. Me concernant, j’aurais plutôt appelé cet album « Suffocating » tant l’oxygène y est raréfié. Seuls les solos se dégagent un tant soi peu de ceux de Josh Homme. C’est le seul moment où on respire un peu. Kyuss semble être une nouvelle religion en Suède, tant les groupes du coin s’y apparentent. Mais comme c’est le cas pour la majorité des religions, leur dogmatisme finit par vous écœurer. Dans la musique comme dans la spiritualité, l’issue est ailleurs que dans la pensée unique.
Encore un manque inadmissible. J’ai bien compté, j’ai regardé dans tous les coins, non et non, il manquait bien sur Desert-Rock l’album de COC, Wiseblood. ‘blablabla’ allez vous me dire, ‘l’album de COC’ c’est Deliverance. Oui mais non. Deliverance était sans nul doute le premier pas affirmé des sudistes sur la voie du southern metal couillu et mélodique, les dignes remplaçants de Lynyrd Skynyrd, au dépends des braves Raging Slab, mais la puissance de feu n’était pas encore leur. Avant de se radoucir sur l’excellent ‘America’s volume dealer’ et de vieillir comme un bon whisky sur ‘In the arms of god’, les ricains firent vraiment parler la poudre sur Wiseblood. A l’image de son icône, ce porc rouge, l’heure n’était pas à une quelconque finesse.
Dès le monstrueux ‘King of the rotten’, une des plus grand hymnes du groupe, Keenan, qui s’accapare définitivement le songwirting et signe ses meilleurs morceaux dont il n’égalera la qualité que sur Down, qui, quand on y réfléchit et écoute bien, n’est qu’un clone de COC, une louche de feeling blues en plus (ce qui n’est pas pour me déplaire, plus y’en a plus c’est bon !).
Les riffs s’enchaînent avec une véhémence rare, la batterie de Mullin sonne comme jamais, son absence se fera cruellement ressentir sur le petit dernier et la basse groovy de Dean n’est pas en reste, apportant la puissance et l’épaisseur à une production qui n’est pas en reste, limpide mais pourtant sale et dégoulinante comme un vieux pick-up. COC a trouvé son son, entre le metal tranchant et le blues dopé aux quaaludes. Les élans mélodiques comme ‘Goodbye Windows’ sont la virtuose démonstration des talents mélodistes des deux guitaristes et de celui de chanteur de Keenan qui est habité par sa musique.
Tour à tour jammesques ou violents, les riffs marquent au fer rouge ces 13 morceaux qui composent la bande son parfaite pour une virée de fin d’après midi estival, l’odeur du bitume mêlé à la gomme se mélangeant à celle forte et ambrée d’un pack de six. Ces gars ont laissé parler la poudre et ça ne m’étonnerait pas que quelques effluves de brûlé ne sortent de vos enceintes.
Un grand disque.
 Evoquer THE OBSESSED dans ces colonnes sans parler de Wino serait proprement scandaleux. A l’image d’un Thor Hayerdal entêté et déterminé à faire traverser au Kon-Tiki les 8 000 km qui séparent le Pérou de la Polynésie, Wino chanteur-guitariste (brillant) de son état, s’est embarqué avec deux jeunes coéquipiers sur son nouveau navire baptisé SPIRIT CARAVAN, un temps nommé SHINE. Si le radeau de Hayerdal prêtait à sourire au vu de ses ambitions, il n’en va pas différemment des pochettes de SPIRIT CARAVAN. Vous seriez mal inspirés de vous y arrêter. Elles sont affreuses (surtout Dreamwheel), mais tant pis. C’est le contenu qui importe, la foi qui anime les hommes dans leurs projets. Force est de constater que le capitaine Wino et ses équipiers nous arrivent dans d’excellentes dispositions. Sa voix (qu’il a plus éraillée qu’auparavant, se rapprochant en cela, par moments, de celle de Lemmy), son jeu de guitare sont toujours aussi emphatiques. Du heavy rock en accords mineurs. Triste et beau à la fois. Confinant au sublime du début jusqu’à la fin, Fang me semble être la figure de proue de l’album. Fier et majestueux, le navire SPIRIT CARAVAN va jusqu’à repousser les limites de son expédition en s’aventurant dans les eaux troubles mais ô combien exaltantes d’un boogie rêche et râpeux. Tout pareil pour le MCD qui conforte l’idée selon laquelle ce groupe est réellement composé de tueurs touchés par la grâce. Aligner autant de morceaux de qualité dans une même année est réellement époustouflant. Grand.
En recevant ce skeud, j’ai bien cru que cette agréable (bien qu’approximative) actrice qui avait suscité tant d’émois suite à sa prestation dans Wayne’s World, s’était mise à la musique. Non, Tia Carrera n’est pas l’extension musicale de Tia Carrere, juste un putain de bon trio d’Austin, Texas, manifestement plus doué à astiquer des manches de gratte qu’à trouver un nom pour son groupe !
Après un album studio et un live, Tia Carrera sort donc cet EP, extraordinaire de bout en bout. Extraordinaire car quintessence du genre : imaginez un trio de texans (inutile de préciser que le boogie est dans leurs gènes et suinte du moindre solo) qui rentrent en studio pour la journée, branchent peinard leurs instruments, appuient sur “Record” et se mettent à jouer. A la fin de la journée, ils appuient sur “Stop”, coupent dans le gras, et aboutissent à un EP obèse de soli et de riffs magnifiques. Trois chansons, 30 minutes, plié.
Trio uniquement instrumental, Tia Carrera ne vit manifestement que pour jammer (voir leur site où des enregistrements live sont en téléchargement régulièrement), et ils s’y entendent, les requins : tout paraît improvisé, les soli déboulent non stop sur des chapes rythmiques tour à tour heavy, prog, jazzy, bluesy.
Evidemment, le charme suranné des 70’s est bien là, alimentant toujours un peu le cliché comme quoi le genre se mord un peu la queue (et tourne en rond). Mais en même temps, pourquoi bouder notre plaisir ? Une galette de cette trempe tous les mois réconcilierait n’importe qui avec le stoner.
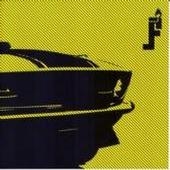 Chez Ishii Kamikazi Records, on ne fait pas les choses à moitié. Le label sort simultanément deux galettes dans un registre très proche pour se lancer. Originaire du même coin de Suisse qu’Ärtonwall, Feuerzeug pratique comme eux un rock sévèrement burné qui mixe des plans stoner dans la veine des formations suédoises et des gimmicks grunge.
Assez abordable par le commun des amateurs de rock indépendants, le style Feuerzeug rappelle autant El Caco que Nirvana. Certaines des douze compositions au sommaire de cette production font mouche à la première écoute à l’instar de ‘Cocaïne’ qui propose un bon gros riffs bien gras tiré en avant par une section rythmique carrée et un refrain speedé qui fait tout son effet. D’autres, plus complexes ou tordues, comme ‘Go Liar !’ explorent des horizons musicaux moins évidents avec une lourdeur à la limite du doom.
Ces types-là fuient la monotonie comme la peste néanmoins ils nous gratifient d’une galette homogène dans son approche traditionnelle d’un style aussi daté qu’indatable. Si l’ombre de Kurt plane sur les quatre premières plages, elle s’estompe titre après titre et, une fois ‘My Home, Our Church’ entamé on savoure du bon vieux fuzz proche de celui que propose les Truckfighters.
La production très brute de ce cd lui donne un rendu sauvage fort appréciable et franchement des bombes comme ‘San Francisco’, à qui va ma préférence, c’est tout bonnement imparable !
Encore un groupe suédois, venu de nulle part, et tout prêt à se battre comme un beau diable pour obtenir sa part du gros gâteau rock’n’roll ! Le premier album de Generous Maria est une vraie claque : sans révolutionner quoi que ce soit, les Suédois s’appuient sur des riffs bien sentis débités par une paire de grattes bien efficaces et un chanteur puissant et finalement original. Il n’en faut pas plus pour fournir à l’auditeur lambda sa dose de bon gros hard rock ‘à la scandinave’. Et ils mettent du cœur à l’ouvrage, les bougres, n’oubliant pas au passage de varier les compos pour ne jamais ennuyer (‘Big Shiny Limo’, ‘Soulflight’, le jouissif instrumental ‘Ashram Of The Absolute’), sans pour autant digresser et se laisser aller dans des sentiers qu’ils maîtrisent moins. Même s’ils sont précédés par bon nombre d’autres groupes suédois ou scandinaves dans cette même mouvance, Generous Maria mérite indiscutablement sa place au soleil.
 Deux ans après Ultra Electric, Sixty Watt Shaman revient avec ce Seed of Decades, qui, contrairement à son prédécesseur, ne laissera pas l’auditeur sur sa faim. En effet, dès l’entame de ‘Fear Death by Water’, on sait déjà que l’on a entre les mains un classique du Stoner.
Le groupe a énormément progressé durant l’intervalle. Les titres sont beaucoup plus accrocheurs que sur Ultra Electric et permettent enfin à Dan Kerzwick de montrer toute l’étendue de son talent de chanteur. Ajoutez à cela le jeu parfaitement maîtrisé de Joe Selby (guitare) et de Jim Forrester (basse) et vous obtenez un cocktail vraiment détonnant de heavy matiné à la sauce des 70’s.
A l’écoute de l’excellent ‘Poor Robert Henry’, du rageur ‘Devil in the Details pt. 1’, ou du très groovy ‘Low Earth Orbit’, on reste tout simplement sidéré par une telle qualité. Et quand arrive le cultissime ‘Roll The Stone’, c’est le coup de grâce et on en redemande.Cerise sur le gâteau, nos Shaman ont réenregistré les deux meilleurs titres de leur premier opus : ‘Rumor Den’ et ‘New Trip’. Ce Seed of Decades est donc à écouter de toute urgence. Un indispensable dans toute CDthèque stoner qui se respecte.
Je vais pas en faire des tonnes avec cette chronique. Shame Club n’est pas un groupe qui rentrera au Hall Of Fame, et cet album, modeste, est juste une petite pépite sans prétention. C’est un album de rock, du gros qui tâche, imprégné de boogie rock, veine sudiste légèrement marquée, mais surtout bien ancré dans une tradition de rock britannique fin 70/début 80, quand c’était fun et débridé. Du travail d’artisans, de l’ouvrage de passionnés, le travail de 3 lascars qui jouent de leur instrument les yeux fermés, sur des scènes sentant le houblon, différentes tous les soirs, et qui écoutent des vieilles cassettes audio dans leur van en route vers leur concert suivant. Vous l’aurez peut-être oublié dans 2 ans, ce disque, mais quand vous le ressortirez, plein de poussière, pour le réécouter, vous vous le direz à nouveau : “putain, c’était bon, ce truc, ça s’appelait comment déja ?”.
 Voici que ressort “Tab”, l’album (EP plutôt) qui succéda à “Spine Of God”. Un séquencement en tous points anachronique, puisque le morceau phare de cet EP (“Tab” en l’occurrence) a été enregistré avant “Spine”. Et ça se sent ! En effet, que dire de cette plage de quasiment une demi-heure totalement aérienne, pur trip musical sous acide, chargé de hautes doses de Hawkwind, Procol Harum ou Amon Düül. L’ensemble se tient bien, avec sur une même base rythmique des fulgurances guitaristiques gonflées de nuées opiumesques, de bruitages zarbi, du chant lointain de Wyndorf (peu reconnaissable), le tout se confondant dans une atmosphère qui se voudrait orientale, mais qui n’évite pas l’écueil de devenir clichesque, avec le recul. Car oui, à l’époque (début des années 90), Monster Magnet était l’un des rares porteurs de l’étendard rock 70’s tendance “acid trip”, bien après ses instigateurs, et bien avant un retour en “grâce” (toute relative) du stoner au sens “pur” du terme. Ce qui paraissait donc, en 1990, comme un intéressant revival, paraît aujourd’hui plus daté. On préfèrera largement l’orientation plus “construite” que Wyndorf impulsera avec “Spine Of God”.”25″, l’autre plage “fleuve” de cet EP, est à l’unisson, vraiment, même traitement, mais sur 12 modestes minutes seulement (!).Les deux morceaux suivants se laissent écouter, avec la même perplexité : le bien nommé “Longhair” laisse imaginer quelque hippie se rouler un quatre-feuilles de compétition, pour mieux s’enquiller un “Lord 13” intéressant en terme de songwriting, mais qui ne vaut, clairement, que pour sa valeur de témoignage historique, tant sa production (un vieil enregistrement pourri sur un 4-pistes) est difficilement supportable.Un titre bonus vient clore cette réédition, sous la forme d’une version live de “Spine of God”, pas transcendante, mais néanmoins assez “trippante” quand on réalise la grosse machine à hard rock formatée qu’est devenu Monster Magnet. Le virage discographique du groupe n’en devient que plus marquant (et toujours surprenant, même si très bien négocié).
 Ouille, ouille, ouille. Le boîtier a du mal à s’ouvrir. Je me casse un ongle en le forçant. Il me glisse des mains et atterrit sur mon orteil nu. Zac. Mon sang s’écoule en deux endroits. Avant d’aller me désinfecter, je charge mes genoux de fléchir pour laisser ma main valide introduire le CD dans le lecteur. En me relevant, paf, je me cogne le haut du crane dans l’étagère. Jurons obscènes. Avant même d’avoir entendu un seul larsen de ce disque, ma chair souffre déjà . Et des larsens il y en a sur ce disque. Chacun des six morceaux de cette galette en est précédé. Prémisses à la folie dans ce qu’elle a de plus funeste. Les six habitants de l’Alabama qui ont donné vie à cet objet doivent être des anciens de la prison de Huntsville. 15 ans de taule pour avoir fumé un joint ensemble. Sans remise de peine. Et les petits mecs de Birmingham, avec leur boulet de fonte au pied sont lentement devenus des boules de haine. Les brimades, les violences, les coups bas les auront affecté à vie. Ce qu’ils traduisent ici par ce disque cathartique. Leurs riffs sont aussi lourds que les boulets qu’ils ont dû traîner pendant leur incarcération. Les cris et hurlements du chanteur sont des appels à l’aide. Tout traduit le malaise, la souffrance, le tourment, l’abandon. Noir de noir. Voilà ce qui arrive à qui trop écoute Eyehategod. Sauf que leur prison à eux était une colonie de vacances à côté de celle d’Huntsville. Les Molehill en ont chié, c’est sûr. Ce disque est leur récit ethnographique d’un quotidien effrayant. C’est ce qui le rend aussi, agréable n’est pas le mot juste, disons plutôt passionnant, à écouter. Du pur bottage de cul. On espère qu’ils s’en sortiront, mais ce serait dommage qu’ils arrêtent de produire des ouvrages de cet acabit. Terrible.
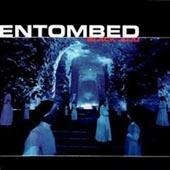 Entombed sur Man’s Ruin. On avait senti le vent arriver avec « Wolverine Blues ». Puis ils ont sorti un album de reprises pas pourries (sauf celle de Venom). Puis ils se sont dégagé la nuque (sauf Lars-Göran Petrov, qui n’a d’ailleurs toujours pas non plus abandonné la cartouchière). Puis ils ont sorti un album avec le chien d’Alice in Chains. Dire pour autant qu’ils sont devenus un groupe de stoner rock serait aller un peu vite. Même si l’on entend ce terme dans le sens le plus large qui soit. Le label ne fait pas le stoner band. Non. Ils se sont calmés un peu et ont arrêté de manger du mort à tous les repas. Ont écouté quelques vieux bluesman mais ça ne s’est jamais trop entendu. Ont changé de look, mais de nos jours on ne sait plus à qui l’on à affaire : Johnny porte le bouc, est-il grunge ? Kerry King a les oreilles dégagées, est-il banquier ? Ont écouté le rock des seventies et rien n’y fait. Ils continuent de manger du mort à chaque repas. Le groupe dont on pourrait éventuellement les rapprocher sur cet album, serait Motörhead en plus punk rock. Donc, il n’est pas plus question de mort metal que de stoner rock. Plutôt une contraction des deux : du mort rock. Tout cela nous fait un album qui n’a pas de quoi réveiller les morts. Les meilleurs morceaux étant certainement « Vices by proxy » pour l’efficacité de son riff et « Lost » pour sa lente lourdeur. Oui, perdus ils le sont un peu, j’ai l’impression. Et ce n’est pas en faisant du reggae que ça va s’arranger.
 Originaire de Koblenz, ce quintette germanique a opté pour une approche assez novatrice d’un genre que l’on peu qualifier de post rock en explorant son côté le plus soft et le plus aérien. Assez perturbante à la première approche, leur musique est en fait un gros mix d’une version apaisée des plans sludge pratiqués par Isis et ses nombreux clones dont je ne citerai pas les noms par gain de paix avec mes camarades de desert-rock. Si les plans calmes du ‘Blue Record’ de Baroness vous ont transporté ces derniers temps, il est de votre devoir de mettre la main sur cette plaque.
Précédemment sur le label de skate à roulettes ricain Go-Kart Records, les Teutons ont abandonné la dimension punkisante de leurs compositions pour se concentrer sur un style planant et cristallin. Si les plages avaient eu le format requis par les stations de la bande fm, j’aurai peut-être utilisé cette galette comme dessous de verre, mais il s’avère que les Allemands ont opté pour le format XXL et que j’éprouve un plaisir tout égoïste à m’envoler en me passant quelques titres de cet opus les yeux grands fermés (comme dirait Stanley). Il est clair qu’en proposant un double LP d’une bonne heure avec seuls six morceaux, ces types-là n’y vont pas à l’économie question timing des compos.
Les compositions, qui frisent donc la dizaine de minutes, tapent à des années lumières du rock progressif et de ce que les mecs comme moi (ceux qui ne savent même pas balancer un riff sur une strato imitation japonaise) appellent le riff qui tournent. C’est un assemblage subtil de structures qui s’insèrent avec volupté les unes dans les autres. Les amateurs de grosses bourrinades vont bouder cet album, mais les aficionados de grands délires instrumentaux qui s’étirent risquent de mouiller leurs petites culottes en écoutant ‘Encore’ qui clôt l’album et se termine puissamment à grands renforts de batterie dans la plus pure tradition sludge.
La masterpiece de cet album, à l’écoute duquel je me suis surpris à headbanger dans mon salon le casque sur les oreilles, est à mon sens ‘Lamb’ qui pulvérise les douze minutes sans jamais lasser son auditeur. Ca débute sur un plan rock presque popisant sur lequel une basse vrombit à grands renforts de reverb puis ça va s’embourber dans un plan tout en noirceur durant lequel les textes sont parlés avant de mixer les deux styles à la limite du doom grand public de Cathedral pour se terminer de manière bien speedée dans un registre presque keupon. Cette vision d’un paysage est supportée par des textes tout en noirceur qui toucheront ou pas l’auditeur selon son état d’esprit. Vu ma forme du moment, j’ai bien apprécié la chose et vous encourage à vous intéresser à cet ovni germain !
Construit sur les cendres de YOB (Mike Scheidt n’adore pas qu’on en parle mais bon, annonçons-le puis basta), Middian est un jeune trio américain qui, néanmoins, possède un solide passé musical. Je vous laisse le soin de flâner sur la bio du groupe que vous trouverez sur le site de leur maison si vous souhaitez en savoir plus.
Age Eternal est le tout premier opus de cette formation mais se distingue déjà par un son et un style à couper le souffle. C’est précis, puissant, pachydermique et passionnant (bonjour les allitérations!). 5 plages oscillant entre 6 et 16 minutes se succèdent dans des arrangements loin de tous les clichés musicaux connus. Ici, la création des atmosphères et l’étalage des sentiments semblent être le leitmotiv servant de fil conducteur aux morceaux.
Commençons par décrire le chant. Entre la mélopée androgyne digne du chant éthylique de sirènes déchirées et les hurlements arrachés à en faire saturer le micro, la voix est plutôt rare et précieuse si l’on considère la longueur des morceaux. Les vocalises mixtes attaquent d’entrée de jeu avec l’ouverture du premier riff post-hardcore hyper-répétitif. Ca marque dès le départ pour ensuite se faire oublier et revenir plus tard dans l’album comme un espoir soudain, un repère inattendu.
En matière de riffs, les mecs n’ont rien à envier à qui que ce soit. Simples et envoûtants, les séquences rythmiques de la gratte vous appellent au voyage dans un mode répétitif avec un section rythmique d’une précision millimétrique. Il faut aussi dire que la prod et le mix sont de toute première qualité (mais alors là, la classe totale!) et les chansons n’en sont dès lors que plus prenantes.
La basse et la batterie sont d’une régularité, d’une puissance et d’une finesse à vous foutre le bourdon si vous êtes musicien amateur. Je n’ose pas imaginer ce que ce trio doit nous réserver sur scène. La 6 cordes nous offrent des soli modulés dans les fréquences noisy, avec des ondulations bien cradingues qui intensifient le côté sombre et désespéré de ces passages précis.
Middian orchestre savamment le post-rock à forte teneur instrumentale et le doom au gré des séquences. L’assemblage est édifiant et crédible. A peine sort-on d’un trip musical que de légères notes cristallines et sombres vous font vite comprendre que le tour n’est pas terminé. Et c’est dans une suite d’accords aux allures célestes qu’on décolle à nouveau pour sombrer rapidement dans une tristesse aux profondeurs abyssales. Si vous aimez le spleen de Neurosis et le vol majestueux de Pelican, vous ne résisterez certainement pas aux charmes de Middian.
Si je n’étais pas en train de taper ces quelques lignes en écoutant cette perle, je serais les 2 pouces bien en l’air, histoire de vous donner une avis imagé. Comptez 3 à 4 écoutes attentives pour percer cet album contemporain qui se jouera certainement du temps à travers les années (petit clin d’oeil à la pochette et au titre).
Imposant, majestueux, triste, splendide, beau à pleurer, d’une qualité sonore irréfutable et d’excellente composition, ce 1er album du groupe mérite toutes les attentions. Puisse-t-il être le début d’une nouvelle envolée musicale.
 Une question s’impose dès l’entame de cet E.P. : Mark Lanegan aurait-il monté un groupe faisant dans l’industriel ? Deux raisons à cela.Premièrement, ce Here Comes That Weird Chill est attribué au Mark Lanegan Band et non pas seulement au géant de Seattle. Ensuite, ‘Methamphetamine Blues’, le titre d’ouverture, n’a rien de « Laneganesque ». Et à mesure que les titres avancent, il faut bien se faire à l’évidence : Here Comes That Weird Chill n’a rien de conventionnel et jette le trouble sur l’auditeur. Tantôt mâtinés de percussions à tendance indus (‘Methamphetamine Blues’, ‘Wish You Well’), tantôt orientés sixties (‘Message To Mine’), les 8 titres de cette galette nous baladent au gré des ambiances et des différents invités (d’où sans doute le « Band ») venus prêter main forte à l’ex Screaming Trees. On reconnaîtra entre autres la patte du génial Chris Goss (Masters Of Reality) sur le décalé ‘On The Steps Of The Cathedral’. On appréciera également l’excellent ‘Skeletal History’, co écrit avec le tandem Josh Homme / Nick Oliveri (Queens Of The Stone Age), et qui aurait très bien pu figurer sur un volume des Desert Sessions.A l’écoute de ce disque, certains argueront que la voie de Lanegan est certainement bien plus appréciable sans tous ces artifices instrumentaux (et ils n’auront pas entièrement tort). Il n’en reste pas moins que cet E.P. est plutôt une bonne surprise et ravira les fans. A écouter absolument.
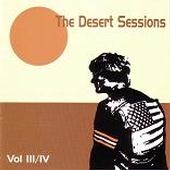 La série des Desert Sessions en CD, c’est un peu comme les oreilles : ça marche par paire. Voici donc les volumes 3 et 4 afin de satisfaire nos oreilles justement.Moins délirante que les autres galettes de la série, cette offrande ressemble plus à une bande originale de série B, genre western de préférence. Ca sent la poussière, le désert, l’ambiance saloon. C’est simple, direct, et ça marche. On se laisse très facilement prendre au jeu de ces 10 titres d’une autre époque. Que ce soit par les sympathiques ‘The Gosso King of Crater Lake’ et ‘Monster in the Parasol’, par le rock tonitruant de ‘Eccentric Man’ ou par le duel amical entre Josh Homme et Pete Stahl sur ‘Avon/Nova’, on est bluffé de bout en bout par ce disque sans prétention.Les fans de Queens Of The Stone Age ne seront pas déçus puisqu’ils découvriront sur ce CD les premières versions de ‘Avon’ et de ‘Monster in the Parasol’ qui seront par la suite repris par le groupe de Josh Homme, ainsi que les premiers méfaits des Eagles of Death Metal (avec Josh Homme à la batterie) bien avant la sortie de leur Peace, Love & Death Metal.Un très bon disque à conseiller aux amateurs du genre.
|
|